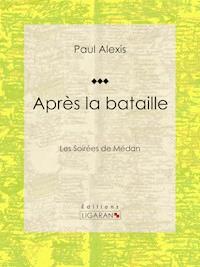14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bauer Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Les Soirées de Médan est un recueil de nouvelles publié le 17 avril 1880 chez Georges Charpentier éditeur à Paris. Il réunit six nouvelles respectivement signées par Émile Zola, Guy de Maupassant, J.-K. Huysmans, Henry Céard, Léon Hennique et Paul Alexis, représentatives du courant naturaliste et qui évoquent la guerre franco-allemande de 1870.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Émile Zola
Les soirées de Médan
table des matières
Avec Zola à Médan
Préface de Léon Hennique
Première partie Émile Zola
Chapitre 1 L’attaque du moulin
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Deuxième partie Guy de Maupassant
Chapitre 6 Boule de Suif
Troisième partie Joris-Karl Huysmans
Chapitre 7 Sac au dos
Quatrième partie Henri Céard
Chapitre 8 La Saignée
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Cinquième partie Léon Hennique
Chapitre 6 L’affaire du Grand 7
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Sixième partie Paul Alexis
Chapitre 4 Après la bataille
Avec Zola à Médan
Le dimanche, en été, Émile Zola recevait ses amis dans sa maison de Médan. Le train, alors, s’arrêtait (il ne le fait plus qu’épisodiquement) à la gare de Médan, en bas du jardin de l’écrivain, et cette proximité qui lui inspirera la Bête humaine, ne l’avait pas retenu dans son acquisition.
Le dimanche, donc, Jules Vallès, Alphonse Daudet, Edmond de Goncourt, Maupassant, J.-K. Huysmans, Henry Céard, l’éditeur Charpentier, Cézanne quand il se trouvait à Paris, débarquaient en bas du jardin, « grand comme le champ d’un pauvre homme », et découvraient l’architecture hétéroclite de la maison de l’auteur des Rougon. Contre la demeure primitive, chalet de banlieue non sans élégance, Zola, animé comme son père l’ingénieur du goût de la bâtisse, avait fait édifier, en brique et ciment, une énorme tour carrée qui écrasait complètement la maison première et que Maupassant comparait à un géant tenant un nain par la main. Nouveau bâtiment qui abritait la salle à manger au rez-de-chaussée, la chambre des Zola au premier et, au-dessus, un immense cabinet de travail pour le maître. « Construction à la tournure féodale, écrit Edmond de Goncourt, qui semble bâtie dans un carré de choux. »
D’ailleurs, les invités débarquaient chaque fois dans un chantier perpétuel. Dès l’acquisition, Zola avait fait venir à Médan une équipe d’ouvriers, qui n’en sortirent de quinze ans. Il faisait décorer ses pièces, méditait de nouvelles constructions et, lopin après lopin, agrandissait son terrain. Mme Zola dirigeait tout ce monde, ouvriers et domestiques, d’une main ferme, et assurait la paie du samedi.
L’intérieur réservait aux arrivants une autre surprise. Comme avant lui Balzac, Dumas, Hugo, Zola était collectionneur, mais avec moins de goût encore. Dévalisant les brocanteurs, il en rapportait des meubles prétendument médiévaux, des objets religieux de pacotille, des hanaps, des cimeterres, des rondaches, des chopes à bière, des chinoiseries de bazar, tout un bric-à-brac que l’on aperçoit sur les photos et qui effarait un peu ses amis, en particulier Edmond de Goncourt, amateur raffiné de l’art du XVIII e siècle. Le décor mural était adapté à cet environnement, et Zola y avait multiplié écussons, fleurs de lys, cheminées tarabiscotées, avec des fenêtres garnies de vitraux comportant une petite part d’ancien.
Puis, on passait à table, et la table était bonne. Zola prenait une douce revanche sur ses années de misère, sur les oiseaux pris au piège dans la gouttière de sa mansarde d’étudiant et rôtis larmes aux yeux, sur les repas à dix sous du commissionnaire en librairie. Maintenant, l’auteur célèbre mangeait, dit Maupassant, « comme trois romanciers ordinaires ».
L’après-midi, on flânait dans le jardin peu à peu agrandi, on s’essayait à la pêche à la ligne, et l’on put traverser le bras de la Seine pour aller dans l’île en face quand Maupassant eut amené là, à force rames, une grande barque aussitôt baptisé La Nana, « parce que tout le monde lui passe dessus ».
La propriété créée par lui à l’image de ses goûts, symbole de sa réussite, nous reste. Nous nous efforçons d’y restaurer le cadre de sa vie et de son travail, d’y cultiver et d’y magnifier son souvenir.
Georges Poisson,
Conseiller technique de la Maison de Zola.
Préface de Léon Hennique
— Or ça, me demandait, il n’y a pas longtemps, un journaliste curieux, journaliste de valeur, qu’est-ce que ces histoires qui courent sur les primes relations de Zola et de son jeune groupe ? Où l’avez-vous rencontré ? À propos de quoi devîntes-vous ses amis, malgré la différence d’âge ? Au nom de quoi en arrivâtes-vous à échafauder les Soirées de Médan.
Je répondis :
— Vous me prenez au dépourvu, mon cher ; vous vous enquérez de choses déjà lointaines… Je ne sais plus, moi, je tâtonne, j’hésite… Permettez que je réfléchisse, me souvienne, fasse comme le voyageur dont la silhouette apparaît tout à coup au bord de la mer.
— Le voyageur ?
— Oui, le voyageur. Il est brusquement ébloui, ne distingue rien, sauf l’astre magnifique, là-bas, puis l’énorme plaine qui ondule, qui, sans trêve, brasse de la lumière. Peu à peu cependant – il s’est ombragé les yeux d’une main – voici qu’il finit par découvrir de chétifs points noirs, un, deux, trois, au diable. Les points noirs bougent, sont des barques de pêcheurs. Il en compte à présent une flottille.
— Et alors ?
— Alors ?… mon apologue est pour vous exhorter à la patience. Revenez un matin et je tâcherai de vous être agréable. En somme, vous n’êtes pas trop indiscret.
Le journaliste n’est plus revenu, je l’attends ; mais, ma réponse, je me suis hâté de l’écrire. Puisse-t-elle intéresser quelques personnes !
C’est par Huysmans, avec lequel je m’étais lié aux lundis de Catulle Mendès, rue de Bruxelles, que je connus Paul Alexis. Nous décidâmes immédiatement de nous réunir de fois à autre, nous choisîmes le lieu de réunion, un café borgne sis place Pigalle, et là, heureux de nous trouver d’accord, pauvres d’argent, riches d’enthousiasmes, nous bavardions littérature, nous exaltions les Rougon-Macquart, nous vitupérions contre certains journaux. Pensez donc ! ils n’avaient pas compris, refusaient de comprendre un fils de Balzac, l’homme qui apportait du neuf, celui que, dès ses débuts, nous avions admiré haut et ferme.
— Moi, s’écria Huysmans, je vais lui foutre un article dans une revue belge. J’y opère en liberté.
— Moi, continua Paul Alexis, je marcheraidans une feuille, où, d’habitude, on m’insère de la copie, gratis.
— Moi…
Je ne sus achever ma phrase, demeurai penaud. Je n’avais ni revue ni feuille.
— Moi, poursuivis-je néanmoins… Oh ! une idée… l’Assommoirest à l’impression, n’est-ce pas ?… si j’en conférenciais aux Capucines ?
J’entends Huysmans m’applaudir, Alexis égrener :
— Dépêche-toi de t’arranger avec le type des conférences et je te mène à Zola. Il te donnera sa préface et une épreuve de l’Assommoir.
–All right!
Ce que j’avais imaginé se réalisa ; le type des conférences fut aimable, et, le lendemain, flanqué de mon introducteur, un soir d’hiver, aux Batignolles, neuf heures tapant, je m’arrêtais à l’huis d’un rez-de-chaussée.
— Sonne.
Zola nous ouvre, en veston de flanelle rouge, grand, barbu, replet, Zola, visage énergique surmonté d’un beau front, les cheveux coupés brefs. Sa bouche ? moyenne. Son nez ? légèrement fendu en deux vers la pointe comme le nez de certains épagneuls doués de flair et de finesse. Sa voix ? une voix d’homme cordial, d’homme excellent.
J’obtiens la préface désirée, les épreuves ; ma conférence a la chance de réussir ; Mme Zola y assiste, incognito.
Quel fut mon plaisir, par la suite, derrière une invitation urgente, d’apercevoir aux côtés de Zola, outre Alexis, Huysmans, l’œil hilare, et quatre messieurs d’aspect sympathique. L’un était Guy de Maupassant, robuste gaillard, franc d’allures, ami de Flaubert ; le second, Henry Céard, Pylade de Huysmans ; le troisième, A. Guillemet, remarquable paysagiste, et le dernier, Marius Roux, d’Aix et du Petit Journal.
Un trimestre ne s’est pas égoutté, d’ailleurs, que Maupassant, Huysmans, Céard et le fauteur de cette narration dînent proche les uns des autres, le mercredi de toute semaine, – puis rendent visite au ménage Zola.
On est bien, chez lui ; on se sent les coudes ; on a même l’honneur de plaire au chien Raton, assez mal expansif.
Zola déménage, s’installe rue Ballu – l’Assommoiravait été un gros succès – et, jugeant la porte ouverte, grâce au travail acharné du Maître, l’aisance pénètre dans le nouvel appartement, l’orne d’un salon capitonné de velours cramoisi. Je me remémore le portrait de Zola par Manet, deux bibliothèques Louis XVI, nombre de bibelots sur les meubles.
— Alexis, prière de ne rien casser aujourd’hui, disait plaisamment Mme Zola, quand le brave camarade surgissait.
Il était d’une myopie dangereuse.
— J’ai acheté une bicoque à Médan, nous raconte Zola, un beau soir. Je l’ai achetée pour ma mère, qui s’ennuie à la ville, et pour moi, lorsque la besogne me déborde.
Nous roulons vers Médan, peu après, et nous atteignons une maisonnette blanche, son jardin, jardin planté de fleurs multicolores, de légumes, jardin borné par des cultures, une voie ferrée, une route, un pont.
C’est au seuil de l’hospitalier logis, que Vallès, plus tard, confie à Zola :
— Vous savez, mon vieux, la prochaine fois que je viendrai, j’apporterai un arbre.
Vallès ne manquait pas de gaieté.
La maisonnette, le jardin s’arrondirent… Et nous sommes à la table d’Émile Zola, dans Paris, Maupassant, Huysmans, Céard, Alexis et moi, pour changer. On devise à bâtons rompus ; on se met à évoquer la guerre, la fameuse guerre de 70. Plusieurs des nôtres avaient été volontaires ou moblots.
— Tiens ! tiens ! propose Zola, pourquoi ne ferait-on pas un volume là-dessus, un volume de nouvelles ?
Alexis :
— Oui, pourquoi ?
— Vous avez des sujets ?
— Nous en aurons.
— Le titre du bouquin ?
— Les Soirées de Médan.
Il s’est rappelé les Soirées de Neuilly.
— Bravo ! J’aime ce titre ! approuve Huysmans. On habillera les enfants et on les amènera ici.
— Vite ?
— Au plus vite.
Les enfants debout, habillés, Boule de Suif mérite une chaude ovation. L’ovation éteinte, je tire au sort les places que chacun – hormis Zola – devra occuper dans le futur in-12, et Maupassant arrive premier.
— Dire qu’il n’aura jamais de talent ! avait prophétisé Tourguéniev, sur un essai du jeune écrivain.
Comme les mieux avertis déraillent !
Le livre des six – Zola y avait ajouté une combative préface – est aux mains de son éditeur… On l’imprime… On le broche… On le dédicace… Il trône à la devanture des libraires… La critique est furieuse, attaque… Nous n’avons pas peur ; nous nous amusons. Le public s’amuse aussi, achète.
Temps simple ! Temps probe, affectueux ! Aucun de mes amis n’admirait que soi ; ils avaient des maîtres, les chérissaient, les respectaient : Flaubert, Edmond de Goncourt, Alphonse Daudet, Zola. Morts, tous morts, et nous également, presque tous…
Que s’efforce de durer une parcelle de notre vie antérieure, une parcelle mélancolique, avec cette récente édition des Soirées deMédan.
L. H. – 1930.
Les nouvelles qui suivent ontété publiées, les unes en France, lesautresà l’étranger. Elles nous ont paru procéder d’une idée unique,avoir une même *philosophie : nous les réunissons.*
Nous nous attendonsà toutes les attaques,à la mauvaise foi etàl’ignorance dont la critique courante nous a déjà donné tant depreuves. Notre seul souci aété d’affirmer publiquement nosvéritables amitiés et, en même temps, nos tendances littéraires.
Médan, 1 er mai 1880.
Première partie Émile Zola
Chapitre 1 L’attaque du moulin
Chapitre 1L’attaque du moulin
Chapitre 1
Le moulin du père Merlier, par cette belle soirée d’été, était en grande fête. Dans la cour, on avait mis trois tables, placées bout à bout, et qui attendaient les convives. Tout le pays savait qu’on devait fiancer, ce jour-là, la fille Merlier, Françoise, avec Dominique, un garçon qu’on accusait de fainéantise, mais que les femmes, à trois lieues à la ronde, regardaient avec des yeux luisants, tant il avait bon air.
Ce moulin du père Merlier était une vraie gaieté. Il se trouvait juste au milieu de Rocreuse, à l’endroit où la grand-route fait un coude. Le village n’a qu’une rue, deux files de masures, une file à chaque bord de la route ; mais là, au coude, des prés s’élargissent, de grands arbres, qui suivent le cours de la Morelle, couvrent le fond de la vallée d’ombrages magnifiques. Il n’y a pas, dans toute la Lorraine, un coin de nature plus adorable. À droite et à gauche, des bois épais, des futaies séculaires montent des pentes douces, emplissent l’horizon d’une mer de verdure ; tandis que, vers le midi, la plaine s’étend, d’une fertilité merveilleuse, déroulant à l’infini des pièces de terre coupées de haies vives. Mais ce qui fait surtout le charme de Rocreuse, c’est la fraîcheur de ce trou de verdure, aux journées les plus chaudes de juillet et d’août. La Morelle descend des bois de Gagny, et il semble qu’elle prenne le froid des feuillages sous lesquels elle coule pendant des lieues ; elle apporte les bruits murmurants, l’ombre glacée et recueillie des forêts. Et elle n’est point la seule fraîcheur : toutes sortes d’eaux courantes chantent sous les bois ; à chaque pas, des sources jaillissent ; on sent, lorsqu’on suit les étroits sentiers, comme des lacs souterrains qui percent sous la mousse et profitent des moindres fentes, au pied des arbres, entre les roches, pour s’épancher en fontaines cristallines. Les voix chuchotantes de ces ruisseaux s’élèvent si nombreuses et si hautes, qu’elles couvrent le chant des bouvreuils. On se croirait dans quelque parc enchanté, avec des cascades tombant de toutes parts.
En bas, les prairies sont trempées. Des marronniers gigantesques font des ombres noires. Au bord des prés, de longs rideaux de peupliers alignent leurs tentures bruissantes. Il y a deux avenues d’énormes platanes qui montent, à travers champs, vers l’ancien château de Gagny, aujourd’hui en ruines. Dans cette terre continuellement arrosée, les herbes grandissent démesurément. C’est comme un fond de parterre entre les deux coteaux boisés, mais de parterre naturel, dont les prairies sont les pelouses, et dont les arbres géants dessinent les colossales corbeilles. Quand le soleil, à midi, tombe d’aplomb, les ombres bleuissent, les herbes allumées dorment dans la chaleur, tandis qu’un frisson glacé passe sous les feuillages.
Et c’était là que le moulin du père Merlier égayait de son tic-tac un coin de verdures folles. La bâtisse, faite de plâtre et de planches, semblait vieille comme le monde. Elle trempait à moitié dans la Morelle, qui arrondit à cet endroit un clair bassin. Une écluse était ménagée, la chute tombait de quelques mètres sur la roue du moulin, qui craquait en tournant, avec la toux asthmatique d’une fidèle servante vieillie dans la maison. Quand on conseillait au père Merlier de la changer, il hochait la tête en disant qu’une jeune roue serait plus paresseuse et ne connaîtrait pas si bien le travail ; et il raccommodait l’ancienne avec tout ce qui lui tombait sous la main, des douves de tonneau, des ferrures rouillées, du zinc, du plomb. La roue en paraissait plus gaie, avec son profil devenu étrange, tout empanachée d’herbes et de mousses. Lorsque l’eau la battait de son flot d’argent, elle se couvrait de perles, on voyait passer son étrange carcasse sous une parure éclatante de colliers de nacre.
La partie du moulin qui trempait ainsi dans la Morelle avait l’air d’une arche barbare, échouée là. Une bonne moitié du logis était bâtie sur des pieux. L’eau entrait sous le plancher, il y avait des trous, bien connus dans le pays pour les anguilles et les écrevisses énormes qu’on y prenait. En dessous de la chute, le bassin était limpide comme un miroir, et lorsque la roue ne le troublait pas de son écume, on apercevait des bandes de gros poissons qui nageaient avec des lenteurs d’escadre. Un escalier rompu descendait à la rivière, près d’un pieu où était amarrée une barque. Une galerie de bois passait au-dessus de la roue. Des fenêtres s’ouvraient, percées irrégulièrement. C’était un pêle-mêle d’encoignures, de petites murailles, de constructions ajoutées après coup, de poutres et de toitures qui donnaient au moulin un aspect d’ancienne citadelle démantelée. Mais des lierres avaient poussé, toutes sortes de plantes grimpantes bouchaient les crevasses trop grandes et mettaient un manteau vert à la vieille demeure. Les demoiselles qui passaient dessinaient sur leurs albums le moulin du père Merlier.
Du côté de la route, la maison était plus solide. Un portail en pierre s’ouvrait sur la grande cour, que bordaient à droite et à gauche des hangars et des écuries. Près d’un puits, un orme immense couvrait de son ombre la moitié de la cour. Au fond, la maison alignait les quatre fenêtres de son premier étage, surmonté d’un colombier. La seule coquetterie du père Merlier était de faire badigeonner cette façade tous les dix ans. Elle venait justement d’être blanchie, et elle éblouissait le village, lorsque le soleil l’allumait, au milieu du jour.
Depuis vingt ans, le père Merlier était maire de Rocreuse. On l’estimait pour la fortune qu’il avait su faire. On lui donnait quelque chose comme quatre-vingt mille francs, amassés sou à sou. Quand il avait épousé Madeleine Guillard, qui lui apportait en dot le moulin, il ne possédait guère que ses deux bras. Mais Madeleine ne s’était jamais repentie de son choix, tant il avait su mener gaillardement les affaires du ménage. Aujourd’hui, la femme était défunte, il restait veuf avec sa fille Françoise. Sans doute, il aurait pu se reposer, laisser la roue du moulin dormir dans la mousse ; mais il se serait trop ennuyé, et la maison lui aurait semblé morte. Il travaillait toujours, pour le plaisir. Le père Merlier était alors un grand vieillard, à longue figure silencieuse, qui ne riait jamais, mais qui était tout de même très gai en dedans. On l’avait choisi pour maire, à cause de son argent, et aussi pour le bel air qu’il savait prendre, lorsqu’il faisait un mariage.
Françoise Merlier venait d’avoir dix-huit ans. Elle ne passait pas pour une des belles filles du pays, parce qu’elle était chétive. Jusqu’à quinze ans, elle avait même été laide. On ne pouvait pas comprendre, à Rocreuse, comment la fille du père et de la mère Merlier, tous deux si bien plantés, poussait mal et d’un air de regret. Mais à quinze ans, tout en restant délicate, elle prit une petite figure, la plus jolie du monde. Elle avait des cheveux noirs, des yeux noirs, et elle était toute rose avec ça ; une bouche qui riait toujours, des trous dans les joues, un front clair où il y avait comme une couronne de soleil. Quoique chétive pour le pays, elle n’était pas maigre, loin de là ; on voulait dire simplement qu’elle n’aurait pas pu lever un sac de blé ; mais elle devenait toute potelée avec l’âge, elle devait finir par être ronde et friande comme une caille. Seulement, les longs silences de son père l’avaient rendue raisonnable très jeune. Si elle riait toujours, c’était pour faire plaisir aux autres. Au fond, elle était sérieuse.
Naturellement, tout le pays la courtisait, plus encore pour ses écus que pour sa gentillesse. Et elle avait fini par faire un choix, qui venait de scandaliser la contrée. De l’autre côté de la Morelle, vivait un grand garçon, que l’on nommait Dominique Penquer. Il n’était pas de Rocreuse. Dix ans auparavant, il était arrivé de Belgique, pour hériter d’un oncle, qui possédait un petit bien, sur la lisière même de la forêt de Gagny, juste en face du moulin, à quelques portées de fusil. Il venait pour vendre ce bien, disait-il, et retourner chez lui. Mais le pays le charma, paraît-il, car il n’en bougea plus. On le vit cultiver son bout de champ, récolter quelques légumes dont il vivait. Il pêchait, il chassait ; plusieurs fois, les gardes faillirent le prendre et lui dresser des procès-verbaux. Cette existence libre, dont les paysans ne s’expliquaient pas bien les ressources, avait fini par lui donner un mauvais renom. On le traitait vaguement de braconnier. En tout cas, il était paresseux, car on le trouvait souvent endormi dans l’herbe, à des heures où il aurait dû travailler. La masure qu’il habitait, sous les derniers arbres de la forêt, ne semblait pas non plus la demeure d’un honnête garçon. Il aurait eu un commerce avec les loups des ruines de Gagny, que cela n’aurait point surpris les vieilles femmes. Pourtant, les jeunes filles, parfois, se hasardaient à le défendre, car il était superbe, cet homme louche, souple et grand comme un peuplier, très blanc de peau, avec une barbe et des cheveux blonds qui semblaient de l’or au soleil. Or, un beau matin, Françoise avait déclaré au père Merlier qu’elle aimait Dominique et que jamais elle ne consentirait à épouser un autre garçon.
On pense quel coup de massue le père Merlier reçut ce jour-là ! Il ne dit rien, selon son habitude. Il avait son visage réfléchi ; seulement, sa gaieté intérieure ne luisait plus dans ses yeux. On se bouda pendant une semaine. Françoise, elle aussi, était toute grave. Ce qui tourmentait le père Merlier, c’était de savoir comment ce gredin de braconnier avait bien pu ensorceler sa fille. Jamais Dominique n’était venu au moulin. Le meunier guetta et il aperçut le galant, de l’autre côté de la Morelle, couché dans l’herbe et feignant de dormir. Françoise, de sa chambre, pouvait le voir. La chose était claire, ils avaient dû s’aimer, en se faisant les doux yeux par-dessus la roue du moulin.
Cependant, huit autres jours s’écoulèrent. Françoise devenait de plus en plus grave. Le père Merlier ne disait toujours rien. Puis, un soir, silencieusement, il amena lui-même Dominique. Françoise, justement, mettait la table. Elle ne parut pas étonnée, elle se contenta d’ajouter un couvert ; seulement les petits trous de ses joues venaient de se creuser de nouveau, et son rire avait reparu. Le matin, le père Merlier était allé trouver Dominique dans sa masure, sur la lisière du bois. Là, les deux hommes avaient causé pendant trois heures, les portes et les fenêtres fermées. Jamais personne n’a su ce qu’ils avaient pu se dire. Ce qu’il y a de certain, c’est que le père Merlier en sortant traitait déjà Dominique comme son fils. Sans doute, le vieillard avait trouvé le garçon qu’il était allé chercher, un brave garçon, dans ce paresseux qui se couchait sur l’herbe pour se faire aimer des filles.
Tout Rocreuse clabauda. Les femmes, sur les portes, ne tarissaient pas au sujet de la folie du père Merlier, qui introduisait ainsi chez lui un garnement. Il laissa dire. Peut-être s’était-il souvenu de son propre mariage. Lui non plus ne possédait pas un sou vaillant, lorsqu’il avait épousé Madeleine et son moulin ; cela pourtant ne l’avait point empêché de faire un bon mari. D’ailleurs, Dominique coupa court aux cancans, en se mettant si rudement à la besogne, que le pays en fut émerveillé. Justement le garçon du moulin était tombé au sort, et jamais Dominique ne voulut qu’on en engageât un autre. Il porta les sacs, conduisit la charrette, se battit avec la vieille roue, quand elle se faisait prier pour tourner, tout cela d’un tel cœur, qu’on venait le voir par plaisir. Le père Merlier avait son rire silencieux. Il était très fier d’avoir deviné ce garçon. Il n’y a rien comme l’amour pour donner du courage aux jeunes gens.
Au milieu de toute cette grosse besogne, Françoise et Dominique s’adoraient. Ils ne se parlaient guère, mais ils se regardaient avec une douceur souriante. Jusque-là, le père Merlier n’avait pas dit un seul mot au sujet du mariage ; et tous deux respectaient ce silence, attendant la volonté du vieillard. Enfin, un jour, vers le milieu de juillet, il avait fait mettre trois tables dans la cour, sous le grand orme, en invitant ses amis de Rocreuse à venir le soir boire un coup avec lui. Quand la cour fut pleine et que tout le monde eut le verre en main, le père Merlier leva le sien très haut en disant :
— C’est pour avoir le plaisir de vous annoncer que Françoise épousera ce gaillard-là dans un mois, le jour de la Saint-Louis.
Alors, on trinqua bruyamment. Tout le monde riait. Mais le père Merlier, haussant la voix, dit encore :
— Dominique, embrasse ta promise. Ça se doit.
Et ils s’embrassèrent, très rouges, pendant que l’assistance riait plus fort. Ce fut une vraie fête. On vida un petit tonneau. Puis, quand il n’y eut là que les amis intimes, on causa d’une façon calme. La nuit était tombée, une nuit étoilée et très claire. Dominique et Françoise, assis sur un banc, l’un près de l’autre, ne disaient rien. Un vieux paysan parlait de la guerre que l’empereur avait déclarée à la Prusse. Tous les gars du village étaient déjà partis. La veille, des troupes avaient encore passé. On allait se cogner dur.
— Bah ! dit le père Merlier avec l’égoïsme d’un homme heureux, Dominique est étranger, il ne partira pas… Et si les Prussiens venaient, il serait là pour défendre sa femme.
Cette idée que les Prussiens pouvaient venir parut une bonne plaisanterie. On allait leur flanquer une raclée soignée, et ce serait vite fini.
— Je les ai déjà vus, je les ai déjà vus, répéta d’une voix sourde le vieux paysan.
Il y eut un silence. Puis, on trinqua une fois encore. Françoise et Dominique n’avaient rien entendu ; ils s’étaient pris doucement la main, derrière le banc, sans qu’on pût les voir, et cela leur semblait si bon, qu’ils restaient là, les yeux perdus au fond des ténèbres.
Quelle nuit tiède et superbe ! Le village s’endormait aux deux bords de la route blanche, dans une tranquillité d’enfant. On n’entendait plus, de loin en loin, que le chant de quelque coq éveillé trop tôt. Des grands bois voisins, descendaient de longues haleines qui passaient sur les toitures comme des caresses. Les prairies, avec leurs ombrages noirs, prenaient une majesté mystérieuse et recueillie, tandis que toutes les sources, toutes les eaux courantes qui jaillissaient dans l’ombre, semblaient être la respiration fraîche et rythmée de la campagne endormie. Par instants, la vieille roue du moulin, ensommeillée, paraissait rêver comme ces vieux chiens de garde qui aboient en ronflant ; elle avait des craquements, elle causait toute seule, bercée par la chute de la Morelle, dont la nappe rendait le son musical et continu d’un tuyau d’orgues. Jamais une paix plus large n’était descendue sur un coin plus heureux de nature.
Chapitre 2
Un mois plus tard, jour pour jour, juste la veille de la Saint-Louis, Rocreuse était dans l’épouvante. Les Prussiens avaient battu l’empereur et s’avançaient à marches forcées vers le village. Depuis une semaine, des gens qui passaient sur la route annonçaient les Prussiens : « Ils sont à Lormière, ils sont à Novelles » ; et, à entendre dire qu’ils se rapprochaient si vite, Rocreuse, chaque matin, croyait les voir descendre par les bois de Gagny. Ils ne venaient point cependant, cela effrayait davantage. Bien sûr qu’ils tomberaient sur le village pendant la nuit et qu’ils égorgeraient tout le monde.
La nuit précédente, un peu avant le jour, il y avait eu une alerte. Les habitants s’étaient réveillés, en entendant un grand bruit d’hommes sur la route. Les femmes déjà se jetaient à genoux et faisaient des signes de croix, lorsqu’on avait reconnu des pantalons rouges, en entrouvrant prudemment les fenêtres. C’était un détachement français. Le capitaine avait tout de suite demandé le maire du pays, et il était resté au moulin, après avoir causé avec le père Merlier.
Le soleil se levait gaiement, ce jour-là. Il ferait chaud, à midi. Sur les bois, une clarté blonde flottait, tandis que dans les fonds, au-dessus des prairies, montaient des vapeurs blanches. Le village propre et joli, s’éveillait dans la fraîcheur, et la campagne, avec sa rivière et ses fontaines, avait des grâces mouillées de bouquet. Mais cette belle journée ne faisait rire personne. On venait de voir le capitaine tourner autour du moulin, regarder les maisons voisines, passer de l’autre côté de la Morelle, et de là, étudier le pays avec une lorgnette ; le père Merlier, qui l’accompagnait, semblait donner des explications. Puis, le capitaine avait posté des soldats derrière des murs, derrière des arbres, dans des trous. Le gros du détachement campait dans la cour du moulin. On allait donc se battre ? Et quand le père Merlier revint, on l’interrogea. Il fit un long signe de tête, sans parler. Oui, on allait se battre.
Françoise et Dominique étaient là, dans la cour, qui le regardaient. Il finit par ôter sa pipe de la bouche, et dit cette simple phrase :
— Ah ! mes pauvres petits, ce n’est pas demain que je vous marierai !
Dominique, les lèvres serrées, avec un pli de colère au front, se haussait parfois, restait les yeux fixés sur les bois de Gagny, comme s’il eût voulu voir arriver les Prussiens. Françoise, très pâle, sérieuse, allait et venait, fournissant aux soldats ce dont ils avaient besoin. Ils faisaient la soupe dans un coin de la cour, et plaisantaient, en attendant de manger.
Cependant, le capitaine paraissait ravi. Il avait visité les chambres et la grande salle du moulin donnant sur la rivière. Maintenant, assis près du puits, il causait avec le père Merlier.
— Vous avez là une vraie forteresse, disait-il. Nous tiendrons bien jusqu’à ce soir… Les bandits sont en retard. Ils devraient être ici.
Le meunier restait grave. Il voyait son moulin flamber comme une torche. Mais il ne se plaignait pas, jugeant cela inutile. Il ouvrit seulement la bouche, pour dire :
— Vous devriez faire cacher la barque derrière la roue. Il y a là un trou où elle tient… Peut-être qu’elle pourra servir.
Le capitaine donna un ordre. Ce capitaine était un bel homme d’une quarantaine d’années, grand et de figure aimable. La vue de Françoise et de Dominique semblait le réjouir. Il s’occupait d’eux, comme s’il avait oublié la lutte prochaine. Il suivait Françoise des yeux, et son air disait clairement qu’il la trouvait charmante. Puis, se tournant vers Dominique :
— Vous n’êtes donc pas à l’armée, mon garçon ? lui demanda-t-il brusquement.
— Je suis étranger, répondit le jeune homme.
Le capitaine parut goûter médiocrement cette raison. Il cligna les yeux et sourit. Françoise était plus agréable à fréquenter que le canon. Alors, en le voyant sourire, Dominique ajouta :
— Je suis étranger, mais je loge une balle dans une pomme, à cinq cents mètres… Tenez, mon fusil de chasse est là, derrière vous.
— Il pourra vous servir, répliqua simplement le capitaine.
Françoise s’était approchée, un peu tremblante. Et, sans se soucier du monde qui était là, Dominique prit et serra dans les siennes les deux mains qu’elle lui tendait, comme pour se mettre sous sa protection. Le capitaine avait souri de nouveau, mais il n’ajouta pas une parole. Il demeurait assis, son épée entre les jambes, les yeux perdus, paraissant rêver.