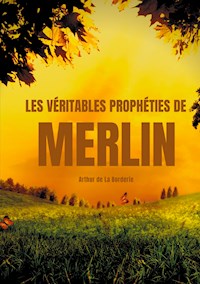
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Französisch
Les Prophéties de Merlin forment un ensemble d'oeuvres littéraires prophétiques rédigées au Moyen Âge par différents auteurs qui les attribuent à Merlin. Ces prédictions concernent surtout la politique. En 1276, un autre volume de prophéties est publié en français, prenant la forme de prophéties politiques intercalées entre des récits romanesques de la légende arthurienne. Elles présentent Merlin en prophète chrétien d'essence divine, il y choisit délibérément d'être enfermé par la fée Viviane. Analyser les prophéties de Merlin permet de mettre en lumière différents langages politiques élaborés pour séduire un large auditoire allant bien au-delà des milieux de cour et des hommes d'Église. Ces textes rares, le plus souvent en latin, ont circulé en Grande-Bretagne, en France et en Europe du Sud. Arthur de la Borderie, avec passion et érudition, revient sur ces textes méconnus et les éclaire d'un jour nouveau. Ce volume contient notamment les prophéties Les pommiers (Afallenau); Les Bouleaux; et le Dialogue de Merlin et de Gwendyz (Kyvoesi Myrddin).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
I. Préambule
II
III
Les pommiers (Afallenau)
IV
V
VI
VII
VIII. Les Bouleaux
IX
X
XI
XII Dialogue de Merlin et de Gwendyz (Kyvoesi Myrddin)
XIII
XIV
XV
XVI Le chant des pourceaux (
Hoianau
ou
Porchellanau
)
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV Éclaircissement sur Merlin, Ryderch Hael, et la bataille d’Arderyd
XXVI
XXVII
XXVIII
I. PRÉAMBULE
Merlin fut jadis, au VIe siècle, le grand barde et le grand prophète de la race bretonne. Au milieu des désastres et des massacres de l’invasion saxonne dans la Grande-Bretagne, il soutint puissamment l’énergique résistance, le patriotique espoir des Bretons, en prophétisant intrépidement, contre toute apparence, leur triomphe complet, définitif.
Quelques siècles plus tard, Merlin le prophète breton a été connu, célébré dans toute l’Europe, comme l’incarnation de la science et de l’esprit divinatoire des races celtiques, tandis que le roi breton Arthur était partout exalté comme l’incarnation suprême de toute vaillance, de toute puissance et de toute grandeur.
Aujourd’hui encore, en sens inverse, ils ont même fortune. Pensant que l’historien a peine à ressaisir quelque trace certaine de l’existence du grand roi, les critiques semblent désespérer de retrouver quelque œuvre, quelque fragment authentique du prophète-barde. Aneurin, Taliésin, Lywarch, bardes aussi et contemporains de Merlin, mais dont le nom ne sortit jamais de l’île de Bretagne, nous ont transmis des morceaux de poésie dont les critiques les plus difficiles ne contestent point l’authenticité. On discute, on discutera sur le sens de ce poème vraiment étonnant appelé Gododin, on n’en dispute point la paternité à Aneurin. Taliésin, après les plus sévères révisions des soixante-dix-sept pièces à lui attribuées, en garde encore une douzaine, et Lywarch autant ou à peu près, Merlin est moins heureux. Dans le volume si intéressant publié par M. de la Villemarqué sous le titre : Poèmes des bardes bretons du VIe siècle, Merlin ne figure même pas.
Il ne manque point cependant de pièces curieuses, célèbres, et d’un tour original, mises sous son nom. Lisez plutôt :
« Vortigern, roi des Bretons, étant assis au bord du lac desséché, deux dragons en sortirent l’un blanc, l’autre rouge, qui s’étant joints se livrèrent un si furieux combat que leur haleine enflammait l’air. Le dragon blanc, ayant l’avantage, rejeta le rouge jusqu’à l’extrémité du lac. Honteux de se voir ainsi chassé, celui-ci sauta sur l’autre et le força à son tour de reculer. Cette lutte continuant, le roi ordonna à Merlin de lui dire ce qu’elle présageait. Merlin alors, fondant en larmes, appela l’esprit prophétique et dit :
« Malheur au dragon rouge, car sa ruine approche ! Déjà sa caverne est envahie par le dragon blanc, qui représente les Saxons appelés par toi, ô roi, dans notre pays ! Le dragon rouge, au contraire, c’est la nation bretonne, qui se verra accablée par le dragon blanc. Ses montagnes et ses vallées seront nivelées, ses fleuves rouleront des flots de sang. Chez elle le culte chrétien sera détruit, on ne verra qu’églises en ruines. Cependant la nation opprimée se relèvera et repoussera la tyrannie des étrangers. Le sanglier de Cornouaille lui prêtera secours et foulera aux pieds le col de ses ennemis ; les îles de l’Océan reconnaîtront son autorité, il possédera les forêts de la Gaule, le palais de Romulus craindra sa puissance, et sa mort sera douteuse. La voix unanime des peuples chantera ses louanges, ses exploits feront la fortune des conteurs1. »
Tel est, dans Geoffroy de Monmouth, le début de cette fameuse prophétie de Merlin, sur laquelle pendant tout le moyen âge s’acharnèrent tous les peuples de l’Europe, la tournant en cent interprétations diverses et y découvrant mille choses, auxquelles jamais ne songea la fantaisie vagabonde, je ne dis pas de Merlin, mais de l’anonyme auteur de cette pièce apocryphe. En 1351, par exemple, Bembro, le chef des trente Anglais qui se battirent contre trente Bretons au chêne de Mi-Voie, avait trouvé dans les prophéties de Merlin l’annonce de son triomphe — qui fut une défaite,— et Jean de Montfort, en 1364, à la veille de sa victoire d’Aurai, celle d’un grand péril qui le menaçait.
Par voie de commentaire ou de développement, on est allé bien plus loin encore. Nous avons sous la main un roman des Prophéties de Merlin, imprimé en gothique chez Jean Trepperel au commencement du XVIe siècle ; voici, entre autres prédictions, ce que le célèbre prophète dicte à son secrétaire :
« Des femmes qui vouldront estre dames de leurs marys.
« Ie veulx que le sage clerc escripue que des lors en auant que la chose qui iadis nasquit ès parties de Iherusalem2 aura mil. CC. LX. ans, ne naistra nulle femme au siècle, que quant elles seront données à leurs marys, ne vouldront estre dames en telle manière comme iadis fut vne femme nommée Teuthis. Ceste Teuthis enchanta son mary par telle manière que quand elle luy commandoit à chanter, il chantoit, et maintes choses luy faisoit faire pour mieulx se moquer de luy. En ceste manière vouldront faire celle qui depuis celuy terme naissant, car elles pourchasseront de donner telle chose à boyre à leurs marys qu’ilz facent du tout à leurs voulentez. Et quant ilz auront ce faict, elles tenseront l’vne à l’autre pour dire : Ton mary n’est pas si obéissant comme le mien3. »
Nous n’avons pas à nous occuper de ces prophéties apocryphes et de ces commentaires fantaisistes : M. de la Villemarqué l’a fait avec beaucoup de charme dans le volume spécial consacré, par lui à Merlin l’enchanteur4. Mais en dehors de ces produits hautement supposés, sur lesquels il n’y a ni ne peut y avoir nulle discussion, il existe des œuvres, des poésies attribuées à Merlin, d’un caractère plus ancien au moins en apparence, et qui étaient encore, il y a peu de temps, regardées par les savants comme authentiques. Elles sont écrites en langue bretonne (en ancien gallois), elles ont été publiées au commencement de ce siècle dans le recueil des monuments de la vieille littérature galloise édité par Owen Jones, de Myvyr5, sous le titre de Myvyrian archaiology of Wales6. Il appartenait évidemment à M. de la Villemarqué de nous les faire connaître, d’en discuter le caractère et la valeur dans la partie de son livre intitulé : Œuvres de Merlin. Par une circonstance étrange, il n’y fait que des allusions beaucoup trop discrètes, il n’en cite que de brefs extraits, acceptant d’ailleurs implicitement, sans observation, l’opinion récente qui les répudie comme supposées.
Quand même cette opinion devrait être acceptée sans réserve (ce qui nous semble fort douteux), encore serait-il intéressant de connaître ces pièces, de savoir pourquoi, après les avoir longtemps admises comme authentiques, aujourd’hui on les rejette. C’est là ce que nous voudrions indiquer.
Notre but est de provoquer M. de la Villemarqué à compléter son livre sur Merlin, bien plus que de suppléer à son silence, ce qui nous est interdit pour plus d’une raison, surtout parce que nous sommes réduit à traduire les pièces bretonnes de Merlin sur les traductions anglaises.
Du moins ferons-nous connaître aux Bretons d’Armorique l’opinion actuelle des critiques gallois sur les monuments curieux qu’on peut encore appeler, croyons-nous, dans une certaine mesure, les Véritables prophéties de Merlin.
1 Galfridi Monemutensis, Historia regum Britannaiœ, lib. VII, cap. 3.
2 La religion chrétienne.
3 Fol. CVIII verso.
4 Paris Didier, 1862, in-8o.
5 C’est le nom de la vallée où il était né.
6 En 1801. Ce titre peut se traduire : Antiquités (littéraires) du pays de Galles recueillies à Myvyr. On appelle ordinairement ce recueil le Myvyrian. Une 2e édition, supérieure par certains côtés à la première, en a été publiée à Denbigh en un seul volume, pet. In-4o, en 1870.
II
Le Myvyrian contient six pièces attribuées à Merlin :
1o Les Pommiers (Afallenau),
2o les Petits Pourceaux (Porchellanau, aussi appelée Hoianau),
3o le Dialogue de Merlin et de sa sœur Gwendyz,
4o le Dialogue de Merlin et d’Yscolan,
5o la Prédiction de Merlin dans son tombeau,
6o les Creusements ou Fouissements (Gorddodau).
Dans l’édition beaucoup meilleure des anciens poèmes gallois donnée par M. Skene (en 1863-1868) sous le titre de The Four ancient Books of Wales, la dernière de ces pièces ne figure pas ; en revanche, M. Skene en donne deux autres comme attribuées à Merlin : les Bouleaux, — et le Dialogue de Merlin et de Taliésin, — ce qui porte à huit le nombre des anciennes poésies bretonnes sur lesquelles le célèbre enchanteur peut élever des prétentions.
Au moment où parut le Myvyrian, la discussion sur l’authenticité des poésies gaëliques attribuées à Ossian était fort vive, et par une pente naturelle, les adversaires de cette authenticité — entre autres Pinkerton et Laing— se laissèrent entraîner à nier celle des poèmes bretons que le Myvyrian rapportait aux bardes du VIe siècle, particulièrement à Lywarch Hen, Aneurin, Taliésin et Merlin. Mais ces poèmes trouvèrent un habile et énergique défenseur dans l’illustre historien des Anglo-Saxons, Sharon Turner, qui publia en 1803 une dissertation intitulée : Vindication of the genuineness of the ancient British poems of Aneurin, Taliessin, Lywarch Hen, and Myrddin, c’est-à-dire, défense de l’authenticité des anciens poèmes bretons d’Aneurin, de Taliésin, de Lywarch Hen, et de Merlin. La haute autorité de Sharon Turner fit loi, et pendant près d’un demi-siècle, son opinion fut admise sans aucune discussion.
En 1840, dans son ingénieux et savant livre, la Littérature des Kymrys, feu M. Thomas Stephens, examinant de nouveau la question, rouvrit le débat par ce coup de tam-tam :
— Lecteur, sois attentif à ce que je vais écrire et ouvre un œil vigilant sur les idées qui vont surgir devant toi, car l’audacieux esprit de la critique moderne est prêt à porter une main violente sur l’antique mobilier de la vénérable tradition7.
On croirait après cette phrase, qu’il va tout casser : il n’en est rien. Il admet comme authentique l’Iliade bretonne (le Gododin d’Aneurin), toutes les poésies de Lywarch, douze poèmes historiques de Taliésin, huit autres du même comme douteux8 ; il finit par écrire un peu plus loin qu’il est heureux de voir son examen aboutir à confirmer les conclusions de Sharon Turner en ce qui touche toutes les œuvres d’Aneurin, de Lywarch, et la partie la plus importante de celles de Talié-sin9. Sur Merlin, quoiqu’à regret il s’en sépare, il consacre soixante-dix pages de son livre à discuter, à combattre successivement l’authenticité des divers poèmes attribués à ce barde, qu’il dépouille absolument. C’est donc Merlin qui supporte à peu près seul le poids des mauvais traitements si bruyamment annoncés en tête du chapitre contre « l’antique mobilier de la vénérable tradition. »
Cela explique assez comment M. de la Villemarqué, publiant en 1850 ses Poèmes des bardes bretons du VIe siècle, où il ne voulait admettre aucune pièce d’une authenticité contestée, n’y fait nulle place à Merlin. Nous comprenons moins pourquoi, des douze pièces de Taliésin admises par Th. Stephens comme authentiques, M. de la Villemarqué n’en publie que six. Mieux eût valu les donner, les traduire toutes, que d’insister dans l’introduction sur cette pseudo-histoire de Taliésin fabuleuse et ridicule, qui n’est même pas une légende traditionnelle, mais une fable apocryphe fabriquée de toutes pièces à la fin du XVIe siècle10.
Le livre de M. Nash sur Taliésin, publié en 1858, va dans la voie de la critique plus loin que M. Stephens ; il aboutit à peu près à poser en principe la suspicion vis-à-vis de tous les poèmes bardiques réputés du VIe ou VIIe siècle, sauf à admettre pour quelques-uns d’entre eux certains tempéraments. Sur Merlin, il se borne à adopter l’opinion de Stephens.
En 1863, sous le titre de Les Quatre anciens Livres du pays de Galles, M. Skene publia pour la première fois le texte exact et complet des quatre plus anciens manuscrits contenant les poèmes bardiques qu’on rapporte aux VIe et VIIe siècles, savoir : le Livre Noir de Caermarthen, manuscrit du XIIe siècle ; le Livre d’Aneurin et le Livre de Taliésin, manuscrits du XIIIe ; et le Livre Rouge d’Herghest, du XIVe. À cette excellente édition, devenue la base nécessaire de toute étude sur les bardes, il joignit (en 1868) une bonne traduction anglaise et une introduction fort intéressante où, à côté de données historiques en partie très contestables, il pose, d’une façon fort juste, fort judicieuse, les principes de la critique concernant les poèmes bretons attribués aux VIe et VIIe siècles.
Il montre par de solides arguments qu’en dépit de l’orthographe relativement moderne sous laquelle ils nous sont parvenus, la présomption historique et littéraire est en faveur de leur authenticité11. Dans le nombre, toutefois, il y en a d’interpolés ; il y en a même de complètement apocryphes, fabriqués au XIIe ou au XIIIe siècle, qui se sont glissés là subrepticement et dont la fraude se trahit par des anachronismes. Mais pour condamner une pièce comme apocryphe, M. Skene exige avec raison des motifs précis, sérieux, bien établis. Aussi il repousse, il réfute spirituellement les exagérations, les hypothèses souvent très peu fondées de M. Nash, et même certains arguments de Th. Stephens, dont il est toutefois beaucoup moins loin que du premier.
Enfin, grâce à son heureuse idée de publier les plus anciens manuscrits au lieu de s’en tenir à l’édition du Myvyrian, faite sur des copies modernes souvent fautives, M. Skene a introduit dans le texte des corrections très nombreuses, parfois même des modifications et des rectifications très importantes. On va, en ce qui touche Merlin, en voir une preuve tout à l’heure.
7The Literature of the Kymry, chap. II, sect. 4, édit. 1876, p. 198.
8 Il est vrai qu’on a attribué à Taliésin jusqu’à 77 pièces de vers.
9Ibid., p. 278.
10 Voir M. Skene, The Four ancient Books of Wales (1868), t. I, p. 191-193.
11The Four ancient Books of Wales, t. I, p. 229-232.
III
La plus célèbre des pièces attribuées à Merlin est celle que les Gallois nomment Afallenau ou Avallenau, c’est-à-dire les Pommiers. Stephens a consacré une douzaine de pages à en faire la critique d’après le texte du Myvyrian





























