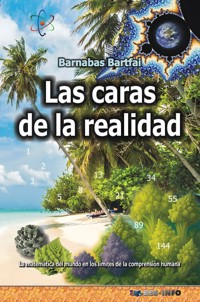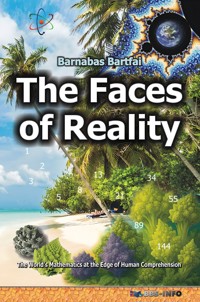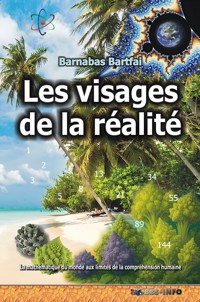
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BBS-INFO
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La physique a aujourd’hui prouvé que la réalité est loin d’être ce que nous en percevons. Mais qu’est-ce que nous voyons, et qu’est-ce qui existe réellement ?
Ce livre vous entraîne dans un voyage de réflexion, où l’on découvre étape par étape à quel point la perception humaine déforme la réalité, et que le monde que nous expérimentons n’est pas identique à celui qui existe véritablement. Il présente la nature réelle et les bizarreries des lois physiques, puis, en poursuivant l’exploration de dimensions plus profondes, nous fait découvrir un monde où la réalité n’est plus fondée sur la matière, mais sur les mathématiques. Tout cela sans équations ni formules complexes, mais simplement à travers le libre cours des idées.
Comme la structure du monde présente presque partout des motifs fractals, les merveilles du numénisme et de la géométrie fractale permettent d’accéder à des interprétations plus profondes qui dépassent la physique matérialiste et, en réinterprétant les systèmes de croyances, peuvent transformer entièrement notre vision du monde — même si cela peut sembler audacieux à première vue.
Ce livre s’adresse à ceux qui ne se contentent pas des apparences. À ceux qui ne veulent pas seulement savoir, mais aussi comprendre. À ceux qui se demandent pourquoi nous percevons le monde tel que nous le percevons, et ce qui se cache derrière cette perception. Aux amateurs de science, aux esprits ouverts à la philosophie, et à tous ceux qui recherchent les facettes les plus profondes de la réalité.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Avant-propos
Ce livre montre à quel point le monde est différent de ce que nous voyons avec nos yeux humains. Vu sous un angle différent, il montre un visage tellement différent que nous aurions du mal à croire qu'il s'agit du même monde. Cependant, pour nous rapprocher de la nature réelle du monde, nous devons d'abord remettre en question notre propre point de vue, cette perspective humaine qui limite si souvent notre interprétation.
Il n'y a pratiquement personne qui n'ait déjà réfléchi aux questions fondamentales de l'existence du monde. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Qu'est-ce qui existe réellement ? Que nous abordions ces questions d'un point de vue philosophique, scientifique ou spirituel, nous nous heurtons souvent à des murs. Les religions sont pleines de contradictions internes et de paradoxes, tandis que la physique et la vision matérialiste du monde se con-centrent exclusivement sur les phénomènes du monde ma-tériel, ignorant les aspects qui dépassent la réalité percep-tible. Certaines visions ésotériques tentent certes d'apporter des réponses à ces questions, mais dans de nombreux cas, elles attribuent des explications mystiques et surnaturelles à des phénomènes qui pourraient être décrits par la physique avancée, ce qui ne fait qu'accroître la confusion.
Choisissons donc la pilule rouge du film Matrix, dé-couvrons le vrai visage de la réalité, puis allons encore plus loin. Cherchons une nouvelle approche, une vision cohé-rente, exempte de contradictions internes, capable d'appor-ter des réponses logiques et rationnelles non seulement aux questions du monde matériel, mais aussi à celles des dimen-sions qui le dépassent. Mais qu'est-ce qui peut être au-dessus de tout cela ? Qu'est-ce qui peut exister indépen-damment du monde matériel ? La réponse est sous nos yeux : les mathématiques.
Est-il possible que la réalité ne soit rien d'autre qu'un système de structures mathématiques existant par elles-mêmes, que « l'existence » ne soit que leur projection frac-tale, et que la conscience ne soit que la perspective interne de la structure, un modèle autoréflexif capable de se perce-voir lui-même ? C'est possible. Bien que cette affirmation puisse sembler audacieuse à première vue, l'un des objectifs du livre est de présenter et de justifier étape par étape la validité de cette idée. Mais pour cela, nous devons d'abord comprendre la nature même du monde, à savoir à quel point la réalité perçue par l'homme diffère de ce qui se cache derrière elle. Car le monde ne peut pas être simple-ment décrit mathématiquement : le monde est lui-même mathématique. Selon la vision traditionnelle du monde, la réalité matérielle est primordiale et les mathématiques ne sont qu'un outil pour la décrire. Ce livre propose au con-traire un revirement radical, en supposant que ce n'est pas les mathématiques qui décrivent le monde, mais que le monde lui-même est de nature mathématique, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une « réalité », une « matière » ou un « espace-temps » pour que quelque chose existe – les mathématiques elles-mêmes suffisent, qui existent en tant que structure éternelle et indépendante, indépendamment de toute existence empirique.
Ce livre n'est donc pas seulement une présentation d'une théorie philosophique, mais la pierre angulaire d'une nouvelle vision du monde. Une approche capable de réin-terpréter le concept d'existence et de montrer que la réalité profonde n'est pas constituée de matière, mais de chiffres. Beaucoup ne pourront probablement pas s'identifier à cette idée, mais ce n'est pas nécessaire, car il ne s'agit que d'une possibilité, nous ne prétendons pas que ce soit la vérité. Mais c'est possible.
1. Introduction
Si nous examinons le monde de manière un peu plus approfondie, nous pouvons voir que rien n'est ce qu'il semble être. La physique nous permet de décrire très bien la nature réelle du monde matériel qui nous entoure, mais même à ce stade, il apparaît déjà que ce que nous perce-vons comme réalité n'est, au niveau du modèle physique, que le reflet de structures plus profondes.
Mais la réalité décrite par les lois de la physique est-elle certaine ? La réalité existe-t-elle vraiment, alors que ces lois ne sont valables que dans certaines circonstances et sont régulièrement remplacées par de nouvelles théories ? Lorsque nous franchissons la frontière de la physique quan-tique, la réalité s'effondre, la vision classique du monde n'est plus tenable : ce que nous croyions être de la matière est en fait des états de champ quantifiés se comportant comme des ondes. Mais qu'est-ce que cela signifie ? De quelles ondes s'agit-il ? Et si l'observation elle-même in-fluence le résultat de la mesure, dans quelle mesure pou-vons-nous considérer comme objective ce que nous appe-lons la réalité ? Se pourrait-il que ce soit simplement notre conscience ou notre observation qui matérialise le monde en tant que réalité ?
1.1. Changeons de point de vue
Une nouvelle tendance philosophique est toujours le résultat d'une recherche de réponses. Des réponses que ni la science moderne, ni les religions traditionnelles, ni les enseignements ésotériques n'ont pu fournir de manière sa-tisfaisante. Depuis des millénaires, l'humanité tente de per-cer le secret de l'existence : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce qui existe réellement, et comment interpréter la conscience, Dieu, l'univers, le temps, la ma-tière ou encore l'espace-temps ?
Les religions évoluent souvent dans un cadre dog-matique et, bien qu'elles fournissent souvent des repères moraux importants et des vérités spirituelles profondes, leurs contradictions internes et leurs paradoxes logiques les empêchent d'offrir une explication cohérente du monde. À l'inverse, l'approche scientifique matérialiste se concentre exclusivement sur le monde perceptible et mesurable, et ignore les questions qui dépassent la réalité empirique. La physique ne souhaite tout simplement pas s'occuper des questions qui dépassent les limites du monde mesurable et vérifiable. Les courants ésotériques, quant à eux, mélangent souvent le mysticisme et la science, et attribuent des expli-cations surnaturelles à des phénomènes pour lesquels il existe des réponses rationnelles et physiques.
Cependant, parmi ces trois approches, aucune n'est à la fois logique, cohérente et capable d'apporter une ré-ponse globale aux questions profondes de l'existence. Il était donc nécessaire de créer un nouveau courant qui résolve précisément ce problème : une nouvelle vision cohérente du monde qui ne repose ni sur la foi, ni sur le mysticisme, ni sur des preuves empiriques exclusives. Une approche ca-pable d'englober toutes les couches de la réalité – matérielle, mentale, temporelle et ontologique – selon un principe fon-damental unique. Ce principe fondamental est la mathéma-tique. Non pas comme outil descriptif, mais comme réalité ontologique. Le numénisme part du constat que les mathé-matiques ne sont pas seulement un langage créé par l'esprit humain, mais une structure qui existe en soi et qui constitue le fondement de toute réalité. La physique quantique montre que la matière existe à un niveau plus profond sous la forme d'états de champ quantifiés, de sorte que le monde perceptible n'est pas identique à la structure complète de la réalité physique. Une structure mathématique qui peut être décrite par des formules. Mais le monde ne peut être décrit par les mathématiques non pas parce que l'homme l'inter-prète ainsi, mais parce que le monde lui-même est de na-ture mathématique. Les nombres, les fonctions, les fractales et les structures ne sont pas le produit de la pensée hu-maine, mais les couches les plus profondes de l'exis-tence.
Le numénisme est donc une réponse qui aborde la question de l'existence non pas de l'extérieur, mais de l'inté-rieur. Il ne demande pas « qu'y a-t-il ? », mais « qu'est-ce qui existe nécessairement ? ». Et la réponse n'est pas la ma-tière, ni le temps, ni l'espace, ni Dieu, mais les mathéma-tiques, en tant que structure éternelle, autonome, indépen-dante de tout phénomène empirique, qui n'a pas besoin d'être créée et pour laquelle la question « qui l'a créée ? » n'a pas de sens. Les entités mathématiques infinies qui exis-tent dans une dimension infinie contiennent déjà tout ce qui peut exister, de sorte que la réalité n'est pas le résultat d'une volonté ou d'un commencement extérieurs, mais le reflet de la nécessité interne des nombres.
1.2. Contexte philosophique et scientifique
La théorie du numénisme n'est pas née de rien. Bien qu'elle offre une explication originale et indépendante du monde, elle est néanmoins étroitement liée à des traditions philosophiques millénaires et aux domaines frontaliers de la science moderne. Pour la comprendre, il convient de passer en revue les antécédents conceptuels et scientifiques qui ont en partie préparé, mais aussi en partie limité, cette nouvelle approche.
1.2.1. Le platonisme – le monde des idées existantes
L'une des racines les plus anciennes du numénisme est le platonisme. Selon Platon, la réalité se compose de deux niveaux : le monde sensible, qui est changeant et im-parfait, et le monde des idées, qui est éternel, immuable et parfait. Les idées – par exemple les concepts de « cercle » ou de « nombre » – ne sont pas le fruit de l'esprit humain, mais des entités autonomes qui se cachent derrière le monde matériel. Le numénisme radicalise cette idée : non seulement les concepts abstraits, mais aussi la réalité tout entière sont de nature mathématique. Les nombres, en tant que structures, n'existent pas seulement, ils sont l'existence même.
1.2.2. Max Tegmark et l'hypothèse de l'univers ma-thématique
Dans la pensée scientifique moderne, le physicien suédo-américain Max Tegmark a formulé la théorie la plus proche du numénisme, qu'il a appelée « hypothèse de l'univers mathématique » (Mathematical Universe Hypo-thesis). Selon Tegmark, tout ce qui existe est en réalité une structure mathématique, et l'univers peut non seulement être décrit à l'aide d'outils mathématiques, mais il est lui-même un objet mathématique. Ce point de vue dépasse radicalement la conception scientifique traditionnelle selon laquelle les mathématiques ne sont qu'un langage créé par l'esprit humain pour décrire et modéliser les phénomènes naturels. Selon Tegmark, les mathématiques ne sont pas une invention humaine, mais une structure qui existe au niveau le plus profond de la réalité. En d'autres termes, le monde physique ne contient pas de relations mathéma-tiques : le monde lui-même est mathématique. Cette idée est étonnamment proche de la théorie des idées de Platon, se-lon laquelle la réalité repose en réalité sur le monde des idées, qui est éternel, parfait et immuable, tandis que le monde perceptible n'en est que l'ombre ou la copie. De la même manière, Tegmark considère que l'univers physique n'est qu'une manifestation de la structure mathématique abstraite qui le sous-tend. Le « monde des idées » mention-né par Platon peut donc être identifié, dans l'interprétation de Tegmark, au royaume absolu des mathématiques.
Une conséquence importante de la théorie de Teg-mark est que si les mathématiques sont réellement le fon-dement de l'existence, alors toute structure mathématique possible peut être interprétée d'une manière ou d'une autre comme un univers existant. Cette idée conduit au concept dit de multivers, selon lequel il n'existe pas un seul monde, mais une infinité d'univers ayant des structures mathéma-tiques différentes les uns des autres.
L'hypothèse de Tegmark repousse ainsi non seule-ment les limites de la physique et des mathématiques, mais soulève également des questions philosophiques :
– Que signifie « exister » si toutes les structures ma-thématiques existent quelque part ?
– Peut-il y avoir conscience si tout n'est que forme abstraite ?
– Et l'esprit humain fait-il partie d'une telle structure mathématique ?
Dans l'ensemble, l'hypothèse de l'univers mathéma-tique de Max Tegmark est l'une des tentatives les plus inté-ressantes de l'ère moderne pour résumer la nature de la réalité en une unité mathématique et philosophique. Tout comme le numénisme, cette idée suggère que l'essence fon-damentale du monde n'est pas matérielle, mais abstraite et spirituelle : « l'être » lui-même est mathématique. Le numé-nisme pousse cette idée plus loin, en affirmant que non seu-lement l'univers, mais aussi toute existence – y compris la conscience, le temps et l'expérience – ont une origine ma-thématique. Alors que la théorie de Tegmark s'inscrit prin-cipalement dans un cadre cosmologique et physique, le numénisme s'aventure également dans les profondeurs on-tologiques et phénoménologiques. Dans ce livre, nous ne nous contentons donc pas de dire que le monde est de na-ture mathématique ou spirituelle, mais nous examinons également la nature même de l'existence et nous nous de-mandons si la réalité est, en fin de compte, matérielle, cons-ciente, divine ou abstraite. En outre, nous ne parlons pas seulement de la réalité d'un point de vue théorique, mais nous l'abordons également sous l'angle de l'expérience hu-maine : comment vivons-nous, percevons-nous ou interpré-tons-nous ce monde « spirituel » ou « abstrait » ?
1.2.3. Physique numérique – la réalité comme calcul
La physique numérique est le nom collectif donné aux théories selon lesquelles l'univers est fondamentale-ment discret et fonctionne selon des règles algorithmiques, comme s'il était piloté par un énorme ordinateur. Des pen-seurs tels qu'Edward Fredkin, Stephen Wolfram ou Konrad Zuse ont tous supposé que la réalité est de nature numé-rique et que ses unités de base ne sont pas des particules matérielles, mais des bits d'information ou des états lo-giques. Le numénisme partage cette vision, mais ne se li-mite pas aux analogies informatiques. Le calcul n'est pas ici un processus mécanique, mais la dynamique interne des structures mathématiques, une sorte de décomposition frac-tale auto-organisée qui ne nécessite ni matériel ni contrôle externe.
1.2.4. La physique quantique, enfant terrible de la réalité
La physique quantique révèle de nombreux phéno-mènes qui constituent un défi majeur pour la vision maté-rialiste classique du monde. Des concepts tels que la super-position, l'intrication ou la non-localité suggèrent tous que ce n'est pas la matière qui domine dans les couches pro-fondes de la réalité, mais les relations informationnelles et mathématiques. La description des états quantiques, par exemple, ne peut se faire uniquement à l'aide de coordon-nées spatiales ou temporelles, mais nécessite des représenta-tions abstraites dans l'espace de Hilbert basées sur des nombres complexes.
Dans l'interprétation du numénisme, ces phéno-mènes quantiques ne sont pas des anomalies, mais les con-séquences naturelles du fait que la réalité n'est pas fondée sur la matière, mais sur une structure mathématique. La mécanique quantique ne se contente pas de décrire, elle révèle en partie ce niveau plus profond où l'existence n'est plus liée à l'espace et au temps, mais consiste en des sys-tèmes de relations abstraites. L'intrication, par exemple, peut être interprétée comme une relation interne entre deux structures qui ne nécessite pas de médiation physique, mais seulement une cohérence mathématique.
La physique quantique est donc non seulement com-patible avec le numénisme, mais elle le confirme en quelque sorte : le monde n'est pas constitué de particules maté-rielles, mais de relations mathématiques qui se manifestent parfois sous forme de conscience, parfois sous forme de phénomènes physiques.
1.2.5. La géométrie fractale, empreinte de Dieu
La géométrie fractale a été l'une des découvertes scientifiques les plus surprenantes du XXe siècle, jetant un nouvel éclairage sur les concepts de nature et d'ordre. Le mathématicien français Benoît Mandelbrot a montré que les formes de la nature – les nuages, les montagnes, les lits des rivières, les ramifications des plantes, voire le système vas-culaire du corps humain – suivent toutes des modèles auto-similaires, de structure fractale. Mais dans un sens plus large, l'humanité elle-même en fait partie, car nous nous ressemblons tous beaucoup, mais nous sommes tous légè-rement différents.
La particularité des fractales réside dans le fait que leur complexité infinie découle des règles mathématiques les plus simples. Ce principe suggère une loi profonde régis-sant le fonctionnement du cosmos : derrière le chaos se cache un ordre caché.
De nombreux penseurs, scientifiques et philosophes, y ont vu « l'empreinte de la création ». Les fractales sont comme les empreintes digitales de Dieu sur la trame du monde : des motifs mathématiquement précis, mais orga-niques et vivants, qui reflètent à la fois l'infini et le simple, le transcendant et le matériel.
La géométrie fractale est donc un symbole clé pour de nombreuses visions du monde : elle montre que la struc-ture de la réalité est en soi sacrée. Les lois mathématiques ne se contentent pas de décrire le monde, elles sont aussi des manifestations de l'ordre du monde, comme si elles étaient les traces de l'esprit créateur ou de la conscience divine dans la nature. (Voir chapitre 3.)
1.2.6. Structures s'interprétant elles-mêmes
La question principale est de savoir si une structure capable de s'interpréter elle-même peut exister. D'un point de vue scientifique et logique, on peut affirmer qu'il existe des structures capables de s'interpréter partiellement et que celles-ci peuvent être démontrées empiriquement, mais une structure capable d'interpréter son propre fonctionnement dans son intégralité et de manière cohérente ne peut en principe pas exister. Indépendamment du fait qu'une struc-ture soit de nature mathématique, informatique ou biolo-gique, elle peut en principe être capable de créer des mo-dèles d'elle-même, d'influencer son environnement, voire de disposer d'une représentation interne (un état pouvant être qualifié de conscience), mais elle ne sera pas capable de connaître le système dans son ensemble. Ainsi, nous, les êtres humains, pouvons faire partie de n'importe quelle structure (biologique ou mathématique), nous pouvons comprendre le monde, mais nous ne pourrons jamais con-naître la réalité dans son intégralité.
1.2.7. L'autonomie du numé-nisme
Bien que le numénisme soit lié à plusieurs égards aux courants susmentionnés, il ne s'y fond pas complètement. Le platonisme ne traite pas du point de vue interne de la conscience, la théorie de Tegmark ne répond pas à la ques-tion de l'expérience et de l'autoréflexion, et la physique numérique reste souvent confinée au cadre du monde phy-sique. Le numénisme va plus loin, affirmant non seulement que le monde est de nature mathématique, mais aussi que la conscience, le temps et l'expérience sont des points de vue internes à ces structures. Ainsi, le numénisme n'est pas seulement une explication du monde, mais aussi une théo-rie de la conscience et un cadre ontologique.
2. La nature de la réalité
Dans ce chapitre, nous examinerons comment nous voyons le monde de l'intérieur et dans quelle mesure ce point de vue comporte des complications et des incon-nues.
2.1. Le monde change-t-il ou le connaissons-nous mal ?
Tout au long de l'histoire de l'humanité, la question revient sans cesse : le monde change-t-il autour de nous ou est-ce nous qui le comprenons mal ? La réponse n'est pas toujours claire.
Nos ancêtres ont longtemps cru que la Terre était plate et que si nous naviguions trop loin, nous risquions de tomber dans le vide. Le détroit de Gibraltar, par exemple, a longtemps été considéré comme « le bord du monde », au-delà duquel seule la mort nous attendait. Puis, il s'est avéré que la Terre était sphérique, même si elle nous semblait plate dans notre petit espace de vie. Puis vint la croyance suivante : que la Terre était le centre de l'univers et que tout – le Soleil, les planètes, les étoiles – tournait autour d'elle. Lorsque certains, comme Copernic ou Galilée, remirent cela en question, ils ne se contentèrent pas de s'engager dans un débat scientifique, mais menacèrent également l'autorité de l'Église, ce qui coûta la vie à beaucoup.
Aujourd'hui, nous savons que la Terre est une pla-nète qui tourne autour du Soleil, et que le Soleil est une étoile de la Voie lactée, qui n'est elle-même qu'une infime partie de l'Univers. Mais il existe encore des limites que nous ne pouvons pas voir. Le Big Bang, la naissance de l'Univers, ne pourra cependant jamais être observé direc-tement à l'aide d'instruments optiques, car l'Univers a con-nu une « période sombre » où les étoiles n'existaient pas encore, et où il n'y avait donc pas de lumière que nous pouvions percevoir. Avant la nucléosynthèse, il n'y avait même pas d'atomes. Il n'y avait pas de matière massive que l'on pouvait « voir ». Et le Big Bang a eu lieu avant cela, certes peu de temps auparavant. C'est pourquoi nous ne pouvons nous faire une idée des origines que de manière indirecte, à partir de modèles théoriques et du rayonne-ment fossile.
Mais peut-être que ce n'est pas le monde qui est compliqué, mais simplement notre point de vue qui pose problème. Tant que nous considérions la Terre comme le centre de l'univers et que nous essayions de décrire le mou-vement des planètes à partir de ce point de vue, nous de-vions modéliser des trajectoires extrêmement complexes, avec des boucles, des inversions et des épicycles. Mais dès que nous avons été capables de sortir mentalement de cette coquille et d'observer le système de l'extérieur, tout s'est simplifié. Le mouvement des planètes s'est réduit à des or-bites circulaires ou elliptiques, et les formules auparavant complexes ont été remplacées par des lois élégantes.
Ce changement de perspective a non seulement ré-volutionné l'astronomie, mais il montre également com-ment nous pouvons comprendre d'autres phénomènes du monde. Une simplification similaire peut être observée dans la théorie de la relativité. Si nous essayons de décrire l'es-pace-temps de l'intérieur, à partir de notre propre système de coordonnées en mouvement, nous avons besoin d'équa-tions différentielles complexes pour comprendre la dilata-tion du temps, la contraction de la longueur ou la cons-tance de la vitesse de la lumière. Mais si nous sommes ca-pables d'observer l'espace-temps de l'extérieur, d'un point de vue géométrique de dimension supérieure, certains phé-nomènes peuvent alors être décrits à l'aide de simples fonc-tions trigonométriques.
Tant que nous ne sommes pas capables de sortir de notre propre point de vue, de cette cage mentale construite par l'habitude, la peur ou les préjugés, le fonctionnement du monde restera incompréhensible. La réalité n'est pas nécessairement compliquée, mais parfois nous la regardons du mauvais côté.
2.2. Disciplines scientifiques, les couches et les distorsions du savoir
L'homme moderne dispose d'une telle quantité de connaissances que cela l'empêche souvent de comprendre le monde dans son ensemble. La spécialisation scientifique a atteint un niveau tel qu'il existe des dizaines de sous-domaines dans chaque discipline, et l'individu peut s'esti-mer heureux s'il parvient à acquérir une relative maîtrise dans l'un d'entre eux. Cependant, se plonger dans les dé-tails obscurcit souvent la vue d'ensemble : l'arbre nous em-pêche de voir la forêt.
Lors de nuits d'insomnie, les grandes questions re-font néanmoins surface : qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la conscience ? Pourquoi tout existe-t-il ? Ce n'est pas en approfondissant les domaines spécialisés, mais en les consi-dérant de l'extérieur que nous pouvons trouver des ré-ponses à ces questions. Cette observation extérieure est tou-tefois difficile, car le plus grand obstacle est précisément notre savoir actuel. Le système scientifique que nous avons construit au fil des siècles nous aide, mais il nous limite éga-lement, car il enferme notre pensée dans un cadre.
Examinons donc la hiérarchie des disciplines scienti-fiques en remontant dans le temps. La vie est un processus biologique, ce que la plupart des gens acceptent. La biologie repose toutefois sur la chimie, car les processus vitaux sont des séries de réactions chimiques. La chimie est quant à elle un domaine spécifique de la physique, car le comportement des atomes et des molécules est régi par les lois physiques. La physique s'exprime dans le langage des mathématiques, sous forme de formules, d'équations et de modèles. Mais les mathématiques sont-elles la base ? Une puissance est cons-tituée de multiplications, la multiplication est constituée d'additions, et l'addition est constituée d'opérations lo-giques. Les opérateurs logiques de type « ou », « et », « ou exclusif » - les éléments de l'algèbre de Boole - constituent la couche la plus profonde des mathématiques. C'est ainsi que nous arrivons à la logique, qui est à la base non seulement des mathématiques, mais aussi de toutes les sciences. Pour-tant, la logique est rarement considérée comme une science à part entière, elle est plutôt traitée comme un arrière-plan, alors que tout le reste repose sur elle.
De notre point de vue, cette décomposition n'est pas seulement une pratique de l'histoire des sciences, mais aussi une reconnaissance ontologique. Si nous acceptons que les couches scientifiques sont toutes fondées sur des bases lo-giques, alors il peut sembler que le monde lui-même soit de nature mathématique et logique. Les nombres, les formules, les lois sont tous des projections de structures logiques. La réalité n'est donc pas l'ensemble des phénomènes décrits par les sciences, mais un système plus profond et abstrait dont ces phénomènes sont issus.
2.3. Les dimensions
Le concept de dimension semble simple à première vue, mais il est difficile à appréhender, que ce soit en phy-sique ou en mathématiques. Nous nous contenterons donc de dire que par dimension, nous entendons une extension dans une direction donnée. Chaque nouvelle dimension représente une nouvelle direction perpendiculaire dans laquelle un déplacement est possible. Si les dimensions n'étaient pas perpendiculaires les unes aux autres, un mouvement dans une direction provoquerait également un déplacement dans l'autre direction, ce qui contredirait le principe des coordonnées indépendantes.
Un point sans extension n'a pas de dimension. La ligne droite est unidimensionnelle : elle s'étend dans une seule direction et un emplacement donné peut être identifié par une seule donnée, par exemple la distance mesurée à partir du point de départ.
Le plan est bidimensionnel : il comporte deux direc-tions perpendiculaires entre elles, et la position d'un point peut être décrite à l'aide de deux données. Il peut s'agir de deux distances ou d'une distance et d'un angle – la manière de les indiquer peut varier, mais le nombre de données est toujours de deux.