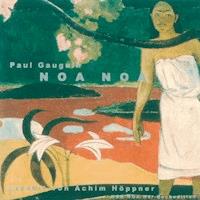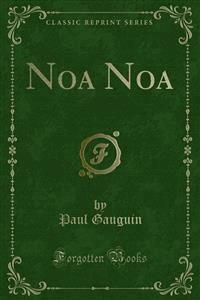Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Lettres de Paul Gauguin à Georges-Daniel de Monfreid" est une plongée fascinante dans l'esprit du célèbre peintre post-impressionniste Paul Gauguin. À travers cette correspondance, le lecteur découvre non seulement les réflexions artistiques de Gauguin, mais aussi ses préoccupations personnelles et ses aspirations. Les lettres échangées avec Georges-Daniel de Monfreid, lui-même artiste polyvalent, révèlent une amitié profonde et une complicité intellectuelle. Gauguin partage ses impressions sur la vie en Polynésie, ses luttes financières, et ses critiques du monde de l'art parisien. Ces écrits sont une fenêtre ouverte sur l'évolution de l'art moderne, où Gauguin exprime ses idées novatrices sur la couleur, la forme et le symbolisme. Le dialogue entre les deux artistes offre une perspective unique sur les défis et les triomphes de la création artistique à la fin du XIXe siècle. Ce livre est une ressource précieuse pour comprendre l'impact de Gauguin sur l'art et sa quête incessante de nouvelles formes d'expression. L'AUTEUR : Paul Gauguin, né en 1848 à Paris, est une figure emblématique du post-impressionnisme. Après une carrière dans la finance, il se consacre pleinement à la peinture dans les années 1880. Influencé par l'impressionnisme, Gauguin cherche rapidement à s'en détacher pour explorer des formes d'expression plus symboliques et émotionnelles. Ses voyages à Tahiti et en Polynésie française marquent un tournant dans son oeuvre, l'incitant à utiliser des couleurs vives et des motifs exotiques. Ces expériences enrichissent son style et le positionnent comme un précurseur du primitivisme. Georges-Daniel de Monfreid, né en 1856, est un artiste français aux multiples talents, connu pour sa peinture, sculpture, et ses travaux en céramique et verrerie. Ami proche de Gauguin, Monfreid joue un rôle crucial dans la promotion de son oeuvre en France. Leur correspondance témoigne de l'influence mutuelle qu'ils ont exercée l'un sur l'autre, et de leur engagement pour l'innovation artistique. Ensemble, ils ont contribué à façonner la scène artistique de leur époque, laissant un héritage durable dans l'histoire de l'art.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
HOMMAGE A GAUGUIN
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVIII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
ICI FINISSENT
HOMMAGE A GAUGUIN
I
PAUL GAUGUIN, né à Paris le 7 juin 1848... — je ne m’attarde pas à exposer ses origines; tout homme exceptionnel étant destiné à décevoir ses parents plus qu’à les prolonger. Et lui-même nous instruit:
«Si je vous dis que, par les femmes, je descends d’un Borgia d’Aragon, vice-roi du Pérou, vous répondrez que ce n’est pas vrai, et que je suis prétentieux. Mais si je vous dis que ma famille est une famille de vidangeurs, vous me mépriserez.»
En vérité, son père fut un journaliste; et sa grand’mère maternelle, une femme de lettres, Flora Tristan, dont les œuvres ni les croyances, saint-simoniennes, n’atteignent à l’intérêt de la vie conjugale. Mal mariée, son conjoint l’aimait cependant d’une telle rancune, qu’après trois ans d’accord et dix-huit années de séparation, il lui infligea la preuve la plus fatale dont un jaloux puisse faire hommage à sa femme, et tenta de la tuer. Elle continua de vivre et d’écrire des romans sentimentaux dans le goût de son école, comme «Memphis, ou le Prolétaire», sans pitié de ses lecteurs ni de son mari, soumis aux travaux forcés pour vingt ans.
Mais par elle, Gauguin remontait à des ancêtres — sinon «Borgia» — du moins de noblesse aragonaise certaine, puisque pauvre et émigrée. Don Mariano Tristan y Moscoso était colonel espagnol à la solde du Pérou, et ses états de service demeurent enviables: ce père de Flora, remarié à l’âge de quatre-vingt-neuf printemps, — sa seconde femme eut Plusieurs enfants dont un certain Etchenique, devenu Président de la République Péruvienne. L’autre ancêtre, son frère, don Pio Tristan, atteignit l’âge de cent treize années. Voilà, pour la vitalité, les véritables chefs de la maison Gauguin.
Ni cette vitalité, ni cette virilité respectables de l’arrière grand-père et grand-oncle, encore moins les vertus humanitaires de Flora Tristan, n’interviennent dans l’ascendance du génie de peintre en Gauguin. Mais il faut convenir que ces ancêtres non français, exportés, cet exotisme puissamment planté dès l’origine, n’étonnent point à considérer l’homme qu’ils engendrèrent, — à le regarder dans un des portraits qu’il fit de luimême les plus rudes, les plus francs, car destiné à l’ami des derniers jours: «A l’ami Daniel», comme l’écrit la dédicace. De profil, sur un torse oblique à forte encolure, avec un geste diagonal plein de volonté, aussi de ruse, un coup d’épaule et du regard... Le menton s’appuie grassement sur l’épaule. Une moustache courte, clairsemée. Le nez est busqué, préhensif; la paupière lourdement levée par le globe d’un œil gros. Un front fuyant; un crâne petit, — afin que la pensée trop intelligente ne déborde pas les merveilleux organes faits pour saisir le monde extérieur à belles dents, à pleines lèvres, à pleines narines, de tous les yeux, de toute la face, comme il sied au peintre bien né...
Si l’œuvre peinte n’est pas donnée dans les qualités ancestrales, on ne peut refuser à ces hispano-péruviens une souche de bon augure pour l’enfant qui devait naître d’eux en plein Paris.
Et d’ailleurs, c’est vers eux que, ruinée par le coup d’Etat, sa famille le ramène en 1851, l’embarquant avec elle pour le Pérou, à l’âge de trois ans. Mais, présages à retenir, — si l’on veut, — Clovis Gauguin, journaliste libéral, exilé volontaire, meurt dans le détroit de Magellan et on le laisse à Port-Famine.
Quatre années suivent de séjour à Lima, dont on retrouve les reflets dans le souvenir des enfances-Gauguin: un ciel insolemment pur; des toits en terrasse où les propriétaires frappés de «l’impôt de la folie» nourrissent le dément domestique, lié par une chaîne; le fou qui se désenchaîne parfois et rôde dans la nuit; les portraits d’ancêtres bougeant et s’animant quand la terre tremble et donne un regard à leurs yeux; la mantille des Liméniennes, partageant le visage de sa mère «gracieuse et jolie» ; et les tributs du pays: céramiques Incas, figurines d’argent natif, bijoux d’or sans alliage pétris par les mains indiennes; enfin la rutilante et clinquante vie politique près de l’ancêtre don Pio, père du Président, — et l’hommage à cette petite cousine dont le jeune corps lui Plut au point que les parents crièrent au viol! Tant d’autres choses... Paul Gauguin avait alors six ans.
Le retour en France ne fut, pour l’enfant, que la préparation à de nouveaux voyages. Sa famille le destinant à l’Ecole Navale, la destinée et quelque paresse lui imposèrent la marine marchande. A dix-sept ans, il s’embarque comme pilotin, et, de nouveau, pour l’Amérique du sud, mais Atlantique: Rio de Janeiro. Puis il s’engage, et on le retrouve timonier à bord du Jérôme-Napoléon, commandé par le Prince Jérôme Napoléon, et naviguant dans les mers boréales, quand, le 1er Juillet 1870, il fut promu matelot de deuxième classe. Cet événement dans sa campagne précéda de fort peu la déclaration de la guerre, — que son chef apprit avec rage, faisant aussitôt «mettre le cap sur Charenton » !
L’année suivante, libéré par un congé renouvelable, il quittait la mer pour longtemps et s’établissait à Saint-Cloud où Madame Gauguin, née Aline Chazal, était morte. Il trouvait là une autre famille, bienveillante et amie, qui, de l’apprenti-marin fit, par simple recommandation chez un agent de change, un excellent apprenti-banquier.
A vrai dire, de toutes les choses étonnantes qui se déroulent dans l’histoire de Gauguin, celle-ci est la moins attendue. Toute aventure qui suivra peut être acceptée si l’on a foi en celle-ci: Gauguin, admis chez Bertin, financier de la rue Lafitte, resta attaché à cette maison durant onze années consécutives. S’il la quitta, ce fut de son plein gré. On doit donc porter à son avoir qu’il débuta dans la vie véritable, la vie sérieuse, par ce bon point de bon agent de change, et convenir qu’aux temps de jeunesse et de fièvre et d’enthousiasme à travers quoi se couve pour éclore — ou crever — la personnalité humaine, Gauguin fut un bon employé. Et, chose que l’issue de sa vie rendra tout-à-fait incroyable, Gauguin, alors, gagna beaucoup d’argent! On cite un chiffre: quarante mille francs dans sa meilleure année. Il mit le comble à cette vie modèle en épousant Mademoiselle Mette-Sophie Gad, d’origine danoise et luthérienne, s’alliant de la sorte à la grande bourgeoisie de Copenhague.
Bon employé, bon époux, et, la permission du Seigneur et le tempérament aidant, bientôt quatre ou cinq fois père, Gauguin, par sa vie endiguée à cette époque, sa vie «honorable», pose le problème insistant: l’artiste, aux prises avec la société, doit-il la reconnaître et en jouir économiquement, ou la repousser, ou l’utiliser en partie afin de vivre juste assez pour une œuvre mitigée, ou encore... Problème à mille facettes dont l’issue est avant tout affaire de santé, de hasards, d’héritage, — problème que les générations précédentes résolurent en partis-pris opposés: soit le bohème jouant de son art, s’accouplant au gré de ses ivresses et mourant extatique ou désespéré ; ou bien l’autre, qu’un séparatisme avisé protège et nourrit. Les actes répétés quotidiennement qui valurent à Joris-Karl Huysmans, fonctionnaire, de l’avancement et une retraite à la fin de ses jours, doivent être excusés pour avoir permis à l’artiste une parfaite liberté d’art. Mais en dehors des catégories marche Rimbaud, fils de l’Apocalypse durant trois ou quatre années de son enfance, bon comptable, ensuite, pour l’éternité de sa vie. Les héros sont parfois bien décevants dans le choix de leurs espèces sociales!
C’est une autre déconvenue que réservait l’approche de M. Gauguin, employé de banque, — déconvenue plus stérile encore. Car si Huysmans, dès le début de sa jeunesse, se cherchait voluptueusement à travers le bourbier de son âme, si Rimbaud, bien avant sa vraie jeunesse, écrivait déjà en prophète, — Paul Gauguin, poussé par la vie, ne peignait pas. Que le lecteur daigne enfin s’étonner: dans cette chronique d’un grand peintre âgé dès lors de plus de vingt-huit ans, il n’a pas été question de peinture.
Et même, par un double paradoxe opposé aux précédents exemples, on peut croire que ses fonctions journalières elles-mêmes conduisirént Gauguin à toucher aux couleurs. Huysmans eut expliqué cela comme une manifestation du Malin qui s’insinue en l’âme par tous les pores suants de la peau... On peut croire que le démon des Visions pénétra sa proie par le vide que laisse en tout bon employé une semaine bien remplie: le Dimanche. Un beau Dimanche, Gauguin, pour occuper son loisir, se mit à peindre. On objectera qu’il pouvait, avec la même fatalité, s’adonner à pêcher à la ligne; ou encore, le goût de peindre, on devrait avec Taine, ce bon examinateur, le rapporter à une influence du milieu, (mais Gauguin même fait observer que Taine a parlé de tout sauf de peinture), et dire avec M. Jean de Rotonchamps que: «peut-être le futur auteur du Christ jaune acquit inconsciemment dans la maison de son tuteur, Gustave Arosa, l’amour latent de l’œuvre peinte, car Gustave Arosa... doué d’un goût délicat avait réuni chez lui un certain nombre de toiles de l’école moderne...» Il vaut mieux reconnaître la vertu génitrice du Dimanche chez un bon employé, la vertu maléficieuse, puisque précisément ce jour-là, repos du Créateur, le Malin s’agite et enfièvre les maudits parmi les hommes, ses fils d’orgueil et de révolte: les artistes, les Hors-la-loi. Je vois dans tout ceci une authentique prédestination!
Mais ce qui vaut mieux, il se trouve que Gustave Arosa était ami de Pissarro. C’est de ce maître que Gauguin apprit le choix des tons à donner à la toile: élimination du noir cireux, du bitume stercoral, des terres et des ocres couleurs de pauvre; et cette décision un Peu naïve mais riante de n’user que des trois «primaires» et de leurs dérivés immédiats: la formule, enfin, trop répétée, du «mélange optique des couleurs». Bien plus, Pissarro lui enseignait l’indépendance, l’affranchissement de toute maîtrise hormis la sienne propre que chaque élève détient, — ou ne détient pas, et c’est en effet la question. Dans la complète, sincère, enthousiaste et cynique biographie de Paul Gauguin, celle qui, dans cinquante ans, quand toute la génération qui l’approcha sera morte, — et nous aussi, — sera possible, il ne faudra point négliger Pissarro, Danois né aux Antilles, vendu par sa famille au négoce et qui apprit, sans doctrine, les éléments de son propre dessin. Bien mieux que la division des couleurs, Pissarro avait d’abord enseigné à Gauguin comment on échappe à la famille, à la fatalité de marchand ou d’homme d’argent, d’homme payé ou payant, d’homme à bilan, d’homme à tout faire, — comment l’on n’est pas commerçant.
Bien que les premiers essais de Gauguin se datent de 1875, — et qu’il ait, en 1876, exposé au salon un paysage, — obtenu de Huysmans en 1880 un brevet de «dilution des œuvres encore incertaines de Pissarro», c’est en 1881 qu’il se révèle: «M. Gauguin, écrit Huysmans se présente avec une toile bien à lui, une toile qui révèle un incontestable tempérament de peintre moderne.
«Elle porte ce titre: Etude de nu. C’est, au premier plan, une femme vue de profil, assise sur un divan, en train de raccommoder sa chemise; derrière elle, le parquet fuit, tendu d’un tapis violacé, jusqu’au dernier plan qu’arrête le bas entrevu d’un rideau d’algérienne.
«Je ne crains pas d’affirmer que parmi les peintres contemporains qui ont travaillé le nu, aucun n’a encore donné une note aussi véhémente dans le réel; et je n’excepte pas de ces peintres, Courbet, dont la femme au perroquet est aussi peu vraie comme ordonnance et comme chair, que la femme couchée de Lefebvre, ou la Vénus à la crème de Cabanel....
«En dépit de ses titres mythologiques et des bizarres pannes dont il revêt ses modèles, Rembrandt seul, a, jusqu’à ce jour, peint le nu.» Et plus loin, négligeant d’autres toiles: «Bien que ces tableaux aient des qualités, je ne m’y arrêterai pas, car la personnalité de M. Gauguin, si tranchée dans son étude de nu, s’est difficilement évadée encore des embrasses de M. Pissarro, son maître.»
L’année suivante, 1882, Huysmans la déclare, pour le même peintre, une année de «rien qui vaille» — : «Tout au plus citerais-je, comme étant plus valide que le reste, sa nouvelle vue de l’église de Vaugirard. Quant à son intérieur d’atelier, il est d’une couleur teigneuse et sourde...»
En effet, Gauguin dans son intérieur, non plus, de peintre mais de mari, remâchait une aventure de ton vraiment domestique; et cette année «de rien qui vaille» fut livrée à cette crise intime, empâtée dans cette couleur «teigneuse et sourde» comme l’avait pressenti la double vue décidément impitoyable de Huysmans. Il semble enfin que les conseils du maître des indépendants, de Pissarro, aient, à ce moment-là même porté dans l’arbre de vie de Gauguin les fruits les plus beaux, les plus vénéneux. C’est en janvier 1883, à l’âge de l’homme fait, milieu juste d’une vie humaine bien rythmée, à trente-cinq ans, que M. Gauguin, agent de change, obsédé d’un travail lucratif qui dérobe ses heures, met en balance sa vie d’employé, et l’autre; celle qu’il tient et celle qu’il veut vivre... se décide pour celle-ci, et, forçat de la petite semaine, prononce enfin le mot le plus fier de son œuvre:
— «Désormais, — aurait-il dit, et je ne l’ai Pas entendu, — désormais, je peins tous les jours.»
Aussitôt, changement magique: Gauguin venait de jouer toute sa carrière sur ces mots, — et, en apparence, de tout y perdre. L’employé cossu se défait de son emploi, le collectionneur de ses toiles; (il en possédait de fort belles de Manet, Renoir, Monet, Cézanne, Pissarro, Sisley...) enfin, le père de famille de sa femme et de ses enfants. La famille Gauguin ayant émigré en Danemark, se disloque vers 1885. Madame Gauguin demeure à Copenhague avec quatre de ses enfants. Lui, pauvre, mais désormais peintre sans dimanches, revient avec son fils Clovis à Paris, et, sans tarder, descend au fond de la détresse: par grande ironie il doit son pain, durant quelques temps, à la parodie même de son nouveau métier. Il colla, pour trois francs cinquante par jour, des affiches «décoratives» à la gare du Nord.
«J’ai connu, écrit-il dans un petit cahier dédié à sa fille Aline, la misère extrême. Ce n’est rien ou presque rien... On s’y habitue, et, avec de la volonté, on finit par en rire. Mais ce qui est terrible, c’est l’empêchement au travail... Il est vrai que, par contre, la souffrance vous aiguise le génie. Il n’en faut pas trop, cependant, sinon elle vous tue... Avec beaucoup d’orgueil j’ai fini par avoir beaucoup d’énergie, et j’ai voulu vouloir.»
Cette énergie, il la promène d’abord de Paris en Bretagne, à Pont-Aven. Puis il se souvient d’autres terres plus lointaines que le «Finistère», — d’îles déjà vues dans sa jeunesse ou son adolescence; de pays entre les deux tropiques où le soleil au zénith ne fait pas d’ombre et pénètre tout même le crâne, — et la machine animale évapore ses humeurs dans un bouillonnement de volupté. Et, parvenu à cet autre point, (il a près de quarante ans) où l’on sent la série des années basculer et glisser au lieu de s’envoler, c’est alors seulement qu’il se décide et part pour les Antilles françaises, la Martinique. Il n’y a Plus lieu de s’étonner. Même on escomptait ce départ, dont l’impromptu seul se manifeste qu’il soit si tardif! Gauguin, peintre enfin libéré, aurait dû se réembarquer plus tôt en sa vie... Comment Gauguin n’est-il pas, depuis longtemps déjà, parti?
C’est en vérité qu’il est décidé au départ beaucoup moins sous l’attrait des haleurs aux horizons-mirages, que par la poussée du budget quotidien. Il calcule, — et ceci demeure jusqu’à la fin pour lui un autre mirage, — il croit «la vie beaucoup moins chère aux colonies qu’à Paris.» Ce n’est point par éblouissement éperdu de la lumière: il se sent de chaleur à la créer; mais par escompte, mal placé, d’une maison moins chère à conduire; d’une vie pratique plus aisée, dans cette arrière province qu’est une colonie à la fin du dix-neuvième siècle. Insoucieux du soleil vers qui il se met en route, il part avant tout afin de vivre librement, ou — simplement, — de vivre.
N’oublions pas que tous les «cieux de braises», le flamboiement des jugements derniers, l’enfer et ses gloires peuvent se peindre sans avoir été subis; que Turner allumait ses toiles dans une arrière-boutique du sous-sol londonien; que Rimbaud, avant d’exprimer toute la mer, avec ses ressacs, ses volumes en marche, ses écroulements d’eau et sa nautilité — Rimbaud n’avait jamais vu la mer.
L’année 1887 se passe tout entière aux Antilles. Mais le climat menace Gauguin et le force au retour.
C’est à nouveau de Bretagne, que vient le tirer vers la Provence une lettre d’ami, — et Pour la première fois dans sa solitude souillée de médiocres camarades, — d’un ami digne de lui: Vincent van Gogh, débarqué de Hollande.
Vincent, qui peignait à Arles, a reçu, en échange du sien, un portrait de Paul par lui-même, et il écrit à son frère Théodore van Gogh: «Cela me fait décidément l’effet de représenter un prisonnier... mais on peut mettre cela sur le compte de la volonté de faire une chose mélancolique; la chair dans les ombres est lugubrement bleutée... Ce que le portrait de Gauguin me dit surtout, c’est qu’il ne doit pas continuer comme cela; qu’il doit se consoler, qu’il doit redevenir le Gauguin Plus riche des négresses.»
Gauguin rejoignit donc van Gogh peignant les Aliscamps de Camargue, Il y eut alors, après l’échange des portraits, opposition de qualités insolites. Van Gogh, timide et mystique, réfléchissait jour et nuit sans trêve sur une toile, et crevant en couleurs, peignait tout d’un coup furieusement. Puis, ce fut la folie, haute en couleurs comme ses gestes sur la toile, — et l’oreille coupée. Et van Gogh fit de lui-même le portrait «L’Homme à l’oreille coupée», — et plus tard se tira un coup de pistolet dans le ventre. Gauguin, enfui de leur vie commune, s’était pour la troisième fois réfugié en Bretagne, et de Pont-Aven au Pouldu.
Et du Pouldu il s’en revient à Paris vers la fin de l’année de l’Exposition, à laquelle il avait participé, non pas aux salons, mais aux cimaises d’un estaminet, sous la rubrique, dédaignée plutôt que choisie par lui du groupe «impressionniste et synthétiste».
Ce fut la période, — deux années —, qu’on Pourrait étiqueter «parisienne», comme on dira plus tard «provençale» ou «martiniquaise ». Ce n'est point la meilleure de sa fonction de peintre. Il fréquente des milieux littéraires dont le millésime, 1890, implique aussitôt la tendance. De jeunes écrivains «compréhensifs», Albert Aurier, Julien Leclerq, l’ont conduit vers l’église symboliste. Il lui est donné de voir et d’entendre le grand Verlaine, le Poète, et de boire auprès de lui; et Moréas, le bon faiseur de vers, et Morice, le rhéteur. Mais l’épithète symboliste est une ferme valeur littéraire à cette date. Nous autres, vivant à ce jour, pouvons bien mesurer ce que ces temps nous ont valu; et toute la jeunesse qu’ils apportaient, et les beaux coups de dents saines dont cette jeunesse déchirait la viande — non pas faisandée mais Putride — de bœuf naturaliste, indigne d’être mangé comme cerf. Mais Gauguin avait passé la quarantaine, — et, bien plus âgé, bien plus mûr, bien plus «sans âge» que l’homme, l’artiste avait dépassé le symbole, lequel, générateur dans le monde des mots, devient vite détestable quand il s’impose là où sa fonction est originelle, dans l’art figuratif, symbolique d’essence par ses traits, sa surface plane, le convenu de son espace pictural.
C’est pourquoi l’aventure parisienne de Paul Gauguin ne faillit qu’à valoir une bien mauvaise toile, où des accessoires groupés sans rythme ni sérieux: un renard, une noce de campagne, une jeune fille nue, — le tout consommé dans un effort pâteux sous l’annonce «la perte du pucelage», aboutit au rancart dans un grenier. Et plus tard, se souvenant de très loin de cette équipée, Gauguin en esquisse plaisamment le blason: «Une croix, des flammes,... V’lan! ça y est, le Symbolisme! »
Enfin, — et depuis tant de mots cet Hommage ne mène qu’à écrire ceux-ci: Paul Gauguin, âgé de quarante-trois ans, se tourne vers le pays le plus éloigné de tous les continents solides, l’archipel qui poudre les mers du Grand Océan, et parmi les milliers d’îles, choisissant l’Unique, il fait son bagage pour Tahiti.
Pourquoi ce nouveau désir extrême-exotique? ce départ pour le «cinquième monde», ainsi que l’appelaient les grands navigateurs, — après quoi, dirait un hagiographe, il n’est plus d’envolée possible que pour l’autre monde... Malgré les calculs de toutes sortes qui encombrèrent la vie domestique du grand peintre, et sa mort, et ce qui suivit sa mort, on peut du moins lui épargner ici l’injure d’une enquête et s’incliner devant ce fait: il s’embarque, un beau jour, pour la Polynésie.
On dira: instinct, pur instinct. Oui, mais le génie. C’est pourquoi l’instinct fut glorieusement rétribué. C’est pourquoi l’artiste reçut là-bas une plus haute récompense que jamais élève d’un jury: la révélation de sa maîtrise. Ce qui désormais devait être le domaine où bâtir sa maison régnante, fut révélé à Gauguin par Tahiti.
C’est à ce point juste, d’ailleurs, que ressortissent les Lettres qui font le corps de ce livre. C’est à propos de ce départ qu’intervient dans sa vie l’homme qui, plus que tout autre, lui correspondra désormais; — je veux dire en qui il se retrouve, se découvre avec noblesse ou abandon, lassitude ou espoir. Par une bienfaisante fatalité, cet homme est comme lui un artiste indépendant, un «classique », disait Gauguin, sans autre maître que les Maîtres. C’est à cet homme que s’adressent les Lettres publiées ici, et dont le recueil, pour la première fois du genre, eut vraiment mérité ce sous-titre:
Lettres d’un Peintre à un autre Peintre, son ami.
II
GEORGES DANIEL DE MONFREID, à vrai dire, était connu de Gauguin depuis le retour de la Martinique. Les deux peintres avaient d’abord été deux bons marins. Monfreid naviguait pour son plaisir sur une goëlette de trente-six tonneaux, faisant son libre cabotage de Saint-Malo à Port-Vendres, puis en Algérie, puis ailleurs... Mais à terre, il dessinait, accomplissant avec ferveur et gravité cette tâche de donner sa propre vision du monde, qui est à tout le monde. Et Monfreid se trouva parmi les premiers à recevoir de l’œuvre de Gauguin les coups de poing que celui-ci lançait au passage, ou les coups d’épaule qu’il prêtait pour que l’on s’appuyât. On ne peut dire, (et Gauguin, si jaloux de sa maîtrise juste, ne le permettrait pas) que Monfreid en quelque sorte fut élève de Gauguin, — mais qu’il était prêt à en saisir les impulsions libératrices dans toute leur portée, que seuls les plus forts pouvaient atteindre. Et dès lors, Monfreid aperçut, évalua et pesa ce qui était lui-même, et sans jamais subir l’empreinte ni l’emprise écrasante d’un maître meurtrier de toutes les faiblesses, peignit comme il fera jusqu’à la fin de sa vie.
C’est donc de cet un à cet autre que les Lettres, durant douze années, vont s’échanger. L’amitié, établie dès le départ, s’accuse, non pas de jour en jour, car les courriers sont rares. Tous les envois commencent par «Mon cher Daniel...» Daniel est un pseudonyme adopté par Monfreid à ses débuts, et que l’on doit intercaler dans son nom. Mais la formule finale, de la première à la dernière lettre, est en progression de confiance: «Cordialement à tous amis artistes...» — «Poignée de main...» — «Tout à vous...» — «Tout à vous grandement...» — «Tout vôtre, affectueusement...» Et voici qu’au nom de Daniel, Gauguin unit celui d’Annette, «chère à Daniel», et l’image enfantine des jolis cheveux roux «qui broussent dans le jardin...»
Ainsi, à travers une absence si profonde qu’il faut cinq à six mois aux demandes et réponses pour être satisfaites, se nourrit cette double amitié. Des deux côtés, les plus solides vertus de l’artiste. Monfreid, avec un geste de peintre ménager de ses mots, tient Gauguin pour «un grand bonhomme». Gauguin juge son ami un bon juge de ses propres efforts: «Je suis impatient, lui écrit-il, du courrier prochain où vous me parlerez des tableaux que j’ai envoyés: j’ai hâte de savoir si je suis dans l’erreur ou non.» Et encore, s’adressant à un acheteur des Degas, Cézanne, Renoir et de Monfreid : «A l’énumération de votre collection, je vois que je suis en compagnie de maîtres, et cela rend heureux mais aussi bien timide... J’y vois des Daniel. Enfin il y a donc des hommes qui savent apprécier la peinture! Daniel, en outre qu’il est artiste, est la plus belle nature loyale et franche que je connaisse... »
Les deux peintres s’étaient confrontés jusque dans leurs valeurs sociales. Gauguin, au mépris du troupeau des hommes, apportait ce «don magnifique» fait à la multitude par quelques-uns. Monfreid répondait d’un regard aussi net, aussi dur, aussi dépouillé de toutes les écoles et même, en tant qu’homme, possédait plus. Gauguin passa pour un «mufle» un «impudent parasite», un «égoïste», un «monsieur sans-gêne», (épithètes relevées dans les jugements de ses bons amis). Monfreid, de l’accord unanime, fut en cette histoire comme en toutes un parfait gentilhomme. C’est en laissant derrière lui, à l’autre face du monde, ce répondant et ce garant, que Paul Gauguin s’en fut aux îles Pacifiques.
Dès lors, il n’y a de vrai compagnon pour lui que l’antique indigène retrouvé. Monfreid affirme: le seul aveu de Gauguin partant Pour Tahiti fut cette décision répétée, obstinée:
— «Je veux aller chez les sauvages».
Pour toujours il ne cherche plus d’autre confident proche, d’autre spectateur étonné, — ni d’autre spectacle, — que l’homme et que la femme maoris.
III
L’HOMME MAORI ne peut pas s’oublier quand on l’a vu, ni la femme cesser d’être aimée quand on l’aime. Paul Gauguin sut aimer làbas, et voir plus puissamment que tout être avec deux gros yeux ronds, ces vivants ambrés et nus qu’il ne faut point, pour les peindre, comparer à aucune autre espèce humaine. Qu’ils soient bien considérés en eux-mêmes: beaux athlètes aux muscles heureux, harmonieux dans un repos dynamique, avec des jointures de lignes plus souples que nerveuses, un visage au nez bien assis, nettement cerné par l’appuyé du pinceau; des veux... des yeux maoris, proches l’un de l’autre pour augmenter la portée du regard; des yeux à fleur de visage, à fleur de la surface peinte dont ils respectent le plan imaginaire, — mais prêts à fouiller les taillis ou la profondeur, ou bien à happer l’autre regard qui se confie, — des lèvres bleu-de-sang, pleines de chair; — un port auquel un fardeau ne fait peur, mais qui marche en dansant de plaisir à porter son poids seul. Beaux nageurs à travers l’étendue; plongeurs de la mer liquide ou navigateurs des étangs verticaux sur les toiles gonflées par le regard; — musiciens des jours de fêtes; — grands veneurs aux menées de l’amour, et, dans la nuit assoupie, beaux dormeurs, sachant inclure comme un dieu le sommeil en leurs membres, soufflant leur haleine comme un rite.
La femme possède avant toute autre la qualité de l’homme jeune: un bel élancé adolescent qu'elle maintient jusqu’au bord de la vieillesse. Et les divers dons animaux se sont incarnés en elle avec grâce. Ses membres ne sont pas faits des segments que balancent autour de nous les corps de nos âmes dites sœurs. De l’épaule au bout des doigts, la maorie dessine, mouvante ou courbée, une ligne continue. Le volume du bras est très élégamment fuselé. La hanche est discrète et naturellement androgyne. Les hanches ne s’affichent point comme une raison sociale de reproduction, la raison d’être de la femme. La maorie n’est point parente au «petit mammifère» de Laforgue, se dandidant, joyeux de se voir «délesté des kilogs de ses couches». Assez rare chez elle, la maternité est mieux portée. La cuisse est ronde, mais non point grasse; le genou, mince et droit, «regarde bien en face», note Gauguin. Toute la jambe est un autre fuseau mouvant; ou, immobiles, deux puissantes colonnes. Le pied, grand, élastique sur une sandale vivante, sait poser avec grâce. Des cheveux opaques, odorants, à peine ondulés, rejoignent et recouvrent les reins qui pourtant seraient vus sans impudeur. Ils sont nets, dessinés pour progresser, rythmer le plaisir ou la danse. «Epaules vastes et reins étroits»,disait Gauguin, voilà ce qui distingue la femme maorie «d’entre toutes les femmes ».
Cela, pour la joie de l’allure, en course, en marche ou en nage entre deux eaux. D’autres vertus secrètes, pures, mystérieuses révélations du corps à ce moment où il semble que Plus rien n’est à découvrir... Mais ceci n’est pas à dire avec des mots.
Et les yeux ont des phosphorescences; et le cou est parfait de sveltesse et de rondeur; les seins doivent seulement se découvrir très Jeunes, dans une première éclosion sans lendemain. Le ventre stérile est un bouclier de Pureté solide. Mais la femme maorie donne de plus en présent à son maître deux tributs incomparablés: le grain de sa peau, — son haleine.
Nue et fraîche, dépolie comme un cristal éteint, cette peau est le plus beau des manteaux naturels. De four, et sous le soleil qui l’enrichit sans la brûler ni la décomposer, sa couleur propre est ambrée-olivâtre, avec ces reflets verts qui la caractérisent. Cette peau est délicate et délicieuse à la pulpe des doigts; aussi douce que la pulpe des doigts qui se reconnaît en elle et ne souhaite ni plus de tact ni plus grande douceur, — ce qui permet la caresse indéfinie...
Enfin l’haleine. Nourrie de fruits mûrs et de poissons vifs, de peu de viandes, — ou bien légères et cuites selon les recettes naturelles, — la maorie s’exhale toute proche des éléments qu’elle absorba. Mais ceci qui ne peut être peint, n’a que faire en cet Hommage à la seule peinture. Le reste est œuvre d’amant, — qu’il soit lui-même maori, — et son apport est symétrique, — ou bien étranger, accueilli comme un dominateur dont le vouloir est bon et le désir digne d’être reçu.
Ces vivants, d’où venaient-ils? Car toutes les terres polynésiennes étaient peuplées, même surpeuplées si l’on en croit les premiers découvreurs, quand les pilotes européens les piquèrent une à une, comme de beaux insectes condamnés à mourir, sur le liège blanc des cartes. D’où venaient ces hommes et ces femmes? L’origine, peu reculée, est une énigme moins historique d’autrefois qu’un problème d’espace marin. L’espace est immense, le Plus grand du globe. Le périple maori du Grand Océan fut possible si l’on admet des émigrants nombreux, hardis; des chaînes d’îles pas très éloignées; beaucoup de hasards, les courants et les vents portant, et de bonnes pirogues doubles, inchavirables, pontées, avec juste ce qu’il faut de marins et de vivres, et de passagères aussi pour peupler... Comme départ: l’une ou l’autre lèvre, américaine ou asiatique, de la grande cuve. Ecartant l’origine américaine, on pose comme donnée l’ascendance indomalaise. Mais alors, les vents principaux et les courants sont contraires qui mènent de l’Est à l’Ouest et du Sud-est au Noroît. On invoque les contrecourants équatoriaux, les cyclones qui renversent pour un temps l’alizé. On suppute la chance de jonction dans l’espace entre la pirogue errante et l’accore d’une falaise; quelque chose comme la fécondation d’un bolide par les germes que la grandeur des «espaces infinis» n’a pas effrayés ni stérilisés. Mais la sporadisation humaine a ses limites. Et, comme il convient en science de la faune humaine, faisant le calcul ironique des probables, y jetant son idée préconçue, on décide que les habitants de l’actuelle Polynésie s’en sont venus, à travers des centaines d’années et des milliers de milles marins, — de l’archipel malais d’Indonésie.
Peu importe. Ni blancs, ni jaunes, ni noirs, les maoris, pour être peints, même avec des mots, ne se doivent comparer à aucune autre espèce d’hommes. Ils n’ont pas, sous le soleil, la fadeur du nu européen. Ils n’ont pas la faux palpébrale, le «repli mongol», ni les pommettes fortes, ni la femme ce visage en lune ovale. Ils n’ont rien du nègre crépu. Il faut donc, — et le peintre s’y est magnifiquement résolu, les contempler sous leur sauvage énigme, celle qu’ils emporteront dans leur mort prévue, la question totalement humaine:
— D’où venons-nous — qui sommes-nous — où allons-nous?