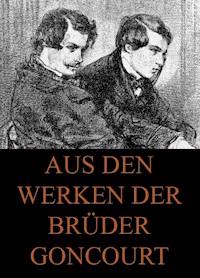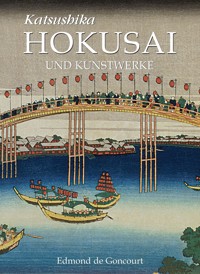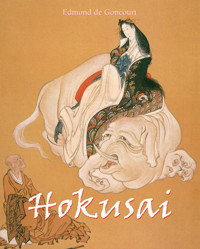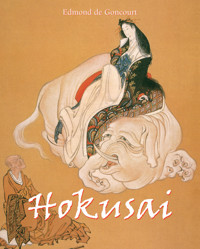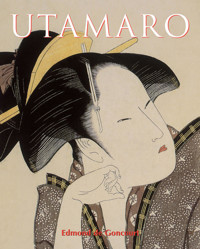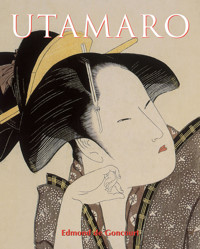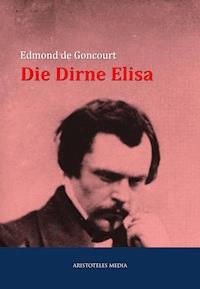Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Manette Salomon est un roman captivant écrit par les célèbres frères Goncourt, Edmond et Jules. Publié en 1867, ce livre nous plonge dans le Paris du XIXe siècle, une époque marquée par les bouleversements politiques et sociaux.
L'histoire tourne autour de Manette Salomon, une jeune femme d'origine modeste qui aspire à une vie meilleure. Elle est prête à tout pour gravir les échelons de la société parisienne, même si cela signifie sacrifier son amour et sa dignité. Manette est un personnage complexe et fascinant, qui nous entraîne dans un tourbillon d'émotions et de rebondissements.
Les frères Goncourt nous offrent une plume raffinée et poétique, décrivant avec minutie les décors somptueux de la haute société parisienne, ainsi que les bas-fonds de la ville. Ils nous dépeignent également les relations humaines, souvent cruelles et hypocrites, mais parfois empreintes de sincérité et de tendresse.
Manette Salomon est un roman qui explore les thèmes de l'ambition, de l'amour, de la trahison et de la quête de soi. Il nous offre une vision réaliste et sans concession de la société de l'époque, tout en nous transportant dans un univers romanesque et envoûtant.
Ce livre est un véritable chef-d'œuvre de la littérature française, salué par la critique et apprécié par les lecteurs du monde entier. Manette Salomon est une lecture incontournable pour tous les amateurs de romans historiques et de récits passionnants.
Extrait : ""Un peu plus loin, grimpait un interne de la Pitié, en casquette, avec un livre et un cahier de notes sous le bras. Et presque à côté de lui, sur la même ligne, un ouvrier en redingote, revenant d'enterrer un camarade au Montparnasse, avait encore, de l'enterrement, trois fleurs d'immortelle à la boutonnière."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 714
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
On était au commencement de novembre. La dernière sérénité de l’automne, le rayonnement blanc et diffus d’un soleil voilé de vapeurs de pluie et de neige, flottait, en pâle éclaircie, dans un jour d’hiver.
Du monde allait dans le Jardin des Plantes, montait au labyrinthe, un monde particulier, mêlé, cosmopolite, composé de toutes les sortes de gens de Paris, de la province et de l’étranger, que rassemble ce rendez-vous populaire.
C’était d’abord un groupe classique d’Anglais et d’Anglaises à voiles bruns, à lunettes bleues.
Derrière les Anglais, marchait une famille en deuil.
Puis suivait, en traînant la jambe, un malade, un voisin du jardin, de quelque rue d’à côté, les pieds dans des pantoufles.
Venaient ensuite : un sapeur, avec, sur sa manche, ses deux haches en sautoir surmontées d’une grenade ; un prince jaune, tout frais habillé de Dusautoy, accompagné d’une espèce d’heiduque à figure de Turc, à dolman d’Albanais ; un apprenti maçon, un petit gâcheur débarqué du Limousin, portant le feutre mou et la chemise bise.
Un peu plus loin, grimpait un interne de la Pitié, en casquette, avec un livre et un cahier de notes sous le bras. Et presque à côté de lui, sur la même ligne, un ouvrier en redingote, revenant d’enterrer un camarade au Montparnasse, avait encore, de l’enterrement, trois fleurs d’immortelle à la boutonnière.
Un père, à rudes moustaches grises, regardait courir devant lui un bel enfant, en robe russe de velours bleu, à boutons d’argent, à manches de toile blanche, au cou duquel battait un collier d’ambre.
Au-dessous, un ménage de vieilles amours laissait voir sur sa figure la joie promise du dîner du soir en cabinet, sur le quai, à la Tour d’argent.
Et, fermant la marche, une femme de chambre tirait et traînait par la main un petit négrillon, embarrassé dans sa culotte, et qui semblait tout triste d’avoir vu des singes en cage.
Toute cette procession cheminait dans l’allée qui s’enfonce à travers la verdure des arbres verts, entre le bois froid d’ombre humide, aux troncs végétants de moisissure, à l’herbe couleur de mousse mouillée, au lierre foncé et presque noir. Arrivé au cèdre, l’Anglais le montrait, sans le regarder, aux miss, dans le Guide ; et la colonne, un moment arrêtée, reprenait sa marche, gravissant le chemin ardu du labyrinthe d’où roulaient des cerceaux de gamins fabriqués de cercles de tonneaux, et des descentes folles de petites filles faisant sauter à leur dos des cornets à bouquin peints en bleu.
Les gens avançaient lentement, s’arrêtant à la boutique d’ouvrages en perles sur le chemin, se frôlant et par moments s’appuyant à la rampe de fer contre la charmille d’ifs taillés, s’amusant, au dernier tournant, des micas qu’allume la lumière de trois heures sur les bois pétrifiés qui portent le belvédère, clignant des yeux pour lire le vers latin qui tourne autour de son bandeau de bronze :
Puis, tous entrèrent un à un sous la petite coupole à jour.
Paris était sous eux, à droite, à gauche, partout.
Entre les pointes des arbres verts, là où s’ouvrait un peu le rideau des pins, des morceaux de la grande ville s’étendaient à perte de vue. Devant eux, c’étaient d’abord des toits pressés, aux tuiles brunes, faisant des masses d’un ton de tan et de marc de raisin, d’où se détachait le rose des poteries des cheminées. Ces larges teintes étalées, d’un ton brûlé, s’assombrissaient et s’enfonçaient dans du noir-roux en allant vers le quai. Sur le quai, les carrés de maisons blanches, avec les petites raies noires de leurs milliers de fenêtres, formaient et développaient comme un front de caserne d’une blancheur effacée et jaunâtre, sur laquelle reculait, de loin en loin, dans le rouillé de la pierre, une construction plus vieille. Au-delà de cette ligne nette et claire, on ne voyait plus qu’une espèce de chaos perdu dans une nuit d’ardoise, un fouillis de toits, des milliers de toits d’où des tuyaux noirs se dressaient avec une finesse d’aiguille une mêlée de faîtes et de têtes de maisons enveloppées par l’obscurité grise de l’éloignement, brouillées dans le fond du jour baissant ; un fourmillement de demeures, un gâchis de lignes et d’architectures, un amas de pierres pareil à l’ébauche et à l’encombrement d’une carrière, sur lequel dominaient et planaient le chevet et le dôme d’une église, dont la nuageuse solidité ressemblait à une vapeur condensée. Plus loin, à la dernière ligne de l’horizon, une colline, où l’œil devinait une sorte d’enfouissement de maisons, figurait vaguement les étages d’une falaise dans un brouillard de mer. Là-dessus pesait un grand nuage, amassé sur tout le bout de Paris qu’il couvrait, une nuée lourde, d’un violet sombre, une nuée de Septentrion, dans laquelle la respiration de fournaise de la grande ville et la vaste bataille de la vie de millions d’hommes semblaient mettre comme des poussières de combat et des fumées d’incendie. Ce nuage s’élevait et finissait en déchirures aiguës sur une clarté où s’éteignait, dans du rose, un peu de vert pâle. Puis revenait un ciel dépoli et couleur d’étain, balayé de lambeaux d’autres nuages gris.
En regardant vers la droite, on voyait un Génie d’or sur une colonne, entre la tête d’un arbre, vert se colorant dans ce ciel d’hiver d’une chaleur olive, et les plus hautes branches du cèdre, planes, étalées, gazonnées, sur lesquels les oiseaux marchaient en sautillant comme sur une pelouse. Au-delà de la cime des sapins, un peu balancés, sous lesquels s’apercevait nue, dépouillée, rougie, presque carminée, la grande allée du jardin, plus haut que les immenses toits de tuile verdâtres de la Pitié et que ses lucarnes à chaperon de crépi blanc, l’œil embrassait tout l’espace entre le dôme de la Salpêtrière et la masse de l’Observatoire : d’abord, un grand plan d’ombre ressemblant à un lavi, d’encre de Chine sur un dessous de sanguine, une zone de tons ardents et bitumineux, brûlés de ces roussissures de gelée et de ces chaleurs d’hiver qu’on retrouve sur la palette d’aquarelle des Anglais ; puis, dans la finesse infinie d’une teinte dégradée, il se levait un rayon blanchâtre, une vapeur laiteuse et nacrée, trouée du clair des bâtisses neuves, et où s’effaçaient, se mêlaient, se fondaient, en s’opalisant, une fin de capitale, des extrémités de faubourgs, des bouts de rues perdues. L’ardoise des toits pâlissait sous cette lueur suspendue qui faisait devenir noires, en les touchant, les fumées blanches dans l’ombre. Tout au loin, l’Observatoire apparaissait, vaguement noyé dans un éblouissement, dans la splendeur féerique d’un coup de soleil d’argent. Et à l’extrémité de droite, se dressait la borne de l’horizon, le pâté du Panthéon, presque transparent dans le ciel, et comme lavé d’un bleu limpide.
Anglais, étrangers, Parisiens, regardaient de là-haut de tous côtés ; les enfants étaient montés, pour mieux voir, sur le banc de bronze, quand quatre jeunes gens entrèrent dans le belvédère.
– Tiens ! l’homme de la lorgnette n’y est pas, fit l’un en s’approchant de la lunette d’approche fixée par une ficelle à la balustrade. Il chercha le point, braqua la lunette : Ça y est ! attention ! se retourna vers le groupe d’Anglais qu’il avait derrière lui, dit à une des Anglaises : Milady, voilà ! confiez-moi votre œil… Je n’en abuserai pas ! Approchez, mesdames et messieurs ! Je vais vous faire voir ce que vous allez voir ! et un peu mieux que ce préposé aux horizons du Jardin des Plantes qui a deux colonnes torses en guise de jambes… Silence ! et je commence !…
L’Anglaise, dominée par l’assurance du démonstrateur, avait mis l’œil à la lorgnette.
– Messieurs ! c’est sans rien payer d’avance, et selon les moyens des personnes !… Spoken here ! Time is money ! Rule Britannia ! All right ! Je vous dis ça, parce qu’il est toujours doux de retrouver sa langue dans la bouche d’un étranger… Paris ! messieurs les Anglais, voilà Paris ! C’est ça !… c’est tout ça… une crâne ville !… j’en suis, et je m’en flatte ! Une ville qui fait du bruit, de la boue, du chiffon, de la fumée, de la gloire… et de tout ! du marbre en carton-papier, des grains de café avec de la terre glaise, des couronnes de cimetière avec de vieilles affiches de spectacle, de l’immortalité en pain d’épice, des idées pour la province, et des femmes pour l’exportation ! Une ville qui remplit le monde… et l’Odéon, quelquefois ! Une ville où il y a des dieux au cinquième, des éleveurs d’asticots en chambre, et des professeurs de tibétain en liberté ! La capitale du Chic, quoi ! Saluez !… Et maintenant ne bougeons plus ! Ça ? milady, c’est le cèdre, le vrai du Liban, rapporté d’un chœur d’Athalie, par M. de Jussieu, dans son chapeau !… Le fort de Vincennes ! On compte deux lieues, mes gentlemen ! On a abattu le chêne sous lequel Saint Louis rendait la justice, pour en faire les bancs de la cour de Cassation… Le château a été démoli, mais on l’a reconstruit en liège sous Charles X : c’est parfaitement imité, comme vous voyez… On y voit les mânes de Mirabeau, tous les jours de midi à deux heures, avec des protections et un passeport… Le Père-Lachaise ! le faubourg Saint-Germain des morts : c’est plein d’hôtels… Regardez à droite, à gauche… Vous avez devant vous le monument à Casimir Périer, ancien ministre, le père de M. Guizot… La colonne de Juillet, suivez ! bâtie par les prisonniers de la Bastille pour en faire une surprise à leur gouverneur… On avait d’abord mis dessus le portrait de Louis-Philippe, Henri IV avec un parapluie ; on l’a remplacé par cette machine dorée : la Liberté qui s’envole ; c’est d’après nature… On a dit qu’on la muselait dans les chaleurs, à l’anniversaire des Glorieuses : j’ai demandé au gardien, ce n’est pas vrai… Regardez bien, mylady, il y a un militaire auprès de la Liberté : c’est toujours comme ça en France… Ça ? c’est rien, c’est une église… Les buttes Chaumont… Distinguez le monde… On reconnaîtrait ses enfants naturels !… Maintenant, mylady, je vais vous la placer à Montmartre… La tour du télégraphe… Montmartre, mons martyrum… d’où vient la rue des Martyrs, ainsi nommée parce qu’elle est remplie de peintres qui s’exposent volontairement aux bêtes chaque année, à l’époque de l’Exposition… Là-dessous, les toits rouges ? ce sont les Catacombes pour la soif, l’Entrepôt des vins, rien que cela, mademoiselle !… Ce que vous ne voyez pas après, c’est simplement la Seine, un fleuve connu et pas fier, qui lave l’Hôtel-Dieu, la Préfecture de Police, et l’Institut !… On dit que dans le temps il baignait la Tour de Nesle… Maintenant, demi-tour à droite, droite alignement ! Voilà Sainte Geneviève… À côté, la tour Clovis… c’est fréquenté par des revenants qui y jouent du cor de chasse chaque fois qu’il meurt un professeur de Droit comparé… Ici, c’est le Panthéon… le Panthéon, milady, bâti par Soufflot, pâtissier… C’est, de l’aveu de tous ceux qui le voient, un des plus grands gâteaux de Savoie du monde… Il y avait autrefois dessus une rose : on l’a mise dans les cheveux de Marat quand on l’y a enterré… L’arbre des Sourds-et-Muets… un arbre qui a grandi dans le silence… le plus élevé de Paris… On dit que quand il fait beau, on voit de tout en haut la solution de la question d’Orient… Mais il n’y a que le ministre des Affaires étrangères qui ait le droit d’y monter !… Ce monument égyptien ? Sainte-Pélagie, milady… une maison de campagne, élevée par les créanciers en faveur de leurs débiteurs… Le bâtiment n’a rien de remarquable que le cachot où M. de Jouy, surnommé « l’Homme au masque de coton », apprivoisait des hexamètres avec un flageolet… Il y a encore un mur teint de sa prose !… La Pitié… un omnibus pour les pékins malades, avec correspondance pour le Montparnasse, sans augmentation de prix, les dimanches et fêtes… Le Val-de-Grâce, pour MM. les militaires… Examinez le dôme, c’est d’un nommé Mansard, qui prenait des casques dans les tableaux de Lebrun pour en coiffer ses monuments… Dans la cour, il y a une statue élevée par Louis XIV au baron Larrey… L’Observatoire… Vous voyez, c’est une lanterne magique… il y a des Savoyards attachés à l’établissement pour vous montrer le Soleil et la Lune… C’est là qu’est enterré Mathieu Laensberg, dans une lorgnette… en long… Et ça… la Salpêtrière, milady, où l’on enferme les femmes plus folles que les autres ! Voilà !… Et maintenant, à la générosité de la société ! lança le démonstrateur de Paris.
Il ôta son chapeau, fit le tour de l’auditoire, dit merci à tout ce qui tombait au fond de sa vieille coiffe, aux gros sous comme aux pièces blanches, salua et se sauva à toutes jambes, suivi de ses trois compagnons qui étouffaient de rire en disant : Cet animal d’Anatole !
Au cèdre, devant un vieux curé qui lisait son bréviaire, assis sur le banc contre l’arbre, il s’arrêta, renversa ce qu’il y avait dans son chapeau sur les genoux du prêtre, lui jeta : Monsieur le curé, pour vos pauvres !
Et le curé, tout étonné de cet argent, le regardait encore dans le creux de sa pauvre soutane, que le donneur était déjà loin.
À la porte du Jardin des Plantes, les quatre jeunes gens s’arrêtèrent.
– Où dîne-t-on ? dit Anatole.
– Où tu voudras, répondirent en chœur les trois voix.
– Qu’est-ce qui en a ? reprit Anatole.
– Moi, je n’ai pas grand-chose, dit l’un.
– Moi, rien, dit l’autre.
– Alors ce sera Coriolis… fit Anatole en s’adressant au plus grand, dont la mise élégante contrastait avec le débraillé des autres.
– Ah ! mon cher, c’est bête… mais j’ai déjà mangé mon mois… je suis à sec… Il me reste à peine de quoi donner à la portière de Boissard pour la cotisation du punch…
– Quelle diable d’idée tu as eue de donner tout cet argent à ce curé ! dit Anatole un garçon aux longs cheveux.
– Garnotelle, mon ami, répondit Anatole, vous avez de l’élévation dans le dessin… mais pas dans l’âme !… Messieurs, je vous offre à dîner chez Gourganson… J’ai l’œil… Par exemple, Coriolis, il ne faut pas t’attendre à y manger des pâtés de harengs de Calais truffés comme à ta société du vendredi…
Et se tournant vers celui qui avait dit n’avoir rien :
– Monsieur Chassagnol, j’espère que vous me ferez l’honneur…
On se mit en marche. Comme Garnotelle et Chassagnol étaient en avant, Coriolis dit à Anatole, en lui désignant le dos de Chassagnol :
– Qu’est-ce que c’est, ce monsieur-là, hein ? qui a l’air d’un vieux fœtus…
– Connais pas… mais pas du tout… Je l’ai vu une fois avec des élèves de Gleyre, une autre fois avec des élèves de Rude… Il dit des choses sur l’art, au dessert, il m’a semblé… Très collant… Il s’est accroché à nous depuis deux ou trois jours… Il va où nous mangeons… Très fort pour reconduire, par exemple… Il vous lâche à votre porte à des heures indues… Peut-être qu’il demeure quelque part, je ne sais pas où… Voilà !
Arrivés à la rue d’Enfer, les quatre jeunes gens entrèrent par une petite allée dans une arrière-salle de crémerie. Dans un coin, un gros gaillard noir et barbu, coiffé d’un grand chapeau gris, mangeait sur une petite table.
– Ah ! l’homme aux bouillons… fit Anatole en l’apercevant.
– Ceci, monsieur, dit-il à Chassagnol, vous représente… le dernier des amoureux !… un homme dans la force de l’âge, qui a poussé la timidité, l’intelligence, le dévouement et le manque d’argent jusqu’à fractionner son dîner en un tas de cachets de consommé… ce qui lui permet de considérer une masse de fois dans la journée l’objet de son culte, mademoiselle ici présente…
Et d’un geste, Anatole montra mademoiselle Gourganson qui entrait, apportant des serviettes.
– Ah ! tu étais né pour vivre au temps de la chevalerie, toi ! Laisse donc, je connais les femmes… j’avance joliment tes affaires, va, farceur ! et il donna un amical renfoncement au jeune homme barbu qui voulut parler, bredouilla, devint pourpre, et sortit.
Le crémier apparut sur le seuil :
– Monsieur Gourganson ! monsieur Gourganson ! cria Anatole, votre vin le plus extraordinaire… à 12 sous !… et des bifteacks… des vrais !… pour monsieur… il indiqua Coriolis qui est le fils naturel de Chevet… Allez !
– Dis donc, Coriolis, fit Garnotelle, ta dernière académie… j’ai trouvé ça bien… mais très bien…
– Vrai ?… vois-tu, je cherche… mais la nature !… faire de la lumière avec des couleurs…
– Qui ne la font jamais… jeta Chassagnol. C’est bien simple, faites l’expérience… Sur un miroir posé horizontalement, entre la lumière qui le frappe et l’œil qui le regarde, posez un pain de blanc d’argent : le pain de blanc, savez-vous de quelle couleur vous le verrez ? D’un gris intense, presque noir, au milieu de la clarté lumineuse…
Coriolis et Garnotelle regardèrent après cette phrase, l’homme qui l’avait dite.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? Anatole, en cherchant dans sa poche du papier à cigarette, venait de retrouver une lettre. Ah ! l’invitation des élèves de Chose… une soirée où l’on doit brûler toutes les critiques du Salon dans la chaudière des sorcières de Macbeth… Il est bon, le post-scriptum : « Chaque invité est tenu d’apporter une bougie… »
Et coupant une conversation sur l’École allemande qui s’engageait entre Chassagnol et Garnotelle : Est-ce que vous allez nous embêter avec Cornélius ?… Les Allemands ! la peinture allemande !… Mais on sait comment ils peignent les Allemands… Quand ils ont fini leur tableau, ils réunissent toute leur famille, leurs enfants, leurs petits enfants… ils lèvent religieusement la serge verte qui recouvre toujours leur toile… Tout le monde s’agenouille… Prière sur toute la ligne… et alors ils posent le point visuel… C’est comme ça ! C’est vrai comme… l’histoire !
– Es-tu bête ! dit Coriolis à Anatole. Ah ça ! dis donc, tes biftecks, pour des biftecks soignés…
– Oui, ils sont immangeables… Attendez… Donnez-moi-les tous… et il les réunit dans une assiette qu’il cacha sous la table. Puis, profitant d’une sortie de la fille de Gourganson, il disparut par une petite porte vitrée au fond de la salle.
– Ça y est, dit-il en revenant au bout d’un instant. Ah ! tu ne connais pas la tradition de la maison… Ici, quand les biftecks ne sont pas tendres, on va les fourrer dans le lit de Gourganson… C’est sa punition… Après ça, c’est peut-être aussi sa santé… J’ai connu un Russe qui en avait toujours un… cru… dans le dos.
– Qu’est-ce qu’on fait à l’hôtel Pimodan ? demanda Garnotelle à Coriolis.
– Mais c’est très amusant, dit Coriolis. D’abord, Boissard est très bon garçon… Beaucoup de gens connus et amusants… Théophile Gautier… la bande de Meissonier… On fait de la musique dans un salon… dans l’autre, on cause peinture, littérature… de tout… Et une antichambre avec des statues… grand genre et pas cher… Un dîner tous les mois… nous avons déboursé chacun six francs pour un couvert en Ruolz… Ça se termine généralement par un punch… Nous avons Monnier qui est superbe ! Il a eu la dernière fois une charge belge, les prenkirs… étourdissante !… Et puis Feuchères, qui fait des imitations de soldat, des histoires de Bridet à se tordre… Un monde bon enfant et pas trop canaille… On bavarde, on rit, on se monte… Tout le monde dit des mots drôles… L’autre jour, en sortant, je reconduisais Magimel le lithographe… Il me dit : « Ah ! comme j’ai vieilli ! Autrefois, les rues étaient trop étroites… je battais les deux murs. Maintenant c’est à peine si j’accroche un volet !… »
– Quel homme du monde ça fait, ce Coriolis ! Il va chez Boissard, excusez ! fit Anatole. Mais tu t’es trompé d’atelier, mon vieux… tu aurais dû entrer chez Ingres… Vous savez, ils sont bons, les Ingres ! ils se demandent de leurs nouvelles ! Plus que ça de genre !
Pour réponse, le grand Coriolis prit avec sa main forte et nerveuse la tête d’Anatole, et fit, en jouant, la menace de la lui coucher dans son assiette.
– Qui est-ce qui a vu le Premier baiser de Chloé, de Brinchard, qui est exposé chez Durand Ruel ? demanda Garnotelle.
– Moi… C’est d’un réussi… dit Anatole Ça ma rappelé le baiser d’Houdon…
– Oh ! un baiser !… lança Chassagnol. Ça, un baiser ! cette machine en bois ! Un baiser, ça ? Un baiser de ces poupées antiques qu’on voit dans une armoire au Vatican, je ne dis pas… Mais un baiser vivant, cela ? Jamais ! non, jamais ! Rien de frémissant… rien qui montre ce courant électrique sur les grands et les petits foyers sensibles… rien qui annonce la répercussion de l’embrassement dans tout l’être… Non, il faut que le malheureux qui a fait cela ne se doute pas seulement de ce que c’est que les lèvres… Mais les lèvres, c’est revêtu d’une cuticule si fine qu’un anatomiste a pu dire que leurs papilles nerveuses n’étaient pas recouvertes, mais seulement gazées, gazées, c’est son mot, par cet épiderme… Eh bien ! ces papilles nerveuses, ces centres de sensibilité fournis par les rameaux des nerfs trijumeaux ou de la cinquième paire, communiquent par des anastomoses avec tous les nerfs profonds et superficiels de la tête… Ils s’unissent, de proche en proche, aux paires cervicales, qui ont des rapports avec le nerf intercostal ou le grand sympathique, le grand charrieur des émotions humaines au plus profond, au plus intime de l’organisme… le grand sympathique qui communique avec la paire vague ou nerfs de la huitième paire, qui embrasse tous les viscères de la poitrine, qui touche au cœur, qui touche au cœur !…
– Neuf heures et demie… Je me sauve, dit Coriolis.
– Je m’en vais avec toi, fit Anatole ; et, sur la porte, son geste appela Garnotelle, comme s’il lui disait : Viens donc !…
Garnotelle voulut se lever, mais Chassagnol le fit rasseoir, en le prenant par un bouton de sa redingote, et il continua à lui exposer la circulation de la sensation du baiser d’une extrémité à l’autre du corps humain.
En ce temps, le temps où ces trois jeunes gens entraient dans l’art, vers l’année 1840, le grand mouvement révolutionnaire du Romantisme qu’avaient vu se lever les dernières années de la Restauration, finissait dans une sorte d’épuisement et de défaillance. On eût cru voir tomber, s’affaisser le vent nouveau et superbe, le souffle d’avenir qui avait remué l’art. De hautes espérances avaient sombré avec le peintre de la Naissance d’Henri IV, Eugène Deveria, arrêté sur son éclatant début. Des tempéraments brillants, ardents, pleins de promesses, annonçant le dégagement futur d’une personnalité, allaient, comme Chassériau, de l’ombre d’un maître à l’ombre d’un autre, ramassant sous les chefs d’école, dont ils essayaient de fusionner les qualités, un éclectisme bâtard et un style inquiet.
Des talents qui s’étaient affirmés, qui avaient eu leur jour d’inspiration et d’originalité, désertaient l’art pour devenir les ouvriers de ce grand musée de Versailles, si fatal à la peinture par l’officiel de ses sujets et de ses commandes, la hâte exigée de l’exécution, tous ces travaux à la toise et à la tâche, qui devaient faire de la Galerie de nos gloires l’école et le Panthéon de la pacotille.
En dehors de ces causes extérieures, les faillites d’avenir, les désertions, les séductions par les commandes et l’argent du budget, en dehors même de l’action, appuyée par la grande critique, des œuvres et des hommes en lutte avec le Romantisme, il y avait pour l’affaiblissement de la nouvelle école des causes intérieures, spéciales, et tenant aux habitudes, à la vie, aux fréquentations des artistes de 1830. Il était arrivé peu à peu que le Romantisme, cette révolution de la peinture, bornée presque à ses débuts à un affranchissement de palette, s’était laissé entraîner, enfiévrer par une intime mêlée avec les lettres, par la société avec le livre ou le faiseur de livres, par une espèce de saturation littéraire, un abreuvement trop large à la poésie, l’enivrement d’une atmosphère de lyrisme.
De là, de ce frottement aux idées, aux esthétiques, il était sorti des peintres de cerveau, des peintres poètes. Quelques-uns ne concevaient un tableau que dans le cadre d’un vague symbolisme dantesque. D’autres, d’instinct germain, séduits par les lieds d’outre-Rhin, se perdaient dans des brumes de rêverie, noyaient le soleil des mythologies dans la mélancolie du fantastique, cherchaient les Muses au Walpurgis. Un homme d’un talent distingué, Ary Scheffer, marchait en tête de ce petit groupe. Il peignait des âmes, les âmes blanches et lumineuses créées par les poèmes. Il modelait les anges de l’imagination humaine. Les larmes des chefs-d’œuvre, le souffle de Gœthe, la prière de saint Augustin, le Cantique des souffrances morales, le chant de la Passion de la chapelle Sixtine, il tentait de mettre cela dans sa toile, avec la matérialité du dessin et des couleurs. Le sentimentalisme, c’était par là que le larmoyeur des tendresses de la femme essayait de rajeunir, de renouveler et de passionner le spiritualisme de l’art.
La désastreuse influence de la littérature sur la peinture se retrouvait à l’autre bout du monde artiste, dans un autre homme, un peintre de prose, Paul Delaroche, l’habile arrangeur théâtral, le très adroit metteur en scène des cinquièmes actes de chronique, l’élève de Walter Scott et de Casimir Delavigne, figeant le passé dans le trompe-l’œil d’une couleur locale à laquelle manquaient la vie, le mouvement, la résurrection de l’émotion.
De tels hommes, malgré la mode du moment et la gloire viagère du succès, n’étaient, au fond, que des personnalités stériles. Ils pouvaient monter un atelier, faire des élèves ; mais la nature de leur tempérament, le principe d’infécondité de leurs œuvres, les condamnaient à ne pas créer d’école. Leur action, restreinte fatalement à un petit cercle de disciples, ne devait jamais s’élever à cette large influence des maîtres qui décident les courants, déterminent la vocation d’avenir d’une génération, font lever le lendemain de l’art des talents d’une jeunesse.
Au-dessous de la grande peinture, parmi les genres créés ou renouvelés par le mouvement romantique, le paysage se débattait, encore à demi méconnu, presque suspect, contre les sévérités du jury et les préjugés du public. Malgré les noms de Dupré, de Cabat, de Huet, de Rousseau qui ne pouvaient forcer les portes du Salon, le paysage n’avait point alors l’autorité, la considération, la place dans l’art qu’il devait finir par conquérir à coups de chefs-d’œuvre. Et ce genre, réputé inférieur et bas, contre lequel s’élevaient les idées du passé, les défiances du présent, n’avait guère de tentation pour le jeune talent indécis dans sa voie et cherchant sa carrière. L’orientalisme, né avec Decamps et Marilhat, paraissait épuisé avec eux. Ce qu’avait essayé de remuer Géricault dans la peinture française semblait mort. On ne voyait nulle tentative, nul effort, nulle audace qui tentât la vérité, s’attaquât à la vie moderne, révélât aux jeunes ambitions en marche ce grand côté dédaigné de l’art : la contemporanéité. Couture ne faisait qu’exposer son premier tableau, l’Enfant prodigue. Et depuis quelques années, il n’y avait guère eu qu’un coloriste sorti des talents nouveaux : un petit peintre de génie naturel, de tempérament et de caprice, jouant avec les féeries du soleil, doué du sentiment de la chair, et né, semblait-il, pour retrouver le Corrège dans une Orientale d’Hugo : Diaz avait apporté, à l’art de 1830 à 1840, sa franche et éblouissante originalité. Mais sa peinture était une peinture indifférente. Elle ne cherchait et ne donnait rien que la sensation de la lumière d’une femme ou d’une fleur. Elle ne parlait à la passion de personne. Toute âme lui manquait pour toucher et retenir à elle autre chose que les yeux.
Dans cette situation de l’art, rejetée, rattachée à la grande peinture par cette lassitude ou ce mépris des autres genres, la génération qui se levait, l’armée des jeunes gens nourris dans la pratique de la peinture historique ou religieuse, allait fatalement aux deux personnalités supérieures et dominantes, aux deux tempéraments extrêmes et absolus qui commandaient dans l’École d’alors aux passions et aux esprits. Ceux-ci demandaient l’inspiration au grand lutteur du Romantisme, à son dernier héros, au maître passionnant et aventureux, marchant dans le feu des contestations et des colères, au peintre de flamme qui exposait en 1839, Cléopâtre, Hamlet et les Fossoyeurs ; en 1840, la Justice de Trajan ; en 1841, l’Entrée des Croisés à Constantinople, un Naufrage, une Noce juive. Mais ce n’était qu’une minorité, cette petite troupe de révolutionnaires qui s’attachaient et se vouaient à Delacroix, attirés par la révélation d’un Beau qu’on pourrait appeler le Beau expressif. La grande majorité de la jeunesse, embrassant la religion des traditions et voyant la voie sacrée sur la route de Rome, fêtaient rue Montorgueil le retour de M. Ingres comme le retour du sauveur du Beau de Raphaël. Et c’est ainsi qu’avenirs, vocations, toute la jeune peinture, à ce moment, se tournaient vers ces deux hommes dont les deux noms étaient les deux cris de guerre de l’art : Ingres et Delacroix.
Anatole Bazoche était le fils d’une femme restée veuve sans fortune, qui avait eu l’intelligence de se faire une position dans une spécialité de la mode presque créée par elle. Entrepreneuse de broderie pour la haute confection, elle avait eu l’imagination de ces nouveautés bizarres qui charmèrent le goût de la Restauration et des premières années du règne de Louis-Philippe : les ridicules à pendants d’acier, les manchons en velours noir avec broderie en soie jaune représentant des kiosques, les boas pour l’exportation, roses, brodés d’argent et recouverts de tulle noir. Au milieu de cela, elle avait eu aussi l’invention des toilettes de féerie : c’était elle qui avait introduit la lame dans les robes de bal, édité les premières robes à étincelles, étonné les bals citoyens des Tuileries avec ces jupes et ces corsages où scintillaient des élytres d’insectes des Antilles. À ce métier de trouveuse d’idées et de dessins, elle gagnait de huit à dix mille francs par an.
Elle mit Anatole au collège Henri IV.
Au collège, Anatole dessina des bonshommes en marge de ses cahiers. Le professeur Villemereux qui s’y reconnut, en le mettant aux arrêts pour cela, lui prédit la potence, une prédiction qui commença à mettre autour d’Anatole le respect contagieux dans les foules pour les grands criminels et les caractères extraordinaires. Puis, plus tard, en le voyant exécuter à la plume, trait pour trait, taille pour taille, les bois de Tony Johannot du Paul et Virginie publié par Curmer, ses camarades prirent pour lui une espèce d’admiration. Penchés sur son épaule, ils suivaient sa main, retenaient leur souffle, pleins de l’attention religieuse des enfants devant ce mystère de l’art : le miracle du trompe-œil. Autour de lui on murmurait tout bas : « Oh ! lui, il sera peintre ! » Il sentait la classe le regarder avec des yeux moitié fiers et moitié envieux, comme si elle le voyait déjà destiné à une carrière de génie.
Son idée d’être peintre lui vint peu à peu de là : de la menace de ses professeurs, de l’encouragement de ses camarades, de ce murmure du collège qui dicte un peu l’avenir à chacun. Sa vocation se dégagea d’une certaine facilité naturelle, de la paresse de l’enfant adroit de ses mains, qui dessine à côté de ses devoirs, sans le coup de foudre, sans l’illumination soudaine qui fait jaillir un talent du choc d’un morceau d’art ou d’une scène de nature. Au fond, Anatole était bien moins appelé par l’art qu’il n’était attiré par la vie d’artiste. Il rêvait l’atelier. Il y aspirait avec les imaginations du collège et les appétits de sa nature. Ce qu’il y voyait, c’était ces horizons de la Bohême qui enchantent, vus de loin : le roman de la Misère, le débarras du lien et de la règle, la liberté, l’indiscipline, le débraillé de la vie, le hasard, l’aventure, l’imprévu de tous les jours, l’échappée de la maison rangée et ordonnée, le sauve qui peut de la famille et de l’ennui de ses dimanches, la blague du bourgeois, tout l’inconnu de volupté du modèle de femme, le travail qui ne donne pas de mal, le droit de se déguiser toute l’année, une sorte de carnaval éternel ; voilà les images et les tentations qui se levaient pour lui de la carrière rigoureuse et sévère de l’art.
Mais, comme presque toutes les mères de ce temps-là, la mère d’Anatole avait pour son fils un idéal d’avenir : l’École polytechnique. Le soir, en tisonnant son feu, elle voyait son Anatole coiffé d’un tricorne, l’habit serré aux hanches, l’épée au côté, avec l’auréole de la Révolution de 1830 sur son costume ; et elle se regardait d’avance passer dans les rues, lui donnant le bras. Ce fut un grand coup quand Anatole lui parla de se faire artiste : il lui sembla qu’elle avait devant elle un officier qui déchirait son uniforme, et tout l’orgueil de son âge mûr s’écroula.
De la troisième jusqu’à la rhétorique, le collégien eut à chaque sortie à batailler avec elle. À la fin, comme il s’arrangeait toujours pour être le dernier en mathématiques, la mère, faible comme une veuve qui n’a qu’un fils, céda et se résigna en gémissant. Seulement, pour préserver autant que possible l’innocence d’Anatole, dans une carrière qui la faisait trembler d’avance par ses périls de toutes sortes, elle demanda à un vieil ami de chercher dans ses connaissances et de lui indiquer un atelier où les mœurs de son fils seraient respectées.
À quelques jours de là, le vieil ami menait le jeune homme chez un élève de David qui s’appelait d’un nom fameux en l’an IX, Peyron, et qui consentait à recevoir Anatole sur le bien qu’on lui en disait.
Il y avait bien un embarras : l’atelier de M. Peyron était un atelier de femmes, mais d’âge si vénérable, sans aucune exception, qu’Anatole put y faire son entrée sans intimider personne. Il se trouva même, à la fin du troisième jour, occuper si peu ces respectables demoiselles, qu’il se sentit humilié dans sa qualité d’homme, et déclara péremptoirement le soir à sa mère qu’il ne voulait plus retourner dans une pareille pension de Parques.
Il entrait alors chez le peintre d’histoire Langibout, qui avait rue d’Enfer un atelier de soixante élèves. Il montait d’abord chez un élève nommé Corsenaire, qui travaillait dans le haut de la maison. Il y restait six mois à dessiner d’après la bosse ; puis redescendait dans le grand atelier d’en bas, pour dessiner d’après le modèle vivant.
Il trouvait là Coriolis et Garnotelle entrés dans l’atelier depuis deux ou trois ans.
L’atelier de Langibout était un immense atelier peint en vert olive. Sur le mur d’un des côtés, sous le jour de la baie ouverte en face, se dressait la table à modèle, avec la barre de fer où s’attache la corde pour la pose des bras levés en l’air, les talonnières pour supporter le talon qui ne pose pas, le T en cuir verni où s’appuie le bras qui repose.
Une boiserie montait tout le long de l’atelier, à une hauteur de sept à huit pieds. Des grattages de palette, des adresses de modèles, des portraits-charges la couvraient presque entièrement. Un faux-col sur un pantalon représentait les longues jambes de l’un ; un bilboquet caricaturait la grosse tête de l’autre ; un garde national sortant d’une guérite par une neige qui lui argentait le nez et les épaulettes, moquait les ambitions miliciennes de celui-ci. Un gentilhomme amateur était représenté dans un bocal, sous la figure d’un cornichon, avec la devise au-dessous : Semper viret. Et çà et là, à travers les caricatures éparses, semées au hasard, on lisait : Sarah Levy, la tête, rien que la tête, rue des Barres-Saint-Paul ; et plus loin : Armand David, fifre sous Louis XVI, modèle de torse, fait la canne.
Sur une des parois latérales se levait le Discobole, moulage de Jacquet.
Les sculpteurs et les peintres, au nombre d’environ soixante, les sculpteurs avec leurs sellettes et leurs terrines à terre, les peintres, juchés sur de hauts tabourets, formaient trois rangs devant la table à modèle.
On voyait là ;
Javelas, « l’homme aux bouillons », le patito de mademoiselle Gourganson, le pâtira, le souffre-douleur de l’atelier, un méridional naïf, un gobeur avalant tout, et qu’on avait décidé à promener son chapeau gris la nuit, en lui affirmant que le clair de lune était le meilleur blanchisseur des castors ; Javelas, auquel Anatole, en lui rognant un peu sa canne tous les jours, arriva au bout d’une semaine à persuader qu’il grandissait, et qu’il n’avait que le temps de se soigner, la croissance à son âge étant toujours un signe de maladie ; Javelas, qui était sculpteur, et qui avait pour spécialité les sujets de piété.
Lestonnat, aux cheveux en broussaille enflammée, aux yeux clignotants, aux cils d’albinos ; Lestonnat ne voyant des couleurs, que le blond et la tendresse, faisant des esquisses laiteuses et charmantes, peintre-né des mythologies plafonnantes ;
Grandvoinet, un maigre garçon qu’on appelait Moins-Cinq, à cause de sa réponse aux arrivants, qui le trouvaient toujours le premier à l’atelier, et lui disaient : Tiens, il est l’heure ? Non, messieurs, il est l’heure moins cinq minutes. Grand acheteur de gravures du Poussin, excellent et doux garçon, n’entrant en colère que lorsque le modèle avait oublié de poser son mouchoir sur le tabouret, et volait ainsi quelques secondes à la pose ; le type du fruit sec exemplaire, dont l’application, la vocation ingrate, l’effort désespéré étaient respectés avec une sorte de commisération par la blague de ses camarades ;
Le grand Lestringant, derrière le dos duquel Langibout s’arrêtait, étonné et souriant d’un détail exagéré ou forcé dans une académie bien dessinée : « C’est bien, lui disait-il, vous voyez comme cela, c’est bien, mon ami, vous voyez comique… » Lestringant, qui devait obéir à sa vraie vocation, abandonner bientôt l’histoire pour mettre l’esprit de Paris dans la caricature ;
Le petit Deloche, joli gamin, la mine spirituelle et effrontée, arrivant la casquette en casseur, la blouse tapageuse, engueulant les modèles, faisant le crâne : il n’y avait pas trois mois qu’arrivant de son collège et de sa province dans des habits de première communion rallongés, et tombant dans l’atelier, au milieu d’une séance de modèle de femme, il était resté pétrifié devant « la madame » toute nue, ses yeux de petit garçon démesurément ouverts, les bras ballants, et laissant glisser de stupéfaction son carton par terre, au milieu du rire homérique des élèves ;
Rouvillain, un nomade, qui, dès qu’il avait pu réunir vingt francs, donnait rendez-vous à l’atelier pour qu’on lui fît la conduite jusqu’à la barrière Fontainebleau : de là, il s’en allait d’une trotte aux Pyrénées, frappant à la porte du premier curé qu’il trouvait le premier soir, lui faisant une tête de vierge ou une petite restauration, emportant une lettre pour un curé de plus loin ; et, de recommandations en recommandations, de curé en curé, gagnant la frontière d’Espagne, d’où il revenait à Paris par les mêmes étapes ;
Garbuliez, un Suisse, fils d’un cabinotier de Genève ; qui avait rapporté de son pays le culte de son compatriote Grosclaude, et la charge du peintre Jean Belin chez le Grand-Turc ;
Malambic « et son sou de fusain », ainsi nommé par l’atelier, à cause de ses interminables jambes, éternellement enfermées dans un pantalon noir, et si justement comparées aux deux bâtons de charbon que les papetiers donnent pour un sou ;
Massiquot, beau d’une beauté antique, le front bas avec les cheveux frisés à la ninivite, des traits d’Antinoüs avec un sourire de Méphistophélès ; un garçon qui avait l’étoffe d’un grand sculpteur, mais dont le temps et le talent allaient se perdre dans la gymnastique, les tours de force, les excès d’exercice auxquels l’entraînait l’orgueil du développement de son corps ; Massiquot, le massier des élèves ;
Lemesureur, le massier de l’atelier, l’intermédiaire entre le maître et les élèves, l’homme de confiance du patron, qui reçoit la contribution mensuelle, écrit aux modèles, surveille le mobilier, et fait payer les tabourets et les carreaux cassés ; Lemesureur, ancien huissier de Montargis, marié à une repriseuse de cachemire, et qui faisait, dans l’atelier, un petit commerce, en achetant dix francs les têtes bien dessinées qu’il revendait à des pensionnats comme modèles ;
Schulinger, un Alsacien à tournure de caporal prussien, grand bredouilleur de français, qui brossait de temps en temps, entre deux saouleries de bière, une figure rappelant le gris argentin de Velasquez ;
Blondulot, un petit vaurien de Paris, pris en sevrage par un amateur braque très connu qui, de temps en temps croyait découvrir un Raphaël dans quelque peintriot comme Blondulot, dont il surveillait les mœurs avec une jalousie intéressée de mère d’actrice, et qu’il allait recommander aux critiques, en disant : « Il est pur ! c’est un ange !… »
Jacquillat, qui n’avait aucun talent, mais que Langibout soignait : c’était le fils de ce Jacquillat qui avait donné des leçons de tour à M. de Clarac et qui exécutait l’étoile à huit cercles ;
Montariol, le mondain, qui déjeunait souvent dans les crémeries avec les domestiques des bals dont il sortait, le monsieur bien mis à l’atelier ; mais ayant dans ses élégances des solutions de continuité et des accrocs, et regardant l’heure à une montre dont le verre avait été recollé avec de la cire à cacheter ;
Lamoize, aux cheveux ras, au blanc de l’œil bleu, au teint indien, toujours serré dans un habit noir râpé ; un liseur, un républicain, un musicien, qui faisait de la peinture à idées ;
Dagousset, le louche, qui faisait loucher tous les yeux qu’il peignait par cette tendance singulière et fatale qu’ont presque tous les artistes à refléter dans leurs œuvres l’infirmité marquante de leur personne.
Puis c’était « Système », Système, auquel on ne connaissait de nom que ce sobriquet ; Système, peignant, à cloche-pied, la main gauche tenant la palette, appuyée sur une tringle de fer ; Système posant sur son bras, dont il retroussait la manche, le ton de chair pris sur sa palette, et l’approchant du modèle pour le comparer ; Système qui partageait avec Javelas le rôle de martyr de l’atelier.
Et l’atelier Langibout possédait encore les deux types du cuveur et du rêveur dans le peintre Vivarais et le sculpteur Romanet. Vivarais était l’homme qui passait sa vie à « s’imprégner » sans presque jamais peindre ; et c’était Romanet qui disait un jour, sur le pas de sa porte à Anatole : Vois-tu, mon cher, pour mon buste, il fallait le marbre… Pourquoi pas en terre ? c’est si long, le marbre… Non… je n’aurais pas eu la ligné rigide, le cassant du trait… Ça aurait été toujours mou, veule… Il me fallait le marbre, absolument le marbre… Eh bien ! laisse-moi le voir… Je t’assure, je n’en parlerai pas… Mon marbre ? mon marbre ? Il est là… lui dit Romanet en se touchant le front.
Pêle-mêle étrange de talents et de nullités, de figure sérieuses et grotesques, de vocations vraies et d’ambitions de fils de boutiquiers aspirant à une industrie de luxe ; de toutes sortes de natures et d’individus, promis à des avenirs si divers, à des fortunes si contraires, destinés à finir aux quatre coins de la société et du monde, là où l’aventure de la vie éparpille les jeunesses et les promesses d’un atelier, dans un fauteuil à l’Institut, dans la gueule d’un crocodile du Nil, dans une gérance de photographie, ou dans une boutique de chocolatier de passage !
Anatole était devenu immédiatement le boute-en-train de l’atelier, le « branle-bas » des farces et des charges.
Il était né avec des malices de singe. Enfant, lorsqu’on le ramenait au collège, il prenait tout à coup sa course à toutes jambes, et se mettait à crier de toutes les forces de sa voix de crapaud : « v’là la révolution qui commence ! » La rue s’effarait, les boutiquiers se précipitaient sur leurs portes, les fenêtres s’ouvraient, des têtes bouleversées apparaissaient, et dans le dos des vieilles gens qui se faisaient un cornet de leur main pour entendre le tocsin de Saint-Merry, le frisson du rentier passait. Malheureusement, à sa troisième tentative, il fut dégoûté du plaisir que lui donnait tout ce sens dessus dessous par un énorme coup de pied d’épicier philippiste de la rue Saint-Jacques. Au collège, c’était les mêmes niches diaboliques. Un professeur, dont il avait à se plaindre, ayant eu l’imprudence à une distribution de prix, de commencer son discours par : « Jeunes athlètes qui allez entrer dans l’arène… » Vive la renie ! se mit à crier Anatole en se tournant vers la reine Marie-Amélie venant voir couronner ses fils. Sur ce calembour, une acclamation trois fois répétée partit des bancs, et le malheureux professeur fut obligé de remettre son éloquence dans sa poche.
Avec l’âge et la sortie du collège, cette imagination de drôlerie n’avait fait que grandir chez Anatole. Le sens du grotesque l’avait mené au génie de la parodie. Il caricaturait les gens avec un mot. Il appliquait sur les figures une profession, un métier, un ridicule qui leur restait. À des fusées, à des cascades de bêtises, il mêlait des cinglements, des claquements de ripostes pareils à ces coups de fouet avec lesquels les postillons enlèvent un attelage. Il jouait avec la grammaire, le dictionnaire, la double entente des termes : la mémoire de ses études lui permettait de jeter dans ce qu’il disait des lambeaux de classiques, de remuer à travers ses bouffonneries de grands noms, des vers dérangés, du sublime estropié ; et sa verve était un pot-pourri, une macédoine, un mélange de gros sel et de fin esprit, la débauche la plus folle et la plus cocasse.
Dans les parties, le soir, en revenant dans les voitures des environs de Paris, il faisait un personnage de province ; il improvisait des récits de petite ville, il racontait des intérieurs où il y a des oranges sur des timbales, il inventait des sociétés pleines de nez en argent, tout un monde qu’il semblait mener de Monnier à Hoffmann, au grand amusement et dans le rire fou de ses compagnons de voyage. Il avait la vocation de l’acteur et du mystificateur. Sa parole était soutenue par son jeu, une mimique de méridional la succession et la vivacité des expressions, des grimaces, dans un visage souple comme un masque chiffonné, se prêtant à tout, et lui donnant l’air d’une espèce d’homme aux cent figures. À ce tempérament de comique, à tous ces dons de nature, il joignait encore une singulière aptitude d’imitation, d’assimilation de tout ce qu’il entendait, voyait au théâtre, et partout, depuis l’intonation de Numa jusqu’au coup de jupe d’une danseuse espagnole piaffant une cachucha, depuis le bégaiement de Mijonnet, le marchand de tortillons de l’atelier, jusqu’au jeu muet du monsieur qui cherche sa bourse en omnibus. À lui tout seul, il jouait une scène, une pièce : c’était le relai d’une diligence, le piétinement des garçons d’écurie, les questions des voyageurs endormis, l’ébranlement des chevaux, le : hu ! du postillon ; ou bien une messe militaire, le Dominus vobiscum chevrotant du vieux prêtre, les répons criards de l’enfant de chœur, le ronflement du serpent, les nasillements des chantres, le son voilé des tambours, la toux du pair de France sur la tombe du mort. Il singeait un grand air d’opéra, un ut de ténor. Il contrefaisait le réveil d’une basse-cour, la fanfare fêlée du coq, les gloussements, les cacardements, les roucoulements, tous les caquetages gazouillants des bêtes qui semblaient s’éveiller sous sa blouse. Des journées qu’il passait au Jardin des Plantes à étudier les animaux, il rapportait leur voix, leur chant. Quand il voulait, son larynx devenait une ménagerie : il faisait sortir, comme d’une gorge de l’Atlas, le rauquement du lion, un rugissement si vrai, que, la nuit, Jules Gérard eût tiré dessus au jugé. Pour les bruits humains, il les possédait tous. Il imitait les accents, les patois, les bruits de la rue, le chantonnement de la marchande de vieux chapeaux, la criée de la marchande de « bonne vitelotte », le cri du vendeur de canards s’éteignant dans le lointain d’un faubourg, tous les cris : il n’y avait que le cri de la conscience qu’il disait ne pouvoir imiter.
L’atelier avait en lui son amuseur et son fou, un fou dont il n’aurait pu se passer. Au bout de ces grands silences de travail qui se font là, après un long recueillement de tous ces jeunes gens pliés sur une étude, quand une voix s’élevait : « Allons ! qu’est-ce qui va faire un four ? » Anatole lançait aussitôt quelque mot drôle, faisant courir le rire comme une traînée de poudre, secouant la fatigue de tous, relevant toutes les têtes de dessus les cartons, et sonnant jusqu’au bout de la salle une récréation d’un moment.
Jamais il n’était à court. L’atelier avait-il une vengeance à exercer ? Anatole trouvait un tour de son invention, et le plus souvent, à la prière de ses camarades et pour répondre à leur confiance, il l’exécutait lui-même. Devait-on faire la réception d’un nouveau ? Il s’en chargeait, et c’était son triomphe. Il s’y surpassait en fantaisie, en imagination de mise en scène.
Le reste de crucifiement, la tradition de torture, demeurés d’un autre temps, dans ces farces artistiques, l’attachement à l’échelle, l’estrapade, la brutalité de ces exécutions qui parfois finissaient par un membre brisé, commençaient à passer de mode dans les ateliers. À peine si l’usage des férocités anciennes était encore conservé chez le sculpteur David, dont les élèves promenaient, en ces années, par tout le quartier, un nouveau lié sur une échelle, avec un camarade, à cheval sur l’estomac, qui jouait de la guitare. Les initiations peu à peu s’adoucissaient et se changeaient en innocentes épreuves de franc-maçonnerie. Anatole les renouvela par le sérieux de la charge et la comédie de la cruauté.
Aussitôt qu’un nouveau arrivait, il commençait par le faire déshabiller, lui injuriait successivement tous les membres, lui reprochait ses « abattis canaille », établissait, avec la voix de pituite de Quatremère de Quincy, le peu de rapports existants entre une figure de Phidias et cet « Apollon des chaudronniers ». Puis, il le faisait chanter, en costume de paradis, dans des poses d’un équilibre périlleux, des paroles impossibles sur des airs dont il avait le secret. Quand le nouveau était enroué et enrhumé, Anatole lui annonçait les supplices. Soudain, il changeait de voix, d’air, de visage : il avait des gestes d’ogre de contes de fée, une intonation de roi de féerie qui donne des ordres pour une exécution, des ricanements de Schahabaham. Une paillasserie sinistre l’animait : c’était Bobèche et Torquemada, l’Inquisition aux Funambules. S’agissait-il de marquer un récalcitrant ? Il était terrible à fourgonner le poêle pour chauffer les fers tout rouge, terrible quand avec les fers, changés habilement dans sa main en chevilles de sculpteur peintes en vermillon, il approchait ; terrible, lorsqu’il essayait ces faux fers, derrière le dos du patient, quatre ou cinq fois sur des planches, pendant qu’on brûlait de la corne ; épouvantable, lorsqu’il les appliquait sur l’épaule du malheureux avec un pschit ! qui jouait infernalement le cri de la peau grillée. On riait, et il faisait presque peur. Et puis, venaient des boniments, des discours de réception, des morceaux académiques, du Bossuet tombé dans le Tintamarre… Pour chaque nouveau, il inventait un nouveau tour, des plaisanteries inédites, un chef-d’œuvre comme les sangsues, la farce des sangsues qu’il montrait à sa victime dans un verre, et qu’il lui posait au creux de l’estomac : la victime plaisantait d’abord, puis ne plaisantait plus : elle se figurait sentir piquer les sangsues, tant Anatole les avait bien imitées avec des découpures d’oignon brûlé !
À l’atelier, on l’appelait « la Blague ».
La Blague, cette forme nouvelle de l’esprit français, née dans les ateliers du passé, sortie de la parole imagée de l’artiste, de l’indépendance de son caractère et de sa langue, de ce que mêle et brouille en lui, pour la liberté des idées et la couleur des mots, une nature de peuple et un métier d’idéal ; la Blague, jaillie de là, montée de l’atelier, aux lettres, au théâtre, à la société ; grandie dans la ruine des religions, des politiques, des systèmes, et dans l’ébranlement de la vieille société, dans l’indifférence des cervelles et des cœurs, devenue le Credo farce du scepticisme, la révolte parisienne de la désillusion, la formule légère et gamine du blasphème, la grande forme moderne, impie et charivarique, du doute universel et du pyrrhonisme national ; la Blague du XIXe siècle, cette grande démolisseuse, cette grande révolutionnaire, l’empoisonneuse de foi, la tueuse de respect ; la Blague, avec son souffle canaille et sa risée salissante, jetée à tout ce qui est honneur, amour, famille, le drapeau ou la religion du cœur de l’homme ; la Blague, emboîtant le pas derrière l’Histoire de chaque jour, en lui jetant dans le dos l’ordure de la Courtille ; la Blague, qui met les gémonies à Pantin ; la Blague, le vis comica de nos décadences et de nos cynismes, cette ironie où il y a du rictus de Stellion et de la goguette du bagne, ce que Cabrion jette à Pipelet, ce que le voyou vole à Voltaire, ce qui va de Candide à Jean Hiroux ; la Blague, qui est l’effrayant mot pour rire des révolutions ; la Blague, qui allume le lampion d’un lazzi sur une barricade ; la Blague, qui demande en riant au 24 Février, à la porte des Tuileries : « Citoyen, votre billet ! », la Blague, cette terrible marraine qui baptise tout ce qu’elle touche avec des expressions qui font peur et qui font froid ; la Blague, qui assaisonne le pain que les rapins vont manger à la Morgue ; la Blague, qui coule des lèvres du môme et lui fait jeter à une femme enceinte : « Elle a un polichinelle dans le tiroir ! » la Blague, où il y a le nil admirari qui est le sang-froid du bon sens du sauvage et du civilisé, le sublime du ruisseau et la vengeance de la boue, la revanche des petits contre les grands, pareille au trognon de pomme du titi dans la fronde de David ; la Blague, cette charge parlée et courante, cette caricature volante qui descend d’Aristophane par le nez de Bouginier ; la Blague, qui a créé en un jour de génie Prudhomme et Robert Macaire ; la Blague, cette populaire philosophie du : « Je m’en fiche ! » le stoïcisme avec lequel la frêle et maladive race d’une capitale moque le ciel, la Providence, la fin du monde, en leur disant tout haut : « Zut ! » la Blague, cette railleuse effrontée du sérieux et du triste de la vie avec la grimace et le geste de Pierrot ; la Blague, cette insolence de l’héroïsme qui a fait trouver un calembour à un Parisien sur le radeau de la Méduse ; la Blague, qui défie la mort ; la Blague, qui la profane ; la Blague, qui fait mourir comme cet artiste, l’ami de Charlet, jetant, devant Charlet, son dernier soupir dans le couic de Guignol ; la Blague, ce rire terrible, enragé, fiévreux, mauvais, presque diabolique, d’enfants gâtés, d’enfants pourris de la vieillesse d’une civilisation ; ce rire riant de la grandeur, de la terreur, de la pudeur, de la sainteté, de la majesté, de la poésie de toute chose ; ce rire qu’on dirait jouir du bas plaisir de ces hommes en blouse, qui, au Jardin des Plantes, s’amusent à cracher sur la beauté des bêtes et la royauté des lions ; la Blague, c’était bien le nom de ce garçon.
L’atelier ouvrait le matin de six heures à onze heures en été, de huit heures à une heure en hiver. Le mercredi, il y avait une prolongation de travail d’une heure « l’heure du torse », pour finir le torse commencé la veille : heure supplémentaire payée par la cotisation des élèves. Trois semaines de modèle d’homme, une semaine de modèle de femme, faisaient le mois.
Pendant ces cinq heures d’étude quotidienne, pendant ce travail d’après nature se continuant des mois, des années, Anatole vit défiler les plus beaux corps du temps, l’humanité de choix qui sert de leçon à l’artiste, les statues vivantes qui conservent les lois de proportion, le canon de l’homme et de la femme, les types qui dessinent le nu viril ou féminin, l’élégance ou la force, la délicatesse ou la puissance, les lignes avec leurs oppositions, les contours avec leur sexe, les formes avec leur style.
Anatole dessina : il fit la longue éducation de son œil et de son fusain ; il apprit à bâtir une académie d’après tous ces corps fameux qui ont laissé leur mémoire dans les tableaux de l’époque : le corps de Dubosc, ce corps merveilleux de cinquante-cinq ans, qui avait conservé la souplesse et l’harmonieux équilibre de la jeunesse ; le corps de Gilbert, ce corps tout plein des trous d’une sculpture à la Puget, de Gilbert, le modèle pour les satyres, les convulsionnaires, les ardents. Il dessina d’après ce corps de Waill, le corps d’un éphèbe florentin, le torse ciselé, les pectoraux accusés sur l’adolescence de la poitrine, les jambes fines et montrant la souple élégance, la longueur filante d’un dessin italien du seizième siècle, des formes de cire sur des muscles d’acier ; le corps de Thomas l’Ours, cet ancien lutteur de Lyon, renvoyé de son régiment à cause de son appétit, le vorace qui prenait son café au lait dans une terrine de sculpteur avec un pain de six livres, et que nourrissaient par commisération les domestiques de Rothschild ; un corps de damné de Michel-Ange, les épaules d’Atlas, une musculature de Crotoniate et d’animal dévorateur où les mouvements faisaient courir des houles sous la peau. Anatole eut encore les corps de grâce sauvage, nerveux, ondulants, élastiques, du nègre Saïd, du nègre Joseph de la Martinique, le nègre à la taille de femme, aux bras ronds, qui charmait les fatigues de sa pose par des monologues à demi-voix, gazouillés dans la langue de son pays. Il eut la fin de ces modèles héroïques, à constitution homérique, formés dans l’atelier de David, la poitrine élargie comme à l’air de ces grandes toiles antiques ; vieux débris d’un Empire de l’art, auxquels l’atelier ne manquait jamais de faire la charité d’habitude avec les vieux modèles, ce qu’on appelle « un cornet », une feuille de papier tournée par un des nouveaux, qui circule, et où chacun met le fond de sa poche.