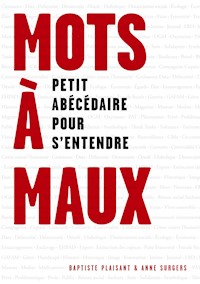
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Les mots voyagent, sont empruntés, adoptés. Certains tombent en désuétude. D'autres apparaissent et deviennent d'usage courant, comme "banlieues", "bienveillance", innovation" ou "vivre-ensemble". Des mots que chacun emploie, entend ou lit chaque jour. Des mots banals, qui ne fâchent pas. Pourtant les mots ne sont ni anodins, ni innocents. Certains pourraient fâcher, si l'on se posait les questions suivantes: disent-ils ce que la chose est? Ce que l'on croit qu'elle est? Ce que l'on veut qu'elle soit? ou ce que l'on fait croire qu'elle est? Le Petit Abécédaire pour s'entendre apportera, nous l'espérons, quelques réponses à ces questions: c'est un voyage à l'écoute des mots, de leur histoire et de leurs usages, pour entendre ce qu'ils disent aujourd'hui en sourdine, quand leur sens est détourné, quand ils servent à taire plus qu'à dire, ou à faire taire, souvent à notre insu. Ecoutons-les. Pour bien s'entendre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOMMAIRE
POUR BIEN S'ENTENDRE
ENTRÉES
Acronyme
Algorithme
banlieues (Les)
Bienveillance
Chamailleur
voir
Registres déplacés
Cible
Co-construction. Co-construire
Commun. Banal
communauté internationale (La)
Compagnon. Copain
voir
Vivre-ensemble
Concorde
voir
Tolérance
contrefoutre (Se)
voir
Registres déplacés
Convivialité
voir
Vivre-ensemble
Cordialement. Bien à vous
Crime contre l’humanité (
voir aussi entrée
Extinction des espèces)
croissance (La)/ décroissance (La) (
voir aussi entrée
Économie)
Data/Données (
voir aussi entrée
GAFAM)
Déconner
voir
Registres déplacés
défavorisés (Les)
Démocratie
désolé (Je suis)
Diabolique
voir
Symbole
Distanciation sociale
Droit à l’enfant
Écologie. Écologiste
économie (L’) (
voir aussi entrées
Croissance
et
Écologie)
Égards
voir
Bienveillance
élites (Les)
Ensauvagement
voir
Registres déplacés
Esclavage
EHPAD (
voir aussi entrée
Acronyme)
experts (Les) (
voir aussi entrées
Think tanks
et
Sachants)
Extinction des espèces
Faire (la Thaïlande, les Seychelles, etc.)
Fraternité (
voir aussi entrées
Solidarités
et
Vivre-ensemble)
Fraude fiscale
GAFAM (Les) (
voir aussi entrées
Acronyme
et
Data/Données)
Gazette
voir
Medias
Gérer
handicapé (Un)
Histoire. Historique. Story
Image (
voir aussi entrée
Symbole)
Incarnation. Incarner
influenceurs (Les). influenceuses (Les)
Innovation. Nouveau
Intime
voir
Privé
invisibles (Les)
IVG (
voir aussi entrée
Acronyme)
Jargon (
voir aussi entrée
Acronyme)
Journal
voir
Medias
LBD (
voir aussi entrée
Acronyme)
LGBT (
voir aussi entrée
Acronyme)
Magazine
voir
Medias
Maman / maman (La) (
voir aussi entrées
Bienveillance, Handicapé
et
Privé-Intime/Public)
medias (Les) / Gazette, Journal, Magazine, Presse
Médicament
voir
Traitement
migrant (Un)
MST (
voir aussi entrée
Acronyme)
mode x (Être en, Se mettre en)
Mort
(voir aussi entrées
Vieux
et
EHPAD)
Nouveau
voir
Innovation
OGM (
voir aussi entrée
Acronyme)
Oxymores inaperçus. Pléonasmes inutiles
PAT (
voir aussi entrée
Acronyme)
Privé, Intime/Public
problématique (Une)
Proie
voir
Victime
Public
voir
Privé
Registres déplacés, inconvenants, incongrus
Réseau social
Revivez (le match, etc.) Vivez le
live
. En
live
sachants (Les) (
voir aussi entrée
Experts)
SIDA, MERS, SRAS, COVID (
voir aussi entrée
Acronyme)
Soin
voir
Traitement
solidarités (Les) (
voir aussi entrées
Fraternité
et
Vivre-ensemble)
Symbole, symbolique
Think Tanks (
voir aussi entrée
Élites)
Tolérance (
voir aussi entrée
Vivre-ensemble)
Traitement / Médicament, Remède, Soin / Prise en charge
Victime
Vieux (
voir aussi entrées
EHPAD
et
Mort)
vivre-ensemble (Le) (
voir aussi entrées
Fraternité
et
Tolérance)
CONCLUSION : « LES MOTS NE MENTENT PAS »
ÉPILOGUE
Ambrogio LORENZETTI,
Allegoria ed Effetti del buon e cattivo Governo
Michel de MONTAIGNE,
Essais
, « Des cannibales » (I, 31)
Charlie CHAPLIN,
The Great Dictator
, 1940, discours final
Georges BRASSENS, « Quand les cons sont braves »
IAM, « Petit Frère »
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Dictionnaires
Ouvrages
Articles
Sitographie
Filmographie. Vidéographie
Podcast
REMERCIEMENTS
Pour Edmée, pour Gaspard et pour les enfants du monde
Si les signes vous fâchent, o quant vous fâcheront les choses signifiées.
RABELAIS, Tiers Livre, chap. 20
Notre parler a ses faiblesses et ses défauts, comme tout le reste. La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes.
MONTAIGNE, Essais, II, 12, Apologie de Raimond Sebond
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789, art. 1er
Bon appétit ! messieurs ! – O ministres intègres ! Conseillers vertueux ! voilà votre façon De servir, serviteurs qui pillez la maison ! Donc vous n’avez pas honte et vous choisissez l’heure, L’heure sombre où l’Espagne agonisante pleure ! Donc vous n’avez ici pas d’autres intérêts Que d’emplir votre poche et vous enfuir après ! Soyez flétris, devant votre pays qui tombe, Fossoyeurs qui venez le voler dans sa tombe ! […] Et vous osez !... – Messieurs, en vingt ans, songez-y, Le peuple, – j’en ai fait le compte, et c’est ainsi ! Portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, Pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, Le peuple misérable, et qu’on pressure encor, A sué quatre cent trente millions d’or ! Et ce n’est pas assez ! et vous voulez, mes maîtres ! Ah ! j’ai honte pour vous !
Victor HUGO, Ruy Blas, 1838, III, 2
POUR BIEN S’ENTENDRE
L’origine de ce Petit Abécédaire pour s’entendre est un peu ancienne : les premières années du XXIe siècle. Je dois au comité éditorial et à une jeune directrice de collection d’une maison d’édition d’avoir, à leur insu, attiré mon attention sur un phénomène dont je n’avais pas mesuré l’ampleur : la marchandisation du savoir, y compris chez les éditeurs universitaires, marchandisation exprimée par les mots, sans détour ni circonlocutions. Ma naïveté, et peut-être une certaine suffisance due à ma croyance désuète – mais je l’ignorais alors – en la valeur de la mission de service public, m’avaient empêchée de remarquer l’importance de cette marchandisation. J’avais publié en 2000 un petit ouvrage de vulgarisation, s’adressant en particulier aux étudiants de sciences humaines, traitant de l’histoire de l’architecture et de la scénographie des lieux de spectacle, et de leur rôle dans la vie de la cité. Cet ouvrage se vendait avec régularité. Je n’avais pas grand mérite à cela : il n’y en a pas d’autres, en France, qui traitent du même sujet. Après plusieurs années, et continuant mon travail de recherche, j’ai demandé à l’éditeur si une réédition, revue et augmentée, était possible. Avant d’accepter, l’éditeur m’a adressé par courriel un questionnaire. À ma grande surprise, ce questionnaire ne s’intéressait qu’à des précisions quantitatives et commerciales, à part la dernière question, qui portait sur le contenu que je souhaitais apporter dans la réédition (réponse demandée : 3 lignes). Je commençais à entrevoir que peu importait à l’éditeur ce que je pouvais transmettre aux étudiants et que seule une logique marchande entrait en jeu, logique qui s’exprimait par un vocabulaire de marketing.
Je me souviens avec précision d’une des questions : « Prescrivez-vous votre ouvrage ? » Sans doute un peu froissée de voir ainsi mon « précieux savoir » passé à la moulinette du marketing, j’ai fait une réponse de Dom Quichotte au petit pied : feignant la méconnaissance du vocabulaire marchand, j’ai précisé ignorer que mon ouvrage avait des vertus thérapeutiques et qu’en conséquence je ne le prescrivais pas, ce qui était d’ailleurs la vérité, puisque je me suis toujours refusée à conseiller la lecture d’un de mes livres en amphi devant 200 étudiants : je fais confiance à leur curiosité. Le comité éditorial a dû me considérer comme une attardée : je l’avais bien cherché, puisque je refusais de parler leur langue, qui n’était pas la mienne. Mais comme ce manuel était rentable, la maison d’édition a accédé à ma demande de réédition.
Ouvrage remanié, nouveau tapuscrit en poche, j’ai rendez-vous avec la directrice de collection, en poste depuis peu. Nous ne nous connaissions pas. Une jeune femme avenante m’accueille avec un grand sourire et me dit : « Ah ! Madame, je suis contente de vous rencontrer. Vous êtes un bon produit. » Ma vanité d’universitaire a été quelque peu piquée. Mais, avertie par la teneur du questionnaire fourni par le comité éditorial, j’ai pris cet accueil pour ce qu’il était : un compliment sincère, venant d’une personne formée dans une école de commerce, travaillant pour vendre des livres comme elle l’aurait fait pour des chaussettes. Ce qui lui plaisait dans son métier n’était pas ce qu’elle vendait, mais comment elle usait de ses « compétences » pour être « performante ». Nous ne parlions pas la même langue. Voilà tout.
Grâce à cette jeune femme, j’ai fait un stage accéléré pour mesurer l’ampleur de la marchandisation du savoir et de sa transmission : quelques mois plus tard (2007), je reçois les premiers exemplaires de la réédition, puis je rencontre le libraire dont la boutique était située en face des locaux de l’université où je donnais cours. Nous nous connaissions bien, et nous nous estimons. Il me demande quand sortira la nouvelle édition, la précédente étant épuisée et les étudiants venant régulièrement lui demander l’ouvrage. Un peu surprise qu’il n’ait pas encore été livré, alors que j’avais vu une semaine auparavant des piles d’exemplaires dans le bureau de l’affable directrice de collection, je téléphone à la gracieuse personne, pour l’informer de ce retard. Sa réponse fut admirable : « Mais c’est normal, on attend avant de livrer : on affame la cible ! » Dont acte. Livres et auteurs vus comme des « produits », collègues vus comme des « prescripteurs », libraires, étudiants et lecteurs vus comme des « cibles » que l’on a intérêt à « affamer », de temps à autre : ce vocabulaire disait beaucoup de l’influence du capitalisme marchand sur notre société. Les péripéties de mes échanges avec une maison d’édition m’ont amenée à être plus attentive aux mots que je ne l’étais déjà : il fallait les écouter avec attention et patience, pour repérer et, peut-être, mieux comprendre l’état et l’évolution d’une société, ou d’une pensée dominante. Les mots, en effet, disent ce que l’on veut que la chose soit, ou ce que l’on croit qu’elle est. Cet abécédaire doit donc beaucoup aux découvertes que m’a aidée à faire une jeune directrice de collection, fraiche émoulue d’une école de commerce, qui faisait son métier du mieux possible, en appliquant à la lettre – au mot près –, mais sans recul, les méthodes productivistes qu’on lui avait enseignées.
Quinze ans plus tard, une expérience pour une banale réédition s’est transformée en un autre manuel, celui que vous avez en main : un petit abécédaire des mots de nos maux. On s’y intéresse à des mots passés dans la langue courante et quotidienne, le plus souvent empruntés à la langue des élites, des experts, de dirigeants d’entreprises ou d’états. Le lecteur y trouvera aussi quelques mots un peu délaissés. Ce n’est pas une somme, mais un choix de cas qui nous ont semblé exemplaires de l’évolution d’une pensée commune. On y contribue à des réflexions sur l’usage des mots par le pouvoir (politique, économique) déjà entreprises entre autres par Victor Klemperer au temps du IIIe Reich (LTI-Lingua Tertii Imperii), par Georges Orwell (1984), ou plus récemment par Jean-Pierre Le Goff (La Barbarie douce), Eric Hazan (LQR), Mariette Darrigrand, ou par plusieurs collectifs d’éducation populaire1. Les travaux et les actions de Noam Chomsky et de Barbara Cassin ont été déterminants pour la réflexion qui a conduit à l’élaboration et à la rédaction de ce petit dictionnaire des mots du quotidien2.
Pour jouer du double sens du verbe « entendre », nous avions pensé intituler ce bref essai Entendons-nous, l’entente semblant nécessaire en ce début de XXIe siècle. Mais la prononciation de « Entendons-nous » est assez incommode, et la sonorité plutôt disgracieuse. Le titre choisi, Mots à maux, joue d’une homophonie, qui peut attirer l’attention et résume le propos. Le mots de la langue courante peuvent être le symptôme de maux d’aujourd’hui, certains mots pourraient aussi aider au bien commun, si l’on en retrouvait l’usage courant. Le sous-titre, Petit Abécédaire pour s’entendre, est descriptif : il ne s’agit pas d’une somme, mais d’un choix, d’un florilège de mots du quotidien, d’usage fréquent, voire répétitif, dans la langue des politiques, des puissants, des medias, et dans la langue commune : des mots dont l’emploi semble parfois surprenant, ou inapproprié, pour peu qu’on les écoute. Le sous-titre joue aussi de la double acception du verbe « entendre », dans le domaine de l’audition et dans celui de l’intellection. Les mots ne sont ni anodins, ni interchangeables, ni innocents. Mieux vaut les connaître, les écouter et les entendre, pour s’entendre, se faire entendre, et pour ne pas se faire séduire, ou manipuler, par qui en userait avec plus d’habileté que son interlocuteur.
Le Petit Abécédaire pour s’entendre a été élaboré, construit à deux. Il a été rédigé pendant la première année de l’épidémie de COVID-19, grâce à un dialogue permettant une sorte de dialectique au jour le jour, « confinements » et couvre-feu obligent. Deux générations, celle des « Boomer ! » et la « génération game boy ». Deux expériences de vie, des interrogations partagées, un souhait : contribuer, avec humilité, à la réflexion et aux actions à inventer et à mener en commun pour un avenir possible, aujourd’hui que le saccage de la planète pour les besoins du consumérisme a presqu’atteint un point de non-retour. La rédaction de Mots à maux revient, pour une part, à celle des deux qui avait le plus d’expérience de l’écriture, aidée par suggestions et les remarques contradictoires, parfois incisives, parfois amènes, de l’autre auteur. Ce que nous y proposons n’est pas un travail de linguiste, ou de philologue, ou de sociologue, ou d’économiste, ou de philosophe, ou d’historien de la langue. C’est plutôt un travail de béotiens, qui chercheraient avec retenue une base solide pour éclairer leur lanterne. Prêter attention aux mots quotidiens, à l’usage qui en est fait, ou à l’oubli d’autres mots, nous a semblé un point de départ simple, sûr et fécond pour la réflexion. Les mots peuvent être libérateurs. Ils peuvent aussi rendre esclave d’une manipulation, d’une croyance, d’une idéologie. L’expression « newspeaknovlangue » inventée par Orwell dans son roman 1984 ne convient pas à la langue analysée ici : la « novlangue » d’Orwell était imposée d’en haut, par la force, tandis que nous utilisons, sans même nous en rendre compte et sans y être contraints, la langue des élites, des puissants, du marketing, qui se répand dans la langue courante, par imprégnation indolore. Peut-être ce phénomène est-il encore plus inquiétant que celui décrit par Orwell. À vous, lecteur, d’en juger.
Mots à maux a été réfléchi et rédigé selon une méthode inverse de celle qu’on trouve par exemple sur les forum de réseaux sociaux : si, comme dans les commentaires, tweet ou chats, le point de départ est une interrogation, une curiosité, une impression, un doute ou une inquiétude, nous ne cherchons ici à exprimer ni colère, ni désaccords, ni mouvements d’humeur. Nous avons, au contraire, souhaité nous appuyer sur l’état des choses, sur une épaisseur temporelle, sur un usage commun : les mots du quotidien. Leur étymologie, leurs sens, et leur évolution au fil du temps, sont les pierres angulaires de ce petit abécédaire. Une assise de connaissances, parfois oubliées, permet ensuite de mieux entendre ce que des mots d’usage courant, ou ceux qui sont tombés en désuétude, disent de la pensée commune, de l’époque, ou des croyances. On pourra alors s’interroger, avec calme, sur ce que l’usage contemporain de ces mots et l’évolution de leurs emplois indiquent, ou enseignent. Afin de contribuer à trouver des remèdes aux maux dont souffrent notre époque et notre bien commun, la terre, chaque entrée s’achève par quelques propositions : quel mot conviendrait mieux ? quel mot aiderait à développer le discernement ? S’il souhaite approfondir une des entrées, le lecteur pourra se reporter à la bibliographie indicative proposée en fin d’ouvrage. Précisons aussi que nous avons choisi, pour aider à une lecture fluide de courtes entrées, de ne pas utiliser l’écriture inclusive, en accord pour cela avec un avis de l’Académie française (2017). L’épilogue propose quelques exemples de textes, de paroles de chansons et d’images qui invitent, nous a-t-il semblé, à la réflexion et au désir de contribuer ensemble à la construction d’un monde plus vivant, plus gai, plus juste et plus calme.
La lecture pourra se faire à bâtons rompus. Nous souhaitons aussi que chaque lecteur puisse enrichir la petite collection proposée. La méthode est simple : repérer dans la langue quotidienne, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, les mots ou les formes grammaticales qui reviennent en refrain, consulter des dictionnaires (lexicographiques, étymologiques, historiques) et analyser ce que dit l’évolution ou le détournement du sens de ces mots. Ce petit exercice aidera à mieux entendre ce que l’on dit, ce que l’on fait dire. Il aidera aussi à renouer les liens essentiels entre le mot et la chose, la parole et le réel, liens qui semblent parfois se distendre aujourd’hui. On en donnera un exemple, parmi tant d’autres. Écoutons la réponse donnée par le président de la République à des journalistes qui l’interrogeaient sur l’emploi du mot « ensauvagement » par le ministre de l’Intérieur (à partir d’août 2020) : « Ce qui m’importe, ce sont les actes, pas les mots!3 ».
Pourquoi ne pas veiller, chacun et tous, à éviter de laisser se corroder le lien entre les mots et les choses, corrosion qui pourrait être cause et symptôme de divers maux : déni du réel, dérive idéologique, volonté de toute-puissance, mépris de ce que les humains ont en commun, la langue ? Entendons-nous bien.
1 KLEMPERER (V.), [1947], LTI, La langue du Troisième Reich, 1996 (Pocket, 2003). Voir aussi : JOLY (F.), La Langue confisquée. Lire Victor Klemperer aujourd’hui, Paris-Liège, Premier Parallèle, 2019. ORWELL (G.), 1984 [1949], nombreuses traductions en français depuis 1950. LE GOFF (J.-P.), La Barbarie douce., [1999] Paris, La Découverte, 2003. HAZAN (E.), LQR. La propagande du quotidien, Paris, Raisons d’agir, 2006. DARRIGRAND (M.), Ces mots qui nous gouvernent, Paris, Fayard, 2008. Collectif L’Ardeur ou SCOP Le Pavé, en particulier.
2 Voir, entre autres : CASSIN (B.), L’Archipel des idées de Barbara Cassin, Paris, MSH, 2014 ; Éloge de la traduction, Paris, Fayard, 2016 ; Quand dire, c’est vraiment faire : Homère, Gorgias et le peuple arc-en-ciel, Paris, Fayard, 2018. Pour une première approche, on pourra aussi écouter en pod-cast, cinq épisodes de l’émission « À voix nue », France Culture, série B. Cassin (décembre 2018) ; CHOMSKY (N.) & HERMAN (E.), [1988, 2002, 2003], La Fabrication du consentement, Marseille, Agone, 2008 ; CHOMSKY (N.), Dominer le monde ou sauver la planète ?, Paris, Fayard, 2004.
3 8 septembre 2020, à l’occasion d’un déplacement à Clermont-Ferrand, propos cités in : LEMARIÉ (A.), « Macron recadre Darmanin et Dupond-Moretti après la polémique sur le terme ”ensauvagement” », Le Monde, 9 sept. 2020.
ENTRÉES
Acronyme
Dans la langue courante, l’acronyme4 (groupe d’initiales, que l’on peut aussi appeler « sigle ») est désormais substitué à une locution intelligible dont il dérive. Ces acronymes sont inventés par des économistes, des experts*5, des lobbies, des politiques, des groupes constitués, ou des sachants*, qui choisissent d’employer des dénominations abstraites plutôt que des mots intelligibles par le commun* des mortels : on dit ARSE pour ? ADALIS pour ? CLSH, CRPC, BIC, MES, OCLAESP, PSP, SPI, pour ? À vous, lecteur, de deviner sans le secours d’un moteur de recherche numérique. Cet usage des acronymes est, au sens propre du terme, un jargon*, « une langue factice dont les gens d’une même cabale conviennent, afin qu’on ne les entende pas6 ». L’emploi d’un jargon*, par des groupes particuliers, n’est pas nouveau : le mot est attesté au XIIIe siècle. Ce qui est nouveau, c’est la docilité, voire la propension collective à employer des acronymes, au quotidien. L’acronyme est concis, certes, mais pour combien d’entre nous n’est-il pas abscons ? On peut se demander pour quelles raisons, le jargon* des élites* ou des spécialistes* s’est diffusé depuis les deux dernières décennies du XXe siècle dans la langue courante, sans injonction, ni contraintes autoritaires : chacun de nous emploie nombre d’acronymes, bon gré, mal gré, souvent pour ne pas passer pour démodé, réactionnaire, vieux*, ignare, voire idiot.
Pour mieux comprendre l’imprégnation de la langue commune par les acronymes, et ses effets, on peut s’interroger sur les causes qui en justifient l’usage. Les acronymes courants peuvent être regroupés en deux catégories : soit ils tendent à éloigner une crainte ou une peur en évitant d’en nommer l’objet, soit ils permettent de détourner l’attention, ou d’écarter des jugements réservés, défavorables. Dans la suite de ce Petit Abécédaire, le lecteur trouvera quelques entrées pour des cas exemplaires où l’usage de l’acronyme recèle et révèle une crainte (entrées IVG et SIDA/MERS/COVID), d’autres où l’emploi d’un acronyme abstrus permet de faire diversion (entrées EHPAD, GAFAM, IVG, LBD, LGTB, MST, OGM, PAT). Le lecteur pourra continuer l’exercice avec d’autres exemples et rester attentif à ce que recèle, ou révèle, d’une façon de penser la multiplication des acronymes abstraits et sibyllins. La généralisation de ce jargon* ne serait-elle pas un signe de soumission à une pensée forgée par des élites* et les lobbies ? Il semble que peu importe.
L’acronyme permet le tour de force de désigner, sans recourir ni à l’étymologie, ni à la description, ni à la référence : parce qu’il distend le lien entre le mot et la chose, l’estompe, ou le masque, il est d’un usage commode pour éloigner les indésirables quand il sert de jargon* aux élites*, experts* ou autres sachants*. Son entrée triomphale dans la langue courante est un signe de difficultés communes* à composer avec des peurs, avec la réalité, avec autrui. En d’autres temps, Victor Klemperer avait analysé avec acuité comment le vocabulaire – dont l’invention d’acronymes – mis à l’honneur par le régime nazi avait été un outil efficace de manipulation et d’emprise sur la pensée et les croyances communes*. Il avait parodié l’usage que le régime national-socialiste faisait des acronymes en intitulant son ouvrage paru en 1947 : LTI-Lingua Tertii Imperii7. La langue peut être un vecteur efficace de diffusion d’idéologies, ou une « machine à décerveler8 ». Pourquoi ne pas y prêter attention ?
Proposition
D’une manière générale, s’abstenir d’employer les acronymes, pour éviter le cas échéant des comportements d’autruches, ou de perroquets des lobbies. Retrouver la capacité d’appeler un chat un chat, de relier les mots au réel et le réel aux mots. Faire l’inverse de ce que fait par exemple un président de la République, suivi par des ministres : dans leurs discours et déclarations officielles, les mots ont valeur de réalité. Des expressions du type « le temps est venu de faire, d’agir », « lancement d’un nouveau processus », ou même « j’irai au bout de ce contrat moral qui nous lie9 », peuvent n’être suivies d’aucune mesure concrète, voire être infirmées quelques semaines plus tard par les décisions du gouvernement et du parlement. Ce procédé qui accorde aux mots énoncés une action sur le réel s’appelle une incantation. Ne conviendrait-il pas de se garder de la pensée magique, qui peut être un leurre, une duperie, ou un attrapenigaud ?
Algorithme
Dans la pensée commune*, le mot désigne les procédés informatiques qui organisent, analysent et traitent les data*. Depuis le milieu des années 2010, il est passé du langage mathématique et cybernétique (voir entrée Data-Données) à la langue commune*, très commune même : depuis qu’il a quatre ans, mon petit fils dit parfois qu’il « dessine des algorithmes », quand il s’amuse avec papier, pinceaux et peinture. Il ne faut pas voir là un quelconque signe de précocité chez cet enfant, mais la preuve de l’imprégnation commune* par la pensée – donc la langue – dominante, celle des GAFAM* en particulier. Pour mémoire, on rappellera l’origine et la définition de ce terme désormais galvaudé.
ALGORITHME. Le mot fait référence à l’invention de la numération décimale par les savants musulmans. « Anciennement. Système de numération décimale en chiffres arabes. […] Ensemble des règles opératoires intervenant dans toute espèce de calcul.◊ » Par extension, « Mécanisme réglant le fonctionnement de la pensée organisée et s’explicitant par des représentations analogues à celles des mathématiciens.◊ » Le mot (sous la forme « algorisme ») est employé par Rabelais (1534) au sens de « l’arithmétique, l’art du calcul en général (Rabelais, Gargantua, 12 […] : Ces enfans deviendront grands en algorisme)◊ ». Algorithme est emprunté à l’espagnol « alguarismo, attesté au sens de “art de compter, arithmétique“ depuis 1256-76 (Libros del Saber de Astronomia) […] L’espagnol alguarismo est issu de l’arabe Aluwārizmī, littéralement “celui de Huwārizm“ [territoire de l’Asie Centrale, actuel Ouzbekistan], surnom d’Abdallāh Muhammad ibn Mūsā◊ », mathématicien-astronome du IXe siècle, dont les traités, traduits de l’arabe en espagnol, ont fait connaître l’arithmétique dans l’Europe médiévale.
banlieues (Les)
Depuis la fin du XXe siècle, le mot « banlieue », quand il est employé au pluriel, avec l’article défini, et dans l’absolu, désigne les grands ensembles de barres d’immeubles situés en périphérie des villes, dont les habitants ont, pour la plupart, des revenus modiques et un accès difficile à l’éducation, aux transports, au travail. Avant que l’expression « les banlieues » ne passe dans la langue commune*, via les politiques et les medias*, on disait « les cités », ou « les quartiers10 », deux dénominations elles aussi employées au pluriel et dans l’absolu11. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l’expression « les quartiers » est l’antonyme implicite d’une autre qui, elle, a droit à un qualificatif : les « beaux quartiers ». La pauvreté serait-elle inqualifiable, ou innommable ? La locution Les banlieues est désormais chargée d’une connotation dépréciative et sous-entend que « les banlieues » sont aussi le lieu de désordres divers, voire de transgression de l’ordre républicain. L’implicite n’étant parfois pas suffisant, l’adjectif « difficile » peut aider à expliciter cette opinion. Pour qui les banlieues sont-elles « difficiles » ? Pour ceux qui y vivent ? Ou pour l’ordre établi par les élites* et les riches ? La question mériterait réflexion. Pour y contribuer, commençons par écouter les définitions et l’histoire des mots.
CITÉ. Dans l’Antiquité et au Moyen Âge, « Groupe d'hommes libres constituant une société politique indépendante, ayant son gouvernement, ses lois, sa religion et ses mœurs propres.◊ » Dans la terminologie juridique, « Ensemble des citoyens constituant un corps indépendant soumis à des lois propres.◊ » Au figuré, « Société politique, religieuse idéale (à venir, à laquelle on aspire) ou mystique.◊ »
QUARTIER. « Partie d'une ville ayant une physionomie propre, une certaine unité.◊ »
BANLIEUE. Dans le droit féodal, la banlieue est l’« espace (d’environ une lieue) autour d'une ville, dans lequel l’autorité faisait proclamer les bans et avait juridiction◊ ». Dérivant de la racine indo-européenne bhâ-parler12, le « ban » est une « proclamation publique pour ordonner, défendre quelque chose ou plus généralement pour porter quelque chose à la connaissance de tous. […] Proclamation du suzerain dans l’étendue de sa juridiction.◊ » Au milieu du XVIe siècle, cette acception de « ban » s’élargit et peut signifier un exil imposé à quelqu’un par proclamation. L’exclu de la juridiction, est « banni ». C’est, mot à mot, un « bandit » (dit-déclaré hors la loi).
Un rappel historique succinct aidera maintenant à comprendre comment la République a pu établir sur son territoire des zones urbaines, dont elle ne sait aujourd’hui plus que faire et où les habitants se sentent souvent délaissés : les banlieues. La reconstruction nécessaire après la Deuxième Guerre mondiale, le développement économique et démographique d’alors, amenèrent un nouveau modèle d’urbanisme : de grands immeubles, implantés en périphérie des villes, construits pour loger ou reloger des familles aux revenus modestes, ainsi que des travailleurs immigrés, main-d’œuvre indispensable à la reconstruction. Certains architectes, en particulier Henri Bernard, Le Corbusier ou Fernand Pouillon, posèrent des principes généraux pour l’élaboration et la construction d’un nouveau système d’habitat collectif : immeubles à plusieurs étages de logements individuels confortables, réunis dans une structure d’ensemble, offrant bien-être aux habitants, lieux pour la vie sociale commune*, commerces, écoles, jardins collectifs et publics*, gymnase ; coûts de constructions limités, mais matériaux durables ; proportions harmonieuses ; adaptation au site. Fernand Pouillon recommanda l’implantation de ces ensembles dans la ville13, le cas échéant, ainsi que l’accession à la propriété14. Le Corbusier choisit un nom qui exprimait ces principes : il appela « Cité radieuse » l’ensemble de logements – que l’on appelle aujourd’hui « sociaux » – qu’il fit construire à Marseille15, en référence à la « cité idéale » à laquelle réfléchissent des philosophes depuis l’Antiquité.
Au début des années 1950, certains banquiers et promoteurs immobiliers dévoyèrent à leur profit ce modèle d’urbanisme pensé pour le bien-être et la vie collective. Ils n’en retinrent que deux éléments : d’une part la possibilité de reloger une classe sociale moyenne ou pauvre et, d’autre part, les grands immeubles, appelés aussi « barres », qui furent érigées le plus souvent avec des matériaux de mauvaise qualité, à la hâte, sur des terrains inoccupés et bon marché, en périphérie des grandes villes : l’opération n’avait plus de dessein social ou républicain, elle ne tendait pas vers le bien commun*, mais permettait des bénéfices rapides.
Contrairement au modèle d’urbanisme mis en œuvre par Hausmann à Paris pendant le Second Empire, la répartition des classes sociales ne se faisait plus verticalement à l’intérieur d’un même immeuble dans la ville, mais horizontalement, les plus riches demeurant dans le centre des villes, les moins riches étant éloignés en périphérie. Certains architectes, en particulier Fernand Pouillon, avaient anticipé les dangers de ce détournement du modèle : exclusion et impossibilité d’échanges entre les classes sociales. Ils avaient proposé des solutions qui auraient permis d’éviter ces écueils. Ils ne furent pas écoutés et la mise à l’écart des plus pauvres dans des immeubles-dortoirs en périphérie des villes fut organisée à grande échelle. Pour dorer leur blason, mais avec cynisme, les classes dirigeantes avaient conservé pour ces groupes d’immeubles le nom proposé par Le Corbusier : on appelait alors « cités » ces nouveaux ensembles de logements relégués en périphérie. Le mot « cité », on l’a vu, peut désigner un « ensemble des citoyens constituant un corps indépendant soumis à des lois propres◊ ». Il porte en germe les dérives de cet urbanisme conçu pour mettre à l’écart et circonscrire ceux que les riches ne veulent ni rencontrer, ni côtoyer. « Peut-être qu’on a donné ce nom pour faire oublier aux gens qu’ils vivaient avec des chiens et des rats, au milieu de la poussière » suggère Jean Marie Le Clézio, dans Désert16.
Au cours du XXe siècle, l’expression « les cités » prend souvent une connotation dépréciative quand elle est employée par ceux qui n’y habitent pas. Dans le même temps – la fin des 30 glorieuses – les premiers habitants partent à la retraite, regagnent parfois leur pays d’origine, leurs enfants et petits-enfants ont des difficultés à trouver du travail, le chômage augmente. Le mot « cité » continue à être employé, au singulier, par les jeunes gens qui y habitent et n’ont que peu d’espoir de pouvoir quitter ces immeubles souvent dégradés et relégués à la périphérie des villes. La permanence de cet emploi de « cité » est un signe d’appartenance à un territoire-village et à un groupe social, dont atteste aussi l’apparition d’une langue et de formes artistiques propre aux jeunes gens des « cités » : le verlan, le rap, le hip-hop, le slam.
Peut-être parce que l’étymologie de « cité » a laissé une infime trace de connotation positive, la dénomination « cités », quand elle est employée par ceux qui n’y habitent pas, cède peu à peu place à les banlieues à la fin du XXe siècle. Dans cette acception à résonance dépréciative, l’expression est riche tant de son étymologie que de l’évolution du sens du mot « ban » entre les XIIe et XVIe siècles. On pourra apprécier avec quelle exactitude et quelle brutalité s’expriment les élites*, les politiques, les medias* dominants : le sens qu’ils donnent à l’expression Les banlieues est l’image fidèle de la conception qu’ils en ont. Par amalgame d’un sens premier de « banlieue » (espace d’une lieue, sous la protection du suzerain) et d’un sens second de « ban » (exclusion officielle de quelqu’un), l’acception du mot « banlieue » est aujourd’hui l’exact antonyme de la « banlieue » médiévale. Les banlieues sont désormais le lieu en périphérie de la grande ville, dévolu aux habitants que les plus riches ne souhaitent plus croiser sur leurs chemins quotidiens, ceux qu’ils ont exclus, bannis du centre des villes et que les politiques, suivis par les medias*, qualifient parfois, depuis le début du XXIe siècle, de « sauvageons » ou « racaille », le mot « bandit » étant un peu désuet. Dans une logique sémantique implacable, les banlieues peuvent donc, pour des élus de la République ou des ministres, être le lieu où s’enracinent, s’expriment et se développent le « séparatisme » ou l’ensauvagement*.
Pourquoi ce que la locution les banlieues implique de mépris, de morgue, de discorde n’est-il plus entendu ? Pourquoi accepter sans sourciller de l’employer, de la lire dans la presse, de l’entendre dans les medias* ? Pourquoi adopter sans réfléchir une langue méprisante ?
Proposition
Bannir du vocabulaire – c’est le moment convenable pour employer le verbe « bannir » : le lecteur voudra peut-être ne pas nous tenir rigueur de ce jeu de mot – l’expression Les banlieues. N’employer le mot « banlieue » ni dans l’absolu, ni au pluriel. Ajouter une précision géographique neutre (banlieue N, E, S, ou O), préciser le nom de la commune. Préférer « la petite couronne » (parisienne, lyonnaise, etc.), ou « la grande couronne », dénominations tombées en désuétude, qui offrent l’avantage de n’avoir aucune connotation péjorative, au contraire.
Bienveillance
Le mot a sans conteste une connotation positive. Il est à la mode et a même été élu « mot de l’année 2018 » par les lexicologues du dictionnaire Le Robert, après un vote en ligne. Il revient comme un leitmotiv, dans la langue des politiques qui déclarent en être pétri, dans les medias* qui louent cette généreuse propension, dans les ouvrages de psychologie et d’éducation, dans le management, dans la publicité, dans les échanges via les réseaux sociaux, donc dans la langue courante.
BIENVEILLANCE. Le substantif, attesté au XIIe siècle, dérive du latin benevolentia-bienveillance, disposition à vouloir du bien (à obliger), dévouement, lui-même dérivé de l’adjectif benevolens-« qui veut du bien, favorable (alicui) à quelqu’un17 », composé par l’association de bene-bien et volens, participe présent du verbe volere-vouloir, désirer, souhaiter. La bienveillance est définie comme « Sentiment qui porte à vouloir du bien à autrui. […] Disposition favorable envers quelqu’un (souvent d’un rang ou d’un âge moindre)18 »
La diffusion de la notion, donc du mot bienveillance, s’explique en partie par l’influence de philosophes, politologues et universitaires féministes, Joan Tronto et Carol Gilligan en particulier, qui théorisèrent, dans les années 1990, le concept de care, que l’on peut traduire en français par « soin », « sollicitude » ou « bienveillance ». Ces études universitaires proposaient le care comme une éthique, à étendre du domaine privé à la sphère publique, politique, économique et environnementale19. Pour Joan Tronto, « Le care doit être considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre “monde”, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. » La théorie anglo-saxonne du care fut reprise en Europe au début du XXIe siècle par les politiques (Martine Aubry, 2010) ou le management. Ainsi, en novembre 2011, Psychologie magazine et le réseau « Entrepreneurs d’avenir » se sont associés pour lancer un « Appel pour plus de bienveillance au travail », appel que signèrent alors 260 chefs d’entreprise, dont France Télécom. Quelques mois plus tôt un salarié de l’entreprise se suicidait par le feu devant une agence France Télécom de Bordeaux, et 35 employés s’étaient suicidés entre 2008 et 2009. Signer un appel à « plus de bienveillance au travail » quand on met en œuvre un management de la brutalité – qui a conduit à un procès en 2019 et à la condamnation à un an de prison de trois anciens dirigeants pour harcèlement moral : c’est surprenant.
Comment expliquer le grand écart entre les faits – management de harcèlement conduisant au suicide d’employés – et les mots ou les déclarations ? Peut-être déjà en écoutant le mot bienveillance, dont la définition implique un rapport de subordination, la bienveillance étant une « Disposition favorable envers quelqu’un (souvent d’un rang ou d’un âge moindre) ». Les corollaires de la notion de bienveillance, telle qu’elle est entendue aujourd’hui, sont d’une part la division de la société en deux groupes distincts, les plus puissants qui peuvent exercer leur sollicitude et leur bienveillance à l’égard de l’autre groupe, appelés désormais les « vulnérables » ou « les plus vulnérables », ou les défavorisés* et, d’autre part, le principe selon lequel les « vulnérables » ne peuvent que s’en remettre aux puissants, en espérant que ceux-ci soient bienveillants envers eux, mot à mot qu’ils leur veuillent du bien.
Le grand écart entre les faits ou les actes (brutalité du management ou des politiques menées) et les déclarations est aussi le signe que le concept de care a été détourné de ses principes, posés dans les années 1990, par Carol Gilligan et Joan Tronto, entre autres : la valeur positive du care est devenue à la fois une doxa et un outil, utile au management comme aux politiques20. Il faudrait en effet être bien grognon, voire malveillant, pour s’inquiéter de la sollicitude et de la bienveillance (care) que les dirigeants d’entreprise entendent manifester à leurs salariés, ou les élus aux citoyens. Mais ne serait-ce pas façon de les obliger ? Le tour de passe-passe langagier anesthésie le jugement et laisse libre cours à des pratiques de prise de pouvoir ou de manipulation des salariés, des électeurs, de tout un chacun. Déclarer son attachement au care est ainsi devenu un élément important de communication, pas toujours d’action. S’en réclamer est un passage obligé dans les discours politiques. La bienveillance est alors réduite à ce que les agences de communication nomment un « élément de langage », parce que c’est un argument d’autorité, difficile à démonter et commode quand on cherche à couper court à toute objection : qui oserait s’élever contre la valeur positive de la bienveillance ? C’est ce procédé rhétorique qu’employait par exemple un ministre qui venait de fonder un nouveau* mouvement politique, un an avant les élections présidentielles de 2017 : « j’ai une règle de vie, pour les femmes et pour les hommes, comme pour les structures : la bienveillance.21 » Le même homme, devenu président de la République, a mis en place le 24 mars 2020 un Comité analyse recherche et expertise Covid 19 dont l’acronyme est, heureux hasard ou remarquable sollicitude, « CARE ».
Proposition
Quel mot pourrait être préféré à bienveillance ? Quel mot pourrait associer celui qui accorde sa bienveillance et celui qui en bénéficie dans un rapport qui ne serait pas une opposition binaire entre un supérieur et un obligé, plus faible, plus fragile, ou « vulnérable » ? Quel mot pourrait aider à dépasser ce dualisme et la condescendance que recèle le substantif Bienveillance, sous des dehors affables ?
Le substantif « égard » est désormais d’un emploi rare dans la langue courante. On lui préfère des mots qui n’en sont pourtant pas synonymes : « bienveillance » ou « respect ». Retrouver l’usage commun* du mot pourrait aider, en commun*, à « substituer une diplomatie à la domination22 ». Nous devons l’expression à Baptiste Morizot, qui dans Manières d’être vivant





























