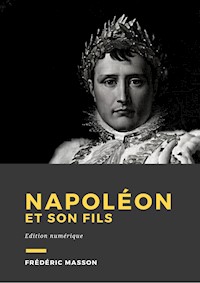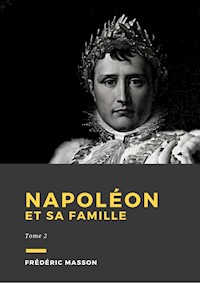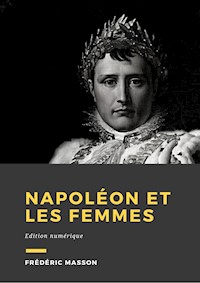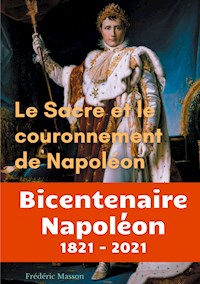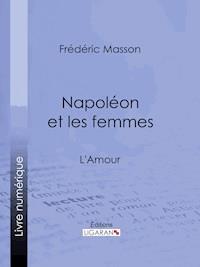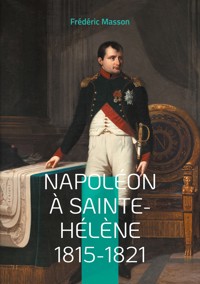
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
« Napoléon à Sainte-Hélène 1815-1821 » de Frédéric Masson offre un portrait saisissant des dernières années de l'Empereur déchu. Cet ouvrage, fruit d'une recherche méticuleuse, plonge le lecteur dans l'intimité de la captivité de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, révélant les aspects méconnus de cette période cruciale de l'histoire du Premier Empire. Masson dépeint avec finesse le quotidien de Napoléon à Longwood, sa résidence forcée sur l'île. Il analyse les relations tendues entre l'Empereur et son geôlier, le gouverneur Hudson Lowe, offrant un éclairage nouveau sur les conditions de vie et les restrictions imposées au prisonnier le plus célèbre d'Europe. L'auteur s'attarde sur les compagnons d'exil de Napoléon, explorant leur loyauté et les conflits qui émaillent leur cohabitation forcée. L'ouvrage accorde une place centrale à l'activité intellectuelle intense de Napoléon durant sa captivité. Masson examine en détail la rédaction des mémoires de l'Empereur, véritable testament politique et historique, révélant comment Napoléon cherche à façonner sa légende pour la postérité. Cette biographie napoléonienne s'inscrit naturellement dans les catégories « Histoire de France », « Biographies historiques » et « Études napoléoniennes » sur les plateformes de vente en ligne. Masson ne se contente pas de relater les faits, il offre une analyse profonde de l'état d'esprit de Napoléon face à son destin brisé. Il explore les réflexions de l'Empereur sur son règne, ses victoires et ses erreurs, offrant ainsi une perspective unique sur l'homme derrière le mythe. « Napoléon à Sainte-Hélène » reste une oeuvre essentielle pour comprendre les dernières années de l'Empereur et leur impact sur la construction de la légende napoléonienne. Masson livre un récit captivant qui dépasse la simple chronique pour offrir une réflexion sur le pouvoir, la gloire et la chute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TABLE DES MATIERES.
AU LECTEUR
I
DE MALMAISON AU NORTHUMBERLAND
L’Empereur quitte l’Élysée. — L’Empereur à Malmaison. — Les Frégates. — Le Mobilier de ville et de campagne. — Le Général Beker nommé commandant de la Garde. — Les Lettres de Davout. — L’Empereur prisonnier. — Le Général Beker. — Les Passeports. — Que pensait Davout ? — Les Arrêtés contradictoires de la Commission executive. — L’Article V. — Les conditions des Alliés. — Livrera-t-on l’Empereur aux Alliés ? Que feraient de lui les Alliés ? — On préfère le contraindre à se livrer lui-même. — Le nœud de la question. — L’Empereur est-il sincère ? — Il est patriote. — L’Empereur offre de sauver Paris. — La Réponse dé Fouché. — Retour de Beker à Malmaison. — Départ pour Rochefort. — La Fuite. — Contraste avec le départ de Joseph. — Napoléon ne veut partir qu’en souverain. — Les Adieux. — Malmaison. — Rambouillet. — Tours. — Poitiers. — Saint-Maixent. — Niort. — Rochefort. — Opinions contradictoires. — Les ordres de la commission executive. — Napoléon à l’île d’Aix. — Divers partis qu’on propose. — Négociations avec le commandant du Bellerophon. — Las Cases et ses imprudences. — Combattra-t-on ? — Le Commandant Philibert. — Suprêmes délibérations. — Napoléon a bord du Bellerophon. — Les ordres de M. le marquis de Jaucourt, ministre de la Marine. — Comment il récompensa et punit. — Comment les Royalistes eussent traité l’Empereur. — La Mission de M. le Commandant de Rigny. — L’arrivée de l’Amiral Hotham. — Honneurs suprêmes rendus à l’Empereur. — Le Bellerophon a Torbay. — Sainte-Hélène désignée pour la déportation. — Craintes des Anglais. — Déchéance de l’Empereur prononcée par les Anglais. — On signifie à l’Empereur sa déportation. — La déportation et l’Opinion anglaise. — L’affluence à Plymouth. — Le Bellerophon reprend la mer. — Le Traité du 2 août 1815. — De quel côté le droit ? — La Protestation de l’Empereur. — L’Empereur doit rester l’Empereur.
II
CEUX QUI SUIVENT L’EMPEREUR
En rade. — La Comédie est jouée. — Les dernières heures à bord du Bellerophon. — Sur le Northumberland. — Les Adieux. — Ceux qui ne partent pas. — Savary et Lallemand proscrits par les Bourbons, exclus par les Anglais. — Les Officiers subalternes. — Ceux qui partent. — Le Grand maréchal Bertrand. — Mme la comtesse Bertrand. — M. le comte de Montholon. — Sa famille. — Ses aventures réelles et imaginaires. — Sa carrière militaire et civile. — Son mariage. — Sa conduite en 1813 et 1814. — À la Restauration. — Promu par elle maréchal de camp. — Sa disgrâce. — Son voyage à Fontainebleau. — Ce qu’il fit aux Cent-Jours. — M. le Baron Gourgaud, — Sa famille. — Sa carrière. — Ses projets de mariage. — Premier officier d’ordonnance. — Colonel. — Général. — Il s’impose à l’Empereur au lieu de Planat. — Pourquoi ce fut un malheur. — M. le comte de Las Cases. — Ses origines. — Sa carrière maritime. — En Émigration. — Rentrée en France. — Chambellan. — Maître des requêtes. — Homme de Lettres. — Pourquoi Las Cases ? — L’Empereur et Las Cases. — Le Médecin : O’Meara. — Piontkowski. — Les Corses. — Antommarchi. — Les Prêtres. — Les Serviteurs. — Cipriani. — Santini. — Marchand. — Saint-Denis. — Pierron. — Les Archambault. — Rousseau. — Lepage. — L’Amour à Sainte-Hélène
III
LA PRISON. — LE GEOLIER LES COMPARSES
Napoléon et Sainte-Hélène (1788. — 1804. — 1805). — Comment, s’instruire de Sainte-Hélène. — La notion qu’on a en Europe remonte au XVIe siècle. — C’est le Paradis terrestre, — Le livre de T.-H. Brooke. — Opinion généralement admise. — Les descriptions. — Les rats. — Les Rats et l’imagination populaire. — Sainte-Hélène et là réalité. — Les coins bénis. — Longwood. — Cherté de la vie à Sainte-Hélène. — La garnison et l’escadre. — Les officiers de la Compagnie des Indes. — L’Amiral Sir George Cockbum. — Napoléon et Cockburn. — Le Gouverneur. — 56 George III. Chap. XXII. — Henry Bathurst, Comte Bathurst. — Sir Hudson LowE. colonel des Royal Corsican Rangers. — Pourquoi Hudson Lowe ? — Sa carrière. — En Corse. — Corsican Rangers. — Royal Corsican Rangers. — À Capri, — À Ischia. — À Sainte-Maure. — En Allemagne. — Avec Blücher. — Comment se décide sa fortune. — Major général. — Lieutenant général. — Le rang local. — Caractère d’Hudson Lowe. — Lady Lowe. — Lowe et sa mentalité. — Lowe et les responsabilités. — Les Commissaires étrangers. — Alexandre Antonovitch de Balmain. — Le baron et la baronne Stürmer. — Le, marquis de Mont-chenu. — L’Angleterre et l’Europe
IV
LE DRAME
La Question du Titre. — Les Anglais avaient constamment esquivé de le donner à Napoléon. — À partir des Cent-Jours, l’Europe le refuse. — L’Empereur sur le Northumberland. — La Navigation. — Les Mémoires. — Le Travail avec Las Cases. — Arrivée à Sainte-Hélène. — Jamestown. — Première visite à Longwood. — Les Briars. — Les Balcombe. — Napoléon aux Briars. — Plaintes des compagnons de l’Empereur. — Les caractères se dessinent. — Dissensions entre Français. — Gourgaud aux Briars. — Fausses nouvelles. — Départ général pour Longwood
Installation à Longwood. — Description. — Hut's Gate et les Bertrand. — Organisation de la Maison. — Montholon y règne. — Conséquences. — L’Écurie. — La Cuisine. — Le Train. — L’Amiral Sir George Cockburn. — Les Restrictions. — Espiègleries de Napoléon. — Longwood, prison perpétuelle. — La Vie à Longwood. — Question du titre. — « Affectation puérile », dit Lamartine. — L’Étiquette à Longwood. — Les Visites. — Les Dîners. — Le Service. — Le Vermeil et le Sèvres. — Les Promenades dans l’île. — Arrivée de Piontkowski. — Piontkowski à Longwood
Sir Hudson Lowe. — Son entrée à Longwood. — Ses Instructions. — L’engagement et les formules. — Dispositions de Lowe à isoler l’Empereur. — Économies commandées par le Ministère. — Calcul des dépenses de l’Empereur. — Quel but poursuit Lord Bathurst ? — Ce que l’Empereur possède à Sainte-Hélène et en Europe. — Vanteries de Montholon. — L’Empereur demande à payer toute sa dépense. — Question des lettres fermées. — Lowe et les réductions sur les fournitures. — La famine à Longwood. — Bertrand et Lowe. — Dernière entrevue de l’Empereur avec Lowe. — Protestation de l’Empereur. — Lowe veut diminuer le nombre des commensaux. — La Question d’Argent. — Bris et vente de l’Argenterie. — Lord Bathurst, ministre économe. — Les Correspondances avec l’Europe. — Lowe félicité par Bathurst. — Quatre serviteurs de l’Empereur enlevés de Longwood. — Signature des formules du Ministère. — Les Commissaires étrangers. — Espérances que l'Empereur avait conçues. — L’Empereur au secret. — Les Lettres. — Les Livres et les Journaux. — Le Livre d’Hobhouse. — Lady Holland, — Ses soins pour l’Empereur. — Qui est Lady Holland ? — Les caisses qu’elle envoie. — L’Affaire des cheveux du Roi de Rome. — L’Affaire du buste du Roi de Rome. — Correspondances de l’Empereur avec l’Europe. — L'Anti-Gallican
Le Départ de Las Cases
La Santé de l’Empereur. — Le Docteur O’Meara et la Santé de l’Empereur. — L’Empereur est-il malade ? — Premières protestations en Europe contre les rigueurs de la captivité. — Santini. — Son pamphlet. — Lord Holland à la Chambre des Lords. — Discours de Lord Bathurst. — Ses allégations. — Le Vote. — La Victoire parlementaire. — Mouvement dans l’Opinion européenne. — Las Cases en Europe. — Aggravation dans la Santé de Napoléon. — Inquiétudes de Lowe. — Propositions qu’il fait. — L’Affaire des Bulletins. — Lowe et O’Meara. — Combinaison de Lowe. — Coup de théâtre
Le général Gourgaud quitte Sainte-Hélène. — Ses altercations avec Las Cases. — Ses querelles avec Montholon. — Ses disputes avec l’Empereur. — Le cartel adressé à Montholon. — Déclarations de Gourgaud à Sainte-Hélène et à Londres. — Ce qu’il advient de lui. — Résultat de ses confidences. — Approbation par tous les cabinets européens des mesures prises contre l’Empereur. — Tout le travail de Las Cases inutile. — O’Meara enlevé de Sainte-Hélène. — L’Empereur sans médecin. — O’Meara en Europe. — Les Aventures du Docteur Stokoë
L’Empereur ne travaille plus. — Période la plus triste de la captivité. — Tout le monde parti. — L’Amiral et Lady Malcolm. — Les Balcombe. — Le Baron Stürmer. — Le Comte Balmain. — Le Général Bingham. — Préparatifs de départ de Mme Bertrand. — Le Cartel du Lieutenant-Colonel Lyster au Grand maréchal. — Efforts de Lowe pour obliger Bertrand à partir. — « Poor Madame Bertrand ! — L’Empereur et les Enfants Bertrand. — Boucles d’oreilles d’Hortense Bertrand. — L’Empereur et le Général Bertrand. — La Question du Départ. — Le Départ de Mme de Montholon. — Montholon a-t-il l’idée de partir ? — Ce qu’il gagne à rester
L’Arrivée du Chirurgien et des Prêtres. — Les trois Corses. — Les Jardins et le Jardinage. — Aménagements intérieurs. — L’Empereur et la Religion catholique. — La Chapelle
Juillet 1820. – Première crise. – Octobre. Débuts de la Maladie suprême. – La Dernière Maladie. – Demande d’un Médecin et d’un Prêtre français. – Le Docteur Antommarchi veut partir. – Dernière Sortie. – Répugnance aux Médicaments. – Les Consultations du Docteur Amott. – New-Longwood. – L’Empereur et le Docteur Arnott. – Rédaction dictée et Copie du Testament. – L'Histoire de Marlborough. – Continuation du Testament. – Le Testament. – Dernières dispositions. – Mme Bertrand chez l’Empereur. – Les Sacrements de l’Église. – L’Agonie. – La Mort. – Lowe devant le cadavre de Napoléon. – L’Autopsie. - L’Exposition du corps. – L’Emplacement du Tombeau. – Le Masque. – La Mise en Bière. – Les Obsèques. – Là-Bas !
AU LECTEUR
Dans les études que j’ai entreprises Napoléon, subsistent des lacunes que je voudrais avoir le temps de combler. La première série : Napoléon dans sa jeunesse doit être remise au point, perdre l’aspect de Notes que je lui avais volontairement donné d’abord et prendre la forme d’un livre ; dans la seconde série, j’ai à parler de Madame Bonaparte en un volume qui prendra place entre Joséphine de Beauharnais et Joséphine Impératrice. Dans la troisième série, Napoléon et sa famille, j’ai à raconter, au point de vue d’où je me suis placé, ce qui s’est passé depuis l’abdication de Fontainebleau jusqu’à la mort de l’Empereur, et trois volumes encore me seront nécessaires. Le tome dixième est presque achevé et paraîtra avant la fin de cette année ; le tome onzième est préparé et le tome douzième aurait pu être livré à l’impression. D’autres séries sont moins avancées et la documentation seule en est réunie : je me borne à celles-là, les seules que mon âge me donne l’espoir de terminer.
Le procédé que j’ai employé explique, s’il ne justifie, le retard que j’ai mis à donner au public les trois derniers volumes de Napoléon et sa famille et la publication que je fais à présent de Napoléon à Sainte-Hélène. C’est que j’ai mené mon enquête, non pas chronologiquement, mais simultanément, sur les événements qui se sont accomplis de mars 1814 à mai 1821 et qui intéressent mes divers sujets d’étude. J’en ai détaché plusieurs fragments trop développés pour figurer tels quels dans mon livre, trop importants pour qu’ils ne dussent point être racontés dans un détail aussi complet que possible. Ainsi, entre autres, l’Affaire Maubreuil dont la publication remonte à six ans, et Le colonel Camille (Comment l’Empereur revint de l’île d'Elbe), paru il y a quatre ans. De même, ai-je fait pour les problèmes que posait l’histoire de la captivité : j’ai abordé le plus important il y a exactement dix ans dans une conférence à la Société de géographie. Des circonstances m’ont alors obligé à publier intégralement les documents sur lesquels j’avais fondé ma conviction, auxquels on n’a rien su opposer et d’après lesquels il me parait matériellement impossible qu’on puisse penser différemment. J’ai procédé de même pour divers personnages qui entouraient Napoléon, pour les médecins, pour le prétendu capitaine Piontkowski[1], pour les cuisiniers, pour le commissaire du roi de France le marquis de Montchenu, puis pour certains événements. Les études contenues dans les trois volumes parus sous le titre Autour de Sainte-Hélène apportent suivies hommes et les choses qui y sont envisagés autant de lumières que j’ai pu en projeter.
Ainsi s’est trouvé préparé le présent livre. Sans doute eût-il été préférable qu’il ne parût qu’après le tome douzième de Napoléon et sa famille où j’essaierai de déterminer quels rapports ont pu, de Sainte-Hélène, subsister entre l’Empereur, sa mère, ses sœurs et ses frères ; mais n’avais-je pas dû ci-devant dans Napoléon et son fils exposer la part qu’avait eu le sentiment paternel dans les souffrances du prisonnier ? Le jour où mon oeuvre, telle quelle, sera achevée, on y verra que, depuis vingt ans, j’ai suivi un plan dont j’avais cru reconnaître la logique et dont l’enchaînement m’a paru irrésistible. C’est ainsi que au présent volume, s’en adjoindra un encore : le Testament de Napoléon, où mon but sera d’abord de montrer les sentiments, les souvenirs et les espérances qui ont déterminé l’Empereur dans cette suprême manifestation de sa pensée ; en second lieu de préciser les motifs de chacune des dispositions ; enfin de raconter les péripéties vraiment surprenantes de l’exécution testamentaire.
S’il était vraisemblable que je vive assez pour aborder, après l’étude des sentiments, celle des idées dont j’ai déjà essayé de rendre certains aspects ; pour continuer l’inspection de la vie extérieure et des entours impériaux, j’aurais encore de quoi remplir une existence, mais cela rentre dans les rêves qui ne sont permis à un vieillard qu’à l’expresse condition qu’il en sache la vanité. Aussi bien je ferai de mon mieux, comme j’ai fait jusqu’ici et, j’espère, jusqu’au bout. Mais faire de mon mieux, cela est peu. Si j’avais pu garder quelque illusion sur cette oeuvre de ma vie, les injures dont je suis l’objet auraient dû m’enseigner la modestie ; comment se fait-il donc qu’elles m’aient surtout appris l’orgueil ? Nul ne peut faire que je ne sois resté constamment et uniquement fidèle au drapeau auquel je me suis attaché et à la cause que je sers. Quant à mes livres, si souvent et si audacieusement démarqués, il ne me semble pas que les outrages en aient compromis la solidité.
Je ne suis rien qu’un chercheur de vérité : s’il m’est arrivé de satisfaire mon esprit en croyant la trouver et ma conscience en m’efforçant de la dire, si je me suis fait comprendre et que j’aie touché a mon but, qu’importe que mes phrases paraissent a quelques-uns malhabiles et peu correctes. Elles auront tout de même, dans la mesure où elles pouvaient agir, contribué, a l’œuvre de salut et de glorification nationale. Et c’est assez.
Je dois dire comment j’ai compris ce livre : Quoique j’ai eu la bonne fortune d’obtenir communication de mémoires inédits d’une grande importance et d’en contrôler même la véracité par d’autres souvenirs également inédits, je ne pouvais penser à fournir jour par jour une analyse chronologique de la vie de l’Empereur à Sainte-Hélène. Un tel livre n’eut point été lisible, mais de plus un tel livre ne peut être écrit : cela, pour cette raison essentielle, que, sur quatre des six années de la captivité, l’on ne possède aucun témoignage.
Il existe sur l’Empereur et sa vie à Sainte-Hélène trois sources d’informations. Sources anglaises : Elles sont sans doute d’une importance majeure lorsqu’il s’agit des rapports de Napoléon et de ses compagnons avec les Anglais, mais, hors cela, elles sont sans valeur, lorsqu’il s’agit de pénétrer a l’intérieur de Longwood, d’y voir vivre l’Empereur, de raconter ses gestes, puisque nul Anglais, depuis la rupture entre l’Empereur et Lowe, n’est entré dans la maison, que nul n’a assisté à l’existence quotidienne de Napoléon. Ce qui est publié, surtout depuis les derniers ouvrages de M. Frémeaux, est amplement suffisant et je ne crois pas qu’on puisse attendre de ce côté aucune lumière nouvelle.
Sources européennes : Rapports et lettres des commissaires des Puissances. Le commissaire d’Autriche disparaît presque tout de suite, le commissaire russe ne tarde pas à suivre son collègue autrichien et sa correspondance, intéressante au début, est tout à fait nulle près d’une grande année avant son départ ; enfin, le commissaire français demeure bien à Sainte-Hélène jusqu’à la mort de l’Empereur, mais, pas plus que ses collègues, il n’entre à Longwood, pas plus qu’eux, il n’a de notions exactes sur l’Empereur et sur sa vie, et n’était que par certaines confidences — d’ailleurs mensongères et tendancieuses — reçues de Montholon, il verse sur ce personnage un jour qui aide à le comprendre, la nullité de sa correspondance égalerait celle de son intelligence. J’ai, au surplus, fourni un portrait suffisant de Montchenu dans Autour de Sainte-Hélène (2e série) où j’ai publié les parties caractéristiques de ses dépêches.
Il y a enfin les témoignages français ou anglais (O’Meara) émanés de l’entourage de Napoléon, des hommes qui l’approchaient et eussent été a même de rendre compte de ses actes et de ses idées. Las Cases, Gourgaud, Bertrand, Montholon, O’Meara, Antommarchi, Marchand, Saint-Denis.
Las Cases aurait pu fournir, par son journal un document de premier ordre, mais il y a mis tant de littérature, il y a inséré tant de réclames personnelles, il y a interpolé, lorsqu’il a rédigé son texte définitif, tant de pièces apocryphes qu’il a nécessairement invalidé une grande partie de son témoignage : j’y attache pourtant une importance, mais à le prendre dans la première édition imprimée en Angleterre avant les atténuations. Il faudrait voir le manuscrit original, s’il existe, dont je doute.
Gourgaud a jusqu’ici fourni le document le plus précieux et le plus essentiel. Comme je l’ai fait pressentir ailleurs, j’ai pu me référer utilement à une copie intégrale du manuscrit original. J’estime qu’on y prend une idée très juste, très complète et peut-on dire définitive de l’état des esprits À Longwood durant les deux premières années de la captivité.
Mais, si Las Cases quitte Longvood le 25 novembre 1816, Gourgaud le quitte le 13 février 1818. On reste — pour combien peu de jours ! — en présence d’O’Meara, J’ai dit ce que je pense du personnage, [2] il n’inspire aucune confiance. Il est à qui le paye, à qui lui fait espérer d’être mieux payé. Par suite, tout ce qu’il avance sans l’appuyer de documents formels est suspect. Toutefois, mieux que les Français, il aide à comprendre Lowe.
Ce que j’ai pu connaître des souvenirs de Bertrand m’a paru rédigé très tardivement avec des erreurs de mémoire évidentes.
Les Récits de Montholon n’ont aucune valeur ; ils ont été écrits vingt ans au moins après les événements, revus sinon rédigés par un romancier illustre et je me suis expliqué ailleurs (Le Cas Gourgaud — AUTOUR DE SAINTE-HÉLÈNE 1er série) sur leur véracité. L’objet de cette publication a été fort différent de ceux que le prince Louis Napoléon qui en paya l’impression, eût pu être tenté de lui attribuer.
L’édition anglaise (en langue anglaise) renferme certains documents qui ont été truqués dans l’édition française postérieure et le récit qui a plus tard été repris, est, dans cette première édition, plus sincère quoique aussi peu intéressant. Les Lettres publiées de Montholon à sa femme, sont entre les plus précieux documents qu’on ait mis au jour : de même certaines lettres en appendice aux Souvenirs de M me de Montholon.
Antommarchi a certainement tenu un journal pour certains faits de la maladie qui sont contrôlables, il fournit même des indications qui ne sont pas inutiles. Tout le reste est de pure invention et il ne faut admettre aucun des propos de l’Empereur rapportés par le prosecteur Corse, lequel a certainement employé un teinturier pour étirer son journal en deux volumes. De ces mémoires, une première édition fut imprimée et parut en Angleterre ; la comparaison avec l’édition postérieure, imprimée en France, est édifiante.
Restent les souvenirs de Marchand dont j’ai dû la communication à l’ancienne amitié de M. le Comte Desmazières et ceux de Saint-Denis sur lesquels je n’ai pu jeter qu’un coup d’œil, mais dont la conformité avec ceux de Marchand m’a paru témoigner d’une amitié étroite et si l’on peut dire d’un contrôle mutuel. Ce sont, après Gourgaud, les plus précieux témoignages, et ils fournissent sur la dernière période de la vie de l’Empereur, des informations qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Mon vieil ami G. Clairin m’a communiqué en outre des Lettres précieuses de son grand’père, le comte Marchand. Écrites de Sainte-Hélène sous l’œil des geôliers, elles provoquent une émotion profonde, mais elles n’apportent guère de renseignements nouveaux.
Tels sont les témoignages recueillis. On peut y ajouter quelques lettres dispersées de gouvernantes, de domestiques, quelques livres de compte, quelques indications fournies par des passants, quelques « interviews » prises par de grands seigneurs ou de grands fonctionnaires anglais ; rien de cela ne permet de rétablir, même sommairement, la vie quotidienne de Napoléon depuis 1818 jusqu’à l’extrême fin de 1820.
J’ai donc dû procéder d’une façon différente pour chercher à exprimer les idées que m’avait suggérées l’étude des documents imprimés ou manuscrits. La situation juridique de Napoléon m’a paru expliquer, justifier, exalter sa résistance à l’oppression anglaise. Tout dérive de là, tout y doit être rapporté. J’ai donc précisé dans le détail quelles raisons avaient déterminé l’Empereur à chercher un asile sur le Bellérophon et comment les Anglais l’y avaient attiré et l’y avaient traité. De l’abus de la force commis envers lui, ont résulté toutes les résistances qu’il y a opposées : C’est la première partie de ce livre : De Malmaison au Northumberland.
Cet élément formulé, j’ai montré quels personnages allaient s’agiter dans le décor de Sainte-Hélène : ceux qui ont suivi l’Empereur et dont personne n’a jusqu’ici recherché la biographie exacte et le caractère véritable, de même que personne n’a exposé les mobiles auxquels ils ont obéi. De précieux documents inédits m’ont permis de mettre en lumière des personnages auxquels la postérité accorde infiniment plus de considération que ne faisaient les contemporains. J’ai exposé sans réticence ce que j’ai trouvé. Il m’a semblé que les pièces, extraites la plupart d’Archives publiques, n’avaient pas besoin de commentaires : elles se suffisent. La reconstitution du milieu est l’un des points nouveaux de cette étude. Je crois n’avoir pas laissé dans l’ombre le moindre des figurants.
Je me suis moins attaché au personnel anglais : un seul individu présente un intérêt majeur Hudson Lowe. Certaines communications précieuses qui m’ont été faites par des Anglais, la série des articles que lui ont consacrés, lors de sa mort, dans des revues spéciales, ses camarades-officiers, m’ont permis, je crois, de m’approcher davantage de sa psychologie et de le traiter sinon avec sympathie du moins avec quelque justice. Je n’ai vu en lui qu’un agent d’exécution et j’ai cherché, derrière le bourreau, le Ministère anglais. Je n’ai point tenté, bien que les éléments en fussent rassemblés, de peindre tous ceux qui ont eu quelque rapports avec l’Empereur ; l’Amiral et Lady Malcolm, l’Amiral Planpin, le Général et Lady Bingham, les officiers des divers régiments. À quoi bon ? Non plus les passants : ce n’est point d’eux que dépend l’action du Drame ; ils n’y influent pas plus qu’ils n’y participent, et tout ce qui en distrairait je l’ai évité. En même temps que les personnages, j’ai tenté d’esquisser le décor et une abondante collection de vues photographiées m’y a aidé. Je ne saurais certes avoir la prétention de décrire un pays où je ne suis point allé, mais l’ensemble des documents iconographiques que je me suis procurés m’a permis d’en prendre une idée et de situer le Héros dans des paysages approchant au moins de la réalité.
Ainsi ai-je préparé l’action dont tout esprit réfléchi pouvait dès lors imaginer les péripéties successives, inévitables et dirai-je infaillibles ; à condition de supposer de cette action, certaines phases sur lesquelles manquent les informations, mais que rendent nécessaires le choc de caractères désormais connus et cette vie en cage dont s’exaspéreraient les hommes les mieux doués de patience. Il eût été d’un art plus subtil et peut-être approchant de plus près la vérité de laisser le lecteur rêver ce drame entier dont nous ne connaissons que quelques scènes et reconstituer un ensemble dont je ne pouvais retrouver que des lambeaux déchirés. Mais c’eût été me soustraire à l’obligation que je m’étais imposée. J’ai donc rangé en ordre, autant que je l’ai pu faire, les questions qui se sont présentées durant la Captivité et qui ont déterminé la lutte entre le Captif et son geôlier. J’ai tenté de les exposer clairement, de faire le partage des responsabilités. Est-ce ma faute si toujours, du misérable Hudson Lowe j’ai dû, pour frapper juste, m’élever à ceux qui lui envoyaient leurs ordres.
Après avoir recherché quelles raisons avaient fatalement amené la lutte entre Napoléon et Lowe, après avoir rendu compte des incidents de cette lutte, j’ai montré dans leur jeu les personnages dont j’avais ci-devant décrit les caractères et par là s’est dévoilée une des pires cruautés de la Captivité ; j’ai dit les départs successifs, l’oisiveté, l’ennui, le terrible et douloureux ennui ; puis autant qu’il m’a été possible, j’ai suivi la progression de la maladie. J’ai eu plus de moyens pour la raconter et je l’ai fait avec quelque détail. Mais, si souvent que ma plume ait tremblé dans ma main, j’ose penser qu’on ne trouvera dans ces pages ni déclamation, ni hors d’œuvre. Je me suis appliqué à exposer, avec une sincérité entière, les faits que les documents me fournissaient, non les impressions qu’ils me suggéraient. J’espère qu’il n’a rien subsisté de celles-ci dans un récit dont la passion eût fait suspecter la véracité.
FRÉDÉRIC MASSON,
Clos des Fées, 1910-1912.
1. ↑ Un Anglais, M. G. L. de St M. Watson, vient de publier un volume de 300 pages intitulé : A Polish exile with Napoléon inbodying the letters of captain Piontkowski to general sir Robert Wilson and many documents from the Lowe papers, the Colonial office records, the Wilson manuscripts, the Capel Lofft correspondence, and the French and Genevese Archives Whithezto Unpublisned. London et New-York., Harper brothers, 1912 (Un exilé polonais avec Napoléon, comprenant les lettres du capitaine Piontkowski au général Sir Robert Wilson et beaucoup de documents inédits des papiers Lowe, des Archives du Colonial Office, de la correspondance de Capel Lofft, et des Archives françaises et genevoises). Je m’attendais à y trouver des renseignements nouveaux qui complétassent ou contredisissent ceux que j’ai donnés sur Piontkowski dans Autour de Sainte-Hélène (2e série). J’y ai trouvé le démarquage intégral de mon étude, mais accompagné d’appréciations qui visent à être critiques et dénotent en même temps que la plus audacieuse fatuité et la plus complète ignorance, la plus épaisse sottise. Pour prendre au sérieux Piontkowski, sa dame et Cappel Lofft, pour réhabiliter le Polonais et consacrer trois cents pages à son apologie, sans apporter aucun fait nouveau, il faut assurément une sublime fatuité : les compatriotes de M. G. L, de Saint Macaire Watson s’étant chargés de remettre les choses au point (Times du 7 mars 1912), je n’ai rien à ajouter, sauf que les garants de la vertu de Mme Piontkowski me paraissent ou bien naïfs ou étrangement dissolus.
2. ↑ Les médecins de Napoléon à Sainte~Hélène ; Autour de Sainte-Hélène, 3e série.
I
DE MALMAISON AU NORTHUMBERLAND
Parti le 25 juin, à midi, de l’Elysée, par la porte des Champs-Élysées, presque en fugitif, — fuyant les acclamations d’un peuple qui le voulait pour son chef, — Napoléon est arrivé à Malmaison où, depuis la veille, Hortense l’attendait. Elle n’a voulu laisser à personne l’honneur, qui n’est pas sans péril, de recevoir le proscrit en cette maison qui a vu la joyeuse ascension de sa prodigieuse fortune. Quelques serviteurs ont suivi, — peu. Déjà on s’est écarté et certains ont pris leur parti : il s’est trouvé pourtant un écuyer, M. de Montaran, pour chevaucher à la portière, un chambellan ou deux, M. de Las Cases et M. de Beauvau, pour se tenir dans le salon de service ; il s’est trouvé des officiers d’ordonnance en nombre et quelques pages. Le dévouement sied aux jeunes cœurs.
Le projet de l’Empereur semble être de passer aux États-Unis. Sachant que deux frégates, la Saale et la Méduse, étaient à Rochefort prêtes à prendre la mer, il avait, dès le 23 au soir, envoyé le Grand maréchal Bertrand demander au ministre de la Marine qu’on les mît à sa disposition. Decrès n’aspirait qu’à servir l’Empereur ; il avait écrit aussitôt au préfet maritime, M. de Bonnefoux, annonçant la prochaine arrivée d’un ministre de France aux États-Unis qui devait, avec une suite de vingt personnes, embarquer sur les deux frégates : « Ne ménagez rien, ajoutait-il de sa main, pour que la table soit très abondante et très honorable... Terminez tout cela promptement et avec l’intelligence qui vous est particulière, mais surtout avec le plus grand secret. »
Le 24, en même temps qu’il avait insisté pour les frégates auprès de Décrès, lequel ne pouvait rien décider sans prendre les ordres de la Commission provisoire — c’est-à-dire de Fouché, — Bertrand avait réclamé de l’administrateur du Mobilier de la Couronne, le baron Desmazis, « de quoi meubler une maison de ville et une maison de campagne et quelques officiers » ; et il était entré dans le plus minutieux détail, précisant les meubles qu’il fallait pour deux salons, huit chambres de maître à la ville, deux appartements de maître et plusieurs appartements de suite à la campagne ; il avait demandé que ces objets fussent emballés au garde-meuble et ne fussent envoyés à Malmaison que sur avis ultérieur. Desmazis en avait référé à l’instant à l’intendant général Montalivet, lequel, empêché par la goutte d’aller prendre les instructions de la Commission provisoire, avait écrit le 25 à Fouché. En marge, Fouché avait mis : Ajourné,
Le même jour 25, pendant la séance de la Chambre, le ministre de la Guerre avait fait porter par un de ses aides de camp à un représentant, le général de division comte Beker, une lettre où il l'informait que, par arrêté de ce jour, il l'avait « nommé au commandement de la garde de l’Empereur casernée à Rueil ». « L’honneur de la France, avait écrit Davout, commande de veiller à la conservation de sa personne et au respect qui lui est dû. L’intérêt de la patrie exige qu’on empêche les malveillants de se servir de son nom pour exciter des troubles. »
À partir du 25 juin au soir où Beker, avant même de voir l’Empereur, s’était fait reconnaître par la garde, Napoléon était prisonnier. Il se contenta de dire, lorsque Beker lui présenta l’ordre de Davout : « On aurait dû m’informer officiellement d’un acte que je regarde comme une affaire de forme et non comme une mesure de surveillance à laquelle il était inutile de m’assujettir, puisque je n’ai pas l’intention de manquer à mes engagements. »
En faisant choix du général Beker, Davout avait-il compté que la vigilance de cet officier serait accrue par une inimitié personnelle ? On a pu le penser et on l'a dit. Né en Alsace, en 1770, engagé en 1788 dans Languedoc-Dragons, Beker était adjudant commandant lors du Consulat ; il avait combattu à l’Armée du Nord, en Vendée, en Hollande, à l’Armée de Sambre-et-Meuse, à Saint-Domingue, à l'Armée d’Italie, et il avait été grièvement blessé à Cassano. Le Premier Consul, qui l'avait pris en gré, le maria à la sœur de Desaix, le fit, après Hohenlinden, général de brigade et l’envoya commander le Puy-de-Dôme, ce qui était bien une faveur, étant donné que la famille Desaix, tout entière dotée, rentée et titrée par lui, y faisait sa résidence. Général de division après Austerlitz, mis en vue par les campagnes de Prusse et de Pologne, comte de l’Empire sous la dénomination de comte de Mons avec une dotation de 30.000 livres de rentes, Beker, après avoir été en 1807 chef d’état-major de Masséna, avait pris un congé en 1808, puis avait paru demander sa retraite, qui lui avait été accordée. Il avait protesté contre cette décision, avait sollicité d’être rappelé au service, sur quoi l’Empereur lui avait de nouveau donné un commandement. Mais, après la journée d’Essling qui lui avait valu la plaque de grand officier, il avait sollicité d’aller se soigner dans le Puy-de-Dôme ; l’Empereur le lui avait permis et avait ajouté la continuation du traitement d’activité.
Hors d’état d’être employé aux armées, Beker avait été mis en réquisition à l’intérieur, pour faire exécuter les lois sur la conscription, pour défendre Belle-Isle-en-Mer menacée d’une descente anglaise, enfin pour commander, en 1814, la 7e et la 19e divisions militaires. N’ayant reçu des Bourbons que la croix de Saint-Louis, il ne paraissait leur être attaché par nul lien et lorsque, élu par le département du Puy-de-Dôme l'un de ses représentants à la Chambre, il présenta à l’Empereur la députation du collège électoral, il le fit en termes d’une fidélité résolue. Depuis le 20 juin pourtant, il avait été l’objet de diverses désignations qui pouvaient faire douter de son dévouement : ainsi avait-il été adjoint par le ministre de la Guerre au général Grenier pour organiser la défense de Paris et surtout avait-il été nommé membre de la Commission administrative de la Chambre et commandant de sa garde.
Cet homme, comblé des faveurs de Napoléon, ne devait guère — à moins de circonstances ignorées — avoir des revanches à prendre, et, si l’on s’étonne qu’il ait accepté une telle mission, l’on voudrait imaginer qu’il le fit pour se rendre utile à l’Empereur.
Celui-ci ne voulut point voir en Beker un geôlier ; après une longue conversation, il lui dit : « Qu’on me donne les deux frégates que j’ai demandées et je pars à l’instant pour Rochefort ; encore faut-il que je puisse me rendre convenablement à ma destination sans tomber aux mains de mes ennemis. »
Cela n’impliquait-il pas qu’on demandât des passeports aux Anglais, maîtres de la mer ?
Fouché, en s’adressant pour cet objet en même temps à Wellington et Castlereagh, se proposait-il, comme on l’a dit, d’avertir les Anglais et de les mettre en garde contre le départ de l’Empereur ou, plus simplement, d’exécuter les désirs de Napoléon ? Napoléon s’était, de très longue date et dès son enfance, formé, sur la générosité du peuple anglais, des illusions dont aucune expérience n’avait pu le guérir et que d’ailleurs il n’était point le seul de sa famille à partager. Le 25, Lucien était parti pour Boulogne, d’où il devait passer en Angleterre, et c’était dans le dessein prémédité d’y chercher des passeports pour lui et pour tous les siens. Il est vrai que, à Boulogne, ayant causé durant une heure avec le comte Otto qui, parti de Paris le 24, sur les ordres donnés la veille par le Gouvernement provisoire, n’avait pu obtenir, pour passer en Angleterre, la moindre autorisation, il tourna bride. Mais était-ce qu’il craignît un refus ou, comme il l’a dit, qu’il fût pris d’un soudain désir de revoir sa famille, qu’il appréhendât d’être retenu en Angleterre et de ne pouvoir retourner à Rome pour les couches de sa femme ? De l’homme qui avait tout sacrifié pour cette femme, on peut bien le croire. Mais que Lucien, tel qu’on le connaît, se fût porté fort d’avoir raison de tous les obstacles grâce aux amis puissants qu’il avait conservés en Angleterre, rien de plus probable. Sans doute, point de trace qu’il fût venu de sa personne à Malmaison, pas davantage Jérôme ; mais Joseph n’en quittait et il avait désormais assumé la direction de la Famille. Or, Joseph était déterminé à passer aux États-Unis, ainsi que Madame et Fesch. Toute la famille devait s’y réunir. L’Empereur n’a donc pu manquer d’être consulté sur la demande des passeports à son nom et il a certainement approuvé que le Gouvernement fît des démarches a cet effet.
Seulement devait-il en attendre les résultats à proximité de Paris ou au port même d’embarquement ? Depuis que l’Empereur l’avait appelé au ministère de la Guerre, Davout avait constamment préconisé les mesures de rigueur et, sans la résistance de Napoléon, il eût tourné le gouvernement vers les moyens révolutionnaires : peut-être eût-ce été le salut ; tout au moins, eût-on intimidé les traîtres qui venaient de livrer à l’ennemi l’armée et la France ; mais, à présent, Davout était mal venu à reprocher à Napoléon de s’y être opposé et sans doute eût-il été plus généreux et mieux inspiré s’il avait montré moins de hâte à se débarrasser de lui ; cette hâte se traduisait en une exaspération brutale que partageaient plusieurs officiers généraux de son entourage. Craignait-il qu’appelé par les soldats l’Empereur ne reprît le commandement de l’armée et ne le lui ravît ? Avait-il conçu des projets et des ambitions que gênait sa présence ? Croyait-il encore aux déclarations des Alliés qu’ils ne faisaient la guerre qu’à Napoléon et, lui tombé, s’était-il imaginé qu’ils s’arrêteraient, laisseraient la Chambre des représentants et la Chambre des pairs choisir, d’accord avec la Commission de Gouvernement, un prince ou une Constitution ? Qui sait ? Il venait d’écrire à Wellington : « Vos mouvements hostiles continuent quoique, suivant leurs déclarations, les motifs de la guerre que nous font les souverains alliés n’existent plus, puisque l’Empereur a abdiqué. » Et il avait requis le général anglais de cesser toute hostilité et de conclure un armistice en attendant la décision que prendrait le Congrès. On a peine à croire qu’une telle naïveté fût sincère, mais n’a-t-on point vu, en France, les mêmes mots provoquer, à deux reprises au moins, les mêmes incertitudes, les mêmes promesses entraîner les mêmes défections, et l’histoire se recommencer à un demi-siècle d’intervalle ?
Quoi qu’il soit des motifs, Davout voulait que, le plus tôt possible, l’Empereur s’éloignât de Paris et certes, dans la Commission, Fouché en était d’avis, mais, en même temps, ne tenaient-ils pas plus l’un que l’autre qu’il prît la mer et partît pour l’Amérique. En le gardant sous leur main pour le livrer à l’occasion comme victime expiatoire, ils assuraient à leur propre tête une garantie qui n’était point négligeable. De là, cet étrange arrêté en six articles par lequel la Commission enjoint au ministre de la Marine « de donner des ordres pour que les deux frégates du port de Rochefort soient armées pour transporter Napoléon Bonaparte aux États-Unis » ; désigne le général Beker pour le conduire au point de l’embarquement et pourvoir à sa sûreté, et, à l’article V porte : « Les frégates ne quitteront pas la rade de Rochefort avant que les sauf-conduits ne soient arrivés. » Davout signifie à Beker cet arrêté que tous les membres du Gouvernement ont signé, cela indique la part qu’il y a prise.
L’Empereur, auquel Beker a communiqué l’arrêté, n’en accepte point les termes ; par Savary et par Lavallette, il demande que l’article V soit rapporté. Ne croit-il plus que les Anglais lui donneront des passeports ? Veut-il gagner du temps ? Espère-t-il contre l’espérance ? Généraux, députés, pairs de l’Empire s’empressent à Malmaison, demandent qu’il reprenne le commandement de l’armée, qu’il sauve la France d’une nouvelle restauration. À Paris, les ouvriers et les soldats deviennent menaçants, réclament l’Empereur, et le bruit lui en arrive. Qui sait ?
La résistance opposée par l’Empereur semble porter effets.
Le 27 au matin, Fouché écrit à Decrès : « Quant à la disposition de l’article V du décret d’hier relatif au sauf-conduit, la Commission vous autorise à le regarder comme non avenu. Toutes les autres dispositions sont maintenues. » Il ajoute : « Il serait important que l’Empereur partit incognito. »
À onze heures, tout est changé. De Laon, le 26, les plénipotentiaires envoyés au-devant des Alliés, ont écrit : « Des conversations que nous avons eues avec les aides de camp du prince Blücher, il résulte en définitive, et nous avons le regret de le répéter, qu’une des grandes difficultés sera, la personne de l’Empereur. Ils pensent que les Puissances exigeront des garanties et des précautions afin qu’il ne puisse jamais reparaître sur la scène du monde. Ils prétendent que leurs peuples mêmes demandent sûreté contre ses entreprises. Il est de notre devoir d’observer que nous pensons que son évasion, avant l’issue des négociations, serait considérée comme une mauvaise foi de notre part et pourrait compromettre essentiellement le salut de la France. Nous avons d’ailleurs l’espérance que cette affaire pourra se terminer aussi à la satisfaction de l’Empereur, puisqu’ils ont fait si peu d’objections à son séjour et à celui de ses frères en Angleterre qu’ils ont paru préférer à son séjour en Amérique. »
Sur quoi, Fouché écrit à Decrès : « D’après les dépêches que nous avons reçues ce matin, l’Empereur ne peut partir de nos ports sans sauf-conduit : il doit attendre le sauf-conduit en rade. En conséquence l’arrêté d’hier reste dans toute son intégrité et la lettre qui vous a été écrite ce matin pour annuler l’article V est nulle. » À midi, Fouché précise par une nouvelle lettre : « Napoléon Bonaparte, écrit-il, restera en rade de l’île d’Aix jusqu’à l’arrivée des passeports. Il importe au bien de l’État, qui ne saurait lui être indifférent, qu’il y reste jusqu’à ce que son sort et celui de sa famille aient été réglés d’une manière définitive. Tous les moyens seront employés pour que cette négociation tourne à sa satisfaction ; l’honneur français y est intéressé, mais, en attendant, on doit prendre toutes les précautions pour la sûreté personnelle de Napoléon et pour qu’il ne quitte pas le lieu qui lui est assigné. » Ordre à Beker de signifier l’arrêté à l’Empereur et de faire observer à Sa Majesté que « les circonstances sont devenues tellement impérieuses qu’il devient indispensable qu’elle se décide à partir pour se rendre à l’île d’Aix ». Faute par l’Empereur de se conformer à ces injonctions, on exercera la plus active surveillance pour qu’il ne puisse sortir de Malmaison ; on fera garder toutes les avenues qui aboutissent vers le château. « Je vous réitère. Monsieur le général, que cet arrêté a été entièrement pris pour l’intérêt de l’État et la sûreté personnelle de l’Empereur ; sa prompte exécution est indispensable. Le sort futur de Sa Majesté et de sa famille en dépend. »
L’écarter des environs de Paris où sa présence pouvait déconcerter les mesures prises par Fouché ; l’interner à bord d’un navire, prison flottante, d’où il ne pourrait penser à s’évader ; marchander plus ou moins pour le livrer, c’était là tout le plan des membres de la Commission de Gouvernement. Si l’on avait le droit d’hésiter sur la générosité de leur conduite, l’opportunité pouvait leur en sembler démontrée. Les aides de camp de Blücher ne s’étaient point trompés sur les intentions des Alliés ; le même jour 26, où ils avaient eu cette conversation, de Manheim, Metternich et Nesselrode, écrivant au duc de Wellington, lui notifiaient ceci : « Les trois souverains regardent comme condition préalable et essentielle de toute paix et d’un véritable état de repos que Napoléon Bonaparte soit mis hors d’état de troubler dorénavant la tranquillité de la France et de l’Europe. Après ce qui s’est passé en mars dernier, les puissances doivent exiger qu’il soit confié à leur garde. »
Qu’en feraient-ils ? Ils ne savaient trop et ils hésitaient ; le livrer au roi de France qui, sur la simple constatation de son identité, le ferait fusiller, disait lord Liverpool ; le pendre, disait Blücher. Fi ! répondait Lord Wellington ; convient-il à des hommes comme nous, qui avons joué un rôle si éminent dans ces affaires, de devenir des bourreaux ? « Si les souverains, ajoutait-il, veulent le mettre à mort, qu’ils cherchent un bourreau, ce ne sera pas moi. »
L’opinion de Wellington et sa résolution lui faisaient honneur, mais son avis prévaudrait-il ? Les commissaires nommés par Fouché pour traiter de l’armistice ne paraissaient point s’en inquiéter. Le 29, lorsqu’ils rencontrèrent Wellington à Etrées-Saint-Denis, ils lui dirent qu’ils avaient toute raison de croire que Napoléon avait quitté Paris et, au cas qu’il ne l’eut point fait, ils agitèrent diverses combinaisons en vue de s’emparer de lui, de l’envoyer en Angleterre, ou de le confier à l’empereur d’Autriche. À quoi l’Anglais répondit que, s’ils avaient sincèrement l’intention d’en disposer de cette façon, ils auraient mieux fait de l’envoyer soit à lui, Wellington, soit au maréchal Blücher. Ainsi délibérait-on sur son sort et, au moment où ces commissaires offraient ainsi de le livrer, nul d’entre eux ne pensait à stipuler qu’il aurait la vie sauve. Ils se contentaient, au dire de Pozzo di Borgo, de l’assurance qu’il serait traité comme un prisonnier de guerre : prisonnier de guerre des Alliés, sans doute, mais, comme Lord Liverpool devait l’expliquer fort nettement : les Alliés n’auraient qu’à le remettre ensuite à son juge naturel : le roi de France.
La Commission de Gouvernement n’envisageait point expressément cette hypothèse et elle eût résisté à la réaliser, car, si la tête de Napoléon tombait, que de têtes seraient en péril ! Sous cette réserve, elle se fût montrée facile. Pour le moment, elle s’accordait à trouver sa présence à Malmaison importune pour son prestige, dangereuse pour ses desseins, périlleuse pour lui-même qui pouvait être pris ou tué par les éclaireurs de Blücher, si bien que, pour mettre Malmaison à l'abri d’un coup de main, — à moins que ce ne fût pour effrayer l’Empereur, — elle ordonna à Beker de brûler le pont de Chatou. Elle voulait qu’il partit ; mais, elle refusait de rapporter l’article V de son arrêté du 26 ; et Napoléon, de son côté, s’obstinait à ne point quitter Malmaison que cet article ne fût annulé.
Vainement, le 28 au matin, a-t-il envoyé son aide de camp, le général de Flahaut, à la Commission pour demander que les frégates pussent prendre la mer sans attendre les sauf-conduits. Flahaut n’a rien obtenu de Davout qui, très monté de ton, a menacé de faire arrêter l’Empereur, de l’arrêter lui-même s’il ne partait sur-le-champ ; Flahaut, détachant ses épaulettes et les jetant dans la salle avec sa démission, est venu en toute hâte rendre compte à Malmaison.
À une heure de l’après-midi, Joseph écrit au comte Berlier, secrétaire de la Commission, dans les termes les plus pressants, pour réclamer « l’expédition de l’ordre de la Commission provisoire pour le départ des deux frégates qui sont à Rochefort ; dans le cas où l’ordre ne serait point signé, veuillez, dit-il, mettre sous les yeux de M. le duc d’Otrante et de ces Messieurs de la Commission la position de l’Empereur et l’urgence d’une prompte détermination ». Berlier envoie une réponse dilatoire.
Le prince d’Eckmühl, quoi qu’il en eût dit, hésitait à porter la main sur l’Empereur ; mieux valait attendre : quoi ? Peut-être cette nouvelle : « Depuis le 27 juin, écrit de Rochefort M. de Bonnefoux, la croisière anglaise s’est tellement rapprochée de la côte qu’il est presque impossible que les frégates puissent sortir. » Cela arrange tout ; de la sorte, on ne livrera point Napoléon, mais, comme il ne pourra point sortir de Rochefort, il sera contraint de se livrer lui-même, — et cela permettra aux membres du Gouvernement de déclarer qu’ils n’y furent pour rien.
Le 28 au soir, la Commission rapporte donc cet article V : « En conséquence, écrit Fouché à Decrès, les frégates sont mises à la disposition de Napoléon. Rien maintenant ne met obstacle à son départ. L’intérêt de l’État et le sien exigent impérieusement qu’il parte aussitôt après la notification que vous allez lui faire de notre détermination. » Le comte Merlin est adjoint pour cette mission au duc Decrès. « Il importe, ajoute Fouché, que vous partiez pour Malmaison avec M. Merlin au reçu de cet ordre. Le comte Merlin va venir vous trouver. » Le comte Merlin s’étant rendu invisible, c’est Boulay (de la Meurthe) qui accompagne Decrès. Ils arrivent à Malmaison le 29 à la pointe du jour et sont aussitôt reçus. L’Empereur annonce qu’il partira dans la journée.
Est-il sincère ? Depuis la journée de Waterloo, depuis les terribles cinq journées qui ont suivi la défaite, près d’une semaine a passé. La dépression physique et morale qu’il a subie est dissipée. Il est de nouveau en pleine possession de lui-même. Il a constaté l’incertitude, l’absence de plans des médiocres acteurs qui se sont mis en sa place ; ne pouvant admettre, ni qu’ils soient si sots que de croire aux discours des souverains alliés, ni qu’ils poussent l’inconscience jusqu’à livrer aux Bourbons contre de vagues promesses, l’armée et la France ; n’imaginant point que certains de ces hommes se flattent de devenir, dans la révolution imminente, les indispensables modérateurs et les conciliateurs nécessaires. Napoléon n’attend-il pas que, dans l’extrême péril où se trouve la nation, un souffle de patriotisme passe sur des hommes qui, tels que Carnot, Quinette et Fouché ont siégé à la Montagne, ou comme Caulaincourt et Grenier, ont constamment servi la Révolution ; qu’ils viennent à lui, comme au libérateur et que, dans l’unanime acclamation des citoyens et des soldats, ils lui défèrent le commandement suprême ? Tout de suite après l’abdication, il était sincère dans son projet de partir pour les États-Unis ; il était sincère lorsqu’il demandait des passeports anglais et s’inquiétait du mobilier nécessaire à une maison de ville et une de campagne ; mais était-il aussi sincère lorsque, pour éviter ou retarder son départ, il a prétexté le maintien ou le retrait de cet article V ? Un coup de chance qui se présente et il est prêt à le jouer — et seul il peut le jouer. Or le coup s’offre. Poussée par la hâte furieuse de Blücher, l’armée prussienne s’est séparée de l’anglaise : l’une comme l’autre plus éprouvée que la française. Rassemblée sous Paris, en nombre qui étonne, celle-ci forme une masse dont le patriotisme n’a pas été atteint, dont la valeur est intacte et qui, non sans vraisemblance, attribue ses revers à la trahison. À la tête de cette armée que sa présence enflammera, il détruira, l’un après l’autre, Blücher et Wellington. « Je puis encore, a-t-il dit, écraser l’ennemi et donner le temps au Gouvernement de traiter avec les puissances. » Il a épinglé ses cartes d’après les renseignements fournis par Lavallette, par Maret, par Joseph, quantité d’autres, car il y a encore des Français ; il est prêt ; il se sent la résolution et le pouvoir de vaincre. Sa ressource est la guerre, et c’est son génie. Il fait appeler Beker et, devant Madame et Fesch venus pour lui dire adieu, il le prie d’aller à Paris, à la Commission, d’y demander de sa part le commandement de l’armée, « non comme empereur, mais comme général dont le nom et la réputation peuvent encore exercer une grande influence sur le sort de l’Empire ». Après avoir repoussé l’ennemi, il promet de se rendre aux États-Unis pour y accomplir sa destinée.
L’Empereur a compté sur le patriotisme de Fouché. « Se moque-t-il de nous ? répond Fouché à Beker, et ne sait-on pas comment il tiendrait ses promesses, fussent-elles acceptables ? » C’est assez dire qu’il a passé marché ailleurs. « Pourquoi, ajoute-t-il, vous êtes-vous chargé d’une pareille mission, lorsque vous deviez presser l’Empereur de hâter son départ dans l’intérêt de sa sûreté personnelle ? » Beker n’essaie point une justification qui n’eût point été entendue ; il réclame seulement une réponse par écrit. Fouché adresse cette réponse au duc de Bassano : il l'invite à user de son influence pour déterminer l’Empereur à partir sans délai, attendu que les Prussiens marchent sur Versailles et vont le faire prisonnier. « Partez promptement, dit-il à Beker, et transmettez à l’Empereur l’invariable résolution prise par nous de ne plus rien changer aux dispositions des arrêtés dont l’exécution vous est confiée. »
Beker retourne à Malmaison. Tout y annonce la guerre et la rentrée en campagne. Napoléon n’a point douté qu’on n’accepte le salut, fût-ce de ses mains. Il prend de Beker la lettre à l’adresse de Bassano : « Ces gens-là, dit-il seulement, ne connaissent pas l’état des esprits en refusant ma proposition. On s’en repentira ; donnez les ordres pour mon départ ; lorsqu’ils seront exécutés, vous viendrez me prévenir. »
La Commission exécutive avait prétendu que l’Empereur partît seul avec Beker dont il eût passé pour le secrétaire, et qu’un seul domestique l’accompagnât. Dans quel but cet incognito ? Pour éviter l’émotion populaire sur son passage, ou pour le mettre à la merci de la moindre émeute ? pour l’aider à passer en Amérique ou pour le livrer plus aisément aux Anglais ? Si quelques personnes voulaient le rejoindre ensuite, la Commission ne semblait point devoir s’y opposer ; mais elle n’avait point prévu que, en dehors de quelques hommes que leur dévouement entraînerait, quantité de ceux qui se jugeraient le plus compromis vis-à-vis du Gouvernement royal s’attacheraient à la fortune de l’Empereur et refuseraient de se séparer de lui. Au retour de Beker, le Grand maréchal Bertrand expédia, de Malmaison, au préfet de police, un officier porteur d’une lettre réclamant des passeports, à destination de Rochefort, pour six généraux, deux colonels, six chefs d’escadron ou capitaines, puis le chambellan Las Cases et son fils, le page Audifredy-Sainte-Catherine, un secrétaire, un médecin, deux maîtres d’hôtel, un officier et sept domestiques.
D’autres allaient suivre en tel nombre, et certains si inattendus, qu’on ne s’explique point comment ils s’étaient imposés : deux femmes, quatre enfants, quatre officiers, deux employés civils, dix-neuf domestiques, outre les dix portés déjà sur les passeports. Bertrand, bien moins au fait de ses fonctions que Duroc et disposé à tourner tout au grand, ne se contentait qu’à peine de ces vingt-neuf domestiques, même en y ajoutant le personnel nécessaire, sous les ordres du piqueur Chauvin, pour vingt chevaux de selle, quarante-huit d’attelage, neuf voitures. De plus, pour les officiers de la suite, onze domestiques dont quatre femmes : près de cent personnes. Même, Napoléon eût-il volontiers emmené quelques savants et, après avoir renoncé à Monge, trop vieux, avait-il fait effort pour décider Bonpland, le naturaliste voyageur, l’intendant des jardins de Joséphine.
Un tel cortège impliquait un départ ostensible, quasi impérial, excluait toute idée de traversée clandestine ; il y avait là un train qui ne pouvait être embarqué sans encombrer les frégates de façon à les rendre presque impropres à naviguer, entièrement à combattre ; il y avait des hommes qui s’accrochaient à l’Empereur comme les naufragés à la bouée de salut : on n’oserait point le tuer, lui, et ils se sauveraient avec lui ; il y avait des femmes et des enfants qu’on n’eût point exposés de gaieté de cœur. Qu’était-ce à dire ? Ou que Napoléon comptait toujours sur les passeports anglais pour gagner les États-Unis ; ou que, à défaut de passeports, il serait traité par les Anglais comme l’avait été Lucien, et ainsi vivrait-il dans un château, à portée d’une ville, recevrait-il qui il lui plairait, irait-il à peu près où il voudrait, au moins dans un certain rayon, correspondrait-il de même presque librement et mènerait-il somme toute une existence encore souhaitable ?
Que l’on compare sa façon d’agir à celle de Joseph au même moment : Joseph demande à Paris des passeports ; c’est sous des noms d’emprunt ; sa suite, des plus restreintes, se compose d’un homme de confiance, d’un médecin espagnol et d’un interprète américain. Joseph est décidé à passer coûte que coûte aux États-Unis, quitte à y débarquer comme un particulier inconnu, quitte à faire la traversée sur un aventurier, quitte à risquer la visite des croisières anglaises et à s’y dérober par un déguisement.
Napoléon trouve de sa dignité de ne partir qu’en souverain ; si donc il ne reçoit point de passeports, il ne lui reste qu’à se livrer aux Anglais, car, à forcer le passage et à combattre la croisière anglaise, y a-t-il songé ? Decrès, lui, y a pensé. Il voit plus juste que l’Empereur la situation ; ministre des marins, averti des ignominies des pontons anglais, il sait ce que vaut l’hospitalité britannique. L’Empereur doit tout affronter pour s’y soustraire, et passer coûte que coûte. S’il a dû subir les ordres de la Commission de Gouvernement, Decrès n’en a pas moins, depuis le début, témoigné à l’Empereur sa bonne volonté, et sa conduite contraste avec celle de Davout et celle de Caulaincourt. Par les instructions antérieures qu’il a données aux commandants de la Méduse et de la Saale, il a prévu jusqu’aux moindres détails d’installation, mais à présent ses ordres portent sur la sortie de vive force. Il écrit au préfet maritime, dans une lettre datée du 27, mais expédiée seulement le 28 : « Quoique j’aie désigné la Saale pour recevoir la personne de l’Empereur, s’il est reconnu cependant que la Méduse a sur la Saale l’avantage de la marche, Napoléon serait embarqué sur la meilleure marcheuse, et les capitaines Philibert et Ponée changeraient de commandement. » Philibert passait pour un des meilleurs manœuvriers de la marine, et il avait fait ses preuves de bravoure ; Ponée était moins brillant, mais son dévouement était absolu ; le rôle qui lui était réservé était digne de lui.
Le 28, en effet, Decrès recommande que, dès l’embarquement de Napoléon, toute communication cesse avec la terre ; puis il écrit : « Si l’on est obligé de combattre les ennemis en force supérieure, la frégate sur laquelle Napoléon n’est pas embarqué se sacrifiera pour donner à celle sur laquelle il est le temps d’échapper... Les commandants, les officiers et les équipages des frégates trouveront dans leur cœur, et il leur est expressément ordonné, de traiter sa personne avec tous les égards et le respect dus à sa situation et à la couronne qu’il a portée. »
Cet appel à un héroïsme qui, tout à l’heure, n’aura pas besoin d’être commandé pour s’offrir, devait rester inutile. Dès que l’Empereur voyait s’anéantir cet espoir suprême d’une revanche à prendre en combattant, et que désormais il devait considérer formellement « sa vie politique comme terminée », peu semblait lui importer. Sa dignité lui interdisait la sortie clandestine ; cette foule qui s’attachait à lui rendait impossible la sortie de vive force ; une seule solution, dès lors : attendre les passeports ; on lui annonçait qu’il les trouverait à Rochefort. Soit ! D’ailleurs il s’abandonnait aux destins, et lui, qui avait toujours commandé, il obéissait.
Il a fait ses adieux à sa mère, à Fesch, à Hortense, — celle-ci la dernière, qui, jusqu’au bout, avec une grâce inimitable, a rempli son rôle de maîtresse de maison, qui y a porté quelque chose de plus que ses formes habituelles de déférence aimable et froide, une sorte de tendresse compatissante, assez filiale pour être comprise, — qui, tandis que tous les autres demandaient de l’argent à l’Empereur, a eu la pensée de lui apporter son plus beau rang de chatons, le suppliant de l’accepter, — comme avait fait Pauline l’année précédente, au départ de l’île d’Elbe,
À cinq heures du soir, il quitte Malmaison, mais ce n’est point par la cour d’honneur où l’attendent, attirés par les voitures qu’on y a fait ranger, les officiers et les soldats empressés à l’acclamer ; c’est par le parc, comme à la dérobée. À une grille de dégagement attend une calèche attelée de quatre chevaux. Beker l’a fait préparer contre les ordres de la Commission. L’Empereur y monte avec les généraux Bertrand, Savary et Beker. Un valet de chambre prend place sur le siège : on part au galop.
À Rambouillet, l’Empereur s’arrête. Il y voit le concierge, le vieil Hébert, « qui fut de sa chambre en Égypte », soupe, passe dans sa chambre à coucher avec Bertrand, s’y enferme. Au bout d’un temps assez long, Bertrand sort, annonce à Beker que l’Empereur, très fatigué, s’est mis au lit. Il espérait encore.
Le 30, à onze heures du matin, on repart, les équipages de la suite quelques heures après. De Rambouillet à Tours, rien. On est à Tours le 1er juillet, au soleil levant. L’Empereur fait chercher le préfet, M. de Miramon, qui est son chambellan et qui a prouvé dans l’Eure, en 1814, comme il entend le devoir. A-t-il reçu un courrier ? — Non. Malgré les instances de Miramon, qui le supplie « de venir se reposer à la préfecture, l’assurant qu’il n’a rien à craindre d’une population pleine de reconnaissance pour tout ce qu’il a fait dans le pays », il repart.
À Poitiers, il s’arrête à huit heures à la maison de poste et invite Beker à envoyer un courrier au préfet maritime de Rochefort « pour l’engager à venir à sa rencontre. Il désire connaître l’état des frégates mises à sa disposition et s’entendre avec lui sur la possibilité et les moyens de sortir de l’île d’Aix ». À Saint-Maixent, ville bleue que le voisinage de la Vendée rend nerveuse, du monde s’assemble lors de l’arrivée de la calèche. On demande les passeports, et Beker a quelque peine à se les faire rendre ; mais, à tort craindrait-on : Saint-Maixent tout entier acclamerait l’Empereur. À Niort, où il arrive à dix heures du soir, il descend à la poste et veut se reposer. Le préfet, M. Busche, averti de sa présence vers minuit par Savary, se rend à l’auberge et supplie l’Empereur de venir à la préfecture. Il s’y établit le 2 au matin. Aussitôt le peuple et les soldats s’empressent.
Beker reçoit la réponse de M. de Bonnefoux à la lettre écrite de Poitiers. Cet officier se dit malade, refuse de venir de sa personne, confirme que, depuis le 27 juin, la croisière s’est tellement rapprochée de la côte, qu’il est presque impossible que les frégates puissent sortir.