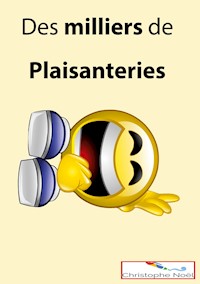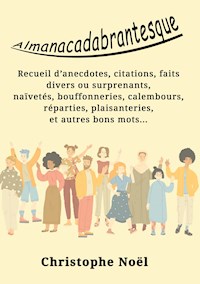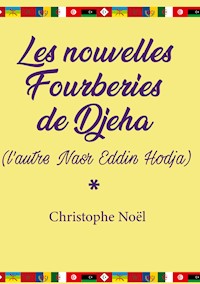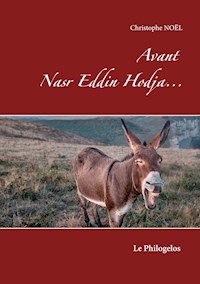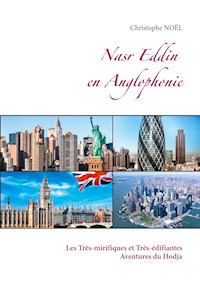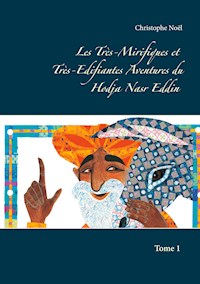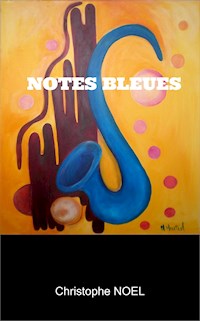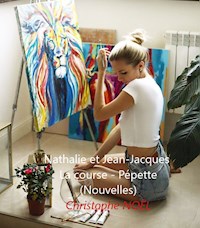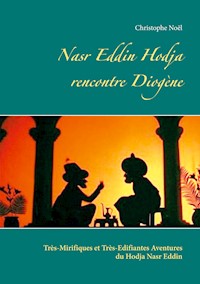
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les Très-Mirifiques et Très-Édifiantes Aventures du Hodja Nasr Eddin
- Sprache: Französisch
Compilation de 150 fables ou anecdotes issues du folklore greco-turc, ayant pour héros le personnage mythique de Nasr Eddin Hodja (sagesse populaire - philosophie soufie). Comparées à 200 anecdotes de la vie de Diogène de Sinope. - Tradition ésopique. Que sait-on de Nasr Eddin Hodja ? Ce personnage de contes philosophico-comiques a bien existé au XIII° siècle, en Turquie, où il a fréquenté le poète soufi Rûmi. Cependant, on le trouve un peu partout, depuis les confins de l'Asie et de l'Arabie, sous les noms d'Apendi, Jouha, Goha ; en passant par le monde Juif sous le nom de Ch'ha ; jusqu'en Sicile et au Maghreb, sous les noms de Jeha, Giufà, où il s'est adapté aux traditions locales. Il semblerait que Voltaire s'en soit inspiré pour son personnage de Candide, tandis qu'on le retrouve parfois chez Molière, sous les traits de Scapin - notamment. Certaines versions le font même vivre à New-York (ouvrage à paraître à ce sujet) où il fréquente un psychanalyste ! Dans cet ouvrage ne sont repris que les anecdotes issues de l'Orient originel, dont certaines parues à Smyrne ou Constantinople dès 1848.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autres publications de l’auteur
EBOOKS (Version numérique):
Errances – recueil de nouvelles (BOD)
Exquises Esquisses, Tomes 1 et 2 – galerie de portraits (BOD)
Notes Bleues – écrits divers (BOD)
Nathalie et Jean-Jacques – recueil de nouvelles (BOD)
Les Très-mirifiques et Très-édifiantes Aventures du Hodja Nasr Eddin Tome 1 (BOD)
Les Ysopets – 1 – Avianus (BOD)
Les Ysopets – 2 – Phèdre version complète latin-français (BOD)
Les Ysopets – 2 – Phèdre version en français (BOD)
Jacques Merdeuil – nouvelle - version française (Smashwords)
Jacques Shiteye – version anglaise – traduit par Peggy C. (Smash-words)
Ζάκ Σκατομάτης – version grecque – traduit par C. Voliotis (Smash-words)
Le Point Rouge –nouvelle - version française (Smashwords)
The Red Dot - version anglaise – traduit par Peggy C. (Smashwords)
VERSION PAPIER :
Les Très-mirifiques et Très-édifiantes Aventures du Hodja Nasr Eddin Tome 1 (BOD)
Nasr Eddin sur la Mare Nostrum –
Tome 3
(disponible chez l’auteur)
Le Sottisier de Nasr Eddin –
Tome 4
(disponible chez l’auteur)
Commandes – dédicaces : [email protected]
Sommaire
INTRODUCTION
1ère partie : Diogène de Sinope
2ème partie : Nasr Eddin
Glossaire
BIBLIOGRAPHIE
INTRODUCTION
Nasr Eddin et Diogène, un peu d’histoire
J’étais de retour en Grèce, après trente longues années d’absence. Dans un bled, j’entame une conversation avec un papou (παπόυς : grand-père) trônant sur une chaise de paille, le komboloï à la main. A un moment de la conversation, je cale :
-- Pardon, dis-je au noble vieillard, j’ai été longtemps à l’étranger, et j’ai un peu oublié la langue…
-- C’est que tu l’auras mal apprise alors, me rétorque-t-il indigné ; le Grec ne s’oublie pas !
-- Ah oui, d’accord. Et parce que vous parlez quelles autres langues en-dehors de la grecque ?
-- Aucune, le grec me suffit.
Ça aurait pu être du Nasr Eddin… Il faut dire que la Grèce, c’est ce bout de terre, empli de cailloux (tu donnes un coup de pied dans un caillou, me disait-on enfant, tu disperses un monument antique), d’herbes sauvages, et battu par les vents.
En chaque Grec, un philosophe sommeille, qui ne demande qu’à s’éveiller. Gamin, j’entendais dire que partout ailleurs dans le monde les hominidés sautaient de branche en branche, alors que les Grecs Anciens philosophaient déjà. Et ils en sont fiers, de leur histoire, d’un passé glorieux qui n’est pas le leur, mais qu’ils ont intégré. Le Grec ne vit pas au jour le jour, comme il cherche à nous le faire accroire, mais hors du temps, dans les éthers de l’éternité.
Philippe et Alexandre, rappelons-le, n’étaient pas Grecs mais Macédoniens, et ils ont soumis la Grèce entière, et élargi ses frontières aux confins de l’Inde et aux Colonnes d’Hercule.
Mais ça ne fait rien. On a bien rigolé quand même, avec tous ces philosophes : Socrate, Platon, Aristote, Diogène …
Diogène
Diogène ? Diogène de Sinope, également appelé Diogène le cynique, philosophe grec de l'Antiquité et le plus célèbre représentant de l'école cynique (Sinope v. 413 – Corinthe, v. 327 av. J.-C.). Il est contemporain de Philippe II de Macédoine, qui le fit prisonnier après la bataille de Chéronée, et de son fils Alexandre.
Disciple de Xéniade et d'Antisthène, il devient le maître, entre autres, de Monime. Parmi tous les auteurs cyniques, c'est sur Diogène que la légende a accumulé le plus d'anecdotes et de mots d’esprit, issus notamment de l'ouvrage de Diogène Laërce ; cette foison rendant leur authenticité douteuse. Les portraits de Diogène qui nous ont été transmis divergent parfois, le présentant tantôt comme un philosophe, débauché, hédoniste et irréligieux, tantôt comme un ascète sévère, volontaire, voire héroïque.
La masse d'anecdotes légendaires sur Diogène de Sinope montre en tout cas que le personnage a profondément marqué les Athéniens. Ce premier anarchiste de l’Histoire vivait dehors, dans le dénuement, vêtu d'un simple manteau, muni d'un bâton, d'une besace et d'une écuelle. Dénonçant l'artifice des conventions sociales, il préconisait en effet une vie simple, plus proche de la nature, et se contentait d'une grande jarre couchée sur le flanc — en grec pithos — pour dormir.
Diogène avait l'art de l'invective et de la parole mordante. Il semble qu'il ne se privait pas de critiquer ouvertement les grands hommes et les autres philosophes de son temps (parmi lesquels Platon).
Un personnage dans les pas duquel marchera le légendaire Nasr Eddin.
Nasreddine
Nasr Eddin Hodja, parfois orthographié Nasreddin ou Nasreddine (victoire de la religion), ou encore Nasrudin, est un personnage mythique de la culture musulmane, philosophe d'origine turque né en 1208 à Sivrihisar (dans le village de Hortu) et mort en 1284 à Akşehir.
Ouléma (ou mollah) ingénu et faux-naïf prodiguant des enseignements tantôt absurdes tantôt ingénieux, sa renommée va des Balkans à la Mongolie et ses aventures sont célébrées dans des dizaines de langues, du serbo-croate au persan en passant par le turc, l'arabe, le grec, le russe et d'autres.
Nasr Eddin vit en général à Akşehir (Turquie), dans le village de Hortu où il est né et a un cénotaphe. Il est le fils de l'imam Abdullah Efendi et de Sıdıka Hanım. Ses histoires ont parfois pour protagonistes le terrible conquérant Tamerlan (Timour Lang), pour qui il joue le rôle de bouffon insolent bien que la situation soit anachronique. D'autres histoires mettent en scène son âne et sa première femme Khadidja ; il exerce parfois la fonction de Cadi voire d'enseignant dans une médersa.
Un ou plusieurs Nasreddine ?
Il aurait vécu au VIIIe siècle à Koufa, un village d'Irak mais deux tombes existeraient : l'une dans un village d'Anatolie et l'autre en Algérie.
Cette version n’est pas si aberrante qu’elle peut le paraître, à première vue. Il existe en effet, dans le folklore italien, et, plus particulièrement sicilien, un personnage nommé Giufà, appelé parfois Giucà.
Si l'on en croit Italo Calvino, Leonardo Sciascia et d'autres, le personnage se serait développé à partir d'histoires racontées à propos de Nasr Eddin Hodja, célèbre dans la tradition populaire turque. On pense que, à l'époque où l'île de Sicile était sous domination musulmane, du IXe au XIe siècle, des histoires sur Nasr Eddin ont été absorbées par la tradition orale sicilienne, avant d'être transformées pour illustrer les normes culturelles, et finalement se transmettre à travers tout le sud de l'Italie.
C’est tout à fait digne de Nasr Eddin : que l’on conte ses exploits avant même sa naissance officielle !
J’ai par ailleurs, découvert des versions de Nasreddine à New York ! Un peu comme Tintin, sauf que l’Amérique a été « découverte » par Christophe Colomb… en 1492 !
Dernière remarque : dans le folklore grec, Nasr Eddin est un intime, comme ce fameux Karaghiozi (Karagheuz en turc), héros du théâtre d’ombres. Au point que parfois, un seul « Hodja », sans article ni autre précision, suffit à le caractériser.
Rûmi
Or il se trouve que Nasreddine est contemporain de Rûmi. Djalāl ad-Dīn Muḥammad Balkhi ou Rûmî, né à Balkh (actuel Afghanistan) dans le Khorasan (grande région de culture perse), le 30 septembre 1207 et mort à Konya (dans l'actuelle Turquie) le 17 décembre 1273, est un poète mystique persan qui a profondément influencé le soufisme.
Son prénom, Djalal-el-din, signifie « majesté de la religion » (de djalâl, majesté, et dîn, religion, mémoire, culte). Quant à sa nisba (l'indication de son origine), elle renvoie soit à Balkh (le « balkhien ») ou à Byzance (RûmÎ: le « byzantin »). Il reçut très tôt le titre de Mawlānā, « notre maître », souvent écrit Mevlana, qui est devenu intimement lié à l'ordre des « derviches tourneurs » ou mevlevis, une des principales confréries soufies, qu'il fonda dans la ville de Konya. Il a écrit la majorité de ses œuvres en persan (farsi).
Son œuvre est profondément marquée par sa rencontre avec celui qui deviendra son maître spirituel, Shams ed Dîn Tabrîzî, dont le prénom signifie « soleil de la religion ». Il en fera même l'auteur de l'un de ses ouvrages, le Divân de Shams de Tabriz.
Rûmî aurait également repris à son compte certaines fables d'Ésope (via le célèbre Kalila et Dimna d'Ibn al-Muqaffa) dans son principal ouvrage le Masnavi (ou « Mathnawî », « Mesnevi »). Les Turcs, Iraniens, Afghans et autres populations de la région font montre de respect pour ses poèmes. Reconnu de son vivant comme un grand spirituel et comme un saint, il fréquentait les chrétiens et les juifs tout autant que les musulmans.
Diogène et Nasreddine, de nombreux points communs
En traduisant hier une historiette de Nasreddine, en vue du deuxième tome que je compte publier sur le personnage, je suis tombé sur l’anecdote que voici :
Le jour où la femme du hodja mit au jour un garçon, la sage-femme ainsi que les autres femmes qui l’assistaient appelèrent le père du nouveau-né :
-- Allez viens, mollah, coupe toi-même le cordon ombilical de ton fils, vu que tu as la main heureuse.
Nasr Eddin s’empara du cordon et, au lieu de le couper là où il aurait dû, bien proprement avec des ciseaux, il tira fortement et l’arracha à la racine, laissant un trou sur le ventre de l’enfant.
-- Mais que fais-tu, insensé ? crièrent affolées les commères.
-- Pas grave, fit-il. Il a déjà tant de trous ; un de plus ou de moins…
J’ai été ébranlé par ce texte. Non, décidément, je ne le trouvais pas drôle. Pas drôle du tout, même. Pire, en tant que père privé par deux fois des joies de l’accouchement, j’ai été profondément choqué. Un père n’agit pas, ne peut pas agir ainsi avec son enfant.
Puis je me suis souvenu que ses textes avaient une portée philosophique, sinon mystique. Car Nasreddine est non seulement lettré, même s’il joue volontiers au naïf, et qui plus est, contemporain de Rûmi, le poète Mevlana des derviches tourneurs, école mystique de l’islam.
Tout porte à croire qu’ils se sont fréquentés, et d’ailleurs les enseignements du hodja portent l’empreinte du soufisme.
C’est cette liberté de ton, ce cynisme affiché, cette irrévérence enfin qui rapprochent notre héros de Diogène, son lointain précurseur, et un de mes personnages historiques favoris.
Non contents de brocarder leurs contemporains et leurs défauts, ils se montrent tous deux critiques à l’égard de l’autorité des puissants ; Nasreddine vis-à-vis de Tamerlan généralement, Diogène face à Alexandre auquel il demande de s’ôter de son soleil.
Bien sûr, Nasreddine est bien plus connu de par le vaste monde musulman, auquel il appartient. Mais en Europe, dans les anciens territoires conquis par l’Ottoman, des portes de Vienne à la Crimée, en passant par l’ancienne Yougoslavie, l’Albanie, la Grèce, la Bulgarie et une bonne partie de la Roumanie, son enseignement reste vivace.
J’ignore ce qu’il en est des autres pays, mais ce que je peux dire en tout cas, c’est que la ressemblance entre les deux personnages est telle, qu’en Grèce les aventures de l’un pourraient être assez aisément confondues avec celles de l’autre, les réparties se ressemblant tellement. Pour moi, ce dernier est l’héritier spirituel du cynique à la jarre.
Les philologues grecs comparent néanmoins Nasreddine à Ésope1, dont ils font un descendant. Ésope est un conteur, un moralisateur, tout comme la ribambelle d’auteurs2 qui ont marché dans ses pas, dont Jean de la Fontaine3 et Florian4.
Or chez Nasr Eddin, il y a des histoires où il se révèle un antihéros, se faisant duper (comme dans le pet devenu proverbial, ou l’économie du foyer, la vache vendue au marché qu’il rachète, l’âne invendable, – entre autres).
Derrière tout ceci, l’origine de ces fables remontant à l’Antiquité Assyro-Mésopotamienne (cela explique l’apparition des histoires de Nasr Eddin/Jeha/Goha en Sicile au IX° siècle, bien avant la naissance du personnage historique au XIII°). De plus, chez Nasreddine, s’ajoute la dimension du mysticisme soufi, dont Rûmi fut un des phares – Rûmi d’ailleurs admis au nombre des continuateurs de l’œuvre d’Esope…
Rompons donc l'os et suçons la substantifique moelle ...
PS : Un glossaire en fin d’ouvrage explique tous les termes en gras et italiques
1 Ésope (en grec ancien Αἴσωπος / Aísôpos, VIIe – VIe siècle av. J.-C.) est un écrivain grec d'origine phrygienne, à qui on a attribué la paternité de la fable.
2 Voir Les Ysopets 1 et 2, Avianus et Phèdre, ainsi que l’introduction d’Esope – à paraître à ce jour. ( chez le même Editeur).
3 Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril 1695 à Paris.
4 Jean-Pierre Claris de Florian, né à Sauve le 6 mars 1755 et mort à Sceaux le 13 septembre 1794, est un auteur dramatique, romancier, poète et fabuliste français.
1ère partie : Diogène de Sinope
Les passages suivants sont extraits de « Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres » de Diogène Laërce. Diogène Laërce (en grec ancien Διογένης Λαέρτιος / Diogénês Laértios) est un poète, un doxographe et un biographe du début du IIIe siècle.
On sait peu de choses sur Diogène Laërce. Le fait est d'autant plus ironique qu'il représente souvent l'unique source que nous ayons sur la vie et les doctrines de nombreux philosophes. C'est, par exemple, uniquement par lui que nous connaissons les lettres d'Épicure et ses maximes capitales, ainsi que les testaments de certains philosophes.
Diogène, fils du banquier Hicésias, était de Sinope. Dioclès dit que son père tenait la banque publique et avait altéré les monnaies, ce qui obligea Diogène à fuir. Eubulide prétend, au contraire, dans le livre sur Diogène, qu’il était personnellement coupable et fut banni avec son père ; et, en effet, Diogène s’accuse, dans le livre intitulé la Panthère, d’avoir altéré la monnaie. Quelques auteurs racontent qu’ayant été mis à la tête de la monnaie, il prêta l’oreille aux suggestions des ouvriers et alla à Delphes ou à Délos demander à l’oracle s’il devait faire, dans sa patrie, ce qu’on lui conseillait.
La réponse fut favorable ; mais Diogène, ne comprenant pas que l’expression change la monnaie, pouvait s’appliquer aux moeurs et aux usages, altéra le titre de l’argent ; il fut découvert et exilé, selon quelques-uns ; suivant d’autres, il eut peur et s’expatria. D’après une autre version, il altéra l’argent qu’il avait reçu de son père : celui-ci mourut en prison ; quant à lui, étant parvenu à fuir, il alla à Delphes demander à l’oracle, non point s’il devait falsifier les monnaies, mais quel serait le meilleur moyen de parvenir à la célébrité; et il en reçut la réponse dont nous avons parlé.
Arrivé à Athènes, il alla trouver Antisthène, qui le repoussa sous prétexte qu’il ne voulait recevoir aucun disciple. Mais Diogène triompha de ses refus par sa persévérance.
Il portait une besace qui renfermait sa nourriture et ne faisait aucune différence des lieux, mangeant, dormant, discourant partout où il se trouvait. Il disait à ce sujet, en montrant le portique de Jupiter et le Pompéum, que les Athéniens avaient pris soin de le loger. L’été, il se roulait dans le sable brûlant, et l’hiver, il tenait embrassées des statues couvertes de neige ; en un mot, il ne négligeait aucun moyen de s’exercer au courage et à la patience. Il était d’ailleurs mordant et méprisant dans ses discours : il appelait l’école d’Euclide un lieu de colère5 et l’enseignement de Platon un assommoir6. Il disait que les jeux dyonisiaques étaient de grandes merveilles pour les fous et que les orateurs sont les serviteurs de la multitude.
1. Il remarqua un jour que dans un repas somptueux Platon ne mangeait que des olives : « Comment ! lui dit-il, grand sage, tu as traversé la mer pour aller en Sicile chercher une table servie comme celle-ci, et maintenant qu’elle est devant toi, tu n’en jouis pas !
— Je te jure par les dieux, Diogène, reprit Platon, que, même en Sicile, je me contentais le plus souvent d’olives et de mets de ce genre.
— En ce cas, répliqua-t-il, qu’avais-tu besoin d’aller à Syracuse ; est-ce qu’alors l’Attique ne produisait point d’olives ?
2. Une autre fois étant à manger des olives, il rencontra Platon et lui dit :
-- Tu peux partager avec moi.
Platon en prit et les mangea ; alors Diogène reprit :
-- Je t’avais dit de partager, mais non pas de manger.
3. Il se rendit un jour à une réunion où Platon avait invité quelques amis, à leur retour de la cour de Denys, et il se mit à fouler aux pieds les tapis en disant :
-- Je foule la vanité de Platon.
— Et moi, reprit Platon, j’entrevois beaucoup d’orgueil sous ton mépris de la vanité.
4. Sotion rapporte, au quatrième livre, un autre mot du cynique à Platon ; Diogène lui ayant demandé du vin et des figues, il lui envoya toute une amphore de vin :
-- Te voilà bien, lui dit Diogène, si on te demande combien font deux et deux, tu répondras : vingt ; tu ne sais ni donner ce qu’on te demande, ni répondre aux questions qu’on t’adresse » allusion piquante à ses interminables discours.
5. On lui demandait en quel lieu de la Grèce il avait vu des hommes courageux :
-- Des hommes, dit-il, je n’en ai vu nulle part ; mais j’ai vu des enfants à Lacédémone.
6. II discourait un jour sérieusement et personne ne l’écoutait ; alors il se mit à débiter des balivernes, et vit une foule de gens s’empresser autour de lui :
-- Je vous reconnais bien, leur dit-il, vous accourez auprès de ceux qui vous content des sornettes, et vous n’avez qu’insouciance et dédain pour les choses sérieuses.
7. Ménippe raconte dans le Diogène vendu qu’il fut fait prisonnier et mis en vente, et qu’interrogé alors sur ce qu’il savait faire, il répondit :
-- Commander aux hommes.
S’adressant ensuite au héraut, il lui dit :
-- Demande si quelqu’un veut acheter un maître.
Comme on lui défendait de s’asseoir :
-- Qu’importe ? dit-il, on achète bien les poissons sans s’inquiéter comment ils sont placés.
8. Xéniade l’ayant acheté, il lui dit que, quoiqu’il fût le maître de Diogène, il devait lui obéir, de même qu’on obéit à un médecin ou à un pilote, sans s’inquiéter s’ils sont esclaves.
9. Eubulus rapporte dans l’ouvrage intitulé Diogène vendu qu’il élevait de la manière suivante les enfants de Xéniade : après les exercices littéraires, il leur montrait à monter à cheval, à tirer de l’arc, à manier la fronde et à lancer le javelot. Il les conduisait ensuite à la palestre ; mais il se gardait bien de les confier au maître pour les exercer comme des athlètes ; il les exerçait lui-même modérément, jusqu’à ce qu’une légère rougeur colorât leurs joues et seulement comme mesure hygiénique. A la maison, il les habituait au service domestique, et leur apprenait à se contenter d’une nourriture légère et à boire de l’eau. Il les menait avec lui dans les rues, la tête rasée jusqu’à la peau, sans aucun ornement, sans tunique, nu-pieds, en silence et les yeux baissés ; il les conduisait aussi à la chasse. De leur côté, ils avaient grand soin de Diogène et le recommandaient à leurs parents.
10. Eubulus rapporte encore qu’il vieillit auprès de Xéniade dont les fils l’ensevelirent à sa mort. Xéniade lui ayant demandé comment il voulait être enterré, il répondit :
-- Le visage contre terre.
Comme on voulait en savoir la raison, il dit :
-- C’est que dans peu ce qui est en bas sera en haut ; faisant allusion à la puissance macédonienne qui, partie de faibles commencements, commençait à grandir et à devenir dominante.
11. Conduit dans une maison splendide par quelqu’un qui lui défendit de cracher, il lui cracha au visage en disant qu’il n’avait pas trouvé d’endroit plus sale.
12. Hécaton dit dans le premier livre des Chries qu’il se mit un jour à crier :
-- Hommes, accourez !
Et que beaucoup de gens s’étant approchés, il les écarta avec son bâton en disant :
-- J’’ai appelé des hommes et non des ordures.
13. On assure qu’Alexandre disait que s’il n’était pas Alexandre il voudrait être Diogène.
14. Les véritables estropiés, disait Diogène, ne sont pas les sourds et les aveugles, mais ceux qui n’ont pas de besace.
15. Métroclès raconte dans les Chries, qu’étant entré un jour à demi rasé dans un festin de jeunes gens, il reçut des coups, et que pour se venger il suspendit à son col un écriteau sur lequel il avait mis les noms de ceux qui l’avaient battu, et se promena ainsi par la ville, les couvrant de honte et les exposant à l’indignation et à la censure publique.
16. Il disait qu’il était chien de chasse, de ces chiens que beaucoup de gens louent, mais sans oser chasser avec eux.
17. Quelqu’un ayant dit devant lui :
--Je triomphe des hommes aux jeux pythiques.