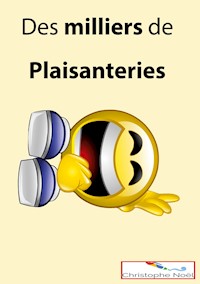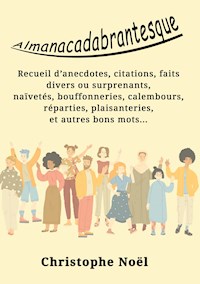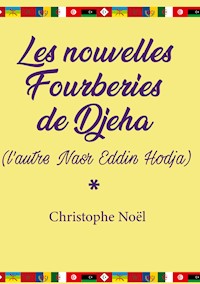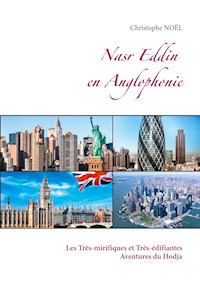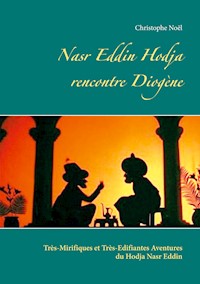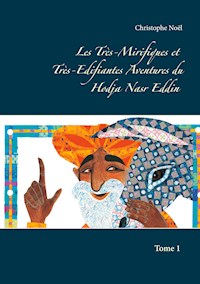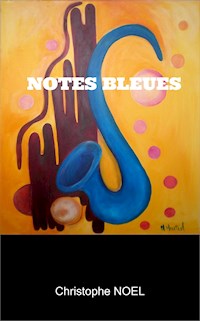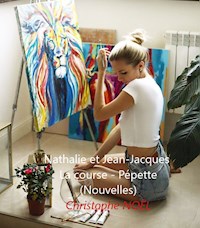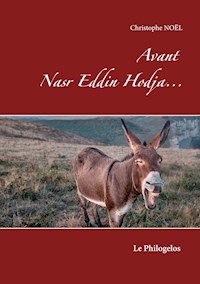
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Les Très-Mirifiques et Très-Édifiantes Aventures du Hodja Nasr Eddin
- Sprache: Französisch
Le recueil Philogelos (signifiant "Ami du Rire") a été retrouvé dans un certain nombre de manuscrits dont aucun n'est antérieur au 10ème siècle . Les auteurs présumés en seraient deux grammairiens, Hiéroclès et Philagrios, ayant vécu au 3ème siècle de notre ère. Beaucoup des anecdotes du Philogelos se retrouveront ultérieurement, tradition orale oblige, avec comme protagoniste notre sympathique personnage oriental. C'est pour cette raison que je l'ai inséré dans la série des Nasr Eddin. Après un détour en nos temps modernes avec Nasr Eddin en Anglophonie, il y fera pendant à l'ouvrage Nasr Eddin rencontre Diogène.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Autres publications de l’auteur
Introduction
Avis du Traducteur
Philogelos
AUTRES PUBLICATIONS DE L’AUTEUR
- Les Très-mirifiques et Très-édifiantes Aventures du Hodja Nasr Eddin Tome 1 (BOD)
- Nasr Eddin Hodja rencontre Diogène – Tome 2 (BOD)
- Nasr Eddin sur la Mare Nostrum – Tome 3 (chez l’auteur)
- Le Sottisier de Nasr Eddin – Tome 4 (BOD)
- Nasr Eddin en Anglophonie – Tome 5 ( BOD)
EBOOKS (Version numérique):
- Errances – recueil de nouvelles (BOD)
- Exquises Esquisses, Tomes 1 et 2 – galerie de portraits (BOD)
- Notes Bleues – écrits divers (BOD)
- Nathalie et Jean-Jacques – recueil de nouvelles (BOD)
- Les Très-mirifiques et Très-édifiantes Aventures du Hodja Nasr Eddin – Tome 1 (BOD)
- Nasr Eddin Hodja rencontre Diogène – Tome 2 (BOD)
- Le Sottisier de Nasr Eddin – Tome 4 (BOD)
- Nasr Eddin en Anglophonie – Tome 5 ( BOD)
- Les Ysopets – 1 – Avianus (BOD)
- Les Ysopets – 2 – Phèdre – version complète latin-français (BOD)
- Les Ysopets – 2 – Phèdre – version Découverte en français (BOD)
- Les Ysopets – 3 – Babrios – version Découverte en français (BOD)
- Les Ysopets – 4 – Esope – version Découverte en français (BOD)
- Les Ysopets – 5 – Aphtonios – version en français (BOD)
- Les Fabulistes Classiques – 1 – Bensérade (BOD)
- Les Fabulistes Classiques – 2 – Abstémius - Hecatomythia (BOD)
- Les Fabulistes Classiques – 3 – Florian (BOD)
- Les Fabulistes Classiques – 4 – Iriarte – Fables Littéraires (BOD)
- Les Fabulistes Classiques – 5 – Perret – 25 Fables illustrées (BOD)
- Les Fabulistes Classiques – 6 – Krilov - Basni (BOD)
- Histoire et avantures de Milord Pet (BOD)
- Eloge du Pet (BOD)
- Discours sur la Musique Zéphyrienne (BOD)
- De la Servitude volontaire – ou Contr’Un
- La Désobéissance civile
- Jacques Merdeuil – nouvelle - version française (Smashwords/ Google)
- Jacques Shiteye – version anglaise – traduit par Peggy C. (Smashwords/Google)
- Ζάκ Σκατομάτης – version grecque – traduit par C. Voliotis (Smashwords/Google)
- Le Point Rouge –nouvelle - version française (Smashwords/Google)
- The Red Dot - version anglaise – traduit par Peggy C. (Smashwords/Google)
- Sue Ann – novela (Google)
Commandes – dédicaces : christophenoel2020 [at] gmail.com
Et maintenant une nouvelle page sur Facebook : « Les aventures de Nasr Eddin Hodja »
INTRODUCTION
Précision liminaire : Pour la présente édition de Φιλόγελως, le document de base utilisé est celui d’Albert Thierfelder, ‘‘Philogelos. Der Lachfreund’‘ (Munich : Heimeran, 1968). Certaines anecdotes se présentent sous deux voire parfois trois occurrences ; une seule est traduite et présentée.
Le recueil Φιλόγελως (Philogelos, signifiant « Ami du Rire ») a été retrouvé dans un certain nombre de manuscrits dont aucun n’est antérieur au Xème siècle.
Les auteurs présumés en seraient deux grammairiens, Hiéroclès et Philagrios, ayant vécu au IIIème siècle de notre ère.
En fait, on ne sait quasiment rien sur eux, si ce n’est que leur recueil est postérieur à 248, car la blague 62 de l’athlète fait référence au millénaire de Rome, célébré cette année-là. Par ailleurs, on en sait encore moins sur leur contribution à l’ouvrage, l’écriture conjointe de deux ou plusieurs auteurs étant quelque chose d’absolument inusité dans la littérature antique.
Certains commentateurs identifient Hiéroclès au philosophe d’Alexandrie, néoplatonicien ou néopythagoricien (sauf que ce dernier vécut au Vème siècle). Il fut notamment l’auteur de Commentaires sur les Vers d’Or de Pythagore. Mais cela demeure une hypothèse. La chose n’est pas confirmée par des spécialistes byzantins comme Fotios (Bibliothèque 214, 251) ni par le dictionnaire encyclopédique du Xème siècle, connu sous lenom de Souda ou Suida.
Philagrios pose le même problème, malgré l’existence du sophiste homonyme, mentionné par Philostratos dans la Vie des Sophistes, 578, et de différentes personnalités dans la période entre 260 et 567, figurant avec ce nom dans Prosopography of the Later Roman Empire (Cambridge, 1980).
La situation se complique davantage avec la référence de la Souda à un certain Philistion de Pruse (ou de Nicée), un écrivain comique de l’époque d’Auguste, auteur de « comédies biologiques », c’est-à-dire des mimes - genre du théâtre antique, présentant des sujets quotidiens de manière comique. La Souda précise également que ledit Philistion a aussi écrit un livre avec pour titre Philogelos. Il n’y a cependant aucun élément permettant de faire le lien entre celui-ci et notre ouvrage en question.
Selon Louis Robert, historien et archéologue spécialiste de la Grèce Antique, le fond du texte a été rédigé au IIIème siècle, en utilisant des éléments antérieurs, et avec des additions ou retouches postérieures (L’Epigramme grec, Genève 1968, p.289).
En outre, la langue, tout comme le ton général de nombreuses blagues, avec ses latinismes (ex: dinar, 86 ; utérus de truie, 103 ; centurion, 138), ainsi que des termes ecclésiastiques, nous renvoient à la langue familière grecque des premiers chroniqueurs byzantins.
Le contenu des blagues ne nous guide guère plus. La 76, se référant au temple de Sarapis à Alexandrie a dû être conçue avant la destruction du temple par les chrétiens en 391.
Peu de noms propres dans le texte, et aucun ne nous éclaire. Seul celui de Scribonia (73) nous permet de situer, en raison de son tombeau, à l’époque d’Auguste. Est aussi présent un certain Lollian (162), mais il est difficile de le rattacher au sophiste Ephésien homonyme du IIème siècle.
Hormis les villes dont les habitants sont mentionnés dans certaines blagues, l’œuvre n’est pas plus circonscrite dans une zone géographique déterminée, puisque nous avons des références à Rome, Athènes, Rhodes, la Sicile, Abdère, Cymé (ou Cumes), le Rhin, etc.
Indéterminé également, le contexte social du document. Le scolastique avec son pantalon (64) nous orienterait vers le IVème ou Vème siècle, quand les habits des Barbares furent à la mode tant à Rome qu’à Byzance. Il en est de même pour l’horoscope de l’astrologue (202), prévoyant des carrières successives au fils de son client – le classique cursus honorum de l’ère romaine. D’autres éléments nous dirigent vers des institutions plus classiques : les jeux athlétiques (144), le théâtre (226, 239), les combats de pugilistes (87, 216).
Cette imprécision s’intensifie par le fait que de nombreuses blagues peuvent être trouvées dans d’autres sources, souvent (148, 150, 263, 264) chez Plutarque. D’un autre côté, trois anecdotes (77, 78, 193) semblent provenir directement de Cicéron, ou Suétone ; s’il en est ainsi, leur présence dans Philogelos dénote une époque ou ceux qui parlaient grec connaissaient le latin et lisaient la littérature latine, ce qui décroît rapidement après le VIème siècle.
Pour situer le Philogelos dans la tradition littéraire à laquelle il appartient, il faut parler de ces vieux livres avec des blagues et autres anecdotes similaires. Le sujet est traité dans les Saturnales de Macrobe (2.1.8-15). Macrobe, qui écrivit au IVème ou Vème siècle, l’équivalent latin des Deipnosophistes (le Banquet des Sophistes ) d’Athénée (IIème ou IIIème s.) ; concentra des collections de blagues de Grecs, mais principalement de Romains. Le même souligne l’éminence pour leurs blagues de Plaute et de Cicéron.
L’humour apparaît tôt dans l’histoire de la littérature romaine. Plaute mentionne des collections de blagues dans deux de ses œuvres : le Perse (392-395) et Stichus (400). Tandis que Macrobe met l’accent sur les livres de Caton l’Ancien. Le dernier recueil de blague est sans doute celui de Mélissos, un précepteur d’Auguste, qui, selon Suétone, aurait réunit 150 tomes de blagues.
Du côté grec, le mythique Palamidès et Radamanthe étaient considérés comme inventeurs de la « blagologie ». Les recueils de blagues et anecdotes, qui se consacraient souvent à un seul personnage, étaient choses habituelles. Des références se trouvent chez Plutarque, Lucien, Athénée. Ce dernier immortalise ce qui devrait être la plus séduisante incarnation du Philogelos, le « Club des Comiques » dans l’Athènes de Démosthène. Il s’agissait d’une équipe de soixante hommes se rencontrant pour aiguiser leur humour dans le temple d’Hercule dans le dème de Diomées, dans les environs d’Athènes.
Le menu peuple les écoutait avec un intérêt particulier et les invoquait. Nous détenons six de leurs noms. Un de leur plus chaleureux amateurs était le roi de Macédoine Philippe II, qui leur fit remettre la somme énorme d’un talent1 pour consigner leurs blagues et les lui faire parvenir.
C’est donc dans cette tradition que s’insère notre Philogelos, qui pourrait être caractérisé comme un recueil d’histoires drôles de niveau moyen.
Certaines blagues reviennent sous plusieurs versions différentes, signe qu’il s’agit bien d’un recueil tiré en grande partie de sources orales. De nombreux personnages sont moqués, dont :
- Les scolastiques (σχολαστικοί / skholastikoí) aussi dénommés intellectuels, pédants ou parfois niais, dont la formation uniquement livresque cache — mal — la stupidité mais grossit la prétention ;
- Les avares (φιλάργυροι / philárguroi) ;