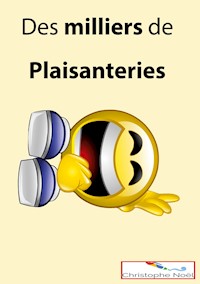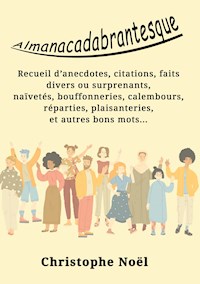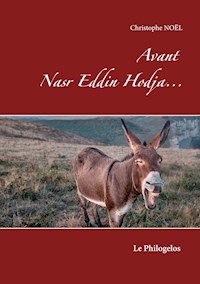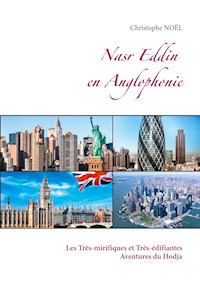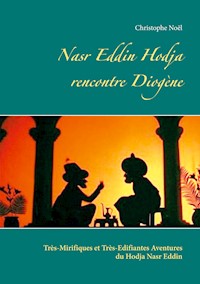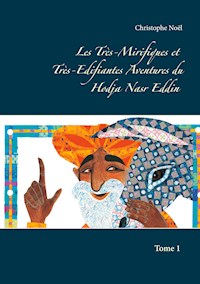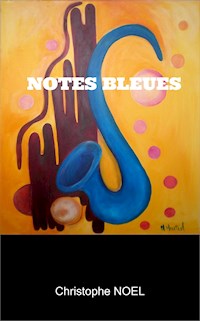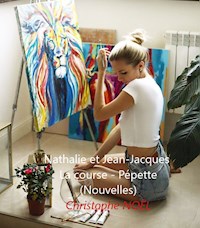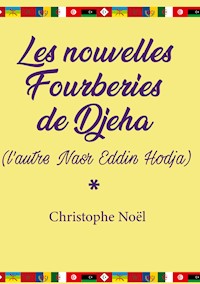
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Dans la continuité de travaux sur le personnage de Nasr Eddin Hodja et ses sources, depuis Ésope voire des mythes babyloniens, en passant par Le Pogge, Bonaventure des Périers, le Roman de Renart ou autres fabliaux médiévaux, ainsi que par une répartition géographique (qui va au-delà de l'Empire d'Alexandre, puisqu'il est populaire même aux États-Unis !), principalement dans l'Est de l'Europe et le pourtour méditerranéen, je me suis arrêté aujourd'hui au Maghreb.La 1ère partie de cet ouvrage consiste en la réédition du livre d'Auguste Mouliéras, Les Fourberies de Si Djeh'a, paru en 1892. Dans la 2nde partie, dont l'ouvrage reprend le titre, on trouvera des anecdotes ou contes glanés de-ci de-là. Principalement tiré du folklore berbère (ou amazigh), toute la côte nord de l'Afrique est balayée, avec les différentes dénominations : Djeha, Jeha, Joha, Djouha, Jha...On y découvre un héros multiforme, tour-à-tour naïf, érudit, ou fourbe ; cette dernière dimension semblant ici prépondérante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TABLE DES MATIERES
Introduction
Si Djeh’a et les anecdotes qui lui sont attribuées
Djouha, du surréalisme avant les surréalistes
Les Fourberies de Si Djeh’a
Les Nouvelles Fourberies de Djeha
Bonus
Bibliographie
Dans la même collection
Les “Berbères” ou “Amazigh” sont un groupe ethnique autochtone d'Afrique du Nord. Aussi Connus dans l'Antiquité sous les noms de Libyens, Numides, Maures, Gétules, Garamantes. Ils furent notamment impliqués au cours de leur histoire dans les guerres puniques, la conquête romaine, la christianisation, l'invasion vandale, la conquête arabe et l'islamisation.
Durant l'ère hellénique, ils étaient appelés « Libyens » (ou « Libyques ») et leur terre « Libye », connue aujourd'hui sous le nom de Libye antique. Leur terre s'étendait des Îles Canaries (à l'ouest du Maroc actuel) à l'ouest de l'Égypte antique. L'Égypte moderne comprend l'oasis de Siwa, région berbérophone, qui fit historiquement partie de la Libye antique.
(source : Wikipédia)
INTRODUCTION
La première partie de cet ouvrage consiste en la réédition du livre, Les Fourberies de Si Djeh'a, Contes kabyles (Paris : Ernest Leroux éditeur), qu’Auguste Mouliéras1 fit paraître en 1892. Assez technique, avec des notes linguistiques à foison, son travail a été fait, selon ses propres termes, en vue de faciliter aux berbérisants l’explication du texte Kabyle. Il est le fruit de la traduction de contes narrés, dit-il, « par mon Kabyle illettré des Béni Jennad ».
Mon lectorat n’étant – a priori – pas forcément berbérisant, j’ai éliminé impitoyablement quasiment toutes ses notes de bas de page, qui alourdissent quelque peu le récit.
Dans la seconde partie, que j’ai intitulée Les nouvelles Fourberies de Djeha, on trouvera des anecdotes ou contes glanés de-ci, de-là, essentiellement dans les ouvrages mentionnés dans ma bibliographie. J’en ai trouvé aussi certains sur des réseaux sociaux, perpétuant ainsi la tradition orale. Et ai rajouté un petit bonus…
J’ai souhaité garder l’introduction initiale de René Basset, intitulée Si Djeh’a et les anecdotes qui lui sont attribuées2, car elle explique assez bien, de manière sérieuse au vu des informations que l’on pouvait obtenir au XIX° siècle, l’histoire de ce personnage polymorphe qu’est Nasr Eddin – Djeha-Djouha-Jeha, et son évolution. Cette contribution, fortement documentée et étayée, je l’ai quelque peu élaguée ; en effet, on y verse dans l’érudition et les références et notes y sont fort nombreuses. Ma remarque du début sur les notes se répète ici, et explique certaines coupures, menant parfois trop loin pour les simples lecteurs sans prétention que nous sommes. Les philologues et les curieux pourront toujours retrouver l’intégralité du texte dans l’ouvrage d’Auguste Mouliéras.
Dans mes recherches, j’ai trouvé un excellent article publié sur le site de l’ADTF (Association Démocratique des Tunisiens en France), et signé par Achour Ben Fguira, intitulé : « Djouha, – du surréalisme avant les surréalistes ». Je vous le livre dans sa savoureuse intégrité en guise de seconde introduction. Non seulement il affine les éléments apportés par René Basset, mais il livre aussi des exemples croustillants, rapportant des anecdotes à travers les âges et l’espace (Russie de Brejnev).
On voit bien que la « culture nasreddinienne » transcende les limites imposées, géographiques et chronologiques, sujet déjà abordé dans certains de mes précédents ouvrages. Comme je m’en suis donc déjà expliqué, cette culture se nourrit d’apports divers, depuis les Fables ésopiques, en passant par les Fabliaux médiévaux, jusqu’aux faits divers récents3. Il s’agit donc, outre l’aspect soufi des débuts, d’une ouverture ou d’un état d’esprit, un peu comme l’humour juif ou zen.
Ne voulant pas alourdir outre mesure la présente édition, il me reste donc à vous en souhaiter une agréable lecture.
Christophe Noël
1 Auguste Mouliéras est un missionnaire et anthropologue français, né le 22 décembre 1855 à Tlemcen (Algérie) et mort le 26 janvier 1931 au Perreux-sur-Marne. Professeur de la Chaire d’Arabe d’Oran, lauréat de l’Académie française, il fut également le président de la Société de géographie et d’archéologie d’Oran.
2 L’orthographe initiale, bien différente de la nôtre concernant localités et personnages, a été conservée.
3 Voir « Bonus » avec un article du Consul de France en Turquie de l’époque, au sujet des hammams.
Si Djeh’a et les anecdotes qui lui sont attribuées
Si l’on en croit des traditions qui ont passé pour historiques, aux yeux de plusieurs écrivains, les anecdotes et les bons mots qu’on met sous le nom de Si Djeh'a auraient pour auteur un certain Nasr eddin Hodja (ou Khodja) qui « est une personnalité historique » affirme M. Decourdemanche4. Celui-ci appuie son opinion sur une citation de Cantemir5 et d’Otter6 à qui l’on montra le tombeau de Nasr eddin à Aqcheher en Asie Mineure. Mais Cantemir raconte avec des détails qu’ont ignorés les historiens arabes, persans et turks contemporains, l’entrevue du prétendu qâdhi avec Timour lenk dont il serait devenu bouffon en titre, en 1402, avant la bataille d’Angora où faillit sombrer l’empire ottoman à ses débuts. Certains traits, attribués à Nasr eddin mettent en scène en effet, le conquérant tatar, mais, […] les anecdotes où il figure7 ont des héros des personnages qui ont vécu bien avant le XIV° siècle. Bien mieux, dans un de ces récits qui n’est qu’une variante d’un conte populaire8, Nasr eddin est mis en présence d’un prince d’Asie Mineure, de la dynastie des Seldjouqides, Ala eddin, qui mourut en 1307, plus d’un siècle avant Timour, mort en 14049. Cette contradiction a frappé M. Ethé10, mais il pense concilier ces données opposées en supposant que Nasr eddin vécut au milieu du XIV° siècle, tout en reconnaissant que ce personnage est devenu dans l’esprit des Turks, une image de fantaisie, à qui l’on a attribué toutes les plaisanteries courant de siècle en siècle11.
… Quelques-unes (de ces anecdotes) sont empruntées à des cycles connus bien antérieurement, comme le Kalilah et Dimna12, les Sept Vizirs13, etc., que d’autres ont été citées par des auteurs de diverses nations, orientales et occidentales, antérieurs au XIV° siècle, enfin que, si l’on rencontre dans quelques-unes des traits qui indiquent une origine musulmane, aucune ne présente la saveur de terroir qu’on a cru y retrouver14.
Le héros de ces facéties est appelé chez les Turks Nas’r eddin H’odja, et chez les Arabes d’Egypte le Khodja Nas’r eddin Djoh’a er Roumi15. Ce dernier surnom, à défaut d’autres preuves tirées du texte même des anecdotes, suffirait à prouver que le texte arabe publié à Boulaq a été traduit du turk. Mais la version turke elle-même me semble n’être qu’une traduction d’un ancien recueil arabe dont le héros était ce même Djoh'a.
En effet, l’auteur du Kitâb el Fihrist, Moh'ammed ben Ish'aq el Ouarrâq, mort à la fin du IV° siècle de l’hégire, mentionne, parmi les livres de plaisanteries dont l’auteur est inconnu, un livre de Djoh'a16. Ce Djoh'a était sans doute un personnage imaginaire comme les héros des autres livres cités par le même auteur Abou Dhimdhim, Ibn Ah'mar17, Ibn el Maous'eli, Ibn Yaqout, Abou ‘Obeïd al H'azmi, Abou ‘Alqamah, Seïfouyah (peut-être Sibouyah). De ce livre, il ne nous reste que le titre, mais des auteurs postérieurs ont été plus explicites et ont fait de Djoh'a un être réel sur lequel ils donnent les renseignements suivants.
Un écrivain anonyme dont l’ouvrage est intitulé (illisible), analysé par Fleischer18, dit en parlant de Djoh'a auquel il attribue le prénom d’Abou'l Fadhl (ch. XXII). « Ce Djoh'a (appelé parfois (illisible) par erreur de copiste) avait un esprit malin et de l’entendement et a donné lieu à beaucoup d’anecdotes, ce dont il était fort peu soucieux. Quelqu’un qui ne lui voulait pas de bien lui attribua des récits badins et les répandit sous son nom. Ibrahim (?) dit : « Je connaissais Djoh'a comme un homme spirituel, fin et instruit, et tout ce qu’on raconte de lui est supposé. Il avait des voisins avec lesquels il plaisantait et qui plaisantaient avec lui, de telle façon qu’ils lui appliquaient des histoires drôles. Je vais donner de son insouciance une preuve piquante ».
À ces renseignements, on doit joindre ceux que fournit Ibn H'addjah qui aurait été de peu postérieur à Nasr eddin, si l’on admet l’existence de ce dernier19. « Quelques-uns prétendent que c’était l’homme le plus amusant du monde, mais qu’il y eut de l’hostilité entre lui et les gens et qu’on lui attribua toute espèce d’histoires. D’autres disent que c’était le plus grand étourdi et le plus grand niais »20. Les anecdotes où il figure sont en effet de deux sortes : dans les unes, il cache sous une sottise apparente un esprit caustique et narquois ; dans les autres, il nous apparaît comme le niais le plus ridicule.
Les Arabes possédaient d’ailleurs plusieurs types originaux dont la sottise était proverbiale : leurs noms nous ont été conservés, ainsi que quelques-uns des traits qu’on leur attribue : Yézid, surnommé Habanneqah ; Abou Ghabchân des Khoza'a, Rabi'ah el Beka à qui l’on prête une sottise qui se retrouve dans l’Heptaméron, Hamzah ben Bidh, Ibn el Djas“as” et El Afqad, contemporains du vizir Ibn el Forât, Behloul, qui vécut réellement à la cour de Haroun er Rachid21.
[…] La version turke est la plus complète : on trouvera la liste des éditions faites en Turquie, dans l’appendice joint par M. Decourdemanche à sa première traduction22. En Occident, six historiettes ont été publiées dans la Chrestomathie ottomane de Dieterici23 d’après un manuscrit de la Bibliothèque royale de Berlin, qui présente une rédaction plus développée que celle des autres versions du même texte.[…]
Ces anecdotes ont passé en roumain et le nom du héros a été à peine altéré en celui de Nastratin Hogea. Elles ont été mises en vers, en 1853, par Anton Pann, sous le titre de Nasdravanii le lui Nastratin Hogea24.
[…] C’est sans doute par les Arabes que le nom de Djoh'a a passé en Italie par la Sicile, et même en Albanie. « Les Siciliens, comme les Italiens des autres provinces ont des personnages bouffons qui les amusent fort ; le premier… se nomme Giufà ; c’est du moins sous ce nom qu’il est célèbre à Palerme, mais les gens de Trapani l’appellent Giucca, et chose étrange, les Toscans aussi qui ont adopté ce personnage. Les Albanais disent Giucha, avec un ch qui se prononce à l’allemande ou à la grecque »25… L’on ne peut songer à un emprunt fait aux Turks qui ne nomment jamais ce personnage que Nasr eddin Hodja.
C’est également aux Arabes que les Berbères ont emprunté le nom de Si Djoh'a (ou Djeh'a) et les anecdotes qui lui sont attribuées, soit à lui, soit aux êtres similaires (Bou Idhes, Bou K'ondour, Bou Khenfouch, etc.). Quelques-unes ont été publiées en zouaoua par M. Bel Kassem ben Sedira26 ; j’en ai recueilli d’autres chez les Guelâia du Rif27, les Qsouriens du Sud Oranais28 et les Mozabites. La collection que publie aujourd’hui M. Mouliéras d’après un Kabyle des Zouaoua, est la plus complète qui ait paru jusqu’à présent.
En résumé, à la fin du IV° siècle de l’hégire, il existait chez les Arabes des recueils de plaisanteries analogues à ceux qu’on composa plus tard en Occident (Til Ulespiègle, Schimpf und Ernst, les sages hommes de Gotham, les sept Souabes, etc.), et qui renfermaient des traits de naïveté tantôt spirituels, tantôt ridicules, parfois obscènes, qu’on retrouve chez tous les peuples et dont il faut peut-être chercher l’origine dans l’Inde. De ces recueils arabes qui fournirent plusieurs chapitres aux auteurs des Kitâb el Adab, un seul survécut, et l’on groupa autour de son héros Djoh'a, les anecdotes qui se rapportaient à ceux qu’énumèrent l’auteur du Fihrist et d’autres. Au XV° ou au XVI° siècle, ce recueil qui, par transmission orale y avait déjà passé en Occident, fut traduit en turk et le principal personnage identifié avec un certain Nasr eddin Hodja, dont l’existence est au moins douteuse. Il semble n’être, en effet, que la personnification de la naïveté, attribuée dans chaque pays à une ville ou à un canton (chez les Grecs Abdère et la Béotie ; en Syrie, H'ems ; en France Saint-Jagu et Saint-Maixent ; chez les Turcs, Sivri Hissar ; chez les Zouaoua, les Béni Djennad).
Cette version turke fut maintes et maintes fois remaniée, et l’un des remaniements fut traduit (avec des additions) en arabe vers le milieu du XI° siècle de l’hégire, XVII° de notre ère. Déjà la tradition orale, peutêtre à la suite de la conquête turke, avait porté dans le Maghreb un grand nombre d’anecdotes dont quelques-unes pénétrèrent chez les Kabyles, et qui doivent être jointes à celles que nous possédons dans les recensions écrites.
René Basset
4 Le Sottisier de Nasr eddin Hodja. Bruxelles, 1878, pet. in-4, p. VIII. (disponible en réédition chez BOD – NdE)
5 Histoire de l’empire ottoman, tr. de la Jonquière. Paris, 1743, 4 vol. in-12, t. I, p. 164-168.
6 Voyage en Turquie, Paris, 1748, 2 v. in-12, t. I, p. 58.
7Avantages d’un bon avis (trad° Decourdemanche – id. 61) – Les oies de Tamerlan (id.62) – Moyens d’effrayer un conquérant (id.63).
8Leçon de cosmographie (id.64).
9 On a, il est vrai, supposé que le prince dont il est question était Ala eddin de Qaramanie, dépossédé par Bayézid 1ᵉʳ, mais il est plus vraisemblable que le souvenir d’Ala eddin III, le plus grand prince de la dynastie, s’était conservé dans la mémoire populaire, de préférence à un prince fort peu connu.
10Essays und Studien, Berlin, 1872, in-8, p.239.
11 L’existence de Nasr eddin Khodja, comme personnage ayant vécu en Asie Mineure, est admise aussi par de Hammer, qui cite précisément, en l’attribuant au poète Ahmed, la riposte de Nasr eddin à Tamerlan au bain (Histoire de l’empire ottoman, tr. Hellert, t. II, Paris 1835, in-8, p. 145 et 464) ; et par Flœgel (Geschichte der Hofnarren) qui en fait, on ne sait sur quelle autorité, le bouffon de Bayézid 1ᵉʳ.
12 Le Pañchatantra (du sanskrit : Pañcatantra signifiant « Le Livre d’instruction en cinq parties ») est un ancien recueil de contes et de fables (probablement le plus ancien qui nous soit parvenu). Ce livre écrit sous forme d’apologues racontant l’histoire des chacals Karataka et Damanaka. Le Pañchatantra a eu une riche postérité littéraire, notamment via le Kalîla wa Dimna arabo-persan. Une version en castillan (Calila y Dimna) est faite en 1251 à la demande d’Alphonse X le Sage. Traduit en latin en 1278, par Jean de Capoue sous le titre de Directorium Humanae Vitae, le recueil se répand dès lors dans tout le monde occidental. Le Pañchatantra a ainsi inspiré de nombreux auteurs comme Marie de France, Jean de La Fontaine ainsi que Grimm. On peut également sentir une filiation avec le Roman de Renart ou certains fabliaux du Moyen Âge. (NdE)
13Les Sept vizirs est un conte des Mille et Une Nuits. (NdE)
14 A propos de l’historiette XI (version turke), M. Decourdemanche fait la remarque suivante : « Cette petite historiette, et surtout la réflexion finale tendraient à prouver que l’auteur était bien de Sivri-Hissar. Il s’y révèle en effet un sentiment de jalousie de clocher (de minaret?) d’une trop âpre saveur pour être inspiré à un littérateur ottoman uniquement occupé à composer un recueil de plaisanteries. » (Sottisier, p. 64). Malheureusement pour cette appréciation, Ibn H’addjah qui cite cette anecdote, avec les noms changés, dans le Thimârat el Aourâq, rapporte qu’El Asma’ï, contemporain de Haroun er Rachid, attribuait le propos à un sot accompagnant des gens de Benou Ghaffar.
15 Les Arabes du Maghreb ne le connaissent que sous le nom de Si Djoh’a ou Si Djeh’a.
16 Kitâb el Fihrist éd. Flugel. Leipzig, 1871, 2 v. in-4, t. I p. 213. Il est à remarquer que dans le livre des Naouddir, (Boulaq 1302, in-8, p. 39), An'med el Qalyoubi cite plusieurs anecdotes de Djoh'a d’après un certain Hamzah el Meïdàni, qui n’est pas autrement connu.
17 Un des personnages qui dans les contes arabes d’Algérie joue le même rôle que Si Djeh'a avec lequel il est souvent confondu, porte le nom de Bou H'êmar.
18 Einige bisher wenig oder gar nichi hekannte arabische und türkische Handschriflen, {Zeitschrift der deutschen morgenlaendischen Gesellschaft, XIV, 1860, p. 527-540 et spéc. 537-538. Fleischer conjecture que l’auteur était égyptien.
19 Ibn H'addjah (Thimârat el Aourâq, Boulaq, 1300, hég. in-8, p. 71), cite trois anecdotes qui manquent aux diverses recensions que j’ai pu consulter. Dans la première, Djoh'a sortant du nain y rentre précipitamment pour chercher ce qu’il croit avoir perdu ; dans la seconde, un portefaix se sauve avec un sac de farine ; la troisième a trait au châtiment de sa fille 'Omaïrah par sa mère.
20 C’est aussi ce que rapporte El Qalyoubi [Naouâdir p. 39), qui le met en rapport avec Abou Moslem el Khaoulâni dans une anecdote qui ne se retrouve pas dans les versions turkes. Le P. Cheïkho, dans ses notes sur le Medjàni el Adab dit, sans citer d’autorité que Djoh'a était un homme des Benou Fezàrah, surnommé Abou'l Ghas’s’ et habitant Koufah (t. 1, Beyrout 1886, in-12 p. 65).
21 Une réponse de Behloul (le nombre des fous) est attribuée à Djoh'a. Dans un recueil syriaque qu’on trouvera cité plus loin, le même trait est placé à Emèse (Hems).
22Les plaisanteries de Nasr eddin Hodja, Paris, 1876, in-18 p. 107-108. (également réédité chez BOD – NdE)
23 Berlin, 1854, in – 8, p. 31-38. Elles ont servi de base à l’étude de M. Ethé : Ein tiürkischer Eulenspiegel, ap. Essays und Studien, p. 234-254.
24 Cf. Gaster, Literatura populara romana, Bucharest, 1883 in-12, p. 162-168.
25 Marc Monnier, Les contes populaires en Italie, Paris, 1880, in-18 jés., p. 11.
26Cours de langue Kabyle, Alger, 1887, in – 12.
27Manuel Kabyle, Paris, 1887, in-12.
28Recueil de textes et de documents relatifs à la philologie berbère, Alger, 1887, in-8.
Djouha, du surréalisme avant les surréalistes
Imaginons la scène. Un bateau, hissant les voiles de l’allégresse, vogue paisiblement vers la Mecque. À bord, de vénérables et pieux musulmans affichent le visage de la satisfaction. Ce voyage aux lieux saints de l’islam, là même où le prophète a marché et vécu, représente pour la plupart d’entre eux le couronnement de toute une vie. Soudain, comme dans beaucoup d’histoires maritimes, une tempête se lève. La houle et les vagues sont si violentes que, rapidement, le bateau prend l’eau. Les pèlerins, devenus simples passagers luttant pour leur survie, s’emploient à qui mieux-mieux pour rendre à la mer son eau meurtrière. Tous les ustensiles sont mis à contribution, de la marmite au seau, de la jarre au fût… Seul dans un coin, Jouha fait exactement l’inverse : tranquillement, il puise l’eau dans la mer et la déverse dans le bateau ! Les passagers-pèlerins en perdent la raison, ils ne sont que colère et indignation :
— Mais tu es devenu fou ou quoi ! Tu concours à notre perte !
Imperturbable, Jouha répond :
— Moi, j’ai toujours appris à être du côté du plus fort, quel qu’il soit…
*
Voilà, le ton est donné. Politique, morale, société, philosophie, absurdité, surréalisme… tout est concentré dans cette histoire qui introduit bien à propos notre héros du jour : Jouha.
Jouha est un pur produit de la littérature arabe. On trouve mention de son nom dès le premier siècle de l’hégire, le septième de l’ère chrétienne. À peine l’époque abbasside arrivée, que le voilà déjà célèbre et le public se raconte ses anecdotes, histoires et bravades, comme il le fait encore de nos jours. Une de ces anecdotes le met en scène avec Abou Mouslim al-Khourasani, mort en 137 de l’hégire, 755 de l’ère chrétienne, le bras armé de la révolution abbasside. Ce haut personnage, ayant entendu parler des facéties de Jouha, a demandé à le voir. La rencontre est organisée par Yaqtine, le bras droit du bras armé. Au jour dit, Jouha est introduit dans une pièce où il n’y a que Abou Mouslim et Yaqtine. Il s’adresse à ce dernier : « Ô Yaqtine, lequel d’entre vous est Abou Mouslim ? ». L’histoire ajoute qu’Abou Mouslim, habituellement si sérieux, si imposant, a éclaté de rire au point de se cacher le visage de ses mains.
Cette même anecdote figure dans de nombreux recueils et anthologies de littérature arabe, dans le chapitre consacré aux « anecdotes des fuqahâ », les docteurs en religion, les jurisconsultes, puisqu’elle est attribuée à l’un des plus célèbres d’entre eux, 3Amir al-Cha3bî, mort en 103 de l’hégire, 721 de l’ère chrétienne. Quelqu’un le cherche partout, en vue de le consulter probablement… On lui indique la maison du vénérable « faqih », qu’il trouve enfin assis en compagnie de son épouse ; imaginons-les même en train de boire du thé… L’inconnu arrive, salue et demande : « lequel d’entre vous est al-Cha3bî ? ». Ce dernier, pincesans-rire, répond : « celle-ci », en désignant son épouse.
Inutile de dire que cette histoire fait encore rire de nos jours ; et si, par exemple, lors de vos futures pérégrinations sur internet, vous faites un tour sur un site qui propose des vidéos en nombre et en tout genre, vous y verrez de doctes imams la raconter avec le sourire ; ce qui provoque immanquablement un grand éclat de rire des priants…
Mais revenons à notre Jouha…
*
Avec l’avènement des Abbassides donc, qui ont vu leur califat s’étendre sur plus de cinq siècles, de 132 hég-750 ch, à 656 hég-1258 ch, Jouha est bien connu et son personnage bien campé. Une autre anecdote le met en scène avec le quatrième calife de la dynastie, al-Mahdi, fils d’al-Mansour le fondateur de Baghdâd et père de Haroun al-Rachid le héros des « Mille et une nuits ». Mieux, vers cette époque, Jouha est le héros de recueils de « nawâdirs », littéralement des raretés, préciosités, et par extension des anecdotes, histoires drôles, qui circulent et passent de main en main à Baghdâd et au-delà. En témoigne la mention de ce livre intitulé « nawâdirs Jouha » par Ibn al-Nadîm, mort en 385 hég-987 ch, un « warraq », copiste, libraire donc, qui a pignon sur rue à Baghdâd et qui nous a laissé son célèbre « al-fihrist », le sommaire, le catalogue, dans lequel il a recensé tous les livres qui lui sont passés entre les mains, classés par thème.
Mais ce Jouha, dont parle Ibn al-Nadîm, est-il une personne à l’existence réelle ou un personnage fictif à qui on accole toutes sortes d’histoires et anecdotes ? Certains chroniqueurs arabes voient en lui un être réel, comme vous et moi. Du reste, une notice biographique lui est consacrée dans bon nombre d’encyclopédies et de dictionnaires de noms propres, tel, par exemple, le dernier en date, « al-a3lâm » d’al-Ziraklî. Jouha a pour nom Doujayn ibn Thâbit et son surnom est Abou al-Ghosn. Il est même de la tribu de Fazara, selon al-Maydâni, mort en 518 hég 1124 ch, l’auteur de « majma3 al-amthâl », la somme des proverbes, un recueil de quatre volumes qui réunit pas loin de cinq mille proverbes ! Ces mêmes chroniqueurs classent Jouha dans la catégorie des « al-hamqâs wa al-moughaffalîns », les simples d’esprit, les fous sympathiques, les benêts. Il est dépeint sous les traits d’un imbécile heureux, plutôt idiot de ville qu’idiot de village, fou du peuple que fou du roi. Si on collecte ses histoires, s’il fait rire ses contemporains et semblables, c’est que le bon mot, la réplique spontanée, le trait d’esprit, lui échappent malgré lui. Bref, la drôlerie de Jouha n’est autre que, comme on dit de nos jours, de l’humour involontaire29…
Avec le temps toutefois, d’autres chroniqueurs ont essayé de lui rendre justice. Il n’est plus perçu ou compris comme idiot ou simple d’esprit mais plutôt comme quelqu’un qui fait l’idiot et le simple d’esprit. C’est une posture, en somme, un paravent, un masque pour affronter les vicissitudes de la vie. Sans doute, face aux excès des gouvernants et aux manières expéditives de leurs agents, est-il préférable quelquefois de passer pour fou ; au moins, un minimum syndical d’impunité est-il garanti, sinon dans tous les cas du moins dans bon nombre de cas ! Voilà pourquoi Jouha a recouru à cette apparente folie, à cette simplicité d’âme qui le rend à la fois inoffensif et sympathique, attachant et drôle…
Et c’est donc ainsi que Jouha, le vrai, a donné naissance à un deuxième Jouha, le personnage ; deuxième et non second puisqu’il va y avoir un troisième Jouha, un quatrième, un cinquième et ainsi de suite, jusqu’à nos jours…
*
Cependant, l’image de Jouha, au fil du temps, n’a cessé d’évoluer et son signe de prendre un ascendant résolument positif. Son personnage s’épaissit, prend de l’ampleur, au point que l’ingénu se double désormais de l’ingénieux. Place au nouveau Jouha, aussi naïf que roublard, aussi candide que malin ; malicieux, rusé, habile, astucieux, facétieux, perspicace… Parfois aussi il est lâche, abonné au crétinisme ambiant ; il courbe l’échine devant le fait accompli, se fait tout petit, nage avec le courant… Bref, il est une auberge espagnole à lui tout seul : chacun le voit à l’image qu’il se fait du héros, un héros, tout de même, dont le qualificatif premier est populaire. Allez, n’ayons pas peur des mots, c’est le héros du peuple, la vox populi par excellence ! Du reste, un proverbe tunisien l’affirme clairement, « en-nâs el-koul J’hewât : tout le monde est Jouha », privilège qui, à ma connaissance, n’est donné qu’à lui, à l’exclusion de tous les autres héros et personnages, réels ou fic tifs ! Quelle plus grande popularité que de voir s’identifier à lui le plus grand nombre, pour ne pas dire « en-nâs el-koul », tout le monde !
Fort de cette popularité inégalée, Jouha est mis sur orbite. Plus rien ne va l’arrêter et les histoires qui lui sont attribuées vont se répandre dans toutes les directions ; histoires et anecdotes en perpétuel mouvement, sans cesse renouvelées, constamment mises à jour et au goût du jour ; elles traversent temps et espace, épousent climat et société, s’adaptent à tout public. On y trouve autant le bon sens que le non-sens, le rationnel autant que l’irrationnel, l’absurdité des choses comme la cruauté des événements, la ruse comme la logique, ruse de la logique et logique de la ruse…
Quant aux sujets abordés dans les histoires de Jouha, ils embrassent tous les domaines de la société, tous les thèmes, à commencer, bien entendu, par la politique ; mais aussi, et surtout, les faits de société, les petits faits, des petites gens. Ainsi, au fil des histoires, sont mis à nu les travers de la société ; les contradictions qui la traversent et la secouent sans répit ; les privations, désirs insatisfaits et envies contrariées ; les mœurs, lâches et corrompues ; l’égoïsme, moi avant tout le monde ; la lâcheté, tant que ma tête est sauve, frappe où tu veux…
De plus, notre Jouha entre dans les maisons, écoute aux portes, passe ses nuits sous les lits, dans les armoires ; il révèle les scènes d’adultère, de ménage, les vols domestiques, les conflits de voisinage, les commérages… Il se faufile dans les couloirs de l’administration, côtoie les fonctionnaires, les imams, les cadis… La justice est un domaine qui semble particulièrement l’inspirer, tant ses démêlés avec les cadis sont multiples, à tel point que, parfois il passe de l’autre côté de la barrière et devient juge lui-même ! À peine quelques tentatives dans la voie de l’intégrité et de l’équité, où il se révèle droit et perspicace, que le voilà, à l’instar de bon nombre de ses collègues cadis, contraint de plonger dans la mare de la corruption, rendant justice aux plus puissants, aux plus offrants, aux plus forts, aux plus belles…
*
Un personnage d’une telle envergure est beaucoup trop grand pour le seul monde arabe. Aussi, ne tarde-t-il pas à prendre son envol, se jouant de la géographie comme il s’est déjà joué de l’histoire. Le voilà sur la route ; il se rend chez les voisins iraniens30, chez qui il s’installe à demeure. Sans se demander comment peut-on être persan, il devient persan, tout simplement ! Ses nouveaux compatriotes l’honorent du titre de « mullah », maître, et du glorieux surnom de Nasr al-dîne, la victoire de la religion. À partir de cette nouvelle position, Mullah Nasreddine va envahir tout le champ culturel persan. Désormais il en fait partie inté grante, aussi célèbre que Hafiz, Attar ou Khayyâm, trois des plus scintillants noms de la littérature spirituelle persane…
Une fois cette popularité bien assise dans le monde perse, Jouha-Mullah Nasreddine, passe en Asie mineure, en Turquie. Il garde le même titre, Mullah devient Khoja, maître, professeur, dans la langue persane comme dans la langue turque, et le même surnom, Nasreddine. Et le voilà Nasreddine Khoja, propriété sinon patrimoine authentiquement turc, plus turc qu’Atatürk même ! Il s’installe dans la région de Konya, en voisin et contemporain de « mawlānā », notre seigneur, Jalal ad-dine al-Rûmî, (604/1207–672/1273) initiateur de la confrérie soufie des derviches tourneurs ; confrérie qui est plus que jamais prospère, de nos jours encore, nourrie qu’elle est du souffle de son père fondateur et jouissant d’un tourisme dont les retombées sont autant spirituelles que matérielles.
Fiers de leur nouveau héros, les Turcs vont même jusqu’à lui donner une nouvelle existence, avec une ville natale, Âq Chahr. C’est dans cette ville qu’il serait né et qu’il a, aujourd’hui encore, son mausolée. Ultime canular, toutefois, ce mausolée renferme un tombeau… vide ! De sorte que, même mort, même inexistant, Jouha continue à donner dans la farce et la facétie ! Mais vide ou pas, le mausolée est autant visité que vénéré. Qui plus est, une coutume veut que les futurs mariés invitent symboliquement Nasreddine Khoja à leur mariage dans l’espoir que celui-ci soit marqué par le sceau de l’humour, de la gaieté et du rire…
Cependant, le plus important de cette étape turque reste que Jouha, à partir de cette nouvelle base, va accéder à la renommée internationale. Ses histoires, telles des vagues concentriques, vont se répandre et se répercuter en cercles de plus en plus larges, traversant, en direction de l’Orient, tout l’espace turcophone, toute l’Asie centrale, l’Indonésie, la Malaisie… et jusqu’en Chine ! Dans ces terres lointaines, Jouha est connu sous le nom de Afandi, Afanti, Epenti, Ependi, qui, tous, dérivent du turc « effendi », mot passé dans la langue arabe également et qui désigne un titre honorifique donné aux dignitaires et notables. En direction de l’Occident, Jouha-Nasreddine Khoja a largement dépassé les frontières de l’empire ottoman ; après la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, le voilà dans toute l’Europe de l’Est, jusqu’en Russie ; et même en Europe de l’ouest, jusqu’en… France, où on trouve trace de quelques unes de ses histoires, telle celle-ci…
*
Après ce portrait aussi sommaire que hâtif de Jouha, venons-en à présent à quelques histoires estampillées de son cachet à défaut de son nom. Le choix et la traduction de ces histoires sont miens et j’en accepte le jugement, quel qu’il soit, en vous rappelant même ce que dit un dicton arabe à ce sujet : « al-ikhtiâr qit3a min al-3aql », qu’on peut traduire sans le trahir par : « le choix révèle l’esprit »…
Comme promis, la première de ces histoires sera française. Pour l’introduire, il nous faut parler d’un chanteur et d’une chanson. Le chanteur c’est Ray Ventura, mort en 1979, autant dire hier ; un talentueux musicien qui a occupé le devant de la scène sur plus de quatre décennies. Ses chansons sont nourries à la veine comique et si certains d’entre vous se sont trémoussés au rythme de « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? », reprise, par exemple et entre autres, par le Grand Orchestre du Splendid, qu’ils sachent que cette chanson est signée Ray Ventura. Tout comme cette autre chanson, archi-classique « Les chemises de l’archiduchesse sont-elles sèches ? archi-sèches ? », Exercice de diction auquel l’artiste s’adonne par la voix d’un garçon qui zozote, d’un Auvergnat qui chochotte et d’un bègue qui s’y perd…
Mais la chanson qui nous intéresse ici et qui est en rapport avec notre Jouha est : « Tout va très bien Madame la Marquise ». Classique parmi les classiques, elle occupe une place de choix dans les anthologies consacrées à la chanson française. Quant à la Marquise qu’elle met en scène, c’est une riche aristocrate absente de son château depuis deux semaines. Aussi, téléphone-t-elle pour avoir des nouvelles. Son valet, James, l’assure que « tout va très bien, Madame la Marquise ». Cependant, « on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise, mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien ». La mort de cette jument est le premier chaînon dans la chaine de faits et de causes qui vont s’abattre sur la tête de la pauvre Marquise. Plus elle va chercher à savoir, plus les catastrophes vont tomber. Ainsi, la jument « a péri dans l’incendie qui détruisit vos écuries » ; et si « l’écurie brûla, Madame, c’est que le château était en flammes ». Finalement, elle va apprendre le fin mot de toute l’histoire. Voilà, le mari de la Marquise, « apprenant qu’il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, que Monsieur le Marquis s’est suicidé, et c’est en ramassant la pelle, qu’il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consuma de bas en haut, le vent soufflant sur l’incendie, le propageant sur l’écurie. Et c’est ainsi qu’en un moment, on vit périr votre jument, mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien ».
Telle est la chanson de Ray Ventura ; et voici son rapport avec Jouha…
Jouha, villageois, se rend en ville. Il descend chez un de ses amis, originaire du même village que lui et installé en ville de fraîche date. Les villageois installés en ville deviennent rapidement des citadins et leurs mœurs s’en ressentent. Pour recevoir les invités, ils n’ont plus les mêmes dispositions ni les mêmes attentions. Que voulez-vous, la ville a d’autres exigences, d’autres logiques… et d’autres prix aussi ! Néanmoins, Jouha est reçu, tant bien que mal, à contrecœur, mais reçu tout de même. Son hôte lui sert ce qu’il a de disponible, du pain et des lentilles. Pendant que l’un est occupé à calmer sa faim, l’autre lui pose des questions sur le village, la famille…
— Tu dis que tu es passé devant ma maison récemment, est-elle toujours aussi solide, telle que je l’ai bâtie de mes mains ?
— Elle est la plus imposante de tout le village…
— Et Oum Outhmân, comment va-t-elle ?
Ici, on comprend que cette Oum Outhmân n’est autre que l’épouse de celui qui demande de ses nouvelles. On comprend également qu’il a un fils nommé Outhmân, puisque « Oum » veut dire « mère » en arabe. Jouha, tout en avalant son repas, répond de son mieux :
— Je l’ai laissée telle que tu la connais, resplendissante de bonheur et de sérénité…
— Et mon fils, Outhmân, comment va-t-il ?
— Je l’ai vu courant et sautillant comme un daim…
— Et ma chamelle, est-elle bien portante ?
— Sa bosse est luisante de santé et son poil est bien prometteur…
— Et mon chien, est-il toujours aussi bon gardien ?