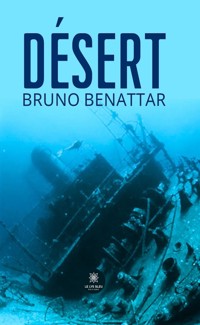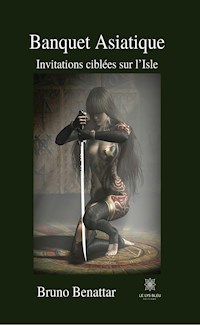Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Quand Corben, un de mes amis aïkidoka à l’Isle sur la Sorgue, a été retrouvé mort vêtu de son keïko-ji et de son hakama, les deux carotides tranchées et un tantô dans le cœur, au milieu d’un champ de basilic, cela m’a vraiment mis en vrac. De surcroît, Ambre, son amie, a également disparu. Comme aucun des deux ne possède ni identité ni existence légale, la police n’a rien compris. En fait, il n’y a que moi qui connaisse l’identité de la victime, l’auteur, le mode opératoire, les circonstances du décès, ainsi que les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Tout cela n’a aucun sens.
Dire la vérité n’apporte que des malheurs. D’ailleurs, si je la racontais cette vérité, personne ne la croirait. On ne se bat pas contre un fantôme. On ne peut l’arrêter, ni le juger, ni le condamner et encore moins l’emprisonner. Un fantôme, pourquoi un fantôme ? Non, il ne s’agit pas d’un revenant, juste d’une manière de parler. Soyons sérieux, les fantômes, cela n’existe pas.
Tout a commencé quand j’ai pris mon premier commandement. Parce que finalement, il existe deux sortes de gens : il y a les vivants et ceux qui sont en mer. Bien plus tard, au large de Gênes, on a recueilli ces naufragés qui ont justement ouvert une école d’aïkido en Italie à Taggia sur la Côte des fleurs en Ligure. Alors, quand les deux clubs se sont rencontrés et qu’on nous a offert ces plants de basilic…
Quand je raconte cela à cette inconnue rencontrée par hasard… Mais, est-ce bien par hasard ? Quel rôle joue-t-elle et pourquoi son insistance à vouloir absolument découvrir la vérité ? Peu importe, comme elle, vous allez ouvrir de grands yeux ébahis et considérer mon récit avec scepticisme, pour finalement me prendre pour un individu étrange et certainement un mythomane. Pour suivre son exemple, vous ne manquerez pas d’inventer des solutions simplistes comme une histoire de cœur, d’argent ou de guerre entre écoles d’arts martiaux.
Alors là, vous n’y êtes pas du tout.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Bruno BENATTAR est né en 1951, il poursuit des études de sciences économiques et de sociologie. Fortement influencé par les mouvements sociaux de mai 1968, il milite activement dans des mouvements pacifistes, non marxistes et non violents, tout en pratiquant les arts martiaux, et ce, encore aujourd’hui.
Refusant de s’intégrer dans la vie professionnelle, il visite le monde et exerce les métiers de moniteur de voile et de plongée bouteille.
Pendant près de trente ans, il travaille comme consultant en droit social, après avoir repris des études de droit. Il publie de nombreux articles et ouvrages spécialisés dans le domaine du droit du travail.
Aujourd’hui, retiré des affaires, il réside dans le Vaucluse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bruno Benattar
Ouragan sur la mémoire
Roman
© Lys Bleu Éditions – Bruno Benattar
ISBN : 979-10-377-0990-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Du même auteur
Déjà parus
Brandir la vague (
Le Lys Bleu
).
Ouragan sur la mémoire (
Le Lys Bleu
)
Déjà parus dans la série « Les chroniques de Pekigniane » :
Cecily : l’Hermabun, suivi du Guide du voyageur à Pekigniane (
Le lys Bleu
).
Guide du voyageur à Pekigniane et au Château-lumière (
Éditions BOD
).
Jézabel : La chute du Château-lumière (
ESA Éditions
).
Seth, le Bobun : Sur l’état de divinité et le militantisme syndical (
Le Lys Bleu
).
Bumberry, l’Archibun. : Le récit d’une sombre crapule qui se croyait sympathique (
Éditions du net et bientôt Le Lys Bleu
).
Lidji, Celle qui a renoncé (
Le Lys Bleu
).
Lilith, la Maudite (
Le lys Bleu
).
Angel, la Pervertie : Déchéance et splendeur d’une call-girl (
Le Lys Bleu
).
Asylie, la Cruelle : Pirate et Vampire (
Le Lys Bleu
).
À paraître dans la série « Les chroniques de Pekigniane » :
Lynn Carter : Les carnets secrets, d’une ethnologue, menant à la destruction du monde.
L’ensemble de ces ouvrages est disponible, en format papier ou électronique, sur les sites des éditeurs Le Lys Bleu, Les Éditions du Net, et des revendeurs tels que FNAC, AMAZON.
Rejoignez l’auteur, pour vous tenir au courant de ses dernières publications, sur FACEBOOK :
Consultez aussi le site de l’auteur :
« https//pekigniane.com ».
Avertissement
Toute ressemblance avec des personnes, des événements ayant existé, existant ou qui existeront n’est que le résultat soit d’une malencontreuse coïncidence, soit de la prise inconsidérée de psah ou de toutes autres substances hallucinogènes licites ou prohibées, soit de leur propre délire sans aucun lien avec autre chose que leur dysfonctionnement mental. Cette impression de similitude peut aussi avoir été provoquée notamment, par des séjours emboîtés dans le temps clic, clac ou cloc, combinés ou non, et/ou avec l’usage excessif du fouitbong.
Nous nous excusons d’en avoir été le déclencheur, même pour sa partie infime, sans aucune relation avec leurs hallucinations. Nous leur préconisons de rompre tout contact avec des individus présentant les mêmes symptômes. Ils entretiendraient leurs délires monomaniaques pouvant déboucher sur une crise mortelle de fièvre afguide. Il conviendrait plutôt d’effacer ce roman de leur mémoire.
À défaut, nous leur conseillons, en cas d’échec, et en dernier recours :
De consulter un homme de loi qui les soulagera de leur argent et les découragera d’entreprendre toute action. À moins que ce dernier envisage de les dépouiller d’une somme, plus importante encore ;
De consulter un psychiatre, un psychologue, ou toute autre personne de la partie qui les délestera d’une autre fortune, colossale cette fois, en leur faisant subir un traitement éprouvant, long et coûteux, dont l’efficacité resterait à prouver ;
De suivre une cure de désintoxication et de ne plus jamais absorber quelque substance hallucinogène que ce soit.
En tout état de cause, nous sommes profondément désolés pour eux et leur souhaitions sincèrement un prompt rétablissement.
Avant-propos
Des lecteurs m’ont fait part de leur plaisir en lisant « Brandir la vague », un simple roman d’aventures. Alors, j’ai décidé de renouer avec le genre. Il existe un autre facteur non négligeable qui m’a motivé. Mes partenaires, camarades et amis de mon club d’Aïkido m’ont demandé pourquoi je n’écrivais pas un roman sur les arts martiaux. Pourquoi pas, d’autant que peu de gens connaissent les dessous de ce monde très fermé. En outre, je n’ai pu m’empêcher de décrire les sentiments de quelqu’un abandonnant les océans qui pourtant restent toujours présents.
Ce n’est qu’un roman policier et un peu intimiste qui n’a pour but que de distraire, rien d’autre. Il n’a bien entendu aucun rapport avec la réalité et encore moins avec mon passé. Rappelez-vous, comme me l’a affirmé quelqu’un, ceux qui écrivent des histoires n’ont pas vécu.
La majorité des droits notamment de l’éditions papier est reversée à :
ASCI (Aïkido Satoru Club Islois), 15 LotissementLes Colombelles, 84800 L’Isle Sur La Sorgue.
Ouragan :
On était à présent dans la saison des ouragans ; quand il n’y a pas d’ouragan en train, c’est le plus beau temps de l’année.
(Ernest Hemingway)
Mémoire :
Il faut garder en mémoire nos rêves, avec la rigueur du marin qui garde l’œil rivé sur les étoiles. Ensuite, il faut consacrer chaque heure de sa vie à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour s’en approcher, car rien n’est pire que la résignation.
(Gilbert Sinoué)
Chapitre I
Origines
Origine :
Je sais maintenant qu’à l’origine, le chaos fut illuminé d’un immense éclat de rire.
(René Daumal)
Heureux qui peut savoir l’origine des choses.
(Virgile)
« Je suis désolée de mon intrusion. Vous permettez que je m’installe à votre table ?
Allez-y, on ne peut rien refuser à une jolie femme.
N’allez rien imaginer, il n’y a tout simplement plus d’autres de libres dehors sous un chauffage. Comme je suis fumeuse, pas question de m’enfermer à l’intérieur et de sortir à chaque fois que j’en allume une.
Je vous comprends car je suis atteint du même travers, si on peut appeler cela ainsi. Je vais vous mettre à l’aise, la place est libre et je n’attends personne. De toute manière, il se fait tard, et je ne vais pas tarder à me rendre à ma séance d’aïkido.
On s’ennuie ferme ici. Les soirées sont d’un triste à mourir en novembre, vous ne trouvez pas ?
Je ne vous le fais pas dire.
Excusez-moi, vous auriez du feu, j’ai oublié mon briquet. Si vous en voulez une ?
Non merci, je préfère les miennes. Je vais vous accompagner. Tenez, gardez ce briquet j’en ai plusieurs.
Merci. Je ne comprends pas d’ailleurs pourquoi ce soir c’est bondé.
Ce doit être la fête de la Saint Machin ou un truc comme ça. En plus, beaucoup d’établissements sont fermés durant cette période de l’année. Puis-je me permettre de vous offrir un verre pour vous pardonner cette intrusion ?
Merci. Avec grand plaisir, cela ne se refuse pas… Vous semblez soucieux.
C’est vrai. Je ne vais pas prétendre le contraire.
Des ennuis ?
Pas vraiment. Enfin, pas plus que cela. C’est compliqué. Je n’ai pas envie de vous importuner avec mes histoires et surtout de me faire passer pour un raseur.
Cela dépend uniquement de vous.
Écoutez, cela ne relève pas de mes habitudes de raconter ma vie à une inconnue. Je crains que vous ne me preniez pour un affabulateur.
Essayez, on verra bien. Et puis, j’ai un peu de temps.
Toutefois, j’y pose une condition. Vous m’écoutez jusqu’au bout.
Pourquoi pas ?
Il y a qu’une chose qui m’ennuie.
Quoi donc ?
Vous me rappelez quelqu’un et je n’arrive pas à savoir qui. Impossible de mettre un nom sur votre visage.
Nous y voilà. Je vous préviens que si vous essayez de me draguer, vous perdez votre temps. Je reconnais que votre technique n’est pas mauvaise, mais cela ne prend pas avec moi.
Ne le prenez pas mal. Je vous rassure, ce n’est nullement mon intention. Je me contenterai de vous raconter une histoire.
D’accord, pour l’instant, je vais faire semblant de vous croire. Alors, allez-y. Mais moi aussi, je pose une condition en retour. S’il y a quelque chose que je ne comprends pas ou qui me semble fumeux, vous me laisserez poser toutes les questions et vous y répondrez franchement. Qu’en pensez-vous ?
…
Alors, c’est d’accord ?
Entendu. Je pense que mon récit vous distraira. Voilà… »
Comme chaque jeudi matin, il y a quelque temps, après avoir fait mes courses, je m’installais au Grand Café de Sorgue. Les jours de marché, trouver une place dehors et à l’ombre relève parfois d’une mission impossible. Pourtant, il suffit de choisir le bon créneau horaire. Avant onze heures, c’est le temps du petit-déjeuner et après onze heures trente, vient celui de l’apéritif, puis celui du déjeuner. Je suis un mange tôt. Alors, avant, j’avais dégusté mon sandwich turc. Donner kebab, galette, sauce blanche et harissa, surtout beaucoup d’harissa, mais pas de frites, pas d’oignons. « Interdit par ma religion », avais-je assené un jour.
« C’est quoi ta religion », avait interrogé timidement le serveur.
« La mienne ».
Fin du débat. On a le droit de ne pas aimer le goût sucré des oignons et de refuser de manger des frites surgelées. Ce qu’il y a de drôle de nos jours, c’est qu’en opposant un interdit religieux, en général personne ne pose plus de questions et répond favorablement à votre demande sans discuter.
On commande un truc et on vous sert un autre truc, parce que tout le monde s’en fout. Mais le mieux, c’est le coup de l’allergie. La crainte de la venue des pompiers ou du SAMU terrorise n’importe quel professionnel des métiers de bouche. Si les services d’urgence débarquent, alors la réputation du commerçant est franchement plus qu’écornée. Vient ensuite la gendarmerie suivie de l’hygiène, et là, c’est la Bérézina, que dis-je, Stalingrad. Ces derniers ouvriront la voie à la horde des ravageurs de l’administration qui saccageront définitivement la réputation de l’établissement à coup d’interdits et d’amendes suite à une enquête pointilleuse car : « Il y a quand même eu une hospitalisation ». La boutique sera fermée, les propriétaires cloués au pilori, après avoir été montrés du doigt, puis traînés dans la boue par des médias avides de sensations fortes. Avec un peu de chance, ils passeront même à la télé à titre d’exemple, pour justifier le danger que représente ce type d’établissement. L’ostracisme sera tel, que les passants feront un détour pour ne plus passer devant le restaurant ou au contraire s’arrêter devant, pour se faire peur en apercevant la Boutique de l’horreur. Les anciens voisins et parfois amis déclareront à l’envie des : « Je le savais », avant de fournir moult détails, puis justifier tant leur suspicion que leur prudence à se taire avant le drame. Un indicible cauchemar que ne saurait décrire un professionnel de l’horreur s’abattra sur ce restaurateur inconscient.
Je n’avais utilisé ce moyen qu’une ou deux fois, juste pour me repaître du regard inquiet du serveur qui avait affiché un je-m’en-foutisme certain au moment de prendre ma commande. On vit dans une société où on commence par vous dire non et vous expliquer pendant des heures pourquoi il n’est pas possible de répondre à votre demande. Ou alors pire, on vous sert n’importe quoi à la place de ce que vous avez commandé. On compte sur votre lassitude.
Ainsi, à Nice, sujet à une petite faim, je rentre dans une boulangerie pour acheter une quiche lorraine. Le patron, un autochtone abruti et méprisant me sert une tarte à l’oignon, sans que je n’y prenne garde. Il n’avait plus le produit demandé et m’a refilé ce qui lui restait. Je paie, je sors et mords dans la tartelette. Et là, pas de doute, il m’avait vendu n’importe quoi. Je retourne dans la boutique et lui demande soit un échange, soit un remboursement. Et là, avec son accent doublé d’une décontraction et d’une faconde ahurissantes, le commerçant me déclare : « Mais c’est pareil, et puis c’est les vacances, on est là pour le soleil ». En plus, il se foutait de ma gueule ce sale con ! Alors je lui ai déclaré que j’étais allergique aux oignons et ai commencé à simuler un début de malaise. Quelques clients de la boutique avaient assisté à la scène et me regardaient inquiets. « Il faut appeler le SAMU », ont proclamé certains. Et là, panique totale, il m’a remboursé immédiatement, s’est emparé de la tarte et l’a fait disparaître par enchantement. Bien entendu, j’ai déclaré qu’heureusement, j’avais recraché ma bouchée, sinon… Quand je suis sorti, seuls les habitués sont restés. Les touristes et les gens de passage avaient déserté l’établissement. Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ! On se doute que je n’ai jamais remis les pieds chez cet abruti.
Bref, j’en étais à mon sandwich turc. Là aussi, il faut bien se caler. Les lycéens débarquent et s’agglutinent par paquet pour passer la commande vers onze heures trente. Moi, j’arrive juste un peu avant.
Après avoir mangé, sur une chaise, dehors au soleil, mes pas me dirigent vers le bord de Sorgue, après avoir remonté la rue de la République. Pas très compliqué, sauf, qu’il faut slalomer entre les bêtes sauvages et les chars d’assaut. Vous avez compris que je parle des chiens, des poussettes et autres véhicules à roulettes, sans compter les groupes aux arrêts intempestifs et ceux qui se plantent sans aucune raison au milieu des allées. Pour moi, cela correspond juste à un exercice de style permettant d’anticiper les mouvements ou leurs absences, sans jamais bousculer ni même toucher quiconque. Toujours en conservant le sourire, quoiqu’il advienne. Par le passé, je m’y étais entraîné dans le métro, durant mes vingt-cinq ans de vie parisienne. Bref !
Arrivé sur place, il suffit de repérer une chaise libre sur la terrasse du Grand café de Sorgue. Je n’ai plus qu’à déposer mon cabas et à m’installer. Observer les passants m’amuse. D’abord les chaussures : des tennis, encore des tennis, toujours les mêmes écrase-merdes ; ensuite l’allure générale : comment est-il possible de s’enlaidir volontairement ainsi ? Enfin, les scarifications tribales : tatouages, piercings, prothèses ongulaires, siliconage, cheveux de toutes les couleurs et que sais-je encore ! Bref, l’horreur, et je ne parle pas des obèses de plus en plus nombreux, ni de la nouvelle mode des femmes sarrasines bâchées pour des raisons prétendues religieuses, et encore moins des coupes de cheveux masculines imitant les hadj ! Le Coran n’a jamais imposé cela. D’ailleurs, le débat sur le port du voile islamique est un vrai sujet à placer au même titre que la pratique du nudisme. Remplacez dans toutes les discussions le terme voile islamique par nudisme, et la solution apparaîtra d’elle-même. « Au fait, que pensez-vous de la pratique du nudisme dans les lieux publics ou à la sortie des écoles ? »
Cela m’évoque un autre débat relatif aux trottinettes électriques. Doivent-elles rouler sur le trottoir, les pistes cyclables ou la chaussée et que sais-je encore ? Si je m’en tiens strictement au Code de la route, s’agissant de véhicules terrestres à moteur sur deux roues, elles doivent comme les vélos électriques, les solex et les autres, être assujetties à la même réglementation : port du casque, gants, assurance, plaque minéralogique, clignotants, etc. Et on les entend débattre et gloser sur les étranges lucarnes ! Que je sache, il n’existe pas de dérogation où ai-je raté un train ? Il est aussi possible que j’ai mal lu ou mal compris. Comment ? Ah oui, c’est écolo ? Alors, tout est permis. N’importe quoi !
Pour revenir à mes observations, on peut même établir des typologies distinctes. Certains modes d’enlaidissement sont antinomiques et d’autres complémentaires. Une femme bâchée n’aura pas de scarifications tribales en dehors du henné. Une tatouée portera divers implants, piercing et s’affublera souvent d’une chevelure multicolore. On peut aussi établir des classements par tranche d’âge. Il existe des valeurs universelles compatibles avec tous les groupes : les tennis, l’obésité et l’enlaidissement, le tout dénotant une absence totale de goût ou un refus de l’esthétisme. Parfois, mais rarement, un couple, une femme ou un homme sort du lot. Je m’étonne qu’à ce jour, aucune étude sociologique sérieuse n’ait encore été établie sur la question. Juste une question de temps… Finalement, je ne vois que des morts-vivants et des chagnasses. Vous ne savez pas ce que sont des morts-vivants et des chagnasses ? Peu importe, je l’expliquerai plus tard.
Mon rituel ne varie pas d’un iota. Pour un observateur extérieur, ma vie semble réglée comme sur du papier à musique.
« Comme d’habitude, un serré avec un verre d’eau ? », proposa le garçon.
« S’il te plaît, et si tu as un journal qui traîne… »
En cette fin d’été, les touristes se raréfiaient. Attablé à l’ombre, je dégustais mon café avec ma première cigarette. Entre Vaucluse Matin et La Provence, je ne distingue pas vraiment de différence fondamentale entre ces deux feuilles de choux concurrentes, sauf parfois un article, en plus chez l’un ou chez l’autre, qui sera repris le lendemain. La majorité des papiers sont des copiés/collés, comme s’ils avaient eu le même auteur. Même la date est identique, c’est dire !
Pour moi, un journal se commence toujours par les dernières pages. D’abord, ce que je ne regarderai pas à la télévision, ensuite l’horoscope, puis la météo. Important la météo, elle m’indique que je devrai comme chaque matin arroser mon jardin. Puis, les pages internationales, pour ensuite ignorer les pages de sports, et enfin se plonger dans la rubrique locale des chiens écrasés.
Et là, en atteignant la fin de mon parcours, je me liquéfiais sur un encart :
« Mort mystérieuse dans un champ de basilic.
Un individu vêtu d’un kimono noir et d’un hakama a été retrouvé mort dans un champ de basilic, les deux carotides sectionnées et un tantô (poignard japonais, NDLR) planté dans le cœur. Découvert tôt hier matin par des ouvriers agricoles, la gendarmerie… »
Merde, merde et merde ! Cela allait devenir franchement très compliqué. Pourquoi ? Mais non, je n’étais pas l’assassin, qu’allez-vous imaginer ? Cela allait devenir compliqué parce que j’avais ma petite idée sur la victime, l’auteur, le mode opératoire et les circonstances du décès, ainsi que les raisons pour lesquelles on en était arrivé là. Il était impossible que je puisse tomber sur un tel article. Cela n’avait aucun sens. Dans ces moments, je ne sais pas ce que vous auriez fait à ma place, mais moi, je me commandais une mirabelle au grand étonnement du serveur. La première lampée je la dégustais en laissant le liquide imprégner mes papilles. Puis, je la vidais cul sec et m’allumais une deuxième cigarette en pensant à la stratégie à adopter. Il ne me fallut pas des lustres de réflexions pour prendre la seule décision possible : attendre et observer mais surtout ne rien faire.
Je ne doutais pas un seul instant que, comme tous les adhérents du club d’aïkido, je serai convoqué à la gendarmerie dès que la victime aura été identifiée. Le serait-elle vraiment ? Personnellement, j’en doutais. Peu importe ! Ce que mes camarades raconteraient ne regardait qu’eux-mêmes. Pas question de se concerter pour délivrer une version commune. D’abord, c’était inutile. Ensuite, ils n’y arriveraient pas, même s’ils le souhaitaient. Il existera toujours une contradiction dans laquelle s’engouffreront les gendarmes. Au final, la vérité éclatera et la suspicion s’abattra à tort sur certains. Cela compliquerait encore plus l’affaire pour arriver au même résultat. Surtout, il faudrait recueillir l’unanimité, ce qui était loin d’être évident.
Parce qu’enfin qu’y avait-il à cacher ? Mais rien, aurais-je eu envie de répondre, ou tout. Pour ma part, avec l’expérience de ma vie passée, j’avais fait mien un proverbe vietnamien : Dire la vérité n’apporte que des malheurs. D’ailleurs, si je racontais la vérité, personne ne me croirait. Donc, j’adopterai la politique des trois petits singes : Je n’ai rien vu, je n’ai rien entendu et je n’ai rien dit. Je me cantonnerai à répondre strictement aux questions posées sans livrer mes conjectures, mes théories, voire mes certitudes. De toute manière, cela ne changerait pas grand-chose. Et puis, on ne se bat pas contre un fantôme. On ne peut l’arrêter, ni le juger, ni le condamner et encore moins l’emprisonner. Un fantôme, pourquoi un fantôme ? Non, il ne s’agit pas vraiment d’un revenant, juste d’une manière de parler. Quoique… je m’interroge. Allons, soyons sérieux, des fantômes, cela n’existe pas.
Il était temps de rentrer chez moi.
Perdu dans mes pensées, je réalisais à quel point j’étais en vrac. Cela ne s’arrangeait pas vraiment. Cela ne faisait qu’empirer d’heure en heure, de jour en jour, de mois en mois et d’année en année. Même mon dernier jeûne, je n’étais pas arrivé à le mener à terme. Tous les ans, je jeûne pendant une à deux semaines depuis des années. Ce n’est pas très difficile, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, sauf si on entame une grève de la faim. Il ne s’agit pas de se priver de nourriture, mais de ne pas manger. La différence est essentielle dans la démarche mentale. Comment fait-on pour tenir, interrogeront les inquiets ? Ce n’est pas bon pour la santé affirmeront certains médecins, d’ailleurs la preuve, on a rapidement des maux de tête. N’importe quoi !
Balayons une fois pour toutes les idées reçues. Il ne s’agit en aucun cas de faire un jeûne total et de rester allongé dans son lit, ce qui pour moi est une totale absurdité. Il existe certaines règles qu’on doit respecter. Première règle, pour ne pas perdre ses muscles, une activité physique s’impose. Pendant ces périodes, je fais beaucoup plus d’efforts physiques qu’en période normale. J’en profite alors pour réaliser des travaux de jardinage ou de bricolage. Deuxième règle, je bois énormément. Attention, je ne bois pas n’importe quoi, mais de l’eau légèrement salée afin de ne pas perdre mes sels minéraux et ainsi d’éviter les maux de tête. Je m’abreuve aussi de thé vert et de café sans sucre, tout en continuant à fumer. Au bout de quelques jours, la consommation de café et de cigarettes se divise par deux puis par quatre, sans aucun effort. Je n’en ai tout simplement plus envie. Troisième règle, je m’occupe avec une activité spécifique pendant les heures de repas. Laquelle ? Aucune importance, que ce soit la pratique de zazen, des arts martiaux, de la peinture sur soie, du macramé, de la marche, de la chasse aux escargots ou de la danse de Saint-Guy, je m’occupe. Notre corps se règle comme une horloge. On n’a pas faim, on a juste pris l’habitude de manger à heure fixe. Quatrième règle, la rupture du jeûne doit être progressive. Un jus d’orange accompagné d’une fine tranche de cake, puis, deux heures plus tard, je prends une soupe miso accompagnée de maki et sashimi. Normalement quand on jeûne, même si on urine, on ne va pas à la selle. Le corps stocke la nourriture et effectue ses réserves. En revanche, dès qu’on mange à la rupture, on se précipite aux toilettes. Pendant cette période, je perds en moyenne un kilo par jour.
Alors que je pratique le jeûne depuis des années, le dernier me laissa un goût étrange. Normalement, quand je commence, je prévois toujours une date de fin. Fixer dix jours ou quinze jours ou vingt jours n’a aucune importance. Cette fois-ci, j’arrêtais quinze jours, mais rien ne se déroula comme prévu. Le début se passa normalement. Pourtant, j’allais à la selle le quatrième jour, sans pour autant être sujet à diarrhée. Et ça, ce n’était pas normal. Le pire, c’est que j’y retournais le huitième. Il faut reconnaître que je profite toujours de cette période pour prendre de grandes décisions. Cette fois-ci, j’avais décidé de rompre définitivement avec Charlène. Peu importe ! Le matin du onzième, j’ai craqué et rompu mon jeûne. Onze jours, c’est pas mal affirmeront certains. Non, il vaut mieux en faire huit alors qu’on a prévu six, que d’en faire onze quand quinze sont au programme. Tout cela me laissait un goût amer.
Je me sentais comme un paquet de meubles IKEA. Je ne suis pas fan de ce type de produits prêt à consommer et ensuite à jeter. Moi, c’est plutôt les meubles asiatiques de style qui ne coûtent pas plus cher mais qui sont plus harmonieux et plus robustes. Vous savez ce que c’est. Bref, quand on regarde le catalogue de la marque, ou qu’on déambule dans les allées, on tombe sur de supers meubles sur lesquels on craque. Alors, on les commande, on passe à la caisse et on vous remet un carton. Et là, on comprend la pleine valeur du synonyme de Passer un week-end de merde : Monter des meubles IKEA. Sauf que pour moi c’était pire. Quand on déballe le carton, tout y est rangé, les vis, les boulons et le reste sont dans des sachets en plastique, ainsi que les outils à part. À la limite, il ne reste qu’à lire le mode d’emploi et suivre le mode opératoire. C’est pénible, mais pas vraiment compliqué. Mais imaginez un instant que vous ayez acheté plusieurs meubles, que tous les éléments aient été mélangés et que de surcroît, il n’y ait pas de mode d’emploi.
Bon, je possédais tous les éléments et la mémoire de ce qui devrait être. Je n’en étais pas dispersé pour autant. Pas du genre qu’on éprouve lors d’un déménagement quand tout a été emballé n’importe comment et qu’il n’y a aucune indication sur les cartons. Non, j’étais juste en vrac. Tout était là, devant mes yeux, mais je ne savais plus par quel bout commencer, ni même si j’avais simplement envie de commencer. En réalité pour reprendre l’analogie des meubles IKEA, je les avais déjà montés, puis démontés, rangées toutes les pièces ensembles, mais sans les avoir séparés meuble par meuble.
« Je pense que vous aurez compris qu’il ne s’agissait pas simplement de la mort de cet aïkidoka
Merci de la précision. Au fait, vous ne deviez pas m’offrir un verre.
C’est vrai. On parle, on parle et on en oublie les bonnes manières. Qu’est-ce que vous prenez ?
Comme vous.
S’il vous plaît, deux bières blanches avec une rondelle de citron. »
Mon ressenti vise mon état d’esprit général. Selon le principe d’incertitude d’Heisenberg, soit on sait où on est et on ne sait pas où on va, soit on ne sait pas où on est et on sait où on va. D’habitude, j’ai plutôt toujours été dans la deuxième situation. Je savais pertinemment où j’allais, quel était mon objectif, sans vraiment bien savoir où j’en étais. Aujourd’hui, c’est plutôt le contraire. Non, je me raconte des histoires, c’est encore pire. Je ne sais plus où j’en suis ni où j’allais.
En y réfléchissant bien, j’ai toujours été en vrac. Sans doute est-ce pour cela que j’ai déjà mené cinq vies différentes. Comme j’appartiens au signe zodiacal vietnamien du chat, le lièvre métallique pour les Chinois, il me reste encore deux vies. Cela ne m’interdit nullement d’être aussi sagittaire avec ascendance sagittaire avant de s’en servir. Vous voyez le genre. Bref, j’ai pleinement conscience, comme tous les lièvres, de courir dans tous les sens et comme le félin de vivre ma sixième et probablement d’attaquer ma septième et dernière existence. S’il vous plaît, ne partons pas en plein délire en parlant de réincarnation ou autres fadaises de cet acabit. Non, je parle de vraies vies depuis ma naissance.
J’ignore pourquoi certains, en fait il s’agit de certaines, m’ont laissé entendre que j’étais inquiétant et que je faisais peur. La première fois qu’on m’a dit cela, je me dirigeais vers la quarantaine. À l’époque, j’avoue ne pas avoir très bien compris. Même maintenant, je ne comprends toujours pas vraiment. Finalement, le jugement le plus étonnant et le plus pertinent que quelqu’un a émis me concernant l’a été par Didier. Didier, c’est l’enseignant de l’aïkido. Je me refuse à l’appeler Maître ou professeur. Je préfère l’appeler par son prénom. Les rapports entre un enseignant d’arts martiaux et ses élèves sont souvent très compliqués, mais ce n’est pas le propos, enfin, pas maintenant. Bref, il m’a dit que je ressemblais à un bloc de glace qui s’effritait. Sur le moment, cela m’a surpris. Il est vrai que nous avions éclusé quelques pintes de bière. Rétrospectivement en y réfléchissant, je reconnais qu’il n’a pas vraiment tort. En outre, il m’avait confié certaines choses le concernant qu’il me demanda de conserver par-devers moi.
« Que vous a-t-il confié ?
Sa confiance m’honore et il n’existe pas de raisons pour la trahir. Alors, vous n’en saurez rien, jamais. Même en présence de mon avocat ou sous la torture, je ne divulguerai rien. Fin de l’histoire.
Pourquoi me raconter cela alors ?
Juste pour vous faire prendre conscience des rapports privilégiés existant au sein de ce groupe.
D’accord, continuez alors ».
Cela ne m’empêche nullement d’être en vrac. Je sais, cela ne signifie rien pour personne. Pourquoi suis-je en vrac ? Avec le temps, j’ai découvert trois raisons distinctes. Mais si j’essaie de creuser et réellement d’en déterminer les causes, j’en identifie au moins six : je n’ai ni attache ni racine, je suis un homme sans femme, et j’ai laissé la morale au vestiaire. Fort de cela il faut rajouter les trois dernières touches. D’abord, j’ai rangé ma vanité, mon orgueil et mon amour propre dans un coffre pour ne conserver que mon intégrité. Ensuite, je crois avoir vaincu la plupart de mes peurs. Et enfin, j’ai réalisé tout ce que j’avais rêvé d’accomplir. Cela constitue le cocktail qui me caractérise.
« Excusez-moi de vous interrompre, mais ce que vous dites est incompréhensible.
Je vais essayer d’être plus clair et surtout plus explicite, tout en sachant qu’une chose en génère une autre et que le système s’auto alimente.
Comment quelqu’un peut-il ne posséder ni attache ni racine ? C’est impossible, cela n’existe pas.
Bien sûr que si.
Vous plaisantez. On possède toujours un nom, un lieu de naissance, une religion et un mode de pensée de par notre éducation. Son enfance, on l’a bien passée quelque part, dans une ville, une maison, il existe toujours des lieux, une famille dans lesquels plongent nos racines. Même si on ignore ces derniers, si on les recherche on les retrouvera un jour. Cela nous permettra de mieux nous enraciner.
Enraciner ? Je préfère le terme ancrer.
Peu importe, votre histoire ne commence pas très bien. J’ai le sentiment que vous me racontez n’importe quoi pour faire genre.
C’est vrai, mais c’est faux. Enfin pour moi, cela n’existe pas vraiment.
Comment cela ? Expliquez-vous ».
Considérons mon nom, par exemple, quel est-il ? Celui de mon état civil me répondra-t-on, avec un sourire entendu. C’est exact, sauf que ce n’est pas le nom dans lequel je me reconnais. Mes ancêtres avaient un nom, mon père possédait un nom. Un abruti à l’état civil a décidé de le changer et de l’écrire en deux mots mais avec une minuscule au deuxième, juste en insérant un espace. Un autre abruti a donné une majuscule au deuxième mot. Certes, je suis né en deux mots avec des majuscules. Sauf, que mon père a toujours écrit son nom en un seul mot et que moi enfant, je l’ai copié. Plus tard, pour détourner le problème, j’ai pris l’habitude de tout écrire en majuscule et laissant un espace imperceptible. Ma signature au début s’écrivait en entier pour se transformer en un gri-gri illisible. Dans une de mes vies passées, j’étais juriste de profession, alors j’aurais pu entamer une procédure devant le tribunal administratif en rectification d’une erreur matérielle. J’aurais pu… Un de mes cousins l’a fait et s’est trouvé dans une pétaudière inextricable. Entre la Sécurité sociale, les impôts et le reste, vous n’imaginez pas sur quel banc de nage de galère il s’est trouvé enchaîné. Il a préféré céder. Cela me fait penser à la blague de quelqu’un qui s’appellerait Benoît dont on aurait transformé le nom en Ben Oit.
Ce que je raconte est impossible prétendront certains, cela n’existe plus, même si cela a jamais existé. Que nenni ! Récemment, une amie d’origine italienne s’est vue affublée d’un accent aigu sur le e de son nom. Le pire de cette scène, c’est qu’elle s’est déroulée devant elle. Face à ses protestations, le fonctionnaire a déclaré : « C’est comme ça et pas autrement ». Elle aussi a perdu son nom et ses origines italiennes dont elle ne cachait pas sa fierté, en raison de la bêtise d’un fonctionnaire borné.
Alors quel est mon nom ? Celui de mon état civil dans lequel je ne me reconnais pas ou celui de mon père, dans lequel je me reconnais, mais que l’état civil ignore ?
Cela va encore plus loin. Je suis né dans un département de l’Algérie quand celle-ci était française. Ma famille n’est absolument pas originaire de cette région. Je ne suis né là-bas que par l’effet du plus grand des hasards. Ma sœur aînée est née à Paris, puis mon frère à Tunis et enfin mon plus jeune frère à Orléans. Tout cela est dû à la profession de mon père qui au début de sa carrière bougeait beaucoup. Dans quel pays suis-je né ? Eh bien, cela dépend. Parfois en France et parfois en Algérie. Sur la copie intégrale de mon acte de naissance qui est manuscrit, il y est mentionné la commune mais aucun pays. Normal, puisque c’était un département français. En revanche, sur l’extrait d’acte de naissance, le nom de la commune est suivi de la mention Algérie. Sur ma carte d’identité, parfois il est écrit France et parfois Algérie. Mon passeport a toujours mentionné France, mais maintenant, il n’y a plus rien de précisé sur ce document. Chaque fois que j’effectue une démarche administrative par internet, c’est la galère. Parfois, il faut inscrire comme pays de naissance France, parfois Algérie avant l’indépendance et d’autres fois Algérie. Cela m’épuise. Pourtant ces ignares devraient savoir qu’à l’époque, l’Algérie était divisée en trois départements appartenant au Territoire National de la France. Elle n’était même pas un DOM, ni un TOM, ni un protectorat et encore moins une colonie de ce qu’on appelait alors l’Empire. Alors quand la police me convoque, et que le fonctionnaire prend mon identité, cela crée un climat extrêmement propice à la sympathie et à la compréhension réciproque. Plutôt que d’entamer des polémiques stériles, je lui déclare : « Je n’en sais rien, alors écrivez ce que vous voulez ». Allez savoir pourquoi cela les énerve.
Si qu’un pouvait me dire dans quel pays je suis né, cela m’arrangerait. Enfin plus vraiment, car maintenant je m’en moque comme de l’an 40, même si au début de ma vie, cela me mettait mal à l’aise. En fait, la réponse dépend exclusivement du logiciel utilisé. Aujourd’hui, cela me fait juste sourire.
De plus, mon père est né britannique et possédait un passeport attestant son appartenance à la perfide Albion. Sur ce document, son nom s’écrivait en un seul mot. J’ai pensé récupérer cette nationalité et mon nom. Malheureusement, mon père n’a jamais retranscrit son mariage, ni même la naissance de ses enfants, sur l’état civil de son pays d’origine. Je sais que mon père a fait la deuxième guerre mondiale en quasi-totalité. Il existe un faux souvenir de ma part qui m’a fait croire qu’il a commencé la guerre sous l’uniforme britannique puis français. Pourquoi cette histoire ? Parce qu’il a été considéré à un moment, comme déserteur par l’armée française et que j’en ignore encore la véritable raison. Les versions familiales sont imprécises et variables selon les circonstances. Mon père, qui a obtenu la Croix de guerre avec palmes, ne parlait jamais de la guerre, ni de celle-là, ni de celle d’Espagne. Juste des bribes égarées, suffisantes pour alimenter mon imaginaire et assez abondantes pour justifier mon antimilitarisme et plus tard mon pacifisme non-violent… Quant à mes deux grand-mères maternelles, elles étaient toutes les deux italiennes, l’une originaire de Livourne et l’autre de Pise. Seul un Italien comprendra l’antagonisme existant entre ma mère et sa belle-mère car un dicton affirme qu’il vaut mieux avoir un mort chez soi qu’un Pisan à sa porte. Finalement, mes origines sont mitigées cochon d’Inde.
Il existe des tas d’histoires, de récits, de contes et de légendes concernant mon nom et ses origines. Inutile d’essayer de démêler le vrai du faux, à force d’être répétés, ils sont devenus réalité. On peut remonter avec certitude aux origines de mon nom au début du IVème siècle. Établis dans la région de Gibraltar, mes ancêtres se convertirent au judaïsme probablement sous l’influence de Rabbi Akiba. À l’époque du début de l’apparition du christianisme, les débats théologiques se tenaient en public. Les chrétiens n’étaient nullement persécutés comme le prétendent des légendes. Ces dernières furent inventées bien plus tard, notamment sous le règne de Constantin par son âme damnée Eusèbe de Césarée, afin de justifier leurs exactions vis-à-vis des païens, mais ce n’est pas le débat. Les joutes oratoires se tenaient sur les forums. Il ne relève pas dans les habitudes des Juifs de pratiquer le prosélytisme religieux. Toutefois, s’ils étaient interpellés publiquement, ils ne refusaient pas le débat et opposaient leurs arguments. Après, ce fut une autre histoire. Mais ce récit de conversion par Rabbi Akiba ne résiste pas à l’analyse historique. Si mes ancêtres étaient originaires de Gibraltar, ils ne pouvaient pas avoir rencontré une personne qui n’a jamais quitté le Proche et le Moyen-Orient. Alors, d’où provient ce mythe ? Certes, mes ancêtres se déplacèrent sur tout le pourtour de la Méditerranée, notamment sur le Maghreb. Il existe même une légende affirmant qu’un de mes aïeux aurait traversé le désert sur le dos d’un lion, avant de s’établir en Tunisie.
En outre, je possède un blason italien datant du XIVème siècle. Qu’on se rassure, ce n’est nullement un blason nobiliaire, il n’est que marchand. À cette époque d’illettrisme, un blason servait de moyen d’identification de son nom, ses navires, ses actes de commerce et même son domicile. En se promenant en Italie, on verra de vieilles demeures ornées d’un blason. Celui-ci a souvent été martelé jusqu’à être effacé, suite à l’occupation française napoléonienne, pendant la campagne d’Italie, à la fin de la révolution de 1789. En effet, les nouveaux occupants imposaient une taxe spécifique aux nobles qu’ils identifiaient par leur blason. Ces ignares ne faisaient pas de différence entre un blason nobiliaire, commerçant ou paysan. Beaucoup d’Italiens, notamment en Ligure et en Toscane, ont préféré marteler leur blason, plutôt que de s’acquitter de cet impôt infondé, ne signifiant plus rien.
Bref, toute cette jolie famille, assez fortunée et propriétaire terrien, vivait en Tunisie. Une généalogie précise remonte sans difficulté jusqu’à la fin du XVIIème ou au début du XVIIIème siècle. Un de mes aïeuls prêta de grosses sommes d’argent au Bey de Tunis, au milieu ou la fin du XIXème. Pour ne pas rembourser sa dette, ce dernier tenta une méthode initiée par un certain roi de France, dont je tairai le nom, pour ne pas pratiquer la délation, vis-à-vis des Chevaliers de l’Ordre du Temple : les trucider et confisquer leurs biens. Informée de cette situation, toute la famille s’embarqua pour Marseille et se fit naturaliser britannique en invoquant et démontrant ses origines de Gibraltar. Pourquoi britannique et pas française alors que la Tunisie était justement un protectorat français ? Ceux qui posent cette question n’entendent rien à la politique. D’abord, jamais la France ne se serait opposée au Bey de Tunis, et ensuite, la perfide Albion appréciait de mettre les Français en difficulté.
Mes parents quittèrent ce protectorat en 1946, à la libération et après la démobilisation de mon père qui fit l’École Centrale de Paris. Avec l’indépendance de la Tunisie, tous les biens familiaux furent nationalisés. C’est ainsi qu’on entrava définitivement ma vocation première : celle de rentier. Après ma naissance à Alger, je connus le Havre, Paris, Orléans et enfin Nancy dès l’âge de sept ans. Même à Nancy, je crois que nous ne sommes pas restés plus de huit ans dans la même demeure. Et après, ce fut pire. Non seulement j’ai souvent déménagé, mais de surcroît, je me suis toujours débrouillé pour habiter au moins dans deux endroits simultanément. Avant de m’installer ici, je possédais ma base à Nice, une résidence en Italie que j’avais acquise après la parisienne, et mon voilier sur lequel je naviguais au moins deux mois d’affilée par an. Et je ne comptais pas mes déplacements professionnels : cinq fois deux semaines par an dans la Caraïbe, les voyages d’affaires à Paris, Lyon ou partout ailleurs en France. À cela, il fallait rajouter mes deux mois de vacances en Asie.
« Alors, selon vous, mes racines, où se trouvent-elles ?
…
Merci, j’attends toujours la réponse.
Je ne sais pas.
L’homme n’est pas une plante, alors, les racines, cela n’existe pas ailleurs que dans notre tête. Ces racines sont des chaînes qui nous interdisent de visiter le monde et qui rapetissent notre champ de vision. Les gens qui proclament
: je suis un enfant du pays
, vous crachent leur étroitesse d’esprit pleine de compromissions et leur vision ethno-centrée.
Pas faux, continuez ».
Certains prétendront que la religion d’origine permet aussi d’établir un ancrage. Rien que des inepties. Je suis né Juif. Mon nom en hébreu signifie fils du couronné. Pour la petite histoire, en arabe il se traduit par fils de l’herboriste ou de l’apothicaire. Rien que pour cela, on comprendra aisément que je préfère mes origines juives à celles berbères et encore moins arabes. Être Juif ne constitue pas une appartenance à une religion, ni même à un peuple ou une culture. Non, c’est bien plus que cela : c’est une civilisation en soi. Ce débat sociologico-politico-religieux ne présente ici aucun intérêt. Je laisse le loisir à tout un chacun de creuser la réflexion et l’étude, s’il le souhaite.
Dès mon adolescence, je n’ai pas mis longtemps à m’en rendre compte, en lisant les textes prétendus sacrés, qu’il s’agissait d’un amas d’inepties débiles, toutes en contradiction avec la réalité historique, géologique et géographique. Même un mauvais ouvrage de science-fiction aurait possédé un meilleur scénario et une meilleure cohérence. Ce n’était même pas de la science-fiction, juste de l’horreur. L’histoire du docteur Frankenstein ou du Conte Dracula possède à mon sens plus de crédibilité et de profondeur. Inutile d’entamer un débat stérile surtout avec des croyants qui tous les jours lavent leur cerveau avec la religion, tout en scandant : J’ai raison et tu as tort, et tu brûleras dans les flammes de l’enfer pour l’éternité, à moins qu’ils ne cherchent à vous trucider. Déçu par ma religion, j’ai étudié les autres. Je me suis depuis interrogé sur la capacité des gens à croire à de pareilles sornettes du niveau intellectuel d’un trisomique. Toutes les mêmes, seuls les jours de fête changent. Ah si pardon, les uns prient debout contre un mur, les autres à genoux face à une croix, quand les derniers le font assis sur les talons face à un point imaginaire qui ne correspond à aucune réalité historique, géographique et géologique. Je me suis vite rendu compte qu’il ne fallait pas confondre religion et spiritualité. Chemin logique vers une religion sans Dieu : le Bouddhisme. Sauf que les Bouddhistes ne valent pas mieux avec leur Sangha ou ordre monastique, sans compter les rites insensés. Bref, j’ai tout jeté à la poubelle, la poubelle à la décharge, et sans tri sélectif s’il vous plaît. Du coup, on est seul à se forger, sans personne pour dire quoi penser ou comment penser. Pour cela, on s’aide d’outils comme zazen, les arts martiaux, la mer et autres techniques de cet acabit. Chacun son truc ! Finalement, un homme avec une religion est comme un colibri avec une trottinette, juste une copie qu’on forme ou plutôt qu’on déforme.
Non, ce n’est franchement pas dans ma religion que je vais plonger mes racines.
« Oui peut-être, mais on possède toujours une dimension sociale identifiée par le métier et les diplômes.
Là, j’ai envie de hurler de rire.
Pourquoi ? »
Mon métier, j’en ai exercé au moins cinq qui n’avaient aucun rapport les uns avec les autres. Je ne vais pas vous balancer mon CV à la figure, ce n’est pas l’objet. Un jour, un cabinet de recrutement m’a demandé d’apporter la preuve de mon passé professionnel. Devant la multitude de documents fournis, le consultant m’a déclaré :
« Je ne sais pas comment vous avez pu réaliser tout cela.
C’est simple, je ne suis pas marié et n’ai pas d’enfants. Je me suis contenté de saisir les opportunités professionnelles qui s’offraient à moi.
D’habitude », ajouta-t-il en souriant, « tous les CV que les candidats me fournissent sont mensongers. Pour une fois, cela fait plaisir d’en étudier un qui ne le soit pas.
Ne vous faites aucune illusion », rétorquais-je, « le mien aussi l’est. Vous n’avez tout simplement pas découvert mes mensonges.
Sans doute, mais dans votre cas, cela n’a pas grande importance ».
Est-ce que j’ai obtenu le poste ? Oui. Mais, finalement, je l’ai refusé car je l’estimais inintéressant.
« J’insiste. Il reste toujours les diplômes.
Bien sûr, il reste les diplômes. C’est cela, oui ».
Chez moi, cela frise le gag. J’en ai perdu certains et on m’en a dérobé d’autres, sans compter ceux que j’ai repassés plusieurs fois et ceux qu’on m’a donnés sans avoir à passer d’examen, me plaçant ainsi dans des situations parfois inextricables ou très avantageuses selon les circonstances. Inutile d’évoquer ceux qui n’ont plus aucune utilité, car tombés en désuétude. Et je pourrais en raconter.
Les meilleurs exemples ont trait à mes permis de véhicules terrestres à moteur. À seize ans, j’ai passé un permis pour conduire des deux roues de moins de 125 cm3, puis à dix-sept, le permis moto. Un bruit courrait à l’époque. On prétendait que si on échouait au code, on vous retirait les permis précédents. Ne déclarant pas le premier permis, je me retrouvais avec deux documents différents et ensuite un troisième pour la voiture. Maintenant, je n’utilise plus que mon permis VL auquel sont intégrés ceux de moins de 125 cm3. Avec celui moto, je suis ennuyé. D’ailleurs, je ne le retrouve plus.
Autre exemple, dans les années soixante-dix, j’ai passé un monitorat de plongée bouteille en Israël, avec des nageurs de combat en mer rouge. C’était à Neviot appelé aussi Nouheiba, entre Eilat et Sharm-el-Scheik, quand le Sinaï était encore israélien. Trois plongées par jours pendant vingt jours : une le matin à huit heures, une autre à midi et la dernière de nuit. Après, le rythme est passé à deux pendant une autre décade : celle de midi a été supprimée. Si on compte, cela fait près de soixante-dix plongées en un mois. Et cela a continué. Pas besoin de décrire les cours théoriques en anglais, le démontage et le remontage de matériel, les kilomètres capelés à la palme et le reste. Des examens j’en ai passé, aussi bien théoriques que pratiques dans la langue de Shakespeare. Je vous promets que les nageurs de combat ne m’ont fait aucun cadeau sous l’eau. Inutile de dire que j’en bavais. En plus, pendant la journée, je faisais mes deux bordées à la voile. Ah oui, j’ai aussi passé mon permis bateau. Mais ces titres ne sont pas reconnus en France. D’ailleurs, ils sont écrits en hébreu moderne et je ne parle ni ne lis cette langue.
Alors qu’à une époque, je plongeais sur la Côte d’Usure, pardon d’Azur, je racontais cette histoire à des amis corailleurs qui m’acceptaient avec mon titre israélien. Et là, ils m’ont emmené profond, très profond, à plus de quatre-vingts mètres. J’ai vraiment connu la narcose à l’azote et à l’oxygène pur aux paliers. Ce sont eux qui m’ont conseillé de repasser mes niveaux. Du coup, j’en ai repassé certains en France, mais pas le monitorat. Sans utilité avec plus de mille plongées aujourd’hui, je n’en ai homologué que plus de la moitié et la majorité des moniteurs n’en possède pas autant et j’ai plongé plus profond qu’eux. Quand j’y repense, il ne m’en reste pas vingt en souvenir.
Il en a été de même du permis côtier. Vingt-cinq ans plus tard, quand j’ai acquis mon voilier, je l’ai repassé avec le hauturier, ainsi qu’un diplôme de capitaine de plaisance que je ne retrouve plus dans le foutoir consécutif à mon dernier déménagement. Bah, il suffirait d’écrire aux Affaires maritimes. À quoi cela servirait-il maintenant ? Un diplôme de capitaine permet juste de commander un bâtiment à titre commercial et d’être rémunéré. Je l’avais passé car j’envisageais, à une époque, de faire du charter à la voile. Embarquer des éléphants à mon bord, je ne l’ai fait qu’une seule fois. D’ailleurs, le seul permis hauturier m’autorise à commander n’importe quel navire, même le porte-avions Charles de Gaulle, mais sans percevoir de salaire et surtout pas à titre commercial. Alors quel intérêt d’entamer de nouvelles démarches administratives, d’autant que ce diplôme ne sert plus à rien depuis la réforme de 2017 ? Un jour, je le retrouverai glissé entre deux papiers. Je comprends pourquoi, certains encadrent leurs diplômes. Moi, je ne le ferai pas, car je n’ai pas envie de sacrifier un pan de mur de mon bureau. En plus, je trouve que cela fait prétentieux.
Une anecdote drôle dans la continuité se déroula aux Philippines. Au bar avec un des moniteurs, un ancien Navy-Seal à la retraite, nous éclusions pinte de bière, sur pinte de bière, entrecoupée de tequila-rapidos. On avait déjà plongé plusieurs fois ensemble. Il appréciait que je ne sèche pas ma bouteille en vingt minutes. Il avait jeté un œil discret sur mes tables de décompression, mon profondimètre et ma montre, bien qu’utilisant aussi un ordinateur de plongée. Ce soir-là, je lui confiais déplorer de ne pas explorer l’épave du New-York, un croiseur lourd américain coulé pendant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, il gisait par plus de quarante mètres de fond. Il me répondit qu’avec les nouvelles règles de sécurité, sauf au mélange, on ne descendait pas à plus de trente mètres et que l’intérieur des épaves était trop dangereux. Je me permis de ricaner en vidant cul sec mon verre de tequila. Les bières aidant, je lui racontais dans le détail mon histoire de monitorat et mon passé de plongeur.
« Avec qui tu l’as passé ?
Des nageurs de combat israéliens.
Comment s’appelaient-ils ?
Le premier Shmoulik et l’autre Uri.
Tu as plongé avec Shmoulik et c’était lui ton moniteur ?
Oui, pourquoi ?
Je le connais, on s’est rencontré lors d’échanges entre les marines américaine et israélienne.
Sans déconner ?
Demain, on plonge tous les deux sur le
New-York
et on se fait l’intérieur de l’épave ».
La plongée fut une des vingt qui reste encore gravée dans ma mémoire : fabuleuse, féerique et les mots sont faibles.