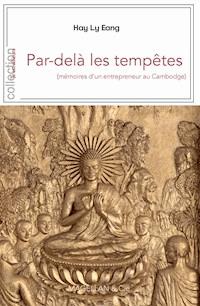
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
L’auteur raconte le drame de la destruction du Cambodge mais aussi, et surtout, les immenses efforts de reconstruction.
Comment tout reconstruire quand tout a disparu ? Prendre en main son destin et avancer ?
Un exemple qui vaut pour tout un chacun.
Un témoignage édifiant, une source d’inspiration pour toutes les jeunes générations.
EXTRAIT
Le 30 mars 1975, je quitte Phnom Penh. Les Khmers rouges encerclent la ville qu'ils pilonnent de roquettes depuis des semaines. Leur victoire sur les forces harassées de Lon Nol est imminente, je le sens, je le sais. Mais mon départ n'est pas une fuite. J'ai vingt-deux ans, je suis étudiant et je pars en France pour y parfaire ma formation de pharmacien.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Quelques jours après le 7 janvier 1979, Hay Ly Eang, exilé en France, apprend que sa famille, restée au Cambodge, a été massacrée par les Khmers rouges. Quand il peut rentrer dans son pays, en 1991, il a quarante ans et une idée en tête : agir pour empêcher à tout jamais le retour d’un régime génocidaire. Pour lui, c’est en créant des entreprises innovantes, socialement responsables, et en œuvrant pour le développement rural que le pays pourra guérir des maux qui ont engendré l’horreur.
Fondateur du laboratoire pharmaceutique PPM et de l’entreprise de produits agricoles Confirel, Hay Ly Eang raconte, dans son livre Par-delà les tempêtes, son parcours d’entrepreneur humaniste, passionné, et qui vibre d’espoir pour un Cambodge à l’âme enfin pacifiée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A la mémoire de mes deux sœurs,de tous ceux de ma familleet de tous mes compatriotesvictimes du régime de Pol Pot
AVANT-PROPOS
Hay Ly Eang appartient à la génération de Cambodgiens qui ont, dans les années 1970, tout perdu lors du génocide khmer rouge, famille, biens, village. Mieux connu sous le nom de Dr Hay, il est également de ceux qui ont décidé de retrousser leurs manches et de reconstruire leur pays plutôt que de demeurer en marge de l’Histoire.
Ce pharmacien exilé en France a donc, dès qu’il a pu le faire, regagné son pays pour s’y transformer en entrepreneur. Tout en montant une fabrique de médicaments dans la banlieue de Phnom Penh, il s’est investi dans la production agricole.
Il a commencé avec le sucre de palme avec l’objectif que ce produit, extrait de l’arbre symbole de l’identité khmère, contribue à renforcer les faibles revenus des paysans pauvres en trouvant une place sur le marché international. Puis il a participé à la relance du fameux poivre de Kampot, dont la production s’était évaporée pendant les ravages provoqués par les guerres de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a aussi amorcé, sur les hauts-plateaux du nord-est cambodgien, la production du cacaoyer qui se fait à l’abri de rangées de bananiers pour protéger du soleil cet arbuste tropical.
Alors que le Cambodge se remet lentement – et parfois mal – des tourmentes subies pendant des décennies, le Dr Hay est l’un de ceux qui offrent un message d’espoir : le pays peut survivre aux tempêtes encaissées. Il ne s’agit pas de réformes radicales et encore moins de révolution. Le Dr Hay propose de se glisser dans un cadre de vie familier, intelligible. Pour aider une société sinistrée, son exemple s’appuie sur une bonne dose d’efforts, de réalisme et de sagesse. Le récit d’une expérience qui ne laisse pas indifférent.
Jean-Claude PomontiPrix Albert-Londres 1973
PROLOGUE
Le 30 mars 1975, je quitte Phnom Penh. Les Khmers rouges encerclent la ville qu’ils pilonnent de roquettes depuis des semaines. Leur victoire sur les forces harassées de Lon Nol est imminente, je le sens, je le sais. Mais mon départ n’est pas une fuite. J’ai vingt-deux ans, je suis étudiant et je pars en France pour y parfaire ma formation de pharmacien.
Un nouveau pouvoir va s’installer au Cambodge, les bombes cesseront de meurtrir le pays et la vie finira par reprendre un cours apaisé après tant d’années de chaos et de souffrances. C’est ce que je crois, ce 30 mars 1975, il y a quarante ans de cela, alors que la Caravelle décolle de l’aéroport de Pochentong et que je laisse en bas, derrière moi, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes sœurs, mes beaux-frères, mes neveux, mes nièces, mes amis d’enfance, mes camarades d’études, mes professeurs.
Je voudrais pouvoir les nommer tous, ceux-là que j’ai quittés ce jour-là et que les hommes de Pol Pot ont assassinés, fait mourir de faim, de maladie ou d’épuisement durant leur règne atroce et sanguinaire sur la terre du peuple d’Angkor.
Moi, le destin m’a mis dans un avion quelques jours avant le début de l’impensable.
Je suis resté vivant, mais avec la douleur de la disparition de tous ces êtres aimés tapie dans mon âme.
Je suis resté vivant, mais avec la douleur d’avoir vu mon pays anéanti par certains de ses propres enfants.
Je suis resté vivant, mais avec le désir impérieux d’agir pour que le Cambodge ne puisse plus jamais connaître une autre calamité génocidaire.
Et j’ai compris en étudiant notre histoire nationale que nos malheurs et nos conflits destructeurs prennent leurs racines dans le sous-développement chronique de nos campagnes cambodgiennes dont les habitants sont bien souvent méprisés par les élites urbaines. J’ai observé que le faible niveau d’éducation d’une population pauvre a constitué un terreau idéal pour les tyrannies de toute obédience. J’ai noté que nos querelles intestines séculaires, attisées par les ingérences et convoitises étrangères, ne pouvaient être vaincues autrement que par la valorisation de nos richesses nationales, par nous-mêmes, dans un esprit de partage.
Dès que j’ai pu revenir au Cambodge, au début des années 1990, j’ai été stupéfait par la désolation que plus de vingt années de guerre y avaient engendrée. Mais j’avais un dessein en tête, mûri en exil alors que mes affaires en France dans le secteur pharmaceutique prospéraient. Celui de créer des entreprises explorant un chemin nouveau dans notre pays, qui produiraient à la fois de la richesse matérielle et de l’harmonie sociale, des profits et en même temps de la concorde et de la fierté nationale. C’était comme proposer un modèle pour guérir le Cambodge de ses maux.
Je me suis d’abord jeté dans l’arène pour construire Pharma Product Manufacturing (PPM), devenu au fil des années le plus important laboratoire pharmaceutique du Cambodge, qui exporte aujourd’hui plus de la moitié de sa production, notamment en Afrique. Avec la relance de Kinal, le premier médicament fabriqué dans notre pays à l’aube des années 1960, avant que les années de guerre anéantissent l’industrie pharmaceutique, j’ai voulu refermer les blessures injustes infligées à notre peuple. Et dire ceci : il y a eu du bonheur sur notre terre cambodgienne et il y en aura encore si nous travaillons ensemble pour cela.
Puis, j’ai créé Confirel. « Tu es fou, Hay ! » Combien de fois me l’a-t-on dit aux débuts de cette aventure. Fou, sûrement pas. Est fou celui qui ne voit pas la richesse potentielle des ressources de nos campagnes et ne s’indigne pas de la pauvreté de celles et ceux qui y vivent. Avec de la recherche, de l’innovation, de l’imagination, nous avons commencé par valoriser le jus du palmier à sucre, l’arbre emblématique du paysage cambodgien, dont les exploitants étaient considérés jusque-là par leurs propres compatriotes comme des traîne-misère ignorants, juste bons à produire du mauvais sucre et de l’alcool frelaté. Aujourd’hui, nos produits dérivés du palmier à sucre séduisent les gourmets du monde entier et les grimpeurs qui récoltent le jus à trente mètres de hauteur vivent mieux. Avec la même philosophie appliquée à d’autres produits de la terre, Confirel se développe et plus personne ne me traite de fou. On m’invite même dans les colloques internationaux pour en parler.
Le bonheur du Cambodge et celui de ses paysans sont liés pour l’éternité comme les eaux du Mékong et du Tonlé Sap s’unissant dans la confluence des Quatre-Bras pour offrir à Phnom Penh l’une des plus belles preuves d’amour que la nature a donné à une ville. Voilà mon idée.
Pour bâtir le Cambodge dont je rêve, à jamais à l’abri du chaos, il m’arrive de penser qu’il suffirait d’une centaine d’entrepreneurs inspirés par ces valeurs auxquelles je crois, même si le chemin reste semé d’embûches. Mais dans les désordres d’un pays en reconstruction s’épanouissent plus facilement les affairistes pressés, les opportunistes qui n’ont que faire de l’intérêt collectif et pour qui la nature comme les hommes doivent s’effacer et se soumettre quand passe le dieu dollar.
Le danger guette encore.
Enfant, j’étais indépendant d’esprit. Je le suis resté. Et je n’écris pas ce livre aujourd’hui pour me présenter comme un modèle aux yeux de mes enfants ou de quiconque. Chacun doit tracer son sillon comme je l’ai fait.
Dans leur folie paranoïaque, les extrémistes polpotistes ont commis un crime impardonnable que le Cambodge paie encore aujourd’hui. Ils ont liquidé les intellectuels, cherché à effacer toute trace de savoir, de science, de culture. Notre tradition orale rend encore plus difficile la constitution et l’enrichissement d’une mémoire collective dont tous les peuples ont besoin.
J’écris ce livre pour contribuer à cette belle encyclopédie vivante que nous incarnons tous ensemble, et pour dire : voilà quel a été mon chemin pour participer à la renaissance du Cambodge, voilà ce que le citoyen du monde que je suis a fait pour le bien commun.
Je noircis ces pages pour que les jeunes Cambodgiens trouvent matière à enrichir leur réflexion sur notre pays, ce qu’il a été et celui qu’ils veulent construire.
Enfin, ce livre veut dire à ceux et celles que j’ai laissés derrière moi le 30 mars 1975 pour ne plus les revoir : je ne vous ai jamais oubliés.
1 - CHI HÈ
Le Cambodge moderne et moi, nous avons fait nos premiers pas ensemble. J’ai vu le jour en 1953, année de la proclamation de l’indépendance totale du pays par le roi Norodom Sihanouk. J’arrive au monde dans un royaume en pleine effervescence, fougueux, brouillon aussi.
Mais à hauteur de l’enfant que je suis, l’univers se limite à une langue de terre généreuse avec les hommes que la providence a posés là pour naître et grandir paisiblement.
Ma famille a jeté l’ancre depuis plusieurs générations sur la rive est du Mékong, à Chi Hè, prospère bourgade commerçante de la province de Kompong Cham, à une centaine de kilomètres au nord de Phnom Penh et à quelques coups de rame de la capitale provinciale.
Si vous passez aujourd’hui à Chi Hè, vous vous direz que, décidément, comme tant d’adultes, j’ai transformé avec l’aide magique du sablier du temps les oripeaux de mon enfance en habits de prince car l’endroit, sans être misérable, n’a plus rien de cossu. Mais je vous parle d’une époque que je n’ai pas inventée, que la guerre a presque effacée de nos mémoires.
À Chi Hè, nous sommes cernés par les eaux, celles du Mékong et du petit Mékong qui démarre son cours ici pour finir sa fugue à Neak Loeung1 où il s’unit à nouveau à son géniteur.
Alors, on vit là un peu comme sur une île dont l’étendue varie selon la saison. Quel formidable terrain de jeu pour des enfants que cette nature en perpétuel mouvement. Au gré du niveau des eaux, on pêche, on rame, on nage. J’en aurai usé des cartables, à force de les jeter n’importe où dans la maison au retour de l’école pour, avec mes amis, profiter de chaque seconde de ces plaisirs dont tant d’enfants sont maintenant privés.
À l’intérieur de cet espace géographique délimité par la nature elle-même et dont on sortait par bateau en ces temps où les routes restaient rares, les quelque deux mille habitants de Chi Hè ne manquent de rien. La bourgade doit sa vitalité économique à son port fluvial, porte de sortie des productions agricoles du district de Koh Sotin, dont elle est le chef-lieu, et des alentours.
Arachide, sésame, maïs, tabac, soja poussent ici avec vigueur. Très tôt après leur arrivée au Cambodge, les Français ont implanté dans la région de Koh Sotin de nouvelles cultures, lançant sur ces terres fertiles l’agriculture moderne du royaume. Henri Mouhot, le naturaliste français qui fit découvrir au monde les temples d’Angkor, avait fait une halte à Koh Sotin lors de ses périples dans le royaume au milieu du XIXe siècle. Le passage de l’éminent chasseur de papillons a sans doute contribué à la bonne fortune des habitants de Chi Hè. On y distille aussi un alcool de riz réputé, qui s’exporte bien au-delà des frontières du royaume.
À cet endroit, j’aurais pu naître paysan ou planteur. Je suis né dans le négoce, au sein d’une famille qui compte déjà un garçon et deux filles à ma naissance, et qu’un autre garçon complétera deux années plus tard.
Mon père, après avoir reçu son éducation à la pagode comme la plupart des garçons de sa génération, a quitté le froc à l’âge de vingt-neuf ans pour entrer dans la vie active. La pagode n’instruit pas seulement sur le bouddhisme. Les garçons y reçoivent une véritable formation professionnelle pour se débrouiller au sortir du wat.2 Ayant appris la joaillerie, il s’est installé dans le métier après avoir épousé ma mère. Son père était arrivé de Chine déjà adulte. Il a transmis à son fils cette culture du commerce que les Chinois transportent dans leurs bagages et, autant que joaillier, mon père était grossiste en produits agricoles. Il achetait dans le district du riz, du maïs, du tabac qu’il revendait à Phnom Penh. Il s’était spécialisé dans le tabac jusqu’à posséder une usine de séchage et de traitement des feuilles qui travaillait avec de grosses sociétés, comme la Compagnie khmère de tabac, une filiale de la Seita française.
Pour son négoce, mon père entretient une relation constante et étroite avec les paysans. Comme ses confrères de Chi Hè, il achète la production de ceux avec qui il a passé contrat par avance. Grossiste en feuilles de tabac, il doit à ses clients annuellement une quantité donnée. En fonction de ses besoins, il fournit à ses paysans sous contrat les plants qu’ils doivent cultiver jusqu’à maturité sur des terres qui lui appartiennent. Il en va de même pour les autres produits dont il fait le négoce. Entre mon père et ses paysans s’est tissée une relation intime. Ont-ils besoin d’argent pour fêter un moment heureux ou affronter une tragédie familiale ? Mon père leur en fait l’avance sur leur prochaine production. À Chi Hè, tous les négociants agissent ainsi, si bien que la cohésion sociale sur notre territoire est très forte.
En 1970, quand des paysans de Chi Hè seront arrêtés pour avoir participé à la grande manifestation de Kompong Cham réclamant le retour du prince Sihanouk3, tout juste destitué par le général Lon Nol4, mon père montera à Phnom Penh pour les faire libérer. Plus tard, quand les paysans du cru deviendront des chefs khmers rouges, ils n’oublieront pas ce geste et plus généralement l’empathie de mon père à leur égard. Ma famille sera d’abord bien traitée. Jusqu’à... Mais restons encore un moment à Chi Hè, au temps où la vie y souriait.
Je voyais peu mon père, toujours dans les champs avec ses producteurs, surtout pendant les récoltes, ou à veiller sur ses plants de tabac. Son implication dans la vie de la communauté lui prenait beaucoup de son temps. Avec d’autres, il avait financé la construction de l’école primaire et du lycée de Chi Hè, ainsi que celle du village de Tum Pong pour laquelle il avait donné un bout de terrain. Sa famille avait également payé la construction de la pagode. Tout autant que sa fortune et son dévouement au bien commun, son ouverture d’esprit l’amenait à être souvent consulté pour résoudre les litiges qui survenaient immanquablement ici ou là.
Durant les années qui précédent ma naissance, mon père s’est aussi engagé en politique. Comme bon nombre d’intellectuels et de membres de la classe moyenne, il a rejoint les rangs du Parti démocrate qui incarne à leurs yeux le rêve d’un Cambodge indépendant, démocratique et moderne. Ainsi s’inscrit-il dans le fil de notre histoire nationale marquée, pour les jeunes générations de son temps, par le combat indépendantiste.
Dès l’institution en 1863 du protectorat de la France sur le royaume, des rébellions avaient surgi, plus ou moins puissantes selon les soutiens qu’elles trouvaient à l’intérieur du pays mais aussi à l’extérieur. La capitulation de Paris en 1940 face aux nazis de Hitler a donné aux mouvements de libération indochinois, communistes ou strictement nationalistes, un élan que rien n’arrêtera plus. Au Cambodge, les Khmers Vietminh et les Khmers Issarak, émanations de ces deux tendances qui engendreront plus tard les Khmers rouges et les républicains, font feu de tout bois pour diriger le mouvement anticolonial, alors que le Japon, allié de l’Allemagne hitlérienne, apporte son soutien à tout ce qui peut ébranler les puissances occidentales en Asie. La victoire finale des Alliés sur les nazis et la capitulation du Japon permettent à la France de reprendre la main sur le Cambodge, après que le royaume a connu quelques mois d’indépendance dans la foulée du coup de force japonais antifrançais en Indochine, en mars 1945. Mais la guerre a bousculé les cartes et le protectorat cesse en 1946, le royaume devenant un État membre d’une Union française nouvellement créée.
Le Parti démocrate est lancé cette même année et gagne à une écrasante majorité les premières élections jamais organisées dans le pays. Les intellectuels, les élites commerçantes et le peuple des campagnes se trouvent ainsi unis autour d’un désir commun pour l’avenir du pays et l’indépendance ne paraît plus alors qu’une question de temps.
Dans cette époque frénétique, mon père représente le parti à Chi Hè. Mais l’indépendance proclamée par le roi Sihanouk en 1953 et son entrée en politique avec la création du Sangkum Reastr Niyum5 – SRN – pour remporter les élections de 1955 mettent un terme à l’ascension des démocrates. Alors démarrent les années Sihanouk. Mon père se met au vert à Phnom Penh, le temps que les vicissitudes engendrées par cette transition politique s’estompent. Il achète durant cette période une maison dans la capitale qui sera plus tard mon port d’attache. Cet épisode met fin à son engouement pour la politique partisane même si, par commodité, il adhère au SRN.
Que mon père, durant mes années d’enfance, soit aussi absorbé par son travail ou l’activisme militant me convient très bien. J’aime bien m’en sortir par moi-même. Quand je le questionne, il m’écoute et me répond comme s’il m’indiquait une voie de réflexion. Ces rapports comblent mon esprit indépendant, sinon franc-tireur.
Ma mère aussi me laisse beaucoup d’autonomie. D’abord, les affaires commerciales de la famille l’accaparent. Et, à la différence de mon père, elle n’a pas reçu d’instruction car, au début du siècle dernier, les filles étaient rarement scolarisées. Elle ne peut donc pas contrôler mes résultats qu’elle supervise en se reposant sur les appréciations de mes professeurs. Mais ma mère m’initie aux arcanes du commerce.
À une centaine de mètres de notre vaste maison – un ensemble en bois constitué de trois compartiments sur deux niveaux, où, avec nous, vivent nos grands-parents et d’autres membres de la famille – mes parents ont acheté un dépôt d’essence pour cet apprentissage. Après l’école, j’y rejoins ma mère ou ma grande sœur. Je sers, j’encaisse l’argent, j’apprends à faire les comptes et, si les clients sont rares, je lance une ligne dans les eaux du Mékong au-dessus desquelles le dépôt paraît flotter à la saison des pluies.
Mais ma mère ignorera jusqu’à un âge très avancé que la plus grande leçon me venant d’elle a le parfum d’une glace au fruit de jacquier. J’ai onze ans et je joue dans la maison. Elle vaque à ses occupations quand passe un marchand de glace ambulant. Elle l’appelle et lui demande un bâtonnet de glace parfumé au fruit de jacquier d’une belle couleur jaune. Je dis à ma mère : « Je veux ça aussi. » J’ai pensé qu’elle en achèterait un deuxième pour moi. Non. Elle m’a donné le sien qu’elle s’apprêtait à déguster. Je ne comprends pas. « Oh, je n’en avais plus envie », m’explique-t-elle. Je ne la crois pas et un remords tenace me saisit de l’avoir privée de quelque chose qu’elle désirait. Ainsi, tout ce dont elle me gratifie chaque jour lui ôterait une part du bonheur auquel son travail, sa sueur lui donnent pourtant droit. Je ne le veux pas et je décide que désormais je gagnerai l’argent de poche dont j’ai besoin pour satisfaire ma soif précoce et vitale d’indépendance. J’en déduis aussi que celui qui accepte l’argent des autres pour vivre ne sera jamais riche car il ignore son prix en sacrifices nécessaires.
Je conquiers mes premiers riels6 en donnant un coup de main aux élèves en difficulté. Doté d’une excellente mémoire, j’apprends vite et facilement.
Mes débuts sur les bancs de l’école en cours préparatoire ont été pourtant sans éclat. Jusqu’à cet incident. Chaque trimestre, l’instituteur établit un classement. Cette fois, je dois être à la huitième ou neuvième place. Mais l’instituteur se trompe en tirant les traits sur son cahier de classement et me proclame premier. N’ayant pas eu l’impression de travailler beaucoup, je suis moi-même surpris. Mais, une semaine plus tard, l’instituteur réalise son erreur et rectifie le classement. « Tu as volé la place du premier », raillent les autres élèves. Je n’y suis pour rien et j’en ressens une vive humiliation, d’autant qu’être le meilleur ne me paraît pas si difficile. Je réagis en me mettant au travail et, le trimestre suivant, j’atteins sans difficulté la première place. Désormais, j’y resterai tout au long de mes études.
Je ne cherche pas à être meilleur que les autres, pas plus que la pression de mon entourage n’a prise sur moi. Je fixe moi-même mes objectifs sans me préoccuper du reste, sans chercher à me mesurer à qui que ce soit, voilà comment je fonctionne depuis mon plus jeune âge.
Hormis les disciplines artistiques pour lesquelles je n’ai aucune disposition, j’aligne de bons résultats dans toutes les matières, mais rien n’annonce que les sciences de la santé deviendront mon domaine de prédilection, puis une passion.
À cet âge, l’histoire du pays pique ma curiosité. Les cours nous racontent par le menu la période préangkorienne jusqu’à l’apogée de l’Empire khmer, et évoquent la grandeur et la vaillance de nos rois d’alors jusqu’au glorieux Jayavarman VII, et puis plus rien. Comme une étoile qui s’éteint, l’Empire khmer décline, dévasté par ses rivaux. Je m’étonne que, sur le trône d’Angkor, s’installent alors des rois dont les réalisations pour le royaume sont à peine mentionnées tant elles sont insignifiantes, alors que leurs prédécesseurs avaient bataillé en héros et gouverné en bâtisseurs pour mériter le respect qu’on leur voue encore aujourd’hui. Je m’emporte même : « Il y a des rois qui règnent trente années et cela se résume à une demi-page. Moi-même, en une seule journée, j’en fais plus qu’eux ! » Puis, dans mes livres d’histoire, le Cambodge revient brutalement à la lumière avec l’indépendance. Plusieurs siècles ont presque disparu, mangés par l’oubli en même temps que la forêt engloutissait les temples témoignant de notre génie déchu. J’interroge les professeurs mais ils se contentent souvent d’un vague et frustrant : « C’était la guerre, alors on n’a pas de documents sur ces périodes. »
Tant de chaos et de trous noirs dans notre passé questionnent l’enfant que je suis et, plus tard, quand je chercherai des explications à la tragédie que notre peuple endure dans les années 1970, je me souviendrai que la méconnaissance de notre histoire nationale et l’absence d’analyse critique sur le passé n’y sont sans doute pas étrangères.
Je poursuis ma scolarité à Chi Hè jusqu’en quatrième, au collège de la bourgade qui accueille les élèves jusqu’en première. L’établissement jouit d’une belle réputation au plan national, ce dont je ne me rendrai compte qu’à Phnom Penh.
Il faut dire que beaucoup d’intellectuels et de cadres du pays sont originaires de notre région ou s’y sont instruits. Dans le royaume, tout le monde connaît Ta Soy, qui, à l’époque coloniale, a bricolé une machine à vapeur et un moteur à bateau. Le docteur Chhay Han Chheng, gendre de Son Sann7 et ancien ministre de la Santé, Cheav Seang Lorn, gendre de Lon Nol et gynécologue réputé, son frère Cheav Seang Lean, plusieurs fois ministre, Sam Nhean, grand-père de Sam Rainsy8 et également plusieurs fois ministre, Say Chhum, actuel président du Sénat, Khieu Samphan9, Hu Nim et Hou Youn10, font aussi partie de ceux qui ont fait ou font encore briller ce petit bout de territoire.
Dans une région riche, davantage de moyens sont accordés par les familles à l’éducation, et les enfants doués disposent de meilleures chances d’établir les fondations d’une grande carrière ou d’un destin exceptionnel.
Un peu isolés sur notre langue de terre, notre vie de collégiens de Chi Hè tourne tout entière autour de la réussite scolaire sous l’œil attentif de la communauté, à l’écart de distractions dont nous ne soupçonnons même pas l’existence.
En dehors de l’école, nous participons aux activités collectives mises en place par la pagode ou le district. Sociable et doué pour l’organisation et le financement d’activités, on me nomme à un poste d’encadrement dans le mouvement local des jeunes sihanoukistes et je mets sur pied avec entrain des actions communautaires. Tout au long de ma vie, on me confiera ainsi des responsabilités sans même que je les sollicite.
J’ai été instruit par le lycée. J’ai appris de mes parents et grands-parents les principes moraux et religieux qu’ils tenaient eux-mêmes de leurs parents. Mais je sens que mon éducation m’a été donnée par le village tout entier de Chi Hè, où les portes de chaque maison restaient ouvertes à tous.
J’aurais dû, selon les règles, continuer mes études au lycée de Kompong Cham mais, à la fin de la quatrième, je décide de ne pas attendre une année de plus pour passer le brevet. Je m’inscris donc sous un faux nom à l’examen à Phnom Penh et je le réussis sans peine.





























