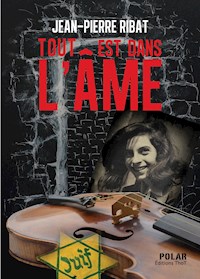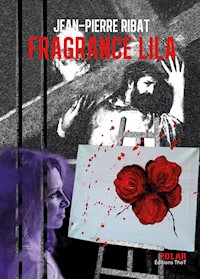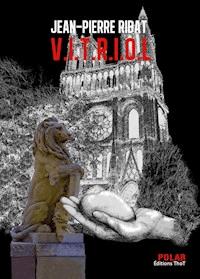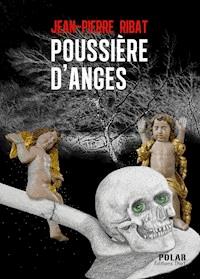Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions ThoT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une intrigue policière et un héros pas comme les autres !
Dernière intervention de la nuit, premier mort du matin. Dans le hangar des établissements Martinez, froidement éclairé par les néons, l’homme pend à plus de deux mètres de hauteur, en chemise de pyjama et chaussures de ville, le sexe et les jambes nus.
— Pas d’obstacle, docteur ?
— Non, pas d’obstacle… Il me reste seulement à lui croquer le gros orteil pour être sûr qu’il est bien mort…
Médecin généraliste, Marcel côtoie avec une folle énergie la faune urbaine dans toute sa diversité… Presque sans le vouloir, il va se retrouver au milieu d’une enquête étrange, voire sanglante, qui mêle Harpies grecques et rites vaudous africains. Dès le départ, une question l’obsède : quel est le lien entre l’albinos pendu et la disparition de son ami Youssef ?
Une première enquête palpitante pour le docteur Fortesse. Découvrez la suite de ses aventures dans Poussière d'anges !
EXTRAIT
— Vous savez que la pendaison (avec un p) conduit les hommes à l’éjaculation ? Pour les femmes, je ne sais pas. C’est si compliqué, le plaisir féminin...
Je lâche ça d’un ton léger, l’air badin. Pour réchauffer l’atmosphère, quoi ! Et j’attends qu’on me réponde : « Avec un “ b ” aussi ». C’est servi sur un plateau. Mais pas un mot. Pas même un regard. Richard, l’ambulancier, les yeux plissés, les dents serrées et la moustache frémissante, semble totalement concentré sur la conduite du véhicule du SAMU lancé à vive allure dans les rues de Mantes-la-Jolie. Pas la peine de jouer de la sirène. La circulation est fluide. Peu de gens dehors à sept heures du matin, ce mardi. Pour nous, équipiers du SMUR, c’est l’heure chaude malgré les fraîcheurs de l’aube. L’heure où les vivants quittent le sommeil et découvrent les morts de la nuit. Celle où l’on recense les misères accumulées depuis la veille, comme sur une plage quand la mer se retire après la tempête.
C’est l’heure des infirmières libérales qui passent au domicile des petits vieux pour leur faire la toilette et leur injecter l’insuline ou l’anticoagulant.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Très inspirée par l'expérience de l'auteur, cette aventure du médecin urgentiste hyperactif est prenante et jubilatoire par le ton utilisé, où les blagues de carabins font de la dérision une protection nécessaire dans ce monde de brutes. -
Chevalierortega33, Babelio
À PROPOS DE L’AUTEUR
Jean-Pierre Ribat est né le 13 novembre 1961 à Toulouse. D’abord médecin généraliste, il devient médecin urgentiste à l’hôpital de Mantes-la-Jolie, puis consultant au centre de dépistage anonyme des maladies sexuellement transmissibles. Il est par ailleurs médecin capitaine des pompiers et fut ainsi missionné en Haïti après le tremblement de terre. Jean-Pierre Ribat est aussi passionné de rugby, de course à pied et est chef de chœur des Copains d’abord, une chorale de 80 personnes... La suite de
Pas d'obstacle ?,
Poussière d'ange, est désormais également disponible en numérique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Présentation de l'auteur : Jean-Pierre Ribat est né le 13 novembre 1961 à Toulouse. D’abord médecin généraliste, il devient médecin/urgentiste à l’hôpital de Mantes-la-Jolie, puis consultant au centre de dépistage anonyme des maladies sexuellement transmissibles. Il est par ailleurs médecin capitaine des pompiers et fut ainsi missionné en Haïti après le tremblement de terre. Jean-Pierre Ribat est aussi passionné de rugby, de course à pied et est chef de chœur des Copains d’abord, une chorale de 80 personnes...
Chaleureux remerciements au commissaire divisionnaire de Mantes-la-Jolie Frédéric Eloir et à son adjoint Philippe Surlapierre pour leurs conseils précieux.
CHAPITRE 1
La pendaison : paradoxalement c’est un dénouement. Vincent ROCA.
— Vous savez que la pendaison (avec un p) conduit les hommes à l’éjaculation ? Pour les femmes, je ne sais pas. C’est si compliqué, le plaisir féminin...
Je lâche ça d’un ton léger, l’air badin. Pour réchauffer l’atmosphère, quoi ! Et j’attends qu’on me réponde : « Avec un “ b ” aussi ». C’est servi sur un plateau. Mais pas un mot. Pas même un regard. Richard, l’ambulancier, les yeux plissés, les dents serrées et la moustache frémissante, semble totalement concentré sur la conduite du véhicule du SAMU lancé à vive allure dans les rues de Mantes-la-Jolie. Pas la peine de jouer de la sirène. La circulation est fluide. Peu de gens dehors à sept heures du matin, ce mardi. Pour nous, équipiers du SMUR, c’est l’heure chaude malgré les fraîcheurs de l’aube. L’heure où les vivants quittent le sommeil et découvrent les morts de la nuit. Celle où l’on recense les misères accumulées depuis la veille, comme sur une plage quand la mer se retire après la tempête.
C’est l’heure des infirmières libérales qui passent au domicile des petits vieux pour leur faire la toilette et leur injecter l’insuline ou l’anticoagulant. Elles trouvent le papi au sol, près de son lit, le col du fémur fracassé par sa chute dans le noir après avoir dérapé sur la carpette. À deux heures du matin, en se levant pour aller pisser, il n’a pas voulu allumer la lumière afin de ne pas réveiller mamie, qui pourtant dormait profondément, vu que ça fait deux ans qu’elle est morte et se repose au cimetière. Mais le somnifère qu’il prend le soir depuis une semaine, embrouille un peu ses souvenirs, et rend son équilibre instable...
C’est l’heure où la fille fait un petit détour sur le trajet de la gare pour embrasser sa mère avant de partir travailler à Paris. Elle pousse la porte du salon, déjà inquiète de ne pas sentir l’odeur du café qui emplit habituellement la maison et aperçoit maman, affalée sur le canapé, la moitié gauche du corps paralysée par un accident vasculaire cérébral. La bouche tordue par un rictus imite un sourire en coin. Le bras droit, valide est désespérément tendu vers le bouton de la téléalarme qui trône près du téléphone, à trente centimètres de sa main.
Ce matin, pour nous, c’est l’heure d’une femme de ménage qui découvre un pendu dans l’entrepôt désert d’une entreprise de transport routier qu’elle est chargée de nettoyer avant l’arrivée des employés.
— T’en as pas marre de sortir des vannes de cul toutes les demi-heures ?
Coincée entre l’ambulancier et moi sur les sièges avant de notre véhicule de réanimation, l’infirmière semble avoir perdu sa tolérance vis-à-vis de mes plaisanteries fines à mesure que la nuit – blanche pour nous – avance vers son terme. Elle a l’air épuisée et il y a de quoi : six interventions depuis hier soir, dont un polytraumatisé qui a nécessité beaucoup de technicité pour maintenir un peu de vie dans son corps en morceaux. Il est temps que la garde se termine. Et pas de chance, juste avant que la relève de jour n’arrive, le bip qui se remet à sonner ! Pour une pendaison... Elle est jeune, incapable encore de prendre la distance suffisante pour rire des tragédies. Ses mains tremblent, ses lèvres aussi. Elle est pâle. Les larmes ne sont pas loin.
— C’est pas une vanne de cul. C’est une réalité scientifique. D’ailleurs certains jeux sexuels sont dérivés de cette observation et peuvent parfois aboutir à la mort accidentelle. Nous avons reçu aux urgences un jeune garçon victime de la dissection d’une artère carotide après s’être laissé volontairement étrangler par sa copine. Il y a perdu la vision d’un œil...
— Tous des malades, les mecs...
J’avais pas bien perçu que ce n’était pas une folle de la baise, notre infirmière... On va essayer autre chose pour la détendre.
— Des légendes courent sur le sperme des pendus. On dit qu’il donne naissance à une plante douée de propriétés magiques, la mandragore. Elle pousse souvent dans les bois et il est arrivé qu’on la trouve sous un arbre dont la branche maîtresse avait servi de gibet, d’où l’idée qu’elle était fécondée par la semence des suppliciés. En plus, ses racines sont anthropomorphes, ce qui veut dire qu’avec un peu d’imagination, on peut y reconnaître le corps et les membres d’un être humain.
Elle m’écoute. Ses lèvres, un peu entrouvertes, ne frémissent plus. Les sorcières maintenant.
— Les sorcières, qui sont les ancêtres des médecins et des pharmaciens, utilisaient cette plante pour soigner ou tuer les gens, selon leurs besoins. Juste une question de dosage. Elles l’utilisaient également pour elles-mêmes en s’enduisant le corps d’un onguent préparé avec de la mandragore pour des séances d’orgies qu’on appelait les sabbats. Les substances toxiques traversaient la peau et créaient un état délirant fortement érotisé à cause de ses propriétés aphrodisiaques. Elles revenaient ensuite lentement à la conscience en gardant de leurs « voyages » des souvenirs lubriques, plus imaginaires que réels.
La petite aime les histoires, ça se voit. Ses beaux yeux de biche se sont asséchés. Son regard, perdu au loin, contemple les images qui naissent des paroles. La couleur revient sur ses joues un peu acnéiques. On ne va pas tarder à arriver sur les lieux de l’intervention. Il va falloir revenir dans le temps présent.
— Les scientifiques ont étudié les substances de la plante. Elles ont des propriétés pharmacologiques désormais bien identifiées : antispasmodiques, sédatives et bien sûr, hallucinogènes. On en a tiré deux substances qu’on utilise couramment en médecine, l’atropine et la scopolamine.
— Ah oui, l’atropine je connais ! On l’utilise beaucoup aux urgences. Alors, on la tire du sperme des pendus ?
Oui... Bon... Elle est fatiguée quand même, notre petite infirmière...
Dans la rue devant l’entrepôt, nous sommes attendus par Robert, un sous-off des pompiers expérimenté, désigné chef-d’agrès-du-VSAB-troisième-départ-de-Magnanville (Ah la poésie si particulière des appellations pompières !).
— Salut toubib ! Te presse pas : homme de cinquante-sept ans, déjà raide et froid. On est en galère pour le décrocher. Il s’est suspendu vachement haut et avec du câble électrique en plus. Les gars sont montés avec une cisaille, mais on a peur qu’il se casse quelque chose en tombant.
— Parce qu’il est toujours vivant ?
— Ben non pourquoi ?
Oui pourquoi ? J’oublie parfois de raisonner comme un combattant du feu... Un mort est un être humain comme les autres...
— On prend du matos ou c’est pas la peine ? demande notre ambulancier.
— Laisse tomber. Ton toubib, il a juste besoin de son stylo pour signer le papier bleu.
— OK, on prend seulement un certificat de décès. Montre-nous le chemin.
J’ai confiance. Ça fait deux décennies que je monte des gardes au SMUR de Mantes et je n’ai jamais vu Bébert se tromper. C’est bien simple, même avec vingt ans de moins, il donnait déjà l’impression d’être un vieux cadre. Avec ce qu’il faut de calme, d’assurance, de coup d’œil. La brioche en moins bien sûr...
Nous franchissons le portail de l’entrepôt en prenant la mine de ceux qui en ont vu d’autres, sauf Géraldine, l’infirmière novice, qui va se trouver face à son premier pendu.
Le hangar est violemment éclairé par de multiples rampes de néons. Il est totalement vide de marchandise. Un groupe de policiers et de pompiers, dont un juché sur une échelle, est massé au centre de l’espace, à cinquante mètres de l’entrée. Malgré la distance, on distingue le cadavre encore accroché à son fil à plus de deux mètres de haut. À mesure que nous nous approchons, se précisent peu à peu la tête violacée, la langue, énorme, sortant de la bouche entrouverte, ainsi que les yeux ouverts et exorbités aux pupilles colorées d’une étrange lueur rougeâtre. Le lien est entré dans les chairs du cou et un peu de sang a coulé sur le thorax. Il est vêtu d’un haut de pyjama rayé. Pas de pantalon pour le bas. Le sexe et les jambes sont nus. Il porte aux pieds des chaussures de ville bien cirées, sans chaussettes.
Un grand drap a été déployé sous le corps, à un mètre du sol, tendu aux quatre coins par un pompier. Celui qui est sur l’échelle attend le commandement pour couper le câble. Il tient une longue et puissante cisaille habituellement utilisée pour les désincarcérations au cours des accidents de la voie publique. Je vois Géraldine se pencher sous le drap pendant les préparatifs de décrochage et se redresser peu après, les joues en feu. Je regarde à mon tour vers l’endroit qu’elle vient de quitter des yeux : juste sous le cadavre, on distingue sur le revêtement de béton brut une petite flaque de liquide blanchâtre qui ne peut être autre chose que le sperme du malheureux.
— Attention toubib. Ton client va descendre. Qu’est-ce que tu fous sous la toile ? Tu vas le prendre sur le râble !
Je m’éloigne vivement en cherchant le regard de l’infirmière. Il est posé sur l’entrecuisse nu du pendu. Le sexe est désormais et définitivement au repos, assez petit et partiellement caché par un ventre proéminent. Je note au passage que la totalité de sa peau est très blanche, et les poils aussi. Je comprends alors ce qui m’avait troublé dans les yeux rouges sans vie de cet homme : c’est un albinos.
Bébert est à la manœuvre.
— Vous êtes prêts à recevoir le paquet, les gars ?
— Ouais chef ! répondent-ils. Ils sont tous penchés en arrière, les muscles pectoraux saillants, les mains crispées sur la toile.
— Vas-y coupe, petit !
Et le petit – un mètre quatre-vingt-dix au garrot – de sectionner d’un coup sec le fin câble de cuivre gainé. Les receveurs accusent le coup en faisant une grimace d’effort un peu exagérée et portent rapidement le corps un peu plus loin.
Pendant cette manœuvre, réduit au rôle de spectateur privilégié, je m’ennuie et sous l’effet de la fatigue, j’ai vite fait de partir en rêveries. Je retrouve dans ma mémoire les propos d’un sauveteur, lors d’un feu d’immeuble, après l’évacuation de plusieurs habitants par la grande échelle. « T’as beau savoir que c’est con, n’empêche que cinquante kilos de jeune fille riante, c’est beaucoup moins lourd que cinquante kilos de vieille grincheuse. » L’éternelle plaisanterie des kilos de plumes et des kilos de plomb...
Je suis resté, pensif, sous la corde du pendu (Je la prends ? Il paraît que ça porte bonheur). Et voilà qu’on m’appelle. Au passage, la petite flaque blanche a été piétinée. Est-ce que les albinos ont du sperme plus blanc que les autres ?... Certes non, me réponds-je, pas plus blanc que celui des Noirs... Mais au fait, je n’ai jamais vu du sperme de Noir ! Est-ce qu’il est blanc ? Faudra que je me renseigne... Je poserai la question au staff tout à l’heure. Il y a beaucoup de collègues africains qui travaillent aux urgences de Mantes... Ça nous changera des drames humains qu’on passe en revue sans émotion lors de cette réunion quotidienne.
— Ça va, j’arrive ! Vous ne comptez quand même pas sur moi pour le ranimer ?
Je rejoins le groupe des pompiers et des policiers qui font cercle autour du corps. Il y a comme un flottement dans l’action. Les hommes attendent des ordres, notamment les miens. Je suis censé déclarer le décès, et déterminer son caractère suspect ou non. Moi qui ai toujours trouvé suspecte cette façon qu’à la mort de se moquer des espoirs des vivants : un jeune homme prometteur est écrabouillé par un camion lancé à vive allure au volant duquel le conducteur s’est endormi. Un vieux con dont tous les proches souhaitent la disparition les enterre tous un à un. Tous les matins au réveil, je pousse le cri de désarroi du Macbeth de Shakespeare : « La vie est un conte, raconté par un idiot, plein de bruit et de fureur, et ne signifiant rien. »
Derrière nous, un nouveau venu se racle la gorge pour se signaler.
— Pardonnez-moi, je suis Yves Marcheur, officier de la police judiciaire de Versailles. J’étais tout près et j’ai entendu parler de cette intervention sur la fréquence locale. Je suis venu jeter un coup d’œil à tout hasard. Qui fait fonction d’OPJ sur les lieux ?
Un major de la police se signale et s’avance en tendant la main.
— Ça par exemple ! Mais c’est le capitaine Marcheur, le chouchou de ces dames ! Ça fait un bail que je ne t’ai pas vu par chez nous. Alors maintenant, à la PJ, vous écoutez les fréquences locales et vous débarquez sur les inters avant même qu’on vous appelle ?
— Salut Thierry, heureux de te voir. J’étais dans le véhicule d’une amie, que tu connais puisqu’elle est de la maison, et on a entendu l’appel à la radio, c’est tout. C’est juste pour ne pas partir pour Versailles et revenir dans une heure quand vous aurez décidé que c’est un crime.
Derrière lui, tentant de se faire toute petite, une jolie blonde en habit de police rougit avec embarras à mesure que les regards de tous les spectateurs se posent sur elle et son décolleté nettement débraillé. Elle y remet rapidement de l’ordre. Dommage...
Le visage de l’officier me dit quelque chose. Gérard Depardieu ou Niels Arestrup ? Belle gueule, pas grand, massif, blond et mal rasé, la quarantaine. Il se tourne vers moi.
— Bonjour. C’est vous le médecin du SAMU ?
— Oui. Mais vous savez, vous n’avez pas besoin de ma science. Tous ces messieurs-dames autour de nous peuvent vous confirmer comme moi qu’il est définitivement mort. Mon stéthoscope n’est pas fondamental dans le diagnostic, ni dans le pronostic d’ailleurs...
— On se connaît, non ?
— C’est ce que je me suis dit aussi, mais je regarde peu la télévision. Vous avez joué dans quel film ?
Il sourit avec indulgence. On a déjà dû lui faire le coup.
— Je suis dans la police, pas dans le cinéma. Je dois vous demander d’examiner le cadavre pour déterminer les causes de la mort.
— Pendaison, il me semble...
— Volontaire, accidentelle ou criminelle ?
— OK compris. Messieurs, s’il vous plaît, aidez-moi à retirer la veste du pyjama de cet infortuné.
À contrecœur, les pompiers s’exécutent. Personne n’aime toucher les morts. Les bras sont déjà rigidifiés et le déshabillage est difficile. L’inspecteur, lui, ne nous aide pas. Il faut dire qu’il n’a pas de gants... Il me dit :
— Vous n’avez pas joué au rugby quand vous étiez jeune ?
Je me relève, surpris et vexé.
— Mis à part à la fin d’une garde au SMUR comme ce matin, je me sens assez jeune pour jouer encore au rugby. Mais je ne sais pas si c’est l’instant idéal pour échanger nos opinions sur la sélection de l’équipe de France pour le prochain tournoi des six nations...
À bien le regarder, c’est peut-être sur un terrain de sport que je l’ai déjà croisé. Les pompiers prennent mille précautions pour ne pas casser les coudes du mort. Ils ont des airs de pucelles effarouchées devant une érection. La peau laiteuse et froide les rebute. Ils la touchent le moins possible, du bout des doigts. À ce rythme-là, on a le temps de causer... En plus, une lumière clignote dans ma tête.
— J’ai connu un Yves Walker qui vous ressemblait quand je jouais au Paris Université Club. C’était vous ?
— C’est moi.
— Marcheur... Walker...
— Je suis anglophobe. J’ai demandé à changer de nom.
— Ah ? Ça suffit comme raison ?
— Non. Mais j’ai des amis bien placés. Vous, vous étiez l’intello de l’équipe, celui qui lit des livres, je me souviens.
— Vous ne lisez pas de livres, vous ?
— Si, mais moins que toi. Tu lisais n’importe où. Dans le bus, dans les vestiaires...
Ah ça y est, on est copains, on se tutoie.
— C’est un principe chez moi : la chanson « la grosse bite à Dudule », je ne la chante qu’une seule fois par jour. Après, je fais autre chose. Je lis par exemple...
— J’ai rien contre, je respecte, il en faut...
Bon ben c’est clair : la lecture n’est pas son truc. Les pompiers, qui ont achevé l’effeuillage mortuaire, attendent patiemment la fin de nos échanges de civilités. Et survient alors l’entrée tonitruante d’un type taillé comme une armoire normande : grand, large et brun.
— Ah nom de Dieu, le con, c’est pas vrai, il a pas fait ça !
Il s’arrête aux pieds du mort et continue ses imprécations en le couvrant d’un regard à la fois courroucé et effrayé.
— Vous êtes ? demande mon nouvel ami.
— Gérard Martinez. Patron des établissements Martinez où vous vous trouvez en ce moment. Et employeur de cet abruti qui était gardien ici. Il aurait pu choisir un autre endroit pour se suicider, merde ! Tiens, la Seine, elle est à deux pas d’ici. Il avait qu’à se foutre à la baille... C’est que dans une heure, j’ai trois semi-remorques bourrés de fret qui déboulent ici, moi. Va falloir me nettoyer ça vite fait.
Il me déplaît fortement, ce sinistre salaud. Il faut que je m’exprime. Mais du calme, mon Marcel. De la compassion...
— Il était certainement très malheureux pour en arriver là. Il ne vous a jamais parlé de son désir de mourir ?
— Il était toujours à se plaindre de quelque chose. À force, on n’y faisait plus gaffe. Mais d’habitude, il s’en prenait bien plus aux Arabes et aux Noirs qu’à lui-même.
— Vous pouvez nous donner son identité ? demande le policier.
Je décroche encore de la conversation pendant que les autorités notent l’état civil de la victime, et de son patron. Je me souviens d’un cours de français au collège avec mademoiselle Mousnier. J’étais dans ma onzième année. Elle nous avait donné à lire la Ballade des pendus de François Villon. Son auteur l’avait écrite en prison, nous avait-elle expliqué, dans l’attente de sa propre exécution après avoir blessé un notaire au cours d’une rixe. Je murmure les paroles que je connais encore par cœur :
Frères humains qui après nous vivez
N’ayez contre nous le cœur trop endurci
Car, si pitié de nous pauvres avez
Dieu en aura plus tôt de vous merci.
« Merci doit se comprendre comme Miséricorde » ajoutait notre jeune professeure, l’éveilleuse de nos âmes. Ce poème fut une de mes premières émotions poétiques. Et ce terme « frères humains » me revient immédiatement en tête quand je tente de définir ceux auxquels mes soins sont destinés.
— Docteur...
Ma première expérience compassionnelle aussi. J’ai partagé à l’orée de mon adolescence l’angoisse du condamné à mort. J’ai perçu comment le destin peut parfois tourner au drame, pour un coup de poing imprudemment porté à un individu influent. J’ai, depuis lors, fait en sorte de ne jamais trop endurcir mon cœur à l’égard des délinquants... Qualité utile à un urgentiste souvent confronté à la violence. Faut-il voir dans la lecture de ce poème le point de départ de ma vocation de médecin ?
— Docteur...
Pour être honnête, bien avant mes années de collège, au cours de nos jeux d’enfants à l’abri du regard inquisiteur des parents... mes jeunes amies qui mimaient la maladie, et dans les fesses si douces desquelles je faisais, avec délice, semblant de planter des aiguilles, avaient déjà tracé ma voie de thérapeute...
— Docteur, j’ai besoin de toi !
Yves Marcheur me touche doucement l’épaule. Me revoici...
— Vas-tu émettre un obstacle médico-légal à l’inhumation de la victime ?
— Non, pas d’obstacle. Aucune trace de violence suspecte, hormis le geste de pendaison bien sûr. Il me reste seulement à lui croquer le gros orteil pour être sûr qu’il est bien mort. Dès que les pompiers auront daigné enlever les chaussures du futur décédé officiel.
Cette manie de sortir une plaisanterie en toutes circonstances, surtout lors des plus tragiques, c’est ma défense à moi. Rire, même en grinçant, pour ne pas pleurer... Mais le jeune pompier en attente près de nous n’a pas été prévenu de ma tournure d’esprit. Dans son cerveau où l’on a enregistré des principes simples, le message dit : « Le médecin te demande de retirer les chaussures de la victime. Le médecin a le statut d’officier. C’est donc un ordre. Action. » Il s’agenouille, dénoue les lacets de la chaussure droite et la retire. Et se fige. Mais son cerveau reprend la main. « Le médecin a dit d’enlever LES chaussures ». Il ôte la chaussure gauche, se relève, blême et me regarde. Je lis la détresse dans ses yeux.
Puis j’aperçois les pieds dénudés : tous les ongles ont été arrachés et le gros orteil gauche est manquant, sectionné à la base. Les plaies sont récentes. Elles saignent encore un peu. Tout ce carnage semble avoir été fait au couteau, de façon grossière. J’en frémis d’horreur et ressens un fort désagréable picotement dans tous mes orteils. Quel choc ! J’en perçois physiquement le bruit. Moi qui allais signer son acte de décès sans sourciller ! Difficile d’imaginer qu’il se soit infligé lui-même de telles blessures avant de se pendre. Voyons ce qu’en pense le capitaine de police...
Je me retourne vers lui. Personne. Ah si ! Plus bas. Allongé par terre, en fait. Sur le dos, inconscient, aussi pâle que le mort, avec une flaque de sang s’élargissant rapidement sur le sol autour de sa tête. Le coup que j’ai perçu il y a peu n’était pas dû au séisme de mes émotions, mais seulement au contact de son crâne contre le béton.
— Le flic nous a fait un malaise vagal. Géraldine, c’est le moment de sortir ton atropine de mandragore. Un demi-milligramme intraveineux direct. Tu me le remplis au sérum physio plein pot. Richard, va me chercher le scope et le sac dans le camion, au pas course s’il te plaît.
En bon professionnel, il est déjà parti avant que je ne le lui demande. Enfin un peu d’action ! Un vivant à requinquer ! L’ambulancier revient déjà avec un pompier, tous deux chargés comme des sherpas. J’empoigne une agrafeuse dans le sac d’urgence et lui plante en rafale trois sutures métalliques sur son cuir chevelu entaillé. Pendant ce temps-là, les pompiers ont dénudé son thorax et ses bras en découpant aux ciseaux sa veste et sa chemise. Et l’infirmière est en train de lui enfoncer un cathéter dans l’avant-bras. Ça va lui faire bizarre, au réveil...
Pendant qu’on ressuscite le représentant de la force publique, tombé transitoirement en faiblesse, Bébert, le chef des pompiers me glisse à l’oreille :
— Tu veux voir où il créchait, ton macchabée ?
Je ne serais pas médecin si je n’étais pas curieux...
— Je t’accompagne.
Nous sortons de l’entrepôt et il me conduit jusqu’à une « construction modulaire transitoire ». Ce que tout le monde appelle un Algeco (nom de marque comme Frigidaire ou Kleenex). L’aspect extérieur crasseux et usagé laisse deviner que le transitoire est devenu définitif depuis plusieurs années. La porte est entrouverte. Nous entrons.
— On touche à rien. Les enquêteurs vont passer par ici tout à l’heure.
— T’inquiète, Bébert. De toute façon, j’ai gardé mes gants.
Des relents de sueur d’homme me tirent une grimace de dégoût. Il y a une douche, au fond là-bas, mais elle ne devait pas servir tous les jours... Ça sent aussi le chien mouillé, mais c’est beaucoup moins pénible. Le lit est défait et les draps sont tachés de graisse. Je ne peux pas m’empêcher de chercher des signes de lutte, mais non. Le banal désordre d’un homme seul, et sale. Trois fusils de chasse sont accrochés aux murs et voisinent avec des bois de cervidés. De nombreuses photographies sont scotchées un peu partout et montrent notre albinos posant devant des animaux morts : un chevreuil, un ours, un lynx et un gnou, entre autres. Un vrai massacreur de bestioles, notre gardien d’entrepôt... Et il a des amis en plus, puisque sur un large cliché de groupe, on le reconnaît au milieu de nombreux chasseurs habillés en tenue de camouflage, arborant fièrement leurs armes derrière une banderole déployée sur laquelle on lit « Confrérie de Saint-Hubert ». J’y remarque au passage le logo de l’entreprise de travaux publics Lauréat, dont je connais le patron pour l’avoir soigné. Celui-ci et l’habitant de ce taudis se tiennent amicalement par l’épaule.
Poursuivant mon inspection de la décoration de la pièce — qui semble plus dictée par le hasard que par une réflexion esthétique —, je survole du regard le mur au-dessus de la tête du lit : le portrait du pape Jean-Paul II semble y adresser un bon sourire à son voisin le Christ en croix. Symétriquement par rapport au saint-père (en considérant Jésus comme le centre de gravité, forcément...) un article de presse est punaisé. Le titre Fàtima, le « Lourdes portugais » ne réveille en moi aucune curiosité. Mais, sous une image de la Vierge aux mains jointes intitulée La dame blanche (phantasme ultime pour un albinos ?), un encadré est cerclé plusieurs fois d’un gros trait de feutre noir :
Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un Ange avec une épée de feu dans la main gauche ; elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde ; mais elles s’éteignaient au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui ; l’Ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d’une voix forte : « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! »
Brrrr ! Ça ne respire pas la joie, dans cette piaule... Je m’éloigne du lit. Sur une table de camping, une boîte ouverte de pizza à emporter traîne avec un couteau et une fourchette dedans. On a laissé le pourtour seulement constitué de pâte à pain. Un écran d’ordinateur posé juste à côté a reçu des éclaboussures de sauce tomate. Une adresse électronique est inscrite sur un Post-it collé en haut du cadre de l’écran : [email protected], mot de passe : vigie.
— Bébert, il s’appelle Adao Bartolomeo notre client ?
— Il s’appelait. Affirmatif. Tiens regarde : j’ai trouvé les témoins du meurtre.
Je me tourne vers lui. Il me désigne le coin-cuisine. Le mur au-dessus de la plaque électrique grouille de cafards. J’en ai assez vu.
Le chef des pompiers me rejoint dehors alors que j’aspire goulument l’air frais du matin pour chasser la puanteur de la chambre du gardien.
— Tu vas pas nous faire ton malaise, toi aussi ? Pour trois petites bêtes.
— Je pense qu’il y en avait dix fois plus. Tu te souviens quand deux petits gamins maliens au Val Fourré avaient disparu il y a une dizaine d’années ? J’étais de garde avec les pompiers quand on les a retrouvés dix jours après leur disparition dans le bois de la Butte-Verte. Leurs cadavres frémissaient de vermine, et l’odeur... Tu crois pas que le flic responsable m’a demandé d’examiner les corps pour vérifier s’ils étaient bien morts ? Je ne m’en suis jamais remis. Je déteste les insectes nécrophages. Même si je sais bien que leur rôle de nettoyage est utile. Mais je suis sorti aussi pour chercher une plus grosse bête : le chien.
— Qué chien ?
— Son chien, au mec. Celui dont l’odeur traîne dans sa turne. Il est chasseur. Il a un chien, sinon deux ou trois. Obligé.
Bébert hoche la tête. Il a compris et je vois son regard se reporter vers l’Algeco. Pas vers l’entrée, mais vers les murs latéraux. Il est en train de se dire que si tu ne peux pas loger ton chien dans la pièce, faute de place, tu lui fais une niche à côté... Un bout de matelas dépasse de l’espace entre la loge du concierge et le mur de l’entrepôt. On s’approche.
Le chien est là. Un grand berger allemand. La gorge tranchée. Les dents fracassées. Une plaie béante entre les pattes arrière, là où devaient se trouver les testicules.
— Un orteil d’albinos... Des couilles de chien... Il manque des morceaux, dans cette histoire.
— T’as tout résumé, Bébert. Viens, on va raconter ça au flic...
...qui a l’air d’aller beaucoup mieux d’ailleurs. Il a été installé dans le bureau du patron de l’entreprise. Géraldine semble aux petits soins avec lui, penchée sur son bras perfusé qu’elle palpe longuement, pour vérifier l’état des veines certainement. Celui que nous avons laissé tout à l’heure blanc comme un suaire a repris des couleurs et ne quitte pas des yeux le décolleté de la jeune femme en lui susurrant des compliments éhontés.
— C’est étonnant, autant de compétences et de sang-froid chez une si jeune et belle demoiselle. Je n’ai même pas senti l’aiguille quand vous m’avez piqué.
— C’est normal, t’étais dans les pommes. Désolé de casser l’ambiance, Roméo, mais faut qu’on rentre. La « jeune et belle demoiselle » peut déperfuser le joli cœur avant qu’il nous fasse une poussée d’hypertension artérielle ou qu’il perde la vue.
Heureusement qu’elle n’est pas armée, l’infirmière, car le regard qu’elle m’adresse en dit long sur ses envies de meurtre. L’inspecteur tend aimablement son bras sans la lâcher du regard. Mais c’est à moi qu’il s’adresse :
— Marcel, il va falloir que je consigne ton témoignage. J’ai activé une équipe d’enquêteurs de la PJ. En les attendant, j’ai demandé qu’on fige les lieux du crime, alors ne touchez plus à rien dans l’entrepôt. Ça me fait plaisir de te revoir après tout ce temps. Tu me donnes ton numéro de portable ?
— Pas de problème, voici. Pendant ton absence, on a été voir la maison du mort, si on peut appeler ça comme ça... Tu vas certainement adorer. T’inquiète pas, on n’a touché à rien. Fais gaffe quand même au matelas du chien, dehors sur le côté. Vu que tu as déjà subi un choc. Prends une chaise avec toi, et assieds-toi avant de tomber.
CHAPITRE 2
La médecine est un métier dangereux. Ceux qui ne meurent pas peuvent vous faire un procès. COLUCHE.
Mea culpa : j’ai fait le fier tout à l’heure devant le flic, mais en rentrant à la base, les images des lieux et des victimes du crime repassent dans ma tête comme un diaporama qui tourne en boucle. On a beau avoir vingt-cinq ans de SAMU, ce n’est pas tous les jours qu’on participe à la découverte d’un meurtre, avec des mutilations en plus...
Il y a un temps pour l’action, et celle-ci nous protège. Pendant qu’on tente de sauver une vie avec deux actes techniques et trois drogues, il n’y a pas de place pour l’émotion ni le questionnement. Les décisions que l’on prend peuvent être lourdes de conséquences. Les posologies sont apprises par cœur, les arbres décisionnels sont élaborés bien longtemps avant d’avoir à servir, les gestes maintes fois répétés doivent être nets et précis. On se réfugie derrière l’élaboration d’une stratégie de sauvetage, le mouvement adéquat des corps, les ordres clairs donnés. Mais il ne faut pas croire qu’on passe à côté du tragique ou du merveilleux pendant le travail. On encaisse. Et ça ressort plus tard.
Je me souviens du décès d’un enfant de huit ans qui avait mené un long combat contre son cancer du rein. Aucune action médicale derrière laquelle s’abriter. Pas de mort suspecte, mais un certificat de décès comme une délivrance pour lui et sa famille. Les parents pleuraient, mais semblaient en même temps heureux que cette issue inévitable ait mis fin au calvaire des chimiothérapies, des ponctions, de la morphine... Je ne savais pas où me mettre, ni quoi dire. J’aurais facilement pu me laisser aller aux larmes avec eux, comme l’infirmière de mon équipe, mais un sentiment de pudeur m’en empêchait, l’idée que je n’avais pas à leur voler leur tristesse. Seul Daniel l’ambulancier, qui a un enfant très lourdement handicapé, savait trouver les mots justes et donner l’aide adéquate au bon moment. Pendant la semaine qui a suivi, mes yeux se sont mis à pleurer, sans prévenir, n’importe quand, mais bien sûr particulièrement en présence d’enfants. Heureusement que c’était le printemps et que j’ai pu arguer d’une allergie saisonnière. Ça ne rassure pas les patients, un médecin qui pleure. Une patiente m’a dit :
— Moi c’est comme ça toute l’année. Je suis allergique à tout. On dirait que je suis allergique à la vie !
— Moi à la mort... ai-je murmuré pour moi-même.
Sous la douche bienfaisante, en me savonnant les valseuses, ce n’est pas au film de Bertrand Blier que je pense, mais au chien. Je parle tout seul :
— J’espère qu’on les lui a coupées après l’avoir égorgé, pauvre bête.
Bizarrement, j’ai plus de pitié pour l’animal que pour le maître. Probable que j’attribue plus de valeur à des testicules qu’à un orteil ou des ongles.
— Comptabilité de macho, dirait ma femme avec raison. Alors j’en parle à qui, de mes angoisses gonadiques ? Peut-être à mes collègues, lors de la séance de travail qui commence dans cinq minutes, si l’occasion se présente...
Tous les matins, à neuf heures, dans une petite salle du service des urgences de l’hôpital de Mantes, qui sert aussi de cuisine et de réfectoire pour le personnel médical, se tient la réunion qui conclut la fin de la garde de nuit et marque le début d’une nouvelle journée de travail. On appelle ce rendez-vous quotidien « Le Staff ».
— Parce que ça le fait mieux, en anglais... m’a dit une fois Bob, enfin Robert, le chef de service. (Que penserait mon nouveau vieux copain, Yves, l’anglophobe, de cet emprunt à nos amis britanniques ?)
Les médecins harassés quittant le service de la veille rencontrent dans cette pièce et à cette heure précise chaque jour, ceux qui arrivent frais et parfumés. C’est l’occasion pour ceux de la garde descendante de raconter les histoires comiques ou sordides auxquelles ils ont été confrontés. L’occasion de ne pas ramener trop d’horreurs à la maison.
Tout ce monde se restaure avec du pain, du beurre et de la confiture industriels bourrés de pesticides en sirotant un café ignoble, mais capable de faire bander un mort. (Tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose... Ne pas oublier de parler de mon pendu éjaculateur.) Ceux de la garde montante tentent de prendre en défaut les démarches diagnostiques et thérapeutiques échafaudées par ceux qui vont rentrer chez eux pour dormir. C’est la règle du jeu. Tout le monde sait que c’est comme ça qu’on devient meilleur. C’est fait dans un esprit paisible et bon enfant, ce qui n’est pas le cas dans tous les services où j’ai travaillé. Ici, même les internes, futurs médecins en cours d’études, traditionnellement traités comme les victimes expiatoires de leurs aînés, sont écoutés et respectés. Certes il arrive parfois, mais très rarement... pas plus d’une ou deux fois par semaine... que le ton monte.
C’est aussi le lieu pour parler de nos interrogations et de nos incertitudes avec des confrères. Ils peuvent avoir déjà été confrontés aux mêmes problèmes que nous et avoir des solutions à proposer. Nous ne sommes pas dans une réunion de la police judiciaire de Versailles, alors j’évite le sujet criminel, pour rester dans le domaine médical. On parlera des couilles du chien plus tard... (Est-ce que les vétérinaires font des staffs, aussi ?) Ah non Marcel ! Reste concentré ! OK je prends la parole :
— Tout à l’heure, sur une pendaison, j’ai bien failli signer le certificat de décès sans obstacle médico-légal. J’ai cru à un suicide jusqu’à ce que je réalise qu’il s’agissait probablement d’un crime. Mais il a fallu un hasard heureux, si j’ose dire dans de telles circonstances, pour que je comprenne. Moi, je n’ai jamais reçu un enseignement universitaire sur les réglementations légales concernant la mort. Je ne sais pas avec certitude quand je dois émettre un obstacle et quand je peux autoriser une inhumation. Un médecin devant un cadavre est l’auxiliaire de la justice des hommes. Sa sagacité peut parfois représenter le dernier rempart, et aussi quelquefois le seul, contre le crime parfait. Ce qui est certain, c’est que s’il rate une mort suspecte et qu’il permet la fermeture du cercueil, il y a de fortes chances pour que le meurtre reste impuni, puisque ignoré. Exemple : Une vieille dame empoisonne son mari. Elle m’explique qu’il est suivi depuis longtemps pour un cancer, ou pour son cœur malade, par des spécialistes. Ce qui est vrai. Elle me montre des ordonnances. Moi médecin du SMUR, je vérifie le décès du papi déjà froid. Il n’a pas la gorge tranchée, ni le crâne défoncé. Comment puis-je me douter que cette mamie éplorée cache une âme de tueuse ? Je signe le certificat de décès. La police n’est pas appelée. On emmène le corps. On l’enterre et la veuve part en voyage à Venise avec le fils du voisin et l’héritage. À bien y réfléchir, je suis persuadé que de nombreuses empoisonneuses se sont débarrassées de leurs conjoints avec la complicité, le plus souvent involontaire, du médecin chargé de la constatation de la mort. L’histoire se pimente un peu si le médecin est précisément le fils du voisin... Mais je suis un vieux con, lecteur de romans noirs et il est probable que désormais, un enseignement de médecine légale est dispensé à la fac. Pas vrai, les jeunes ?
« Pas d’obstacle, docteur ? » Cette phrase, qui m’a été adressée par plus d’une centaine de policiers depuis que je suis « thèsé » – à chaque décès un tant soit peu inattendu –, c’est comme si je l’entendais pour la première fois. La répulsion face à l’examen approfondi d’un cadavre est probablement la seule raison de mon empressement à signer l’impitoyable papier bleu... Tous ces corps « déshabités » qui jalonnent mon parcours professionnel ne m’ont pas débarrassé d’un frisson d’horreur devant la mort.