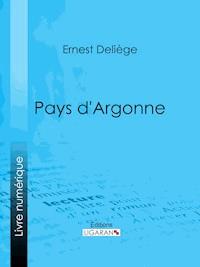
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le sol du « Pays d'Argonne » est formé spécialement par la gaize ou pierre morte. C'est une roche poreuse, légère, quoique assez dure que les habitants utilisent pour les fondations de maisons et pour la construction de la couche inférieure des chemins et des routes. En se délitant, cette roche donne une terre sableuse, légère et perméable convenant particulièrement aux essences de nos forêts, ce qui fait de l'Argonne un pays essentiellement boisé."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« … Qui me rendra mes amours :
L’Argonne, ses forêts fraîches et son silence ? »
L. FORGET.
Le Pays d’Argonne est une région très pittoresque qui servait autrefois de trait d’union entre les anciennes provinces de Lorraine et de Champagne. Aujourd’hui, il s’étend quelque peu sur les confins des départements de la Meuse, partie ouest de l’arrondissement de Verdun, de la Marne, partie est de l’arrondissement de Sainte-Ménehould, des Ardennes, partie occidentale de l’arrondissement de Vouziers, formant ainsi un vaste plateau, long du nord au sud d’environ dix-huit lieues, large de l’est à l’ouest de trois à quatre lieues.
Ce plateau est coupé en deux endroits différents par la Biesme et l’Aire, affluents de l’Aisne ; il est rattaché aux régions voisines par des dépressions dont la pente est des plus variables.
Il a été déjà beaucoup écrit sur ce pays. Les œuvres d’André Theuriet, de Léon Forget, de Paul Collinet ; les excellents articles des Revues d’Ardenne et d’Argonne, de Champagne et de Brie, du Bulletin-Revue de l’Œuvre des Voyages scolaires, pour ne citer que les meilleures études, en font certainement foi.
Aussi, n’est-ce pas une nouvelle description de cette intéressante région que nous offrons à nos lecteurs. Ce sont de simples croquis dont la seule qualité est d’être pris sur le vif. Nous nous sommes plu à les recueillir pendant qu’il en était temps encore ; ils sont destinés à montrer ce qu’est la caractéristique du Sol, des Eaux, des Champs et Prairies, des Forêts, des Localités, des Habitants et de l’Histoire d’un pays qui mérite certainement autant et plus que beaucoup d’autres, d’être visité par les admirateurs de sites remarquables de notre belle Patrie.
Nous avons choisi à dessein cette division naturelle des chapitres, afin de donner complète satisfaction aux touristes qui parcourront l’Argonne ou mieux encore, qui villégiatureront dans cette charmante contrée.
À ceux dont la passion est d’arracher au sol les précieux trésors qu’il renferme, nous rappellerons les multiples industries anciennes et modernes dont la terre argonnaise fut la pourvoyeuse infatigable ; aux rêveurs, mollement assis sur les bords enchanteurs des fontaines et des ruisseaux de la « Vallée », nous raconterons les vieilles légendes des cours d’eau et nous énumérerons les richesses inépuisables des étangs échelonnés dans les coupures du massif argonnais ; aux amis de la nature, qui foulent le tapis moelleux des prairies émaillées de mille fleurs et le sol fécond des vergers aux senteurs enivrantes, nous narrerons les mœurs originales de ces robustes laboureurs à la fois mi-lorrains et mi-champenois ; à ceux qui préfèrent les futaies silencieuses et les combes ombreuses de la forêt profonde, orgueil du pays, nous dirons les plaisirs, les joies et les largesses, dont elle est la dispensatrice de tous les instants ; pour ceux qui aiment les vestiges et les ruines des temples et des abbayes, des manoirs et des villages d’antan, nous évoquerons les anciennes coutumes qui donnaient aux rustiques localités, à certains jours de l’année, une physionomie si originale ; aux admirateurs des héros guerriers, des écrivains, des artistes et des savants, nous offrirons les biographies des plus illustres Argonnais ; enfin, à ceux toujours avides des récits captivants de l’histoire, nous résumerons les évènements importants dont l’Argonne a été plus d’une fois le théâtre.
Nous pensons justement atteindre le but que nous nous proposons grâce à la collaboration précieuse et spontanée qui nous a été offerte durant notre période de documentation. Aussi, avant de terminer ces quelques lignes de préface, est-ce pour nous un devoir très agréable que d’adresser l’expression de notre plus vive reconnaissance à tous, historiens et poètes, dessinateurs et photographes, chercheurs et collectionneurs, qui ont rendu notre tâche à la fois si douce et si agréable.
E. DELIÈGE.
Reims, le 25 Mai 1907.
Le sol du plateau du « Pays d’Argonne » est formé spécialement par la gaize ou pierre morte. C’est une roche poreuse, légère, quoique assez dure que les habitants utilisent pour les fondations de maisons et pour la construction de la couche inférieure des chemins et des routes. En se délitant, cette roche donne une terre sableuse, légère et perméable convenant particulièrement aux essences de nos forêts, ce qui fait de l’Argonne un pays essentiellement boisé.
À la base du plateau, vers l’ouest, la gaize est remplacée par du sable vert ; au sud, c’est une argile grise, le « gault » qui convient surtout à la fabrication de la tuile et qui est recouverte de terres froides, tenaces et pauvres.
Il n’est pas rare de trouver à la partie inférieure de la gaize une couche de nodules phosphatés dont l’épaisseur varie entre huit et trente centimètres.
Tel qu’un génie bienfaisant, ce sol est le nourricier de ceux qui fouillent ses entrailles, tireurs de « coquins » et tireurs d’argile, pour en extraire les richesses qu’il renferme, et le pourvoyeur des usines locales, tuileries, briqueteries, faïenceries et verreries, qui transforment ces trésors en Objets de première utilité pour les besoins de la vie humaine.
Il existe dans certaines gorges de l’Argonne et cela depuis près de cinquante ans, particulièrement entre les Islettes et Clermont-en-Argonne, de vastes champs d’exploitation de « coquins ».
En ces endroits, au milieu du vert tapis des prairies, d’assez nombreuses taches noirâtres ne manquent pas d’attirer l’attention des promeneurs ou des touristes.
En approchant de plus près, ils ne tardent pas à s’apercevoir que ces taches sont formées par des dépôts de matières terreuses qui ne sont autres que des nodules phosphatés. Si leur curiosité se trouve éveillée et que, par le sentier qui donne accès au champ d’exploitation, ils parviennent jusqu’à ce terrain, ils sont tout surpris de trouver la surface du sol environnant percée de nombreux orifices de puits, les uns à moitié plein d’eau, les autres presque remplis de terre et certains surmontés de treuils que des hommes tournent sans interruption pour remonter au jour les coprolithes que d’autres ouvriers extraient de galeries souterraines.
Tous ces hommes sont des tireurs de « coquins ».
Le tireur de « coquins » est un véritable mineur avec cette différence qu’au lieu de s’attaquer à un combustible, il s’attaque à un engrais ; il n’a pas à craindre les explosions du feu grisou, mais il a souvent à lutter contre les infiltrations des eaux ; comme son confrère des houillères profondes, sa besogne est des plus laborieuses.
Couvert de vêtements grossiers, coiffé d’un chapeau de feutre très résistant, botté de souliers solides, il descend chaque jour, vers six heures du matin, dans le puits donnant accès à la mine : à cet effet, une poutre, attachée à l’une des parois du trou et garnie de petites traverses horizontales, lui sert simplement d’échelle.
Le tireur de « coquins » travaille généralement assis ou à genoux. Armé d’un pic à manche très court, il s’attaque à la couche de nodules placée souvent à huit ou dix mètres sous terre. Au fur et à mesure qu’il avance dans la galerie horizontale, il l’étaye à l’aide de traverses longues de soixante à soixante-dix centimètres supportées par de petits poteaux de dimensions sensiblement les mêmes, et c’est dans un étroit couloir offrant à peine deux tiers de mètre au carré qu’il lui faut se mouvoir et peiner durant des heures entières.
Parfois, le mineur manque d’air : il pratique alors une sorte d’aération artificielle en allumant à l’entrée de la galerie un fourneau à bois dont le tuyau émerge à l’orifice du puits.
Le tireur de « coquins » n’est pas seul dans la mine. Il est secondé par un garçonnet qui transporte les nodules au bas du puits d’extraction. Ces nodules sont jetés par le mineur dans une sorte de panier en osier garni d’une anse et posé sur un chariot minuscule, à quatre roues, haut tout d’un coup de vingt centimètres et muni d’une poignée métallique à l’avant et à l’arrière.
Lorsque le panier est plein, le garçonnet passe en rampant derrière le chariot et pousse le véhicule vers le fond du puits ; arrivé là, il saisit le bas de la corde attachée au treuil, y suspend le récipient, et, à un signal convenu, le fait enlever par un aide tournant la manivelle à la partie supérieure du sol : cet aide vide le panier non loin de lui et le renvoie au garçonnet qui le détache pour le reporter au mineur.
Bien dur est également le travail de ces deux ouvriers.
Heureusement, la besogne la plus difficile est terminée.
D’autres journaliers qui descendront, leur tour venu, dans la mine, jettent les « coquins » par pelletées sur les claies inclinées ; le choc débarrasse partiellement les nodules de la terre les recouvrant, celle-ci passe au travers du treillis et les coprolites, entraînés par leur propre poids, retombent au bas de la claie.
On les laisse se dessécher durant quelque temps, puis il est procédé au lavage pour enlever les derniers vestiges de terre. Un des ruisseaux de la vallée a été préalablement barré en plusieurs endroits différents. Dans ces barrages, l’avant est fermé par un grillage, l’arrière par une vanne.
On remplit partiellement par des « coquins » l’intervalle compris entre la vanne et le grillage ; après quoi on fait arriver l’eau de la partie supérieure du cours d’eau ; quand les coprolites en sont recouverts, on les brasse fortement à l’aide de râteaux en fer à longs manches ; lorsque l’eau qui s’écoule du barrage est à peu près claire, l’opération est terminée : les nodules sont enlevés et entassés sur les rives pour se dessécher à nouveau.
De là ils sont transportés au moulin à « coquins » où des meules puissantes les réduisent en une sorte de poussière grisâtre. Ces cendres fertiles quitteront alors les jolis vallons de l’Est pour aller, bien loin, dans les plaines de l’Ouest, rendre plus féconde une région sœur moins favorisée que la nôtre.
Le tireur d’argile travaille à ciel ouvert. La fosse où il exerce son labeur quotidien est située presque toujours à proximité d’une tuilerie.
De bon matin, aussitôt que le jour pointe, il se rend à sa besogne. Vêtu d’un pantalon et d’une vareuse d’étoffe vulgaire, chaussé simplement de sabots en bois, ayant comme outil une bêche spéciale, la « bêche à rafosser », il enlève par tranches minces la terre glaise propre à la fabrication des divers produits de l’usine. Cette terre est mise en tas après avoir été préalablement débarrassée des petites pierres ou « grisettes » qui pourraient nuire à la bonne qualité des tuiles ou des briques. À mesure que le tas augmente le tireur l’arrose et le piétine de manière à obtenir une masse compacte et homogène.
Cela fait, il abandonne la bêche métallique pour prendre un instrument semblable en bois, le « palon », dont le tranchant présente des dentelures ayant quelque analogie avec celle d’une scie. Il enfonce le « palon » dans la masse d’argile et envoie la terre glaise sur le bord de la fosse où il la dispose ensuite en un tas parallélipipédique qui séjournera là jusqu’au jour où le besoin s’en fera sentir à l’usine. L’argile y sera transportée à l’aide de petits tombereaux disposés pour cet usage.
C’est un métier bien difficile que celui de tireur d’argile. Puis cet ouvrier subit de fâcheux contretemps : sans qu’il s’y attende, des sources d’eau souterraines font souvent irruption dans la fosse et l’inondent partiellement. Il lui faut rejeter cette eau, seau par seau, et fermer l’orifice des sources avant de continuer l’extraction de la terre. Et si, pour une raison ou pour une autre, il n’est pas possible d’empêcher l’infiltration liquide, le travail est abandonné et la nécessité s’impose de chercher ailleurs une couche argileuse où pareil inconvénient est toujours à craindre.
Néanmoins, quand le brave ouvrier a terminé sa rude journée, il s’estime fort heureux de rapporter aux siens les quelques francs qu’il a si bien gagnés. Et n’allez pas lui dire d’abandonner sa profession pour en choisir une autre moins pénible et plus lucrative : il est trop fortement attaché à sa fosse et à son usine. À moins d’accident ou de maladie, il ne quittera son emploi que pour le laisser à son fils, car il est de tradition au village que là, où le père a peiné, le fils sera choisi de préférence par le patron bien avisé qui cherche ainsi à s’attacher, de génération en génération, des familles de bons et fidèles travailleurs.
Dans la région argonnaise où le sous-sol est argileux, se sont élevées, il y a longtemps déjà, des usines, tuileries et briqueteries, dont les produits ont acquis une réputation bien méritée.
On les avait surtout construites vers le sud de l’Argonne ; mais aucune localité n’en présentait et n’en présente encore une telle agglomération que Passavant : aussi ce petit bourg mérite-t-il entre tous, le qualificatif de « Village aux Tuileries ».
Une donation, en principal, de 50 livres faite en 1640 à la fabrique de Passavant par M. Robert, montant d’une dette du 17 mars 1625 acquittée par Jean Périn, tuilier audit lieu, indique que cette profession était déjà exercée dans ce bourg au début du XVIIe siècle.
Le dessin ci-dessus représentant une tuile enlevée à la toiture de l’église de Passavant, est une preuve que les tuileries y prospéraient également dans la première moitié du siècle suivant.
Lorsqu’après avoir franchi l’Aisne, sur la route qui conduit de Sainte-Ménehould à Triaucourt, on arrive aux premières maisons de Passavant, on est frappé de suite par le grand nombre d’usines échelonnées à droite et à gauche du chemin ; les unes sont en pleine activité, les autres ne témoignent que d’un travail très ordinaire ; certaines sont complètement arrêtées, d’aucunes ne sont plus que des ruines d’un passé plus prospère, car si l’on s’en rapporte aux dires des vieillards, au commencement du siècle dernier on avait alors l’illusion de véritables ruches ouvrières.
Douze usines travaillaient concurremment.
Dès qu’avril laissait échapper ses effluves printaniers, on voyait arriver, joyeuses et disposes au travail les « Hirondelles de Lorraine » : c’était le surnom que l’on donnait aux ouvrières des tuileries, originaires presque toutes de villages meusiens environnant Clermont-en-Argonne ; les Passavantins dédaignaient, à cette époque, le travail des usines pour s’occuper plus spécialement de leurs vergers et de leurs vignobles.
Les tuilières élisaient domicile chacune respectivement chez le patron qui les employait ; outre le logement, elles recevaient la nourriture et une allocation totale en argent variant entre cent cinquante et deux cents francs pour les six ou sept mois qu’elles restaient au pays. Durant ce laps de temps, sans trêve et sans relâche, elles frappaient, roulaient, disposaient au séchoir, enfournaient, défournaient, tuiles, briques et carreaux que des rouliers loués tout spécialement conduisaient par des routes et des chemins plus ou moins praticables jusque vers les villes de Vouziers et de Reims.
La corporation avait sa fête placée sous le patronage de sainte Madeleine, le vingt-deux juillet de chaque année.
La veille au soir, quelques musiciens pris au village ou à la ville voisine parcouraient le pays et donnaient force aubades devant chaque tuilerie.
Le jour de la fête, patrons et ouvriers, tuiliers et tuilières, revêtus de leurs plus beaux habits se rendaient en groupe à la messe de la corporation. Après quoi de vrais festins réunissaient dans chaque usine son personnel particulier. Au dessert, chacun en était pour sa chansonnette et la gaieté la plus franche ne cessait de régner parmi les convives.
Une journée si bien commencée se terminait toujours par un bal rustique où la jeunesse entière du village s’en donnait à cœur joie jusqu’à une heure très avancée de la nuit. Quelquefois, après le bal, les plus hardis « couraient la broche ». Ils allaient de maisons en maisons et ces francs buveurs d’antan joutaient à qui viderait le plus rapidement les bocaux de framboises et de cerises que les ménagères de l’Argonne savent encore si bien préparer. L’aurore, qui blanchissait les frondaisons de la forêt voisine, mettait seule fin à ces agapes fraternelles.
La construction de tuileries en d’autres points du département, l’établissement des voies ferrées et comme conséquence la facilité de transports des produits de régions parfois fort éloignées, occasionnèrent pour Passavant une diminution considérable de travail.
Les tuilières de Lorraine moins occupées et par suite moins payées ne revinrent plus que rarement au village. Quelques habitants de la localité firent leur apprentissage d’ouvriers-tuiliers ; peu à peu leur exemple fut suivi, si bien que depuis une cinquantaine d’années, ils suffisent à la besogne des usines. Particularité à signaler, ces artisans habitent presque tous dans la partie haute du village qualifiée, on ne sait trop pourquoi, du nom historique de « Pologne ».
Actuellement, la fête de la corporation n’est plus guère qu’un souvenir. D’ailleurs les usines tendent toujours à perdre de leur activité d’autrefois. Seules, celles qui ont amélioré leur outillage et qui se sont mises à la fabrication des briques creuses, des tuiles mécaniques et des drains ont quelque espoir de subsister. Néanmoins que les tuiliers n’oublient pas qu’il leur faut marcher constamment dans la voie du progrès s’ils veulent utiliser les réserves du sol lesquelles peuvent fournir durant de longs siècles, une matière première, dont la qualité permet de lutter avec avantage contre les établissements similaires.
Là où les membres de la famille ne sont pas dispersés loin du pays natal, et c’est la règle générale de l’Argonne, on remarque souvent dans la plus vaste pièce de la maison paternelle, celle qui sert à la fois de cuisine et de salle à manger, un meuble d’un aspect particulier : c’est le « Dressoir des aïeux ».
Vieux de plus d’un siècle, formé de solides planches de chêne sculptées assez originalement par le menuisier du village, entretenu avec un soin jaloux par la maîtresse de la maison, il verra sans doute encore plusieurs générations si quelque cause imprévue ne vient à le détruire brutalement.
Sa base est un vrai bahut où sont rangés soigneusement nappes et serviettes aux bonnes senteurs d’iris, couverts et vaisselle modernes, qu’on ne sort qu’aux jours de fête familiale.
Le haut est disposé en étagère avec trois ou quatre rayons très rarement abrités par de brillantes vitrines.
Par contre c’est une charmante harmonie de couleurs que les faïences des Islettes, exposées sur le dressoir, offrent aux hôtes ou aux visiteurs de l’hospitalier foyer argonnais : les tons les plus variés des roses et des verts s’y marient aux multiples nuances du bleu et du violet.
Les antiques assiettes à dessert, dont un des motifs les plus gentils est un coq gracieusement perché sur de riches corbeilles de fleurs, s’y intercalent avec les plats finement décorés d’œillets, de marguerites et de roses, où l’on sert la « galette lorraine » si bien chantée par le grand poète de l’Argonne. Aux places d’honneur, des pièces plus rares, avec sujets variés représentant tantôt un Chinois, tantôt un volontaire de la première République, tantôt un soldat du premier Empire, quelquefois même des grenadiers, excitent constamment l’envie du collectionneur.
Dans les coins, des soupières aux formes très originales, des salières, des sucriers, des pots à tabac témoignent aussi du goût artistique des faïenciers de l’époque.
Ajoutez à cela des encriers agrémentés de mignonnes fleurettes, des statuettes de la Vierge ou de Saints particulièrement honorés en « Pays d’Argonne » et vous aurez une idée assez exacte des trésors amassés sur le « Dressoir des aïeux ».
Et si vous voulez être renseignés sur l’origine de toutes ces richesses, faites une promenade jusqu’à la pittoresque station des Islettes ; demandez à ce que l’on vous conduise aux « Vignettes », petit hameau placé à proximité du bourg, mais sur la rive gauche de la Biesme, et vous trouverez là quelques bons vieillards qui se feront un plaisir de vous raconter ce qu’ils savent de l’antique faïencerie dont l’emplacement est occupé actuellement par une usine aux produits très ordinaires et sans aucune couleur artistique, nous avons cité une « briqueterie ».
Les habitants des rares villages construits sur les plateaux forestiers du « Pays d’Argonne » désignent communément sous le nom de « Vallée » la dépression étroite dans laquelle coule la partie supérieure de la Biesme.
C’est tout d’abord une gorge resserrée se subdivisant en deux parties au hameau de Courupt ; la partie est finie brusquement à Bellefontaine, tandis que la partie nord, conservant à peu près la même largeur à Futeau, la Contrôlerie et les Senades, se trouve bientôt coupée transversalement au bourg des Islettes par le défilé du même nom ; à partir de cette localité, la « Vallée » s’est fortement élargie et les quelques petits hameaux que l’on y rencontre : les Vignettes, Broda, les Petites-Islettes, le Neufour et le Claon, agrémentent heureusement la dépression du vallon ; après avoir dépassé la Chalade, il n’existe plus qu’un passage exigu où l’on remarque le Four-de-Paris et la Harazée, ce dernier hameau étant le point terminus de la « Vallée » proprement dite.
Tous ces groupements, plus nombreux que populeux, sont échelonnés le long d’une route charmante, longeant la rive droite de la Biesme, traversant une prairie magnifique, bordée des deux côtés par de minuscules collines boisées dont le pittoresque rappelle un peu certaines régions de la Suisse.
Quoi qu’il en soit, le touriste se demande souvent quelle est la cause d’une telle agglomération de localités (on en compte jusqu’à seize), dans un parcours qui atteint à peine quinze kilomètres.
À cela, on peut répondre que ce sont sans doute les verreries de naguère qui ont réuni tant d’habitations dans la vallée de la Biesme. En effet, si l’on s’en rapporte à la tradition, aux vestiges des bâtiments et à certains documents que possèdent encore les propriétaires actuels des verreries argonnaises, il existait de ces sortes d’établissements à Courupt, Bellefontaine, Futeau, la Contrôlerie, les Senades, les Islettes, les Vignettes, le Neufour, le Claon, la Chalade, le Four-de-Paris et la Harazée. La particularité est assez rare pour qu’il en soit dit quelques mots ici.
On ignore les débuts exacts de la fabrication du verre en Argonne.
D’après des découvertes toutes récentes, il semblerait que les premières verreries étaient ambulantes. Les verriers devaient s’établir dans les clairières de la forêt où ils trouvaient du bois à volonté. Ils y construisaient un four sommaire sur lequel ils plaçaient un ou plusieurs creusets ainsi que le confirment les débris qui ont été retrouvés. Comme on ne voit autour des ruines de ces fours aucune trace ou vestige d’habitation, il est à croire que les verriers vivaient là, isolés, comme le font les charbonniers de nos jours et ne quittaient l’emplacement choisi qu’autant que le bois et les matières premières leur faisaient défaut.
Quant à l’époque à laquelle existaient ces premiers artisans, elle est variable suivant qu’il s’agit de verreries à produits divers ou de simples verreries à bouteilles.
Les premières dateraient de l’époque gallo-romaine et de l’époque franque. M. L. Mauget, de Sainte-Ménehould, un chercheur infatigable et dont les trouvailles ont déjà fait l’objet de rapports élogieux au Bulletin archéologique du Ministère de l’instruction publique, a découvert tout récemment aux Bonis des fibules de couleur verdâtre, une goutte de verre noire opaque et lenticulaire, un éclat de coupe en verre noir, des cubes de verre revêtus d’une gangue vitrifiée, du verre transparent formé de deux plaques ayant la même épaisseur et soudées entre elles, du verre coupé au couteau, du verre déprimé au moyen de pinces plates, tous spécimens de valeur qui ne laissent aucun doute sur l’existence de verreries gallo-romaines en « Pays d’Argonne ». M. G. Chenet, du Claon, ami de M. Mauget, chercheur non moins infatigable que lui, a découvert dans la gorge de Pairupt, forêt domaniale de La Chalade, les ruines très bouleversées d’un ouvreau et à côté des fragments de coupes, de fioles à col étroit, de soucoupes à côtes, de vases à anses, en un verre blanc verdâtre qu’il attribue à des verreries franques.
On peut faire remonter les verreries à bouteilles antérieurement à 1448, car à cette date une charte dite « Charte des verriers », fut octroyée aux verriers par Jean de Calabre qui gouvernait les duchés de Lorraine et de Bar en l’absence de René d’Anjou, son père .
Il ne faudrait pas se figurer que ces artisans du XVe siècle étaient simplement des gens d’origine obscure ; bien au contraire, ils appartenaient à la noblesse d’alors et portaient le titre de Gentilshommes verriers.
Pour qu’ils acceptassent cette profession sans déroger, les rois de France et les ducs de Bar et de Lorraine leur avaient accordé des privilèges très importants.
(Collection G. Chenet).
Entre autres choses, ils jouissaient des droits de pêche et de chasse et c’est pourquoi les Gentilshommes verriers furent toujours de francs et hardis chasseurs ; de plus ils pouvaient prendre à volonté le bois des forêts aussi bien pour le chauffage des fours que pour la construction des maisons.
Grâce à ces avantages exceptionnels et au droit exclusif de fabriquer des bouteilles dans la région, ils ne tardèrent pas, on doit le supposer, à devenir tout à fait sédentaires.
Ils construisirent des verreries fixes entourées d’habitations ; l’une des usines les plus anciennes est celle de Courupt. Faire sa description, c’est faire celle des autres qui étaient à peu près identiques.
Elle comprenait un bâtiment plus long que large, assez élevé, recouvert d’un toit à deux pentes très inclinées, ouvert longitudinalement à sa partie supérieure ; cette ouverture, abritée par un autre petit toit surélevé sur le premier, permettait l’échappement régulier de la fumée. Les deux plus longs murs étaient percés de vastes baies destinées à laisser pénétrer l’air vif de la « Vallée » qui venait ainsi atténuer la chaleur excessive dégagée par les fours.
Ces derniers, construits en briques réfractaires, étaient installés au beau milieu de la verrerie, leurs ouvreaux faisant face aux baies des deux côtés de l’usine. En avant existaient des plates-formes élevées d’environ un mètre au-dessus du sol et sur lesquelles se plaçaient les verriers dans la période de travail. À l’intérieur des fours étaient déposés les creusets, sortes de grands pots où le sable, la soude, les cendres, les débris de verre cassé fondaient simultanément pour former un mélange parfait sous l’action de la chaleur dégagée par le chauffage fait alors uniquement au bois.
La plupart des matières premières provenaient des environs : le sable de la Côte de Biesme ou de Florent, les cendres des tuileries de Passavant et de tous les villages sis à proximité : on voyait à cette époque de petits industriels parcourir les campagnes, précédés de quelques ânes sur les bâts desquels ils plaçaient les sacs remplis de cendres que les ménagères déposaient à l’avance sur le seuil des maisons ; en même temps des marchands de faïence ambulants recueillaient les détritus de verre et donnaient en échange quelques pièces de vaisselle. Quant au bois, il était amené à dos de mulets : de véritables pyramides s’élevaient à proximité des verreries et c’était chose très curieuse de voir ces dociles animaux monter jusqu’au sommet du tas par la voie bien fragile qui le contournait généralement.
Lorsque le verre était à point, l’on en fabriquait des bouteilles. Par l’ouverture circulaire pratiquée dans une des parois du four, un ouvrier, cueillait avec une canne, tube de fer long de plus d’un mètre, percé intérieurement d’un canal de 3 à 4 millimètres de diamètre, une quantité de pâte de verre suffisante pour faire une bouteille. Il la passait ensuite au maître verrier ou souffleur. Celui-ci, soufflant alors modérément, puis avec plus de force, donnait à la pelote de verre la forme d’une poire allongée. Il introduisait cette poire dans un moule qui modelait le fond ; quant à la partie supérieure elle dépendait absolument du coup de main du maître verrier, c’est pourquoi il n’est guère possible de trouver deux bouteilles de cette époque absolument semblables. En ce qui concerne la pose de la bague qui enserre le goulot, on réchauffait la bouteille à l’ouvreau et le souffleur la formait à l’aide de verre fondu qu’on lui apportait à cet effet : c’était là une opération des plus délicates.
Un des plaisirs favoris des aides du maître verrier consistait à faire souffler une bouteille aux personnes qui visitaient l’usine ; elles emportaient leur œuvre toujours plus ou moins parfaite, mais en retour elles laissaient un petit pourboire aux apprentis.
André Theuriet aimait à visiter les Verreries de la « Vallée ». C’est à la suite d’une de ces excursions dans l’Argonne qu’un de ses amis, Camille Fistié (Tristan), charmé de ce qu’il avait vu dans la Verrerie des Islettes, et après avoir soufflé sa bouteille, composa cette jolie poésie dans laquelle il chante si bien les produits du pays du verre.
LA CHANSON DE LA BOUTEILLE
Dans la verrerie, non loin des fours, se trouvaient les annexes ; la salle pour le mélange des matières premières et la salle du four à recuire, c’est dans ce dernier qu’un gamin déposait les bouteilles où elles se refroidissaient graduellement de manière à les rendre moins fragiles.
Ces travaux duraient des mois entiers ; puis, quand l’usine avait besoin de réparation on laissait éteindre les feux et l’on disait que les « fours étaient morts ».
Quant aux produits, ils étaient transportés à la hotte par les journaliers ou en bâts par les mulets des « brioleurs » à travers des sentiers ou des chemins peu ou point entretenus, jusqu’au bourg des Islettes. Là, des rouliers se chargeaient de les emporter et de les vendre dans les diverses régions de l’Est de la France. Beaucoup fournissaient la Champagne et échangeaient souvent leurs bouteilles contre l’excellent vin de cette région qu’ils ramenaient et revendaient en Argonne. À ce métier, un certain nombre fit fortune assez rapidement.





























