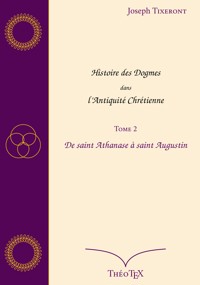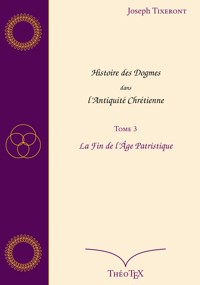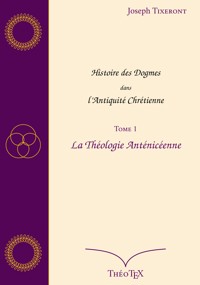2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
L'abbé Tixeront (1856-1925) fut un professeur très apprécié au séminaire d'Alix et à la faculté de théologie de Lyon, selon le témoignage d'anciens élèves, qui se souvenaient de la clarté et de la précision remarquables de son enseignement. A ces deux qualités se joignait une immense érudition, que l'on voit se déployer dans les trois tomes de l'Histoire du dogme dans l'antiquité chrétienne, son ouvrage le plus connu. Écrit pendant la grande guerre, le Précis de Patrologie est moins étendu, mais d'une utilité pratique incontestable pour qui veut se familiariser avec les Pères de l'Église. L'auteur, en effet, ne s'est pas contenté de nous fournir une simple compilation chronologique de noms et de titres, mais sa maîtrise du latin, du grec et du syriaque, l'immensité de ses lectures, sa hauteur de vue, lui permettent de porter sur chaque personnage et ses écrits, un jugement sûr et nuancé. Cette réédition ThéoTeX reproduit celle de 1918.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322462018
Auteur Joseph Tixeront. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Ce livre est, en partie, le fruit des loisirs que la guerre m'a donnés, et il est aussi, à sa façon, un livre de guerre.
Si l'on excepte, en effet, les deux volumes de Mgr Batiffol et de M. Rubens Duval sur « La littérature grecque » et « La littérature syriaque » dans la Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique, nous n'avons pas, en français, de manuels récents de Patrologie autres que des ouvrages traduits de l'allemand les Pères de l'Église traduits de Bardenhewer et les Éléments de Patrologie traduits de Rauschen. Le premier, en trois volumes in-8o est excellent, mais un peu considérable et un peu cher pour le commun des lecteurs ; le second a dû pratiquement être abandonné comme livre d'enseignement : tous deux ont le tort d'être des traductions. Il a donc paru à quelques personnes que, en ce moment, il y avait place, en cette matière, pour un livre français de dimension réduite qui ne présenterait pas les inconvénients des deux autres, et elles m'ont pressé de l'écrire, en ajoutant que ce serait à mon Histoire des dogmes un complément utile. J'ai cédé à leurs conseils et présente ici au public le résultat de mon travail.
Quelques mots sur la façon dont je l'ai conçu et le but que je m'y suis proposé.
Mon intention n'a pas été de composer un gros ouvrage d'érudition. Des ouvrages de ce genre existent déjà chez nous ou ailleurs, et les spécialistes sauront bien les trouver. Les lecteurs que j'ai eus en vue sont d'abord les séminaristes et les prêtres, pour qui la connaissance des Pères de l'Église est un complément de leur science théologique et historique ; puis les laïques qui désirent joindre à leurs études des littératures profanes une étude au moins sommaire de l'ancienne littérature chrétienne, et aussi cette armée de jeunes candidats et candidates aux brevets d'instruction religieuse qui doivent, d'après leurs programmes, posséder sur ce sujet des notions élémentaires sans doute, mais exactes et précises. Or ces diverses catégories de lecteurs et de lectrices n'ont que faire d'une liste complète des auteurs chrétiens qui ont tenu une plume dans l'antiquité, et d'un bilan de leurs œuvres qui en relèverait les moindres parcelles. Ils veulent plutôt être renseignés sur les écrivains principaux dont l'autorité est universelle, qui ont vécu dans notre pays ou dont ils ont rencontré les noms dans leurs lectures, savoir ce qu'ont été ces hommes, par quels ouvrages surtout ils sont devenus célèbres, ce que ces ouvrages contiennent en gros, quelles études dans notre langue ils pourraient consulter avec intérêt sur ces matières, etc. Un exposé des discussions critiques et des hypothèses nouvelles serait pour eux inutile, parce que souvent hors de leur portée et indifférent au but qu'ils poursuivent, qui est de se mettre au courant des résultats acquis et certains.
D'après ces considérations, je n'ai pas craint de m'étendre un peu longuement sur les auteurs de premier ordre, de donner une appréciation de leur caractère, de leur talent, de leur style — la seule chose que retiennent beaucoup de lecteurs, — de mentionner au complet ou à peu près leurs écrits et d'ébaucher des principaux de ces écrits une courte analyse. Quant aux auteurs secondaires, j'en ai traité plus brièvement, et un grand nombre de troisième ordre n'ont reçu qu'une simple mention. Encore trouvera-t-on probablement que, pour ces derniers, j'ai été trop large et qu'il eût mieux valu en passer beaucoup entièrement sous silence. Mais « abondance de biens ne nuit pas », et il ne tiendra qu'au lecteur de négliger ce qui lui est inutile.
C'est d'après ces mêmes considérations que j'ai traduit autant que possible en français les titres grecs et latins des ouvrages mentionnés, que j'ai signalé, quand il en existe, les traductions françaises de ces ouvrages, que, dans les études et travaux à consulter, j'ai indiqué avant tout les travaux français et d'une lecture plus facile, que j'ai écarté les articles de revue en langue étrangère dont mes lecteurs ne sauraient pratiquement profiter. Tout cela était nécessaire pour alléger le volume et l'adapter à son but.
La division en trois périodes — période des trois premiers siècles, périodes d'apogée et de décadence — est classique et s'imposait d'elle-même ; on en peut dire autant de la division en chapitres. Si nous descendons aux sous-divisions, il eût fallu, pour garder une marche absolument logique, les multiplier beaucoup et partager, par exemple, les chapitres en articles, les articles en paragraphes et ceux-ci encore en numéros. C'est ce qu'a fait Bardenhewer et ce que l'on fait souvent dans les manuels techniques d'enseignement. Pour ce Précis, ce morcellement m'a paru excessif et capable plutôt d'embrouiller le lecteur. Mais celui-ci pourra d'ailleurs démêler aisément l'ordre que j'ai suivi et réduire, s'il le veut, en un tableau synoptique toute l'histoire de la littérature patristique : il lui suffira pour cela d'un peu d'attention. Quant au principe adopté pour grouper les auteurs, il varie suivant les périodes. C'est tantôt le caractère de leurs ouvrages, tantôt leur ordre chronologique ou leur distribution géographique qui m'a guidé. Aucune règle absolue ne pouvait convenir ici.
Puisse ce modeste travail contribuer à faire connaître mieux ceux qui furent, aux origines de l'Église, les Pères de notre foi, et les chefs-d'œuvre que leur zèle et leur génie nous ont laissés.
On entend par littérature chrétienne l'ensemble des écrits composés par des chrétiens sur des sujets chrétiens. Par cette définition se trouvent exclus les ouvrages profanes composés par des chrétiens, comme le sont de nos jours une foule de livres de science positive ou d'histoire, aussi bien que les ouvrages des non-chrétiens portant sur des sujets chrétiens : le Discours véritable de Celse par exemple.
La littérature chrétienne ancienne est celle des premiers siècles chrétiens, de l'antiquité chrétienne. On s'accorde généralement à fixer la fin de cette antiquité, pour l'Église grecque, à la mort de saint Jean Damascène (vers 749) et, pour l'Église latine, à celle de saint Grégoire le Grand (604) ou mieux de saint Isidore de Séville (636), moment où des éléments nouveaux, empruntés au monde barbare, viennent modifier sensiblement la pureté du génie latin.
Ainsi entendue, l'ancienne littérature chrétienne embrasse et les écrits du Nouveau Testament — écrits essentiellement chrétiens, œuvres de chrétiens, — et les écrits des hérétiques que l'on peut encore appeler chrétiens. C'est ainsi que l'ont comprise et qu'en ont traité M. Harnack dans son Histoire de l'ancienne littérature chrétienne jusqu'à Eusèbe, et Mgr Batiffol dans sa Littérature grecque.
D'autres auteurs — et c'est le plus grand nombre jusqu'ici parmi les catholiques — ont exclu de leurs histoires non seulement les livres du Nouveau Testament, objets d'études indépendantes, mais aussi les écrits des hérétiques notoires, condamnés par l'Église. Ils ont eu tendance ainsi à réduire l'histoire de l'ancienne littérature chrétienne à l'histoire des écrits des Pères de l'Église, à une Patrologie.
Le nom de Père de l'Église, qui a son origine dans le nom de Père, donné dès le deuxième siècle aux évêquesa, est devenu courant au ve siècle pour désigner les anciens écrivains ecclésiastiques — ordinairement des évêques — morts dans la foi et la communion de l'Église. Il ne convient toutefois strictement, d'après les théologiens modernes, qu'aux écrivains qui réunissent les quatre conditions suivantes : orthodoxie doctrinale, sainteté de la vie, approbation de l'Église, ancienneté. Mais pratiquement, on l'étend à bien des auteurs qui ne réalisent pas, intégralement du moins, les trois premières conditions. Personne, par exemple, ne songe à éliminer de la liste des Pères Tertullien, Origène, Eusèbe de Césarée, Fauste de Riez et beaucoup d'autres. Les erreurs qu'on leur reproche n'ont pas tellement contaminé leurs ouvrages qu'ils soient plus dangereux qu'utiles, et que le bien ne s'y montre supérieur au mal. C'est à eux, en tout cas, que convient éminemment le titre d'écrivains ecclésiastiques.
[Pour être Docteur de l'Église l'antiquité n'est pas requise, mais, outre les trois autres qualités demandées pour les Pères, il faut une science éminente et une déclaration spéciale de l'autorité ecclésiastique. L'Église latine reconnaît particulièrement quatre grands docteurs : saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin et saint Grégoire ; l'Église grecque admet trois grands docteurs œcuméniques : saint Basile, saint Grégoire de Nazianze et saint Jean Chrysostome.]
Quelle que soit l'étendue que l'on donne au nom de Père de l'Église, la Patrologie est l'exposé de la vie et des œuvres de ceux que l'on désigne par ce nom. Elle reste donc, en définitive, une partie de l'Histoire de l'ancienne littérature chrétienne, puisqu'elle laisse en dehors de ses recherches et les écrits canoniques du Nouveau Testament, et les écrits formellement et foncièrement hétérodoxes. On comprend cependant que, sur ce dernier point, il existe pour les auteurs de patrologie une certaine tolérance. Comme la connaissance des œuvres des hérétiques est souvent nécessaire pour comprendre les réfutations qu'y ont opposées les Pères, la plupart de ces auteurs n'hésitent pas à en mentionner et à en faire connaître les principales. C'est ce que nous ferons ici nous-même. Nous ne dirons rien des écrits du Nouveau Testament ; mais nous signalerons, en partie du moins et brièvement, les livres hétérodoxes qui ont eu cours dans l'antiquité.
Une question seulement se pose ici : la Patrologie, outre l'histoire de la vie et des œuvres des Pères, doit-elle comprendre un exposé de leur doctrine ; doit-elle fournir les éléments d'une théologie patristique ?
Théoriquement, on l'affirme ; en fait, la chose est difficile à réaliser. Une patrologie qui voudrait exposer, même succinctement, l'enseignement de chaque Père sur toute la doctrine chrétienne devrait être très étendue et se répéter sans cesse. Que si elle négligeait ce que cet enseignement a de commun avec celui des autres Pères, et se bornait à signaler ce qu'il offre d'original et de singulier, elle risquerait fort de donner de l'auteur une impression fausse et de n'en présenter que des vues incomplètes. Aussi pensons-nous qu'il vaut mieux résolument séparer la Patrologie de la Patristique et traiter de la doctrine des Pères dans l'Histoire des dogmes. Les deux sciences ne peuvent que gagner à être ainsi étudiées chacune pour soi. Tout au plus la Patrologie peut-elle indiquer, pour certains Pères, les doctrines qu'ils ont le plus mises en relief.
[Ce défaut de laisser une impression fausse est arrivé à Nirschl, Fessler, Rauschen et même à Bardenhewer. L'idée de Nirschl de citer, à la suite de la notice sur chaque Père, quelques-uns de ses textes les plus importants, a été reprise et scientifiquement réalisée par J. Rouet de Journel, Enchiridion patristicum, 3e édit., Friburgi Brisgoviae. 1920. Cet ouvrage suppléera abondamment à ce que nous ne disons pas ici.]
L'histoire de l'ancienne littérature chrétienne n'étant qu'une partie de l'histoire générale de l'Église, tous les historiens de l'Église anciens et modernes ont touché plus ou moins à ce sujet.
Pour l'antiquité toutefois, la source principale est Eusèbe. Bien qu'Eusèbe n'ait point rédigé d'ouvrage spécial sur les auteurs chrétiens qui l'ont précédé, son Histoire contient sur eux et sur leurs écrits une foule de notices d'autant plus précieuses que beaucoup de ces écrits ont disparu et ne sont connus que par lui.
Saint Jérôme, le premier, à la prière du laïque Dexter, composa, en 392, un catalogue développé des anciens écrivains chrétiens et de leurs œuvres. C'est le De viris illustribus, qui comprend 135 notices. Il doit beaucoup à Eusèbe et, dans la partie propre à saint Jérôme, offre bien des lacunes et des erreurs. Mais il a le mérite d'être venu le premier, et d'avoir amorcé les travaux qui suivirent.
Le catalogue de saint Jérôme, en effet, fut continué sous le même titre par Gennadius de Marseille, qui le conduisit jusque vers la fin du ve siècle. Gennadius a ajouté 97 ou 98 notices, dont quelques-unes peut-être ont été interpolées.
Et enfin l'œuvre de Gennadius fut continuée à son tour, et toujours sans changement de titre, d'abord par saint Isidore de Séville († 636), puis par saint Ildefonse de Tolède († 667).
En Orient, il faut nommer le patriarche Photius († 891), dont la Bibliothèque contient 279 notices d'auteurs ou d'ouvrages lus par lui, et qu'il est parfois seul à nous faire connaître.
Le moyen âge n'a pas négligé l'histoire littéraire chrétienne. Entre tous, signalons le précieux Catalogue d'Ebedjésus, métropolitain de Nisibe, écrit en 1298 (édité dans Assemani, Bibliotheca orientalis, III, 1) et le savant ouvrage de l'abbé Jean Trithemius, De scriptoribus ecclesiasticis, écrit en 1494. Cependant, comme ce dernier livre s'occupe surtout des écrivains postérieurs à l'époque patristique, nous pouvons le négliger ici.
Du xviie et du xviiie siècle, outre les Mémoires de Tillemont, toujours à consulter, les histoires de l'ancienne littérature chrétienne le plus souvent citées sont celles de W. Cave, Scriptorum ecclesiasticorum historia litteraria, Londres, 1688, complétée par H. Wharton en 1689, édit. d'Oxford, 1740-1743 ; de Fabricius, Bibliotheca graeca, seu notitia scriptorum veterum graecorum, 1705-1728, rééditée par J. Chr. Harlez, Hambourg, 1790-1809 ; de L. Ellies du Pin, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, Paris, 1686-1714 (à l'index) ; du bénédictin D. R. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, Paris, 1729-1763 ; réédition en 1858-1869.
Le xixe et le xxe siècle ont été féconds en travaux plus ou moins développés sur notre sujet. Pour ne citer que les principaux et les plus récents, toute la période des six ou sept premiers siècles a été traitée dans les ouvrages catholiques de J. Nirschl, Lehrbuch der Patrologie und Patristik, Mainz, 1881-1885, 3 vol. ; Fessler-Jungmann, lnstitutiones patr ologiae, Œniponti, 1890-1896, 2 vol. (excellent, surtout pour les Pères latins de basse époque, du v au viie siècle) ; O. Bardenhewer, Patrologie, 3e édit., Fribourg-en-Br., 1910, un vol. ; traduction française par MM. Godet et Verschaffel, Les Pères de l'Église, Paris, 1905, 3 vol. ; H. Kihn, Patrologie, Paderborn, 1904-1903, 2 vol. ; G. Rauschen, Grundriss der Patrologie, 3e édit., 1903 ; traduct. franc, par E. Ricard, Éléments de Patrologie et d'Histoire des dogmes, 2e édit., Paris, 1911, un vol. ; et dans l'ouvrage protestant (moins utile) de H. Jordan, Geschichte der altchristlichen Literatur, Leipzig, 1911, un vol. — D'autres œuvres également, ou même plus importantes, n'ont embrassé qu'une partie du sujet : A. Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius, 2 parties en 3 vol., Leipzig, 1893-1904 ; G. Krueger, Geschichte der altchristlichen Literatur in den ersten drei Jahrhunderten, Fribourg-en-Br., 1895, supplément en 1897 : A. Ehrhard, dans K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, 2e éd., Munich, 1897 ; O. Staehlin, dans W. von Christ, Griechische Literaturgeschichte, 5e édit., Munich, 1914 ; A. Ebert, Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande, 2e édit., 1889 ; trad. franc, par Aymeric et Condamin, 3 vol., Paris, 1883 ; P. Batiffol, Anciennes littératures chrétiennes : La littérature grecque, 4e édit., Paris, 1905 ; R. Duval, Anc. litt. chrét. : La littérature syriaque, 3e éd., Paris, 1907 ; P. Monceaux, Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne, 5 vol. parus, Paris, 1901-1920 ; P. de Labriolle, Hist. de la littér. latine chrét., Paris, 1920.
C'est à quelques-uns de ces ouvrages qu'il se faut adresser dès que l'on veut entreprendre sur les Pères ou anciens écrivains ecclésiastiques une étude un peu complète. Le présent volume n'est qu'un manuel modeste qui fournira des indications précises, mais forcément restreintes.
On peut distinguer, dans le travail d'édition des Pères et écrivains ecclésiastiques, comme trois moments successifs. Un premier moment qui est celui des éditions princeps par les érudits du xvie siècle, les Estienne, Froben, Erasme, etc. Plusieurs de ces éditions, devenues rares, ont acquis la valeur des manuscrits qu'elles ont reproduits, et qui depuis se sont perdus. Un second moment est celui des éditions des xviie et xviiie siècles par les bénédictins de Saint-Maur, les jésuites, les oratoriens, etc. Ce sont les plus souvent citées. Enfin, depuis une trentaine d'années, de nouvelles découvertes et de nouvelles facilités pour consulter les manuscrits ont provoqué un nouveau travail d'éditions. On en verra ci-dessous les résultats.
La première grande collection qui ait été faite des anciens écrivains ecclésiastiques est celle de Marguerin de la Bigne, chanoine de Bayeux († 1589). Sa Bibliotheca sanctorum Patrum, en neuf volumes infolio (Paris, 1575-1579), contenait le texte de plus de 200 auteurs de l'antiquité et du moyen âge. Cette œuvre qui, en se développant, devint la Maxima Bibliotheca veterum Patrum de Lyon, en 27 volumes in-folio (1677), fut complétée, corrigée ou même supplantée par les collections analogues de Fr. Combéfis, O. P. († 1679), en 1648 et 1672 ; de J. B. Cotelier († 1686), en 1677-1686 ; de Bernard de Montfaucon († 1741), en 1706, et surtout de l'oratorien Andr. Gallandi († 1779), en 1765-1781 et 1788. La collection toutefois qui les a pratiquement toutes remplacées est celle de J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus. Elle comprend deux séries : la série des Pères latins, qui va des origines à Innocent III (1216) et compte 217 volumes (Paris, 1844-1855) ; la série des Pères grecs, qui va jusqu'au concile de Florence (1439) et compte 162 volumes (Paris, 1857-1866)a. Que dans une œuvre aussi colossale il y ait des points faibles et des parties à refaire ; qu'on y trouve çà et là quelques lacunes, et aussi quelques répétitions ou hors-d'œuvre, on n'en saurait être surpris. L'ensemble n'en reste pas moins fort remarquable. Venant après Mai, Routh, et conseillé par Pitra, Migne profitait des travaux et des connaissances de ces grands érudits. Le choix qu'il a fait des éditions anciennes à reproduire est presque toujours excellent : il les a améliorées encore par les dissertations et études de date plus récente qu'il y a jointes. Sa collection est à peu près complète, d'un format commode, d'un prix relativement modéré ; la langue latine, partout adoptée pour les traductions et les notes, en favorise l'emploi universel. Malgré les critiques dont elles ont été l'objet, les Patrologies de Migne se sont imposées et s'imposeront encore longtemps comme ouvrage fondamental.
Depuis Migne cependant, trois grandes collections ont été publiées ou sont en cours de publication pour améliorer et compléter son œuvre.
D'abord les Monumenta Germaniae historica, Auctores antiquissimi, Berolini, 1877-1898, 13 vol. in-4o. Puis, Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, editum cons. et impens. Academiae litterarum Caesareae Vindobonensis, Vindobonae, 1866 et suiv. Éditions très soignées, bien que de valeur inégale ; format in-8o commode ; tout est en latin. La publication se poursuit sans ordre chronologique. Enfin, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, publiés par l'Académie de Berlin, Leipzig, 1897 et suiv. ; une trentaine de vol. parus. Editions critiques très savantes, sans traduction. Les introductions et l'apparat critique sont en allemand.
Les collections que nous venons de mentionner ne comprennent que les auteurs grecs et latins. Pour les écrivains des langues orientales, on ne possédait guère jusqu'ici que le grand ouvrage de J. S. Assemani, Bibliotheca orientalis clementino-vaticana, Romae, 1719-1728, 4 vol., qui est moins une collection qu'un catalogue développé d'auteurs et de manuscrits. De nos jours, deux ou trois grandes collections ont commencé à combler cette lacune :
R. Graftin, Patrologia syriaca, Paris, 1894 et suiv. (2 vol. seulement), continuée pratiquement par R. Graffin et F. Nau, Patrologia orientalis, Paris, 1903 et suiv., 14 vol. parus. Les textes syriaques, coptes, arabes, éthiopiens, etc. sont accompagnés d'une traduction latine, française ou anglaise. Aucun ordre chronologique n'est suivi, et le même volume contient des ouvrages de langues différentes.
J. B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat, B. Carra de Vaux, Corpus scriptorum christianorum orientalium, Paris, 1903 et suiv. La collection est divisée en quatre séries : écrivains syriens, coptes, arabes, éthiopiens, distingués par la couleur de la couverture. Les traductions sont éditées (et vendues) à part du texte.
Indépendamment de ces grands et coûteux ouvrages, on a du reste, à l'usage surtout des étudiants, publié ou commencé à publier des collections plus modestes et d'une évidente utilité. Tels, en France, les Textes et documents pour l'étude historique du christianisme de MM. H. Hemmer et P. Lejay, Paris, 1904 et suiv. ; format in-16 commode, textes accompagnés d'une traduction française. En Allemagne, outre la collection de H. Hurter, SS. Patrum opuscula selecta, Œniponti, 1868-1885 (48 vol.), 2e série, 1884-1892 (6 vol.), on a les collections de G. Krueger, Sarnmlung, etc., Fribourg-en-Br., 1891-1896, 2e série, 1901 et suiv. ; de H. Lietzmann, Kleine Texte, etc., Bonn, 1902 et suiv. ; de G. Rauschen, Florilegium patristicum, Bonnae, 1904 et suiv. En Angleterre, on a les Cambridge patristic texts d'A. J. Mason, Cambridge, 1899, suiv. ; en Italie, la Bibliotheca SS. Patrum de J. Vizzini, Romae, 1902 et suiv.
Signalons enfin, comme comprenant à la fois des textes et des études critiques, trois publications importantes :
Plusieurs de ces publications permettent aux lecteurs même non spécialisés de prendre contact avec la littérature patristique, et d'en lire les productions les plus remarquables. Si la plupart de ces productions ne peuvent lutter avec les œuvres classiques pour la pureté de la langue et l'élégance de la forme, en revanche elles les dépassent sûrement par l'intérêt du but poursuivi, par l'élévation de l'idéal moral, et par l'intensité de foi et de zèle qui animait leurs auteurs.
L'histoire de l'ancienne littérature chrétienne se partage naturellement en trois périodes :
Nous suivrons cette division.
On donne le nom de Pères apostoliques à un certain nombre d'écrivains ou d'écrits (dont plusieurs sont anonymes) qui datent de la fin du ier ou de la première moitié du iie siècle. Ce nom vient de ce que ces auteurs sont censés avoir connu les apôtres, et représentent un enseignement immédiatement ou presque immédiatement dérivé du leur. Leurs ouvrages continuent la littérature des évangiles et des écrits apostoliques.
D'autre part, ces ouvrages n'offrent ni l'intensité de sentiment des œuvres canoniques, ni la plénitude de pensée théologique de la littérature postérieure. Si l'on excepte saint Ignace, leurs auteurs y montrent peu de puissance et d'élan intellectuels, preuve que le christianisme s'est recruté d'abord dans un milieu peu lettré. Ils n'en ont pas moins pour nous une très grande valeur, soit à cause de leur ancienneté, soit parce qu'ils témoignent de la façon dont les chrétiens de la seconde et de la troisième génération avaient compris l'œuvre de Jésus-Christ et des apôtres.
On compte une dizaine environ de Pères apostoliques. La moitié de leurs écrits se compose d'épîtres (Clément, Ignace, Polycarpe, Pseudo-Barnabé) ; l'autre moitié de traités doctrinaux, parénétiques ou disciplinaires (la Didachè, la Secunda, Clementis, Hermas, Papias, le Symbole des apôtres).
[L'édition des Pères apostoliques de Migne (P. G., i, ii, v) est absolument insuffisante. Il faut pratiquement se servir de celle de F. X. Funk, Patres apostolici, Tubingae, 1901, en 2 vol. avec traduct. latine et notes (le deuxième volume a été revu et réédité par F. Diekamp en 1913), ou des éditions séparées de la collection Hemmer et Lejay. On a encore les édit. mineures (sans traduction ni notes) de Funk et de Harnack, Gerhardt et Zahn. Voir Freppel, Les Pères apostoliques et leur époque, Paris, 4e éd., 1885.]
D'après la tradition la plus sûre, saint Clément fut le troisième successeur de saint Pierre, le quatrième évêque de Rome (Pierre, Lin, Anaclet, Clément). Rien n'établit qu'il faille l'identifier, avec le Clément dont parle saint Paul (Philipp.4.3), encore moins avec le consul Flavius Clemens, cousin de Domitien, décapité en 95 ou 96. Mais il a dû connaître les apôtres, et c'était peut-être un affranchi ou un fils d'affranchi de la gens Flavia d'où il aura tiré son nom. Quoi qu'on en décide, Clément fut certainement un pontife remarquable par quelque endroit, car il a laissé dans l'Église un souvenir profond. Outre une deuxième épître qui n'est pas de lui, on lui a attribué deux épîtres aux vierges, deux épîtres à Jacques, le frère du Seigneur, la collection des homélies dites clémentines, et on lui a fait jouer dans le roman des Récognitions un des rôles principaux. A la fin du ive siècle, Rome l'honorait comme un martyr ; mais les actes que l'on donne comme ceux de son martyre ne lui appartiennent pas ; ce sont les actes d'un autre Clément, martyr grec inhumé à Cherson, avec qui on l'a confondu.
On possède du pape Clément un seul écrit authentique : c'est une épître aux Corinthiens, contenue dans deux manuscrits grecs, l'Alexandrinus, probablement du ve siècle (actuellement au British Museum), et le Constantinopolitanus ou mieux le Hierosolymitanus, daté de 1056, actuellement à Jérusalem. Le premier est incomplet de la portion 57.6 à 63.4 ; le second est complet. Il en existe de plus une version latine très littérale, qui paraît remonter au iie siècle, une version syriaque et deux versions coptes incomplètes.
Cette épître ne porte pas de nom d'auteur. Elle se présente, dès le début, comme une lettre de « l'Église de Dieu qui séjourne à Rome à l'Église de Dieu qui séjourne à Corinthe ». Mais bien qu'écrivant au nom d'une collectivité, il est certain que son auteur est un personnage unique et que cet auteur est Clément. La preuve décisive en est fournie par le témoignage de Denys de Corinthe (vers 170-175) on ne peut mieux placé pour être bien renseigné (Eusèbe, H. E., 4.23.11). On y peut joindre les témoignages d'Hégésippe, de Clément d'Alexandrie et même de saint Irénée (Adv. haer., 3.3.3). Saint Polycarpe a connu certainement notre écrit, puisqu'il s'est efforcé de l'imiter dans son épître aux Philippiens, et cette circonstance seule prouve qu'il remontait à peu près au temps de saint Clément.
Or le pontificat de Clément se place entre les années 92 et 101. D'autre part, sa lettre a été rédigée au sortir d'une persécution qui paraît être celle de Domitien. Celle-ci s'est terminée en 95 ou 96. C'est donc entre les années 95-98 que Clément a écrit aux Corinthiens.
L'occasion qui l'y invita fut un schisme qui se produisit dans l'Église de Corinthe. Un ou deux meneurs (47.5-6) y avaient soulevé la masse des fidèles contre les presbytres, dont plusieurs, de vie irréprochable, avaient été destitués de leurs fonctions. Nous ignorons ce dont on les accusait. L'Église de Rome eut connaissance de ces troubles par la rumeur publique, car il ne semble pas, malgré ce qui est dit 1.1, qu'elle ait été avisée par l'Église de Corinthe elle-même, ni sollicitée d'intervenir. Mais Clément était papeb et il intervint. Il intervint pour ramener la paix dans les esprits et indiquer les remèdes à la situation.
Son épître se divise en deux grandes parties. Une partie générale (ch. 4 à 38) comprend une série d'exhortations à pratiquer les vertus de charité, de pénitence, d'obéissance, d'humilité, de foi etc., propres à maintenir la bonne harmonie entre les fidèles. Elle est coupée (ch. 23 à 30) par un développement sur la certitude et la gloire de la résurrection future. La seconde partie (ch. 39 à 59) vise particulièrement les faits signalés à Corinthe. C'est Dieu qui a établi l'ordre de la hiérarchie ecclésiastique. Dieu a envoyé Jésus-Christ ; Jésus-Christ a établi les apôtres ; les apôtres ont, à leur tour, établi des évêques et des diacres, lesquels se sont, quand il l'a fallu, choisi des successeurs. A ces hommes on doit la soumission et l'obéissance. Ç'a donc été une faute de destituer les presbytres de leurs fonctions. Les coupables doivent faire pénitence et s'éloigner, pour un temps, de Corinthe, afin que la paix y revienne. — L'écrit se continue par une longue prière (59.3 à ch. 61) où alternent les louanges de Dieu et les supplications pour les chrétiens et aussi pour les princes ; et il s'achève sur de nouvelles exhortations à la concorde et des souhaits spirituels (ch. 62 à 65).
L'épître de saint Clément a joui dans l'antiquité de la plus haute estime, au point d'être mise par quelques auteurs au nombre des écrits inspirés. Saint Irénée l'appelle une lettre « très forte » ; Eusèbe une lettre « grande et admirable », et ce dernier témoigne qu'en beaucoup d'Églises elle était lue publiquement dans les réunions des fidèles (H.E., 3.16). Elle mérite cette estime par l'heureux mélange d'énergie et de douceur qui s'y rencontre ; par la finesse d'observation, la délicatesse de touche et l'élévation des sentiments dont l'auteur y fait preuve partout. La grande prière de la fin est d'une inspiration très haute. Il est fâcheux que l'abus des citations de l'Ancien Testament, dans la première partie surtout, brise parfois le développement et l'élan de la pensée.
Au point de vue théologique, l'épître de saint Clément a une importance considérable. Elle est « l'épiphanie de la primauté romaine », la première manifestation du sentiment qu'on en avait à Rome. Elle contient aussi la première affirmation patristique du droit divin de la hiérarchie (42.1,2,4 ; 44.2).
Saint Ignace, appelé aussi Théophore, avait, suivant la tradition, succédé à Evodius, premier évêque d'Antioche après saint Pierre (Eusèbe, H. E., 3.12). De sa jeunesse et même de son épiscopat on ne sait rien de certain. On soupçonne seulement qu'il était né dans le paganisme et s'était plus tard converti.
Il était évêque d'Antiochec, quand une persécution dont on ignore le motif s'abattit sur son Église. Il en fut la plus noble et peut-être l'unique victime. Condamné aux bêtes, Ignace dut prendre le chemin de Rome pour y subir son supplice.
Le voyage se fit tantôt par terre et tantôt par mer. Il passa à Philadelphie de Lydie, et de là arriva à Smyrne par la route de terre. A Smyrne, il fut accueilli par l'évêque Polycarpe, et reçut des délégations des églises voisines, d'Éphèse, de Magnésie et de Tralles avec leurs évêques respectifs, Onésime, Damas et Polybe. C'est à Smyrne qu'il écrivit ses lettres aux Ephésiens, aux Magnésiens, aux Tralliens et aux Romains. Puis de Smyrne il vint à Troas, et y écrivit ses lettres aux Églises de Philadelphie et de Smyrne, et la lettre à Polycarpe. Un vaisseau le transporta ensuite à Néapolis d'où partait la route de terre qui, passant par Philippes et Thessalonique, aboutissait à Dyrrachium (Durazzo), en face de l'Italie. Les Philippiens reçurent Ignace avec vénération et, après son départ, écrivirent à Polycarpe pour le prier de faire porter par son courrier la lettre qu'ils destinaient aux chrétiens d'Antioche, et lui demander de leur envoyer à eux, Philippiens, ce qu'il possédait des lettres d'Ignace. C'est le dernier renseignement que nous ayons sur l'évêque d'Antioche. Il souffrit à Rome la mort qu'il avait désirée ; mais les deux relations de son martyre qui nous restent (Martyrium romanum, Martyrium antiochenum) sont légendaires.
Les lettres de saint Ignace nous sont parvenues en trois recensions différentes :
Une recension longue qui, outre les sept lettres susdites en une forme plus développée, comprend six autres lettres : une lettre de Marie de Cassobola à Ignace, et cinq lettres d'Ignace à Marie de Cassobola, aux Tarsiens, aux Antiochiens, à Héron et aux Philippiens : en tout treize lettresd.
Une recension courte, en syriaque, qui comprend seulement, sous une forme très abrégée, les trois épîtres à Polycarpe, aux Ephésiens et aux Romainse.
Enfin une recension moyenne, qui comprend les sept épîtres aux Ephésiens, aux Magnésiens, aux Tralliens ; aux Romains, aux Philadelphiens, aux Smyrniotes et à Polycarpe dans un texte moins développé que celui de la recension longue, plus développé que celui de la recension courte.
Or, de l'aveu actuellement unanime, ni la recension longue, ni la recension courte n'ont droit à représenter l'œuvre authentique d'Ignacef. Celle-ci, si elle s'est conservée quelque part, l'a été dans la recension moyenne. Mais l'a-t-elle été même dans la recension moyenne ? Autrement dit, les sept épîtres de la recension moyenne sont-elles authentiques ?
A cette question, longtemps et âprement débattue, il faut répondre par l'affirmative. Les considérations intrinsèques, les seules à peu près que l'on puisse invoquer contre cette solution, n'ont vraiment aucune force, et ne sauraient prévaloir contre les témoignages d'Eusèbe (H.E., 3.22,36,38), d'Origène (In Cantic. canticor., prolog. ; In Lucam, homil. vi), de saint Irénée (Adv haer., 5.28.4) et de saint Polycarpe (Ad Philipp.,xiii). Sauf quelques auteurs obstinés, les critiques même protestants et rationalistes se mettent d'ailleurs sur ce sujet de plus en plus d'accord avec les catholiques. On peut dire que l'authenticité des épîtres ignatiennes est un point acquis.
A quelle date ces épîtres ont-elles été écrites ? A une date évidemment qui coïncide sensiblement avec celle de la mort de saint Ignace. Or celle-ci ne saurait être exactement fixée. Une seule chose paraît certaine : c'est qu'Ignace fut martyrisé sous Trajan (98-117). Les actes du martyre donnent la neuvième année de Trajan (107), saint Jérôme (De vir. ill., 16) la onzième année (109). On ne se trompera guère en plaçant ce martyre et par conséquent la composition des lettres autour de l'an 110.
Le but principal que se propose Ignace dans toutes ses épîtres — sauf celle aux Romains — est de précautionner les fidèles à qui il écrit contre les erreurs et les divisions que tâchaient de semer parmi eux certains missionnaires de l'hérésie et du schisme. La doctrine que ceux-ci s'efforçaient de propager était une sorte de gnosticisme judaïsant : d'un côté, ils poussaient à la conservation des pratiques juives ; de l'autre, ils étaient docètes et, ne voyaient dans l'humanité de Jésus-Christ qu'une apparence irréelle. De plus, ils se séparaient du gros de la communauté, et tenaient à part leurs conventicules liturgiques. Saint Ignace combat leurs prétentions en affirmant que le judaïsme est périmé, et en insistant avec force sur la réalité du corps et des mystères de Jésus ; mais il s'efforce surtout de ruiner dans son principe toute leur propagande, en recommandant aux fidèles, comme le premier de leurs devoirs, de ne se séparer jamais de leur évêque et de leur clergé. Au-dessous de l'évêque, unique dans chaque Église, Ignace distingue nettement un corps de prêtres et de diacres qui lui sont soumis. Ils constituent avec l'évêque l'autorité à laquelle il faut nécessairement obéir si l'on veut que se maintiennent dans l'Église l'unité et la saine doctrine.
Quant à l'Épître aux Romains, son objet est spécial. Ignace craint que, mûs par une fausse compassion, les fidèles de Rome n'essaient d'empêcher son martyre. Il les supplie de n'en rien faire.
Le style d'Ignace est « rude, obscur, énigmatique, plein de répétitions et d'insistances, mais d'une énergie continue, et çà et là d'un éclat saisissant » (Batiffol). Nul auteur, si ce n'est saint Paul à qui il ressemble beaucoup, n'a mieux fait passer dans ses écrits toute sa personne et toute son âme. Un mouvement que l'on sent irrésistible entraîne cette composition incorrecte et heurtée. Un feu court sous ces phrases où parfois un mot inattendu jaillit comme un éclair. La beauté de l'équilibre classique a fait place à une beauté d'ordre supérieur, parfois étrange, qui a sa source dans l'intensité du sentiment et dans les profondeurs de la piété du martyr. Rien n'égale, à ce point de vue, la lettre aux Romains : elle est peut-être le plus beau morceau, en tout cas « l'un des joyaux de la littérature chrétienne primitive » (Renan).
Le souvenir de saint Polycarpe est intimement lié à celui de saint Ignace d'une part, de l'autre à celui de saint Irénée. Polycarpe est né très probablement en l'an 69 ou 70, d'une famille aisée, et a été disciple de saint Jean l'évangéliste (Eusèbe, H. E., 5.20.6). Il a conversé avec ceux qui avaient vu le Seigneur et a été établi, relativement jeune encore, évêque de Smyrne, puisqu'il a reçu en cette qualité saint Ignace allant à Rome. Saint Irénée relève avec insistance son amour de la tradition et de la saine doctrine. Vers la fin de sa vie, en 154, il vint à Rome trouver le pape Anicet, pour discuter avec lui la question de la Pâque et soutenir l'usage de son Église. Les deux évêques ne purent s'entendre, mais se séparèrent en paix. Un ou deux ans après, en 155 ou 156, Polycarpe mourait martyr.
Les détails de sa mort ont été conservés par une lettre, rédigée par un certain Marcion au nom de l'Église de Smyrne, et adressée, dans l'année même qui suivit le martyre de l'évêque, à l'Église de Philomelium « et à toutes les chrétientés du monde appartenant à l'Église universelle »a. Polycarpe fut brûlé vif, ou plutôt tué d'un coup de poignard sur le bûcher, et ensuite consumé par le feu. Les chrétiens purent « recueillir ses ossements d'une plus grande valeur que les pierres précieuses, plus estimables que l'or, pour les déposer dans un lieu convenable », auprès duquel ils se réuniraient plus tard pour célébrer l'anniversaire de son martyre (18.2).
Au témoignage de saint Irénée (Eusèbe, H. E., 5.20.8), saint Polycarpe avait écrit un certain nombre de lettres. Nous ne possédons que sa lettre aux Philippiens, écrite à l'occasion du passage d'Ignace parmi eux. Celui-ci avait engagé les chrétiens de Philippes à écrire à ceux d'Antioche pour les féliciter d'avoir vu finir la persécution qui leur avait enlevé leur évêque. Les Philippiens s'adressèrent à Polycarpe pour le prier de faire porter leur lettre aux Antiochiens par le messager qu'il enverrait lui-même à Antioche, et lui demander en même temps de leur faire parvenir les lettres d'Ignace qu'il pourrait avoir. C'est la réponse de Polycarpe à cette missive des Philippiens que nous possédons. Elle a dû être écrite peu après la mort de saint Ignace.
Nous ne l'avons entière que dans une version latine médiocre. Tous les manuscrits grecs connus s'arrêtent vers la fin du chapitre 9. Heureusement Eusèbe a reproduit tout ce chapitre 9 et le chapitre 13, les deux plus importants (H. E., 3.36.13-15).
C'est en vain qu'on a attaqué leur authenticité, liée à celle des épîtres de saint Ignace. Cette authenticité, comme celle de toute l'épître, est assurée.
L'écrit de Polycarpe est du reste peu original et extrêmement terne de pensée et de style. L'évêque de Smyrne voulant exhorter les Philippiens, qu'il connaissait peu, a composé sa lettre de conseils empruntés au Nouveau Testament et surtout à l'épître de saint Paul aux Philippiens. Il ajoute qu'il leur envoie, conjointement avec cette lettre, toutes les épîtres de saint Ignace qu'il a en mains.
On possède, sous le nom de saint Barnabé, une épître contenue dans deux manuscrits principaux, le Sinaïticus, du ive siècle et le Hierosolymitanus, de 1056. Les anciens attribuaient unanimement cet écrit au compagnon de saint Paul, bien qu'on le rangeât parmi les ἀντιλεγομέναι γραφαί, c'est-à-dire qu'on en contestât la canonicité. Les critiques actuels s'accordent au contraire à en rejeter l'authenticité. Au moment où l'épître a été composée, saint Barnabé n'était sûrement plus de ce monde, et, l'eût-il été, il n'aurait pas pris contre la loi mosaïque l'attitude violente et excessive dont témoigne notre écrit.
Les destinataires de la lettre sont des païens convertis, à qui des judéo-chrétiens, plus juifs que chrétiens, ont tenté de persuader que l'Ancienne Loi conserve sa valeur et reste obligatoire. Pour combattre cette prétention, l'auteur consacre la plus grande partie de son épître (ch. 1 à 17) à montrer que les observances anciennes sont abrogées et que l'ancienne alliance de Dieu avec les juifs a été rompue par le fait de la mort de Jésus-Christ et de la promulgation de la Loi chrétienne. Il va plus loin. Ces observances, ajoute-t-il, n'ont en réalité jamais existé telles que les comprenaient les juifs. Les prescriptions relatives aux jeûnes, à la circoncision, au sabbat, au temple, etc. qu'ils ont entendues au sens matériel et grossier, devaient s'entendre au sens purement spirituel de la mortification des passions et de la sanctification du temple intérieur qui est notre âme. — Dans la seconde partie (ch. 18 à 21), l'auteur, entamant brusquement un autre ordre d'idées, reproduit le contenu des chapitres sur les Deux voies qui sont dans la Didachè, contenu qu'il a puisé ou dans un écrit original, ou dans la Didachè elle-même. Il y a deux voies, l'une des ténèbres et du vice, l'autre de la lumière et de la vertu : il faut suivre celle-ci et se détourner de l'autre.
On désigne généralement Alexandrie et l'Egypte comme la patrie de l'Épître de Barnabé. C'est là qu'on la trouve d'abord citée (Clément d'Al.) et tenue en haute estime. C'est là encore que nous ramène l'allégorisme outré qui s'y montre. L'auteur voit dans les 318 serviteurs d'Abraham la figure de Jésus-Christ et de sa croix (Τ = 300, ιη = 18). Il est millénariste.
La date est difficile à fixer, et dépend de l'interprétation que l'on donne des chapitres 4 et 16. Funk et Bardenhewer mettent l'écrit sous Nerva (96-98) ; Veil, Harnack, Oger sous Hadrien, de 117 à 131 environ.
La Doctrine des douze apôtres (Διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων), désignée souvent par le nom abrégé de Didachè, n'était pas, quand le texte complet en fut découvert, un livre entièrement inconnu. L'épître du Pseudo-Barnabé, Clément d'Alexandrie, Origène, les Constitutions apostoliques, d'autres auteurs encore l'avaient citée ou en contenaient des fragments. Saint Athanase l'avait mentionnée par son titre de Doctrine des apôtres. L'écrit avait eu dans l'antiquité beaucoup de vogue, et avait même été regardé par quelques-uns comme inspiréb. Mais le texte original entier n'en fut découvert qu'en 1873 par Philothée Bryennios dans le codex Hierosolymitanus, daté de 1056. L'édition princeps est de 1883. Elle a été suivie, depuis, de beaucoup d'autres. Outre l'original grec, il subsiste d'ailleurs une version latine des six premiers chapitres et quelques morceaux d'une traduction arabe. Des citations faites par l'Adversus aleatores et par saint Optat prouvent même qu'il a dû exister, dès le iie siècle, une version latine différente de celle que nous possédons, et qui comprenait tout l'ouvrage.
La Didachè peut se diviser en quatre parties nettement tranchées : une catéchèse morale (ch. 1 à 6) ; une instruction liturgique (7 à 10) ; une ordonnance disciplinaire (11 à 15), et enfin une conclusion d'ordre eschatologique (16).
La catéchèse morale enseigne ce qu'il faut faire (voie de la vie, 1 à 4), et ce que nous devons éviter (voie de la mort, 5 et 6).
L'instruction liturgique a pour objet le baptême, la manière de l'administrer et de s'y préparer (ch. 7) ; le jeûne (8.1) ; la prière (8.2-3) et enfin la célébration de l'eucharistie (ch. 9 et 10).
L'ordonnance disciplinaire indique la conduite à tenir à l'égard des prédicateurs, et spécialement des apôtres itinérants (11.3-6), des prophètes (11.7-12 ; 13.1,3-7), des frères voyageurs (ch. 12) et des docteurs éprouvés (13.2) ; puis, s'attachant à la vie intérieure de l'Église, elle prescrit la synaxe dominicale, et dit de quelle façon on doit traiter les évêques, les diacres et les frères de la communauté (ch. 14 et 15).
Conclusion : Veillons sur nous dans la pensée de la venue du Sauveur. Description des signes qui précéderont et accompagneront la parousie (ch. 16).
La Didachè est un écrit anonyme et l'auteur en est inconnu. Mais cet auteur en a très bien harmonisé et fondu les diverses parties. La question seulement est de savoir s'il ne s'est pas servi d'ouvrages antérieurs, et notamment si les six premiers chapitres (catéchèse morale) n'ont pas d'abord constitué un écrit indépendant, que l'auteur s'est approprié en l'incorporant à son œuvre. Quelques indices tendraient à le faire croire. Sous le titre des Deux voies, un petit écrit moral aurait d'abord circulé où auraient puisé la Didachè et plusieurs des auteurs qui semblent l'avoir citée. Cependant cette conclusion n'est pas certaine. Quant à voir dans les Deux voies un écrit juif que la Didachè aurait christianisé par l'addition du passage 1.3 à 2.1, c'est une pure hypothèse plutôt contredite par les faits.
Les dates fixées par les critiques pour la composition de la Didachè s'échelonnent entre les années 50 et 160. L'ouvrage remonte vraisemblablement aux années 80-100. D'une part, en effet, la liturgie et la hiérarchie qu'il décrit sont des plus primitives, et il ne contient aucune trace de symbole ni de canon scripturaire ni aucune allusion à la persécution païenne et au gnosticisme. D'autre part, l'auteur connaît les évangiles de saint Matthieu et de saint Luc, et témoigne déjà d'une défiance marquée contre les prédicateurs d'occasion qui visitent les communautés. Cet état de choses convient bien à la fin du Ier siècle.
Quant au lieu d'origine de la Didachè, il est impossible de le déterminer d'une façon précise. C'est sûrement en Orient qu'elle a vu le jour ; mais rien ne permet de dire avec certitude si c'est en Syrie, en Palestine ou en Egypte.
Quoi qu'il en soit, l'importance de ce petit écrit est considérable ; car, la question dogmatique mise à part, il nous représente assez fidèlement quelle était, dans ces temps reculés, la vie intérieure des communautés chrétiennes au point de vue de l'enseignement moral reçu, des pratiques observées et du gouvernement qui s'y exerçait. Quelques-uns y ont vu le plus ancien rituel chrétien ; on y peut voir plus exactement une sorte de Vade mecum du fidèle et de directoire à l'usage des préposés de l'Église.
On donne le nom de Deuxième épître de saint Clément à un écrit contenu dans les deux manuscrits grecs et dans le manuscrit syriaque de la lettre authentique de saint Clément, et que ces manuscrits désignent comme une seconde épître de ce pape. Eusèbe, qui en parle le premier (H.E., 3.38.4), remarque cependant « qu'elle n'a pas été aussi connue que la première, puisque nous ne voyons pas que les anciens s'en soient servis ». De fait, ce n'est ni une lettre ni une épître, mais bien une homélie ou un discours lu dans une assemblée de fidèles. « Frères et sœurs, après (la parole du) Dieu de vérité, je vous lis cette exhortation, afin qu'en prêtant attention aux choses qui ont été écrites, vous vous sauviez vous-mêmes, et votre lecteur avec vous » (19.1). L'opinion qui y voyait la lettre du pape Soter aux Corinthiens, dont parle Denys de Corinthe (Eusèbe, H.E., 4.23.11), n'est donc pas soutenable. On ne saurait non plus attribuer cet écrit au pape Clément. Non seulement le silence des anciens va contre cette hypothèse ; mais « les différences de style, de ton, de pensée accusent un contraste si complet avec l'Épître (authentique) aux Corinthiens que la seule critique interne serait fondée à rejeter l'attribution du second écrit à l'auteur de l'épître » (Hemmer)
Nous sommes donc en présence d'un sermon anonyme dont il est impossible d'indiquer l'auteur. Comme on n'y trouve pas de sujet précis traité avec suite, il est difficile d'en analyser le contenu. Après une affirmation énergique de la divinité de Jésus-Christ, l'auteur s'étend sur le prix du salut qu'il nous a apporté, et sur le soin que nous devons avoir d'observer les commandements (ch. 1 à 4). Notre salut ne peut s'opérer que par une lutte continuelle contre le monde. Embarquons-nous donc pour le combat céleste (5 à 7), et efforçons-nous de pratiquer les vertus chrétiennes, la pénitence, la pureté, la charité mutuelle, la confiance en Dieu, l'amour de l'Église (8 à 17). Conclusion : travaillons à nous sauver quoi qu'il en coûte : Gloire à Dieu ! (18 à 20).
Comme on le voit, ce discours n'est pas proprement une homélie sur un texte déterminé de l'Écriture : c'est une exhortation chaleureuse à vivre chrétiennement et à gagner le ciel. « La pensée est souvent banale… l'expression est souvent gauche, imprécise. La composition est lâche, sans dessein suivi », et néanmoins on y peut « noter au vol des sentences assez bien frappées ». C'est l'œuvre d'un auteur inexpérimenté, mais pénétré de ce qu'il dit, et qui a su parfois le dire avec onction.
Certains critiques, frappés des analogies que notre écrit présente avec le Pasteur d'Hermas, ont pensé qu'il avait vu le jour à Rome. Ces analogies toutefois sont, en somme, peu caractéristiques. D'autres ont aperçu dans 7.1-3, où il est question des lutteurs qui accourent à force de voiles, et de l'embarquement des chrétiens pour le combat, une allusion aux jeux isthmiques, et croient, en conséquence, que l'exhortation a été lue à Corinthe même. Ceci expliquerait qu'elle ait été jointe dans les manuscrits à l'épître de saint Clément aux Corinthiens. C'est une hypothèse assez vraisemblable.
Quant à la date de sa composition, on est d'accord pour la fixer dans la première moitié du iie siècle, plus précisément entre 120-140, avant l'éclosion des grands systèmes gnostiques dont l'auteur n'a pas l'air de se défier.
Nous possédons, sous le nom d'Hermas, un écrit assez long, intitulé Le Pasteur, dont il existe deux manuscrits grecs, tous deux incompletsc, deux versions latines (l'une, la Vulgate, très ancienne), une version éthiopienne et quelques courts fragments de version copte. Le titre est emprunté au personnage qui joue, dans la seconde partie de l'ouvrage, le rôle principal, l'ange de la Pénitence à qui Hermas a été confié, et qui se présente à lui sous la figure d'un berger (Vision 5).
Qui est cet Hermas, auteur du livre ? Origène voyait en lui l'Hermas que salue saint Paul à la fin de son épître aux Romains (Rom.16.14). D'autres en ont fait un contemporain de saint Clément de Rome, d'après la vision 2.4.3. Mais l'opinion de beaucoup la plus probable, appuyée sur l'autorité du Canon de Muratori et du Catalogue libérien, croit qu'Hermas était un frère du pape Pie Ier, qui régna de l'an 140 à l'an 155 environ. « Quant au Pasteur, dit le Canon de Muratori, il a été écrit tout récemment, de notre temps, dans la ville de Rome, par Hermas, pendant que Pie, son frère, occupait comme évêque le siège de l'Église de la ville de Rome. » Ce témoignage paraît concluant.
Il ne donne cependant point de détails sur la vie d'Hermas lui-même. Mais celui-ci, dans son livre, en a donné. D'après cette autobiographie, Hermas, d'abord esclave et chrétien, aurait été vendu, à Rome, à une dame chrétienne nommée Rhodé, qui ne tarda pas à l'affranchir. Devenu libre, il s'adonna à l'agriculture et au commerce et fit fortune. Par contre, il négligea la direction morale de sa famille et surtout ne corrigea pas sa femme et ses enfants qui étaient vicieux. Survint la persécution. Pendant qu'Hermas et sa femme confessaient leur foi, ses enfants apostasièrent, dénoncèrent leurs propres parents et s'abandonnèrent à tous les désordres. La conséquence fut pour lui la ruine de sa fortune. Un petit domaine lui resta cependant sur la voie campanienne, qui suffit à ses besoins. Mais l'épreuve lui fut salutaire. De chrétien médiocre devenu chrétien fervent, Hermas s'efforçait de réparer le passé quand commencèrent les événements qu'il va raconter.
Il est difficile de démêler dans ces détails le vrai du fictif. La personne d'Hermas est certainement historique et certains traits le sont aussi probablement. D'autres ont pu être imaginés pour les besoins du livre. En somme Hermas a beaucoup inventé, comme nous l'allons dire, et il se peut donc qu'il ait arrangé sa propre histoire.
Le but de l'auteur, dans tout son ouvrage, est d'amener les pécheurs à faire pénitence. De graves désordres se sont glissés en effet, il le constate, dans l'Église romaine (Simil, 8.6-10 ; 9.19-31), et cela non seulement parmi les fidèles, mais jusque dans le clergé. Ces pécheurs doivent-ils faire pénitence ? Certains imposteurs le niaient (Simil., 8.6.5) : Hermas l'affirme. Cette pénitence nécessaire sera-t-elle utile à ceux qui la feront et leur vaudra-t-elle leur pardon ? Des docteurs rigoristes enseignaient que non, et que la seule pénitence salutaire était celle que l'on faisait au baptême (Mandat., 4.3.1) : Hermas annonce précisément de la part de Dieu qu'une pénitence après le baptême est possible et efficace au moins au moment où il écrit, et qu'il a mission expresse d'inviter les pécheurs à profiter de cette grâce. Et enfin, comment doit s'opérer la pénitence ? Hermas le dira au cours de ses développements. Ces trois idées, nécessité, efficacité de la pénitence, conditions générales de la pénitence forment tout le fond du Pasteur.
Mais ces idées, Hermas ne les présente pas comme siennes. Afin de les faire plus aisément accepter, il les a présentées comme des instructions morales reçues à l'occasion de manifestations surnaturelles dont il a été favorisé. Il s'est posé en voyant et en prophète, semblable à ceux des premiers temps de l'Église, et tout son livre n'est que la relation de ses visions et des révélations qui lui ont été faites.
A ce point de vue, qui est celui de la forme du livre, le Pasteur se divise en trois parties qui comprennent cinq Visions, douze Préceptes