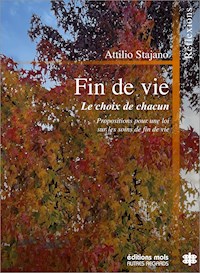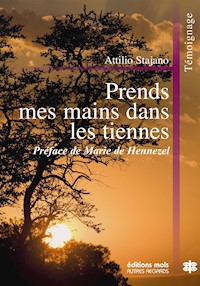
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mols
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Attilio Stajano est volontaire dans l’unité de soins palliatifs d’un hôpital bruxellois. À travers les personnes qu’il rencontre au sein de ce service, mais aussi à travers sa propre expérience de la fin de vie, il nous donne à voir des histoires et des sensibilités très différentes, qui ont pourtant toutes un trait commun : à la fin, quand les gestes et les mots se font rares, il ne reste que l’amour. « On sort de la lecture de ce livre convaincus qu’il ne faut pas passer à côté de cette expérience de l’accompagnement d’un autre, proche de sa mort. Il ne faut pas en avoir peur. Laissons parler notre coeur, laissons notre intuition guider nos gestes. nous découvrirons en nous des ressources insoupçonnées, une tendresse, un tact, une disponibilité dont nous ne nous sentions peut-être pas capables. Bref, nous sortirons de cette expérience plus généreux et plus humain, car au seuil de la mort, c’est bien l’amour qui a le dernier mot. » Marie de Hennezel Autant de chapitres, autant de rencontres relatées avec une immense délicatesse tout empreinte de poésie. Traduction française de L’amore, siempre. Il senso della vita negli incontri degli ultimi giorni, Lindau (3e édition, 13 février 2020) Réédition augmentée Le livre a également été traduit et publié en allemand, en anglais et en espagnol.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRENDS MES MAINS DANS LES TIENNES
Attilio Stajano
PRENDS MES MAINS DANS LES TIENNES
Le sens de la vie dans les rencontres des derniers jours
DEUXIÈME ÉDITION
Préface de Marie de Hennezel
Traduit de l’italien par Tiziana Stevanato
éditions mols
collection autres regards
Les droits d’auteur seront versés pour moitié à la
Fondation privée Soins palliatifs des Cliniques de l’Europe
(IBAN BE58 0682 5039 1379 - BIC GKCCBEBB)
http://stajano.org
Titre original :
L’amore, sempre. Il senso della vita nel racconto dei malati terminali
© 2013 Lindau s.r.l.
corso Re Umberto 37 – 10128 Torino, Italia
Première édition : février 2013
ISBN 978-88-6708-045-8
Troisième édition : janvier 2020
L’amore, sempre il senso della vita negli incontri degli ultimi giorni
ISBN 978-88-3353-291-2
Première édition en français
Prends mes mains dans les tiennes
ISBN: 978-2-87402-280-7
© Carnets Nord, 2014
Six ans après la première publication de ce livre en français, cette deuxième édition reflète les lectures et les rencontres que l’auteur a eues en Italie et à l’étranger à l’occasion de la présentation des précédentes éditions du livre. Elle présente la position de l’auteur sur les transformations de la profession médicale et de la société civile belge où maintenant l’euthanasie est acceptée comme un des choix thérapeutiques en fin de vie, sans démarcation entre ce qui est permis et ce qui est juste. Cette édition est le résultat d’une réécriture complète et s’enrichit d’un nouveau chapitre et d’une nouvelle annexe sur les « Pratiques et normes en fin de vie » dans différents pays européens.
Pour la préface de Marie de Hennezel :
© 2014 Marie de Hennezel
© Éditions Mols, 2020, pour la traduction française
Collection Autres Regards
www.editions-mols.eu
Au Dr Michel Stroobant †, maître et ami, pionnier des soins palliatifs en Belgique, et à tout le personnel soignant qu’il a formé et guidé pendant vingt ans.
Je remercie mon épouse, Kathleen, ma famille et les amis qui ont lu le livre au cours de sa rédaction pour leurs encouragements, leurs conseils et leurs corrections : Martine, Catherine, Saura, Cristina, Angel, Isabelle, Piera, Francesco, Aska, Bruce, Ruth, Fides et Annie.
Préface
Nous avons en commun, Attilio Stajano et moi, d’être intimement convaincus l’un et l’autre que mourir sereinement, sans souffrir et entouré d’affection et de spiritualité, n’est pas une expérience exceptionnelle.
Je le sais parce que j’ai travaillé neuf ans dans la première unité de soins palliatifs française, auprès de personnes perdues pour la médecine curative, mais encore vivantes et désireuses de le rester jusqu’à leur dernier souffle. Avec une équipe motivée et compétente, nous avions décidé de tout faire pour que nos mourants ne souffrent pas et puissent mourir à leur heure, ayant le sentiment de rester sujets de leur mort.
Notre expérience pilote, que j’ai relatée, il y a vingt ans, dans un livre qui a fait le tour du monde, La Mort intime1, et que notre président de la République, François Mitterrand, lui-même mourant, avait préfacé, a servi de modèle au développement des unités de soins palliatifs dans toute l’Europe.
C’est dans l’une d’entre elles, à Bruxelles, qu’Attilio, une fois retraité, a dispensé son énergie de volontaire. En lisant son récit plein de finesse et de cœur, j’ai retrouvé les émotions que j’avais éprouvées à l’époque. J’ai retrouvé les enseignements que les mourants m’avaient prodigués, par leur seule manière d’être, leur humour, leur humilité et leur courage.
Côtoyer au quotidien des hommes et des femmes que la médecine ne peut plus guérir mais qu’elle peut accompagner de la manière la plus digne et la plus humaine possible n’est pas chose facile, dans un monde qui dénie la mort et considère que le temps du mourir est un temps inutile, pénible, absurde. Dans le grand public, aujourd’hui, on estime généralement qu’il vaut mieux abréger ce temps que de le vivre. À quoi bon attendre la mort, lorsqu’on sait que la médecine ne peut plus vous guérir ? On se prive alors d’une expérience irremplaçable. Et c’est bien ce que nous découvrons en lisant le témoignage d’Attilio. Car les derniers échanges avec celui qui va mourir, ces regards, ces gestes, ces mots d’amour, d’apaisement, ou de confiance, permettent aux survivants de vivre leur deuil d’une tout autre manière, et nourrissent le reste de leur vie. On n’est plus le même avant et après l’accompagnement d’un proche ou d’un ami au seuil de la mort. Cet accompagnement nous transforme. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous mortels, conscients que nous sommes de passage sur cette terre et que ceux que nous aimons ne seront pas toujours là, près de nous. Et cette proximité avec la mort d’autrui, si elle est une écharde au cœur de notre humanité, si elle nous blesse, nous ramène aussi à l’essentiel.
Pas facile donc d’accompagner quelqu’un dans ses derniers instants, dans des hôpitaux qui se sont éloignés de leur mission d’accueil de la personne pour devenir des entreprises technocentrées à visée économique. C’est tout un mouvement, auquel j’ai activement participé, qui s’est battu pour que la culture palliative pénètre au cœur des hôpitaux et des institutions médicales et médico-sociales. Il s’agit de développer un esprit palliatif afin que partout où l’on meure, la personne humaine puisse terminer sa vie dans la dignité. Lorsque le responsable médical d’un service de cancérologie, par exemple, ou le directeur d’une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes, a compris l’importance du non abandon du patient que l’on ne peut plus guérir, lorsqu’il a une équipe de soignants et de volontaires capables, comme Attilio, de dialoguer avec des personnes qui souffrent en vérité souvent d’être isolées derrière un paravent de mensonges, ou d’aider les proches à rester aux côtés de celui qui s’en va, alors le temps du mourir peut être un temps fécond.
Lorsque, au contraire, le malade en fin de vie se sent un poids pour les autres, lorsqu’il sent qu’il n’a plus sa place dans la communauté des vivants, il demande souvent à ce que l’on en finisse avec lui. Cette demande d’euthanasie masque une immense détresse.
Il y a aujourd’hui une sorte de promotion de la mort anticipée. On parle de droit à la mort, de droit de choisir sa mort, son heure, de liberté assumée, de dignité. Mais quelle est la liberté d’une personne fragile et vulnérable qui sent qu’elle est devenue un problème pour les autres ? Quelle est cette conception restrictive de la dignité qui la réduit à l’image que l’on a de soi ou que l’on donne à l’autre ? Une personne abimée par la maladie ou le grand âge a-t-elle perdu à nos yeux sa dignité d’être humain ? Attilio pose les bonnes questions. Les questions qui dérangent. Et ce qui m’a particulièrement touchée, dans les pages qui suivent, c’est l’implication personnelle et humble de cet homme qui prend son lecteur par la main pour lui montrer le chemin que nous ferons tous un jour. Un chemin de détachement, parfois douloureux mais fécond, un chemin d’ouverture vers le meilleur de soi.
Les malades en fin de vie nous offrent, malgré eux, un exemple de ce qui compte dans la vie. Ils se libèrent des conditionnements qui ont encombré leur existence. Ils s’allègent. Ils nous aident à vivre le présent, à envisager l’avenir « avec optimisme et reconnaissance », sans regretter ce que la maladie ou la vieillesse enlèvent. Ils nous montrent combien il est important d’accepter notre vulnérabilité et de savoir recevoir des autres.
On sort de la lecture de ce livre, convaincus qu’il ne faut pas passer à côté de cette expérience de l’accompagnement d’un autre, proche de sa mort. Il ne faut pas en avoir peur. Laissons parler notre cœur, laissons notre intuition guider nos gestes. Nous découvrirons en nous des ressources insoupçonnées, une tendresse, un tact, une disponibilité dont nous ne nous sentions peut-être pas capables. Bref, nous sortirons de cette expérience plus généreux et plus humain, car au seuil de la mort c’est bien l’amour qui a le dernier mot.
Marie de Hennezel
Introduction
Mon premier contact avec la mort remonte à il y a soixante ans, à l’occasion du décès de ma grand-mère Alice. Je terminais mes études et je vivais encore avec mes parents et ma sœur. Ma grand-mère était une femme ronde, forte, volontaire, dynamique, cultivée, joyeuse, indépendante, anticonformiste. Elle a été une présence très importante dans ma vie et je l’aimais beaucoup. Quand elle est tombée malade cinq ans avant sa mort, nous l’avons accueillie à la maison ; ma mère la prit en charge et la soigna avec un dévouement exemplaire. Quand son état s’aggrava, elle renonça peu à peu aux mille activités qui avaient occupé ses journées ; son horizon finit par se restreindre au cercle familial et à son rêve de noces princières pour ma sœur. Ma grand-mère mourut dans les bras de ma mère qui la coiffait en vue de sa rencontre avec le pasteur vaudois compagnon spirituel de son dernier chemin.
Pendant les années qui ont suivi mon départ à la retraite, j’ai pu constater, comme volontaire au sein d’une unité de soins palliatifs2 d’un hôpital bruxellois, que mourir sereinement, entouré d’affection et de spiritualité, n’est pas une expérience exceptionnelle : à la fin de leur vie les personnes atteintes d’une maladie en phase terminale sont accompagnées, on soulage leur douleur dans un environnement de relations humaines, de respect et de dignité.
L’accompagnement des personnes en fin de vie m’amène à relativiser la perception du temps. Pour nous qui sommes bien portants et nous croyons immortels, il s’écoule tout autrement que pour ceux qui ont pris conscience de l’imminence inexorable de la mort. La valeur que les malades en phase terminale donnent aux jours qu’il leur reste à vivre m’aide à décider de la façon d’employer mon temps, avant qu’il ne soit trop tard, et m’incite à tenter de comprendre le sens de ma vie, à accepter ma vulnérabilité et à me préparer sereinement à ma propre mort.
Autrefois la mort était plus familière, elle était présente au quotidien en raison de la forte mortalité infantile et d’une plus grande cohésion familiale, qui réunissait trois ou quatre générations. Aujourd’hui les conditions sanitaires et sociales ont changé, les progrès de la médecine et le nouveau rôle de l’hôpital ont éloigné et marginalisé la mort, au point que lorsque l’un de nos proches est mourant nous ne voulons pas admettre que sa maladie est terminale. Dans une vaine attitude protectrice, nous avons tendance à cacher la vérité à notre proche sans même chercher à comprendre s’il souhaite ou ne souhaite pas que le diagnostic lui soit communiqué ouvertement.
Je sais que je dois mourir, que nous mourons tous tôt ou tard, mais au fond, c’est comme si je n’y croyais pas, et j’agis comme si j’étais immortel. De même, beaucoup de médecins agissent comme s’ils ne pensaient pas que la mort était l’inévitable et naturelle conclusion de l’existence : ils considèrent la mort comme l’échec de leurs efforts et la défaite de la médecine. Alors, avec une obstination déraisonnable, ils s’acharnent à pratiquer des traitements curatifs à outrance, même si ceux-ci ne font que prolonger la souffrance.
Mais la mort existe-t-elle ? Peut-être pas. Peut-être n’est-elle que l’entrée dans un autre monde, un simple passage3, qui cependant fait peur : on craint la douleur physique, la perte de statut et d’estime de soi dans la phase terminale de l’existence. Mais cette peur ne doit pas nous inciter à mourir avant de mourir.4 Nous devons nous mettre complètement au monde avant de disparaître5 : le problème n’est pas tant de savoir si nous vivrons après la mort que d’être dans la vie avant la mort6. Et le rôle des thérapies ne doit pas être d’ajouter, grâce aux progrès technologiques de la médecine, des jours vides à une vie privée de relations mais plutôt d’ajouter de la vie aux jours qu’il nous reste encore à vivre.
Ce livre est un témoignage exprimé à travers le récit de rencontres personnelles avec la souffrance et la mort et les situations vécues dans mon activité actuelle de volontaire dans un hôpital. Les événements sont transfigurés et transcendent les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, de sorte que le récit donne un sens aux événements de la vie. Ce livre naît aussi du besoin de communiquer des expériences trop intenses pour être gardées en moi, même s’il m’a fallu bien des années avant de pouvoir exprimer et partager ces émotions, quand, après avoir traversé le désert, un nouvel équilibre est né du chaos.7 Les noms des soignants sont inventés, et j’assume toute la responsabilité des propos qu’ils tiennent car ils reflètent mes opinions personnelles. Les médecins, les infirmières, les infirmiers du service m’ont beaucoup appris et inspiré par leur humanité, leur compétence, leur sensibilité et la richesse des différences de leurs approches. Mais le Dr Charles n’existe pas ; il est le médecin que j’aurais voulu être, si j’avais choisi cette profession ; de même que d’autres personnages, comme Tunç, Émile et Angela sont introduits pour raconter des épisodes de ma vie. Les noms des malades et les circonstances de leur vie ont été modifiés pour éviter de révéler le vécu de ceux qui m’ont honoré de leurs confidences. En revanche, je n’ai pas voulu modifier le prénom de mes parents ni celui de quelques autres personnes que j’ai accompagnées jusqu’à la mort parce que le lien qui nous unit est trop profond pour être occulté par une fiction littéraire. Mais je pense être en droit de les appeler par leur nom et de raconter leur vie sans pour autant révéler de secret, parce que, somme toute, quand je parle d’eux, c’est de moi que je parle ; et rien n’est inventé, tout s’inspire de ce qui est vécu et enduré dans cette mystérieuse proximité de la mort, qui, au fond, nous rapproche de la vérité et de la vie éternelle.
* * *
Dans le récit des rencontres avec les malades, je présente les soins palliatifs, soins spécialisés aux personnes souffrant de maladies incurables avec un pronostic fatal à court terme. Cette démarche trouve son origine dans les propos et l’expérience de Dame Cicely M. Sanders en Angleterre dans les années 60 du siècle passé. Son modèle a été adopté partout dans le monde à partir des années 80 et a permis à des millions de malades de terminer leur vie dans un cadre de soulagement de la douleur, avec un confort et une qualité de vie impensables il y a cinquante ans. Les soins palliatifs tiennent la vie en haute estime et donnent toute sa dignité à la mort ; ils respectent la dignité et l’autonomie du patient et placent ses priorités au centre des soins. Elles sont le nouveau visage d’une médecine qui, tout en faisant siens les progrès de la science et de la technologie, redécouvre les rapports interpersonnels et l’unité de la personne dans toutes ses dimensions : physiologique, psychique, affective et spirituelle. Une nouvelle médecine qui ne considère pas l’hôpital comme une entreprise où les machines doivent tourner pour équilibrer le bilan et où qualité rime avec productivité plutôt qu’avec humanité.
Au début du XXIe siècle dans les pays du Benelux, des lois dépénalisant l’euthanasie ont créé les conditions pour déshumaniser les soins de fin de vie. Elles sont en train de transformer la profession médicale et la société civile où maintenant l’euthanasie est acceptée comme un des choix thérapeutiques en fin de vie. Une pente glissante amène à des extensions arbitraires des critères d’application de la loi par rapport aux intentions initiales du législateur et les transgressions ne sont pas sanctionnées. Dans l’annexe de ce livre, pratiques et normes en fin de vie dans plusieurs pays européens sont présentées, avec un focus particulier sur la Belgique. Le monde entier regarde la Belgique comme un pays dans lequel trop facilement le principe multimillénaire de ne pas tuer a été brisé. Des recherches internationales indépendantes montrent que lentement toute contrainte est abandonnée et que les catégories les plus faibles, comme les nourrissons, les déments et les patients psychiatriques risquent, elles aussi, d’être victimes de l’euthanasie, en tant que solution radicale. Dans mes témoignages, je partage mon expérience d’un accompagnement possible qui garde au malade sa dignité et sa capacité de communication jusqu’au bout ; dans l’annexe, je présente l’urgence de s’arrêter, de réfléchir et de modifier les lois de dépénalisation. La France et le Royaume-Uni ont proposé en 2015 des projets de loi de dépénalisation qui, après un débat long et animé, ont été rejetés avec des majorités écrasantes. Des modes de fonctionnement ont été adoptées où l’équipe médicale, en conscience, et avec le support de lignes directrices et de comités éthiques, trouve les solutions adaptées à chaque cas. J’espère que la Belgique sortira d’une situation qui révèle le déclin d’une société qui ne peut plus crier « Non! » face à ce qui est ignoble, et qui – habitée par un polythéisme des valeurs – n’est plus en mesure de faire la distinction entre ce qui est juste, aux yeux de la conscience, et ce qui est autorisé, de par la loi.8
Mon père
Mon père, Mario, est né à la fin du XIXe siècle. Il avait dixneuf ans en 1917 quand il fut enrôlé, après la bataille de Caporetto, dans le régiment Nizza Cavalleria. La plupart des cadets de l’école militaire ne revinrent pas du front, mais mon père, qui avait déjà résisté au choléra dans son enfance à Naples, avait une forte constitution, si bien qu’au milieu des années 90 il était encore en grande forme. Il attendait le cap des cent ans avec l’espoir de recevoir de sa banque une prime d’un million de lires, comme son légendaire ami Claudio. Celui-ci avait vécu jusqu’à cent trois ans et avait reçu à son centième anniversaire la somme fantastique d’un million, à une époque où l’inflation n’avait pas encore raboté le pouvoir d’achat. Même si cette somme ne signifiait plus grand-chose désormais, pour mon père, qui avait perdu la notion de la valeur de l’argent, elle suffisait pour rêver au chanceux Signor Bonaventura ; ce dernier gagnait cette somme chaque semaine dans le Corriere dei Piccoli, l’hebdomadaire illustré qu’il me lisait dans l’après-guerre.
Papa n’a pas dépassé ce cap : à partir de l’âge de quatre-vingt-seize ans ses forces commencèrent à décliner et il ne s’en sortait plus à se déplacer du lit au fauteuil, sans l’aide de deux personnes. Il me disait :
— La secrétaire du bon Dieu doit avoir égaré mon dossier.
Ma maman aussi se faisait vieille, et, quand elle se fractura le col du fémur, il leur fut impossible de vivre seuls à la maison. Pendant son séjour à l’hôpital, je cherchai une maison de soins et de convalescence où ils pourraient être accueillis tous les deux. Ils y séjournèrent un an, puis nous les ramenâmes à la maison. Avec ma sœur Piera, nous avions organisé un système efficace d’assistance à domicile, d’après le mode de fonctionnement de la maison de repos.
Pour faire face à leurs nouvelles conditions de vie, j’avais suivi pendant plusieurs mois une formation sur l’accompagnement des personnes âgées et malades : ce fut mon premier pas vers mon actuel engagement de volontaire à l’hôpital dans le service des soins palliatifs.
Mon père avait travaillé cinquante ans dans une banque ; il avait fait une belle carrière dont il était très fier. C’était un homme juste et sévère qui inspirait de la crainte à ses employés. À la maison il se faisait appeler « monsieur le directeur » par la femme de ménage, ce qui donne une petite idée de la façon dont il vivait son rôle. Pendant la Seconde Guerre mondiale nous habitions à Rome ; il allait au bureau au centre à vélo, et quand il parlait de la côte de la via Capolecase, je l’imaginais comme Gino Bartali au col de Pordoi. Le dimanche nous allions à la campagne à vélo, sur la via Salaria, jusqu’à un pont sur le Tibre avant Monterotondo, détruit par un bombardement. Trop petit pour pédaler, j’étais assis sur un petit siège derrière lui. Je devais chanter sans arrêt pour prouver que je ne m’étais pas endormi et je me disais qu’il aurait été moins épuisant et plus amusant de pédaler. Piera était grande et autonome. Notre maman n’était pas à l’aise sur deux roues, elle descendait à chaque carrefour pour le traverser à pied, et nous nous moquions d’elle.
Pendant les années d’école primaire, ma mère était ma confidente et mon refuge contre les difficultés et les cauchemars provoqués par la fréquentation du catéchisme. Le curé me terrorisait en me promettant le feu de l’enfer comme punition de mes péchés ; il diabolisait aussi ma chère grand-mère parce qu’elle était protestante et il suggérait que je la convertisse. Même Sistilia, la femme de ménage, était considérée comme une présence diabolique parce qu’elle avait avoué s’être inscrite au Parti communiste. Or, tant ma grand-mère que Sistilia étaient bonnes et gentilles avec moi, plus que toute autre présence féminine autour de moi. Sûrement plus que Piera, qui trafiquait avec notre caisse commune, ou que maman, qui me faisait récrire cent fois les jambages des lettres.
Mon père, en revanche, était une présence sûre mais froide, qui me faisait un peu peur. Par ailleurs, j’avais au fond de moi des secrets rassurants qui le concernaient, comme cette découverte que je fis quand j’avais sept ans, dont je ne lui ai jamais parlé, étant donné notre mode de relation. En 1942 j’avais quatre ans ; il faut savoir qu’à Rome à cette époque il n’y avait pas grand-chose à manger et j’allais souvent au lit avec un petit creux à l’estomac et parfois avec une grande faim. Le pain était rationné : il y avait une carte vert foncé avec des timbres, et chaque foyer avait droit à un certain nombre de ciriole par jour, en fonction de la taille de la famille. Les ciriole sont des petits pains de moins de cent grammes, et nous qui étions quatre pouvions en acheter huit par jour. Souvent ma grand-mère m’emmenait acheter du pain chez Venanzio, le boulanger de la via Trebbia. J’aimais la bonne odeur de four de son magasin et j’aimais bien Venanzio, qui était gentil avec les enfants ; un jour il m’avait offert une ciriola encore chaude à manger séance tenante. Ma grand-mère m’emmenait ensuite à la Villa Borghese et, en chemin, elle m’apprenait un tas de choses. Elle m’avait entre autres appris à compter, puis à effectuer les quatre opérations sur les nombres jusqu’à vingt. C’est ainsi qu’un beau jour, au parc des Daini, en jouant avec des glands dont je faisais des petits tas, j’ai découvert que huit divisé par quatre ne font pas trois. Or, j’avais une ciriola le matin, une à midi et une le soir, comme Piera du reste.
— Heureusement ma grand-mère n’a sans doute pas appris à papa à faire les divisions, me disais-je. Mieux vaut ne rien dire à personne, au risque de perdre une ciriola chaque jour.
Une fois en deuxième année de primaire, je me suis rendu compte que mon père, en regardant mon cahier, maîtrisait les divisions des entiers jusque vingt, voire plus. C’était donc son cœur qui ne savait pas faire les divisions : pendant deux ans, lui et maman avaient mangé un seul petit pain par jour pour ne pas nous laisser mourir de faim. Cette découverte me bouleversa, mais je n’en dis jamais rien à personne et certainement pas à papa parce que j’étais trop timide, trop ému, et puis papa n’encourageait pas la communication verbale. Je gardai cette découverte comme un trésor, dans le secret de mon cœur. Entretemps les Alliés étaient arrivés : il y avait de la soupe aux pois et du pain blanc.
Papa a travaillé pendant cinquante ans dans la même banque ; ensuite il vécut comme retraité pendant plus de trente ans. Cette longue période lui permit de dépasser l’attitude austère et sévère qui avait caractérisé sa vie et qui le poussait à imposer, à moi et peut-être aussi à Piera, ses décisions autoritaires et indiscutables ; son autoritarisme m’amena à quitter la maison dès que possible, et je m’éloignai de lui. Ce n’est qu’au prix d’un long et douloureux cheminement que je me retrouvai libre et en pleine possession de ma vie. Avec le temps papa s’est bonifié comme le bon vin ; dans son extrême vieillesse, il est devenu un père et un grand-père affectueux, attentif, capable de dialoguer et d’aimer. Il a laissé un beau souvenir de lui et a su se faire aimer en entrant en relation avec les personnes qu’il fréquentait. Je l’ai vu baiser furtivement la main d’une aide-soignante qui s’occupait de lui dans la maison de repos. Dans ses dernières années, il apprit à découvrir la beauté de la création et à s’émerveiller. Pour lui la vieillesse ne fut pas un processus de diminution progressive mais le point culminant d’un parcours9 où il avait atteint la plénitude de son humanité.
La formation pour l’accompagnement des mourants m’avait appris à faire découvrir à la personne en fin de vie qu’elle pouvait être fière de son existence, qu’elle avait fait de belles et grandes choses. Ainsi, une fois que j’étais allé à Rome pour voir mes parents, je décidai de parler à mon père de la découverte que j’avais faite étant enfant. Papa était à moitié assoupi dans son fauteuil ; il avait perdu un peu de sa lucidité, mais les souvenirs lointains étaient présents dans sa mémoire. Il se souvenait du rationnement du pain, de la distribution à la maison et de notre souffrance à tous. Je l’ai remercié et nous avons pleuré ensemble.
Il se souvenait aussi d’un autre épisode que nous avons reconstruit en détail ensemble. Cela concernait un de ses frères aînés, l’oncle Federico, colonel de l’armée de l’air en retraite. Je me souviens bien de l’oncle Federico en grand uniforme : il avait l’air d’avoir avalé un parapluie et il avait aussi une épée. Je me demandais comment il pouvait s’en servir dans les combats aériens.
L’oncle Federico avait trouvé, piazza Istria, un portier qui vendait du pain au marché noir ; mon oncle avait l’argent pour se le procurer mais il n’aurait jamais osé faire des achats au marché noir, lui qui avait été officier supérieur de l’armée de l’air et disait que « certaines choses ne se font pas ». Néanmoins, si les principes étaient saufs, mon oncle restait pragmatique et il demanda à mon père d’aller lui acheter dix baguettes en lui promettant de lui en donner une pour sa commission. Ainsi papa alla à vélo piazza Istria avec l’argent de mon oncle et rapporta le butin sur son porte-bagages. Avant de livrer le pain à son frère, il passa par la maison ; dans la remise à vélos – on devait les monter sur le dos au quatrième étage pour les mettre en sécurité – il y avait une bonne petite odeur de pain : comment aurais-je pu résister ? J’aurais bien mangé une baguette entière ou même deux, mais j’ai jugé plus prudent de mordre à chacune des extrémités des dix baguettes, en me proposant d’accuser les souris si quelqu’un s’en était rendu compte. Mais la trace de mes petites dents fut une preuve flagrante de ma culpabilité. Mon père me gronda sévèrement, mais je m’aperçus qu’il pleurait.
Maintenant ce grand vieillard était au bout de ses forces et n’avait plus faim, il n’arrivait même plus à manger quoi que ce soit. Mais il avait été en état de s’émouvoir et de retrouver des souvenirs de souffrance, de partage et d’amour. Ce qui nous avait éloignés appartenait désormais au passé. Nous étions ensemble, nous nous sommes aimés et nous nous sommes pardonnés.
— Pour moi tu as été un bon père, et je te remercie pour l’exemple que tu m’as donné, lui ai-je dit, et il m’a répondu :
— Tu es un bon fils et je t’aime.
Cet échange empreint d’amour et de pardon a, par la suite, adouci la tristesse due à sa mort. Je le porte en moi et il honore sa mémoire.
Une vieille connaissance
Sylvie, la dame du lit 553/1, est une vieille connaissance. Dans l’autre lit se trouve Oda, une dame d’environ soixante-cinq ans arrivée il y a peu, qui ne semble pas avoir envie de parler d’elle. Sylvie, en revanche, nous avons eu le temps de bien la connaître : pendant neuf ans elle a été en dialyse, après l’ablation du rein qu’on lui avait transplanté six ans auparavant. Elle est venue en dialyse plus de mille fois à raison de trois fois par semaine : pendant les trois ou quatre heures que dure la dialyse, un volontaire de notre équipe passe avec des objets de première nécessité et des boissons, disponible pour l’écoute et l’échange.
Sylvie a soixante-cinq ans, elle est veuve depuis vingt ans de Pierre, avec qui elle a eu deux enfants, André et Yvonne. Si je ne connaissais pas sa date de naissance, je lui donnerais dix ans de plus. Depuis quelques années elle ne peut plus marcher et passe dans son fauteuil le temps qu’elle ne passe pas au lit. De ce fait elle a pris du poids et son dos s’en ressent. Elle venait à la dialyse en fauteuil roulant, dans la camionnette de l’hôpital qui va chercher et raccompagne les patients à mobilité réduite. Elle conserve l’élégance d’une femme belle et soignée grâce à l’aide à domicile d’une dame polonaise. Ses yeux bleus ont la sérénité d’une femme en paix avec elle-même et avec le monde. Dernièrement, des complications ont aggravé son état déjà difficile, et elle n’en peut plus. Il faudrait l’opérer pour placer trois by-pass, mais les médecins ont émis des réserves : ils craignent que son état général ne permette pas d’effectuer l’opération en toute sécurité. Ils lui ont patiemment et clairement expliqué la situation en présence de son médecin traitant et de sa fille cadette, Yvonne, qui la suit de près.
Depuis quelques années, Yvonne s’est réconciliée avec sa mère, après une longue période d’incompréhension et de difficultés. Sa présence est très importante pour Sylvie, d’autant plus que son fils aîné, André, vit à Boston et ne vient en Belgique qu’une fois par an, se bornant à téléphoner à sa mère de temps en temps. Maintenant se pose pour Sylvie le problème de décider de se soumettre ou non à l’intervention chirurgicale. Un rendez-vous est prévu avec le cardiologue pour la fin de la semaine. Yvonne est très liée à sa mère et elle ferait l’impossible pour lui assurer une fin paisible. Elle craint que l’intervention ne soit une forme d’acharnement thérapeutique et qu’elle ne présente trop de risques. Mais en même temps elle est tiraillée et appréhende le prochain rendez-vous avec le cardiologue. Pour s’y préparer, elle a consulté le médecin traitant de sa mère : celui-ci déconseille l’opération qu’il juge trop risquée.
La dialyse a été récemment suspendue, et, après deux semaines d’interruption, l’état général de Sylvie s’est amélioré. Cela lui avait donné l’illusion d’une perspective de vie sans la servitude et la dépendance de la dialyse. Puis, il y a quelques jours, Sylvie a été hospitalisée dans le service de médecine interne à cause de l’aggravation d’un des effets secondaires de la dialyse, la péricardite chronique constrictive. À la suite des examens du service de médecine interne, Sylvie a été transférée dans l’unité de soins palliatifs. Maintenant son état général semble se détériorer : le cardiologue passera demain pour lui dire que l’intervention chirurgicale est reportée.
Quand j’entre dans sa chambre, elle me salue affectueusement et me dit :
— Ici je suis très bien installée. Si vous avez le temps de vous arrêter un moment nous pouvons bavarder intimement, ce qui n’était pas possible dans le service de dialyse. J’ai beaucoup de choses à vous dire.
Cet accueil me réjouit et je m’assieds en face d’elle : elle est installée dans un fauteuil roulant devant une petite table sur laquelle son petit déjeuner est servi. Sylvie s’appuie sur les accoudoirs pour s’avancer et s’approcher de moi.
— Je ne me sens pas prête à affronter une grosse opération au cœur. À la prochaine consultation avec le cardiologue, j’ai l’intention de refuser l’intervention qu’ils m’ont proposée : mon heure est peut-être venue, et de toute façon je ne veux pas affronter d’autres épreuves. Depuis que Pierre est mort, et cela fait vingt ans déjà, c’est la première fois que je vois Yvonne sereine, et j’espère que son calvaire est fini. Elle a trouvé un compagnon qui est un garçon charmant, sensible et affectueux. Il s’appelle Pierre comme mon pauvre mari et il est jardinier dans une pépinière. Il est venu me voir hier et m’a apporté un cyclamen en pot. Figurez-vous qu’Yvonne m’a dit que, la première fois qu’il l’a invitée chez lui, il a parsemé l’entrée de pétales de roses, comme on le fait en Inde ou au Congo pour accueillir l’épouse dans sa nouvelle maison. Je crois que Pierre saura l’aimer, la protéger et, je l’espère, la rendre heureuse. Pauvre petite ! Elle y aurait bien droit, après tout ce qu’elle a souffert. Mais je dois te dire quelque chose d’important à propos de moi.
Après tant d’années, c’est la première fois que Sylvie me tutoie. Je crois que ce changement annonce quelque chose de très particulier. Sylvie s’approche de moi et j’accompagne son mouvement en me penchant vers elle.
— Cette nuit je me suis réveillée : un rayon de lune éclairait la chambre et en particulier cette photo de Pierre prise vers 1970 quand il était dans la fleur de l’âge. Je me suis rendormie et j’ai rêvé de lui. Il m’a dit : « Sylvie, tu es belle et je t’aime. » Ce sont exactement les mots qu’il a dits un jour de printemps il y a bien longtemps. Nous étions assis au soleil, à la terrasse d’un café à la campagne, près de Braine-l’Alleud, non loin du Lion de Waterloo : nous mangions des tartines de pain complet au fromage blanc et aux radis, accompagnées d’un verre de Gueuse. Puis nous nous sommes promenés dans les prairies et Pierre m’a embrassée. C’était la première fois que je me sentais aimée par un garçon dont j’étais moi-même amoureuse. Ce fut le plus beau jour de ma vie, et cette nuit, en rêve, Pierre a dit les mêmes mots que quand il s’est déclaré. Quand je me suis réveillée j’étais très émue. Cette nuit Françoise était de service, je le sais parce que c’était elle qui m’avait changée : alors j’ai osé sonner et elle est arrivée presque aussitôt. « Me voici, Sylvie, a-t-elle dit, tu as besoin de quelque chose ? » Et moi : « Oui, j’ai besoin de te dire que je suis heureuse. » Alors elle m’a embrassée et nous avons pleuré ensemble. Sylvie est émue et me dit qu’elle entend Pierre près d’elle comme s’il l’invitait à le rejoindre.
— Je pense que l’opération de by-pass ne me servirait vraiment à rien.
Sylvie est fatiguée. Elle a mangé quelque chose et souhaite retourner au lit. Il n’y a que deux pas entre le fauteuil et le lit mais pour ce bref parcours elle a besoin de tout mon soutien. Je l’accompagne et l’aide à s’asseoir sur le lit, puis je la fais pivoter en lui soulevant les jambes. Je lui installe les coussins et la couverture. Elle me regarde avec ses beaux yeux bleus qui semblent maintenant voilés de larmes. Elle ébauche un sourire, puis sa tête se penche, s’abandonne sur le côté gauche. Elle ne respire plus. Je lui dis :
— Sylvie, tu es belle.
Ensuite je sonne, et Denise accourt. Elle sait que Sylvie est une patiente NTBR10, c’est-à-dire à ne pas réanimer. Elle me murmure:
— Elle est morte en paix.
Denise referme le paravent autour du lit avant qu’Oda ne se rende compte de ce qui s’est passé. Je ferme les yeux de Sylvie et je reste recueilli à son chevet. Denise appelle la chef de salle qui décide de transporter le lit de Sylvie dans une chambre inoccupée.
La perception que Sylvie a eue d’être en contact avec Pierre avant sa mort me rappelle la mort de ma mère. Mes parents ont vécu jusqu’à un âge avancé, soignés chez eux par ma sœur Piera et grâce à l’assistance de soins à domicile que nous avions organisée pour le jour et pour la nuit, avec l’aide d’Edgar, un infirmier équatorien qui les accompagna avec compétence et affection. Mon père, Mario, mourut en paix avec lui-même et avec Dieu à l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans, après soixanteneuf ans de mariage. Ma mère, Anita, qui avait alors quatre-vingt-douze ans, ne put se faire à l’idée d’être restée seule et se réfugia dans l’illusion que son mari avait recommencé à travailler et était momentanément absent. Un gériatre avisé qui la soignait nous expliqua que notre maman se réfugiait dans cette fiction insensée pour se protéger d’une réalité qui lui était intolérable et nous suggéra de la conforter dans sa chimère.
Notre maman mourut de chagrin quelques mois après mon père : la veille de sa mort, en ma présence et celle de ma fille Cecilia, elle eut la vision de son mari qui l’appelait à lui. Elle s’anima sur son lit et cria affectueusement « Mario ! » en tendant les bras en avant vers un coin de la pièce. Le lendemain, sans plus avoir parlé, elle s’éteignit sereinement dans les bras de ma sœur Piera.
Revenu à moi après l’évocation émue de la mort de ma mère, je m’assieds à côté du lit d’Oda, qui se rend maintenant compte qu’elle est seule dans la chambre. C’est la première fois que je reste longtemps près d’elle. Je vois une femme élégante et menue, très maigre, marquée par la souffrance. Sur sa chemise de nuit brodée, elle porte un beau châle en laine au crochet. Il doit y avoir quelqu’un qui se soucie et prend soin d’elle. Après un long silence dont je ne peux évaluer la durée, pris comme je suis par l’émotion, elle me dit :
— Ils l’ont emmenée, elle s’est peut-être sentie mal ou bien c’est pour la dialyse.
Je décide de ne pas répondre tout de suite et je reste en silence à son chevet. À un moment elle se tourne vers moi pour me confier :
— Je sais où elle est allée, je ne la reverrai plus. Je pensais que mon tour viendrait avant, je le lui avais même dit. Moi aussi j’aimerais mourir ainsi, sereinement. Peut-être que si Antoine donnait signe de vie…
Je sais qu’Antoine est le fils d’Oda, mais nous ne l’avons jamais vu à l’hôpital. Je demande à Oda :
— Savez-vous où peut bien être votre fils ? Voulez-vous que je me mette en contact avec lui ?