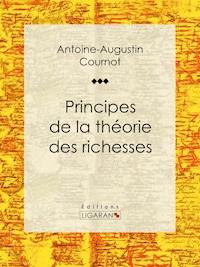
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Extrait : "– La racine tudesque rik ou reich, qui a passé dans toutes les langues romanes comme un signe de la conquête, exprimant vaguement une idée de supériorité, de force, de puissance. Los ricos hombres se dit encore en espagnol des nobles de distinction, des grands seigneurs ; et telle est l'acceptation des mots riches hommes dans le français de Jonville. Notre idée moderne de la richesse ne pouvait être conçue par les hommes de race germanique, ni à l'époque de..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335043013
©Ligaran 2015
AU LECTEUR
J’approchais déjà de la quarantaine et je n’avais encore fait paraître que des morceaux détachés, je ne m’étais essayé que dans le métier de critique, d’éditeur ou de traducteur, lorsque j’ai décidément abordé le métier d’auteur en publiant en 1838 un mince volume intitulé : Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. Malgré le mauvais succès de quelques devanciers qui avaient visiblement fait fausse route, je m’étais figuré qu’il devait y avoir de l’avantage à appliquer les signes mathématiques à l’expression de rapports et d’idées qui sont certainement du ressort des mathématiques : et je comptais encore sur un nombre honnête de lecteurs, dans un siècle où l’on étudie surtout les mathématiques pour être ingénieur, et où l’on recherche l’état d’ingénieur en vue surtout de se faire admettre sur un bon pied dans les grandes entreprises qui donnent la richesse. Je m’étais trompé. Quand on veut aller contre les habitudes prises, ou l’on fait une révolution (ce qui heureusement est fort rare), ou l’on n’attire point l’attention, et c’est ce qui m’est arrivé. On a vu paraître ; depuis 1838, des théories marquées au coin de la nouveauté et de l’originalité, comme celles de M. Stuart Mill, de Frédéric List, de Frédéric Bastiat ; il y a eu de grandes révolutions tentées ou effectuées dans le monde économique et des discussions bien vives à propos de ces révolutions, sans que les hommes habiles qui les ont faites, préconisées ou combattues, aient paru se douter que j’avais tâché d’appliquer aux questions intéressantes de l’économie sociale ma logique et mon algèbre, avant de m’en servir (non sans quelque succès, je crois) pour débrouiller d’autres questions plus délicates encore, et depuis plus longtemps débattues. Je voudrais voir aujourd’hui si j’ai péché par le fond des idées ou seulement par la forme : et à cette fin j’ai repris mon travail de 1838 en le corrigeant, en le développant là où les développements manquaient, en le complétant sur les points auxquels je m’étais abstenu de toucher, et surtout en le dépouillant absolument de l’attirail d’algèbre qui effarouche tant en ces matières. Non seulement j’ai repris toutes les pages de mon premier ouvrage, qui pouvaient cadrer avec mon nouveau plan, mais je ne me suis fait nul scrupule d’en transcrire quelques autres que mon plan réclamait, et qui ont déjà paru dans mon Traité de l’enchaînement des idées fondamentales, où les idées fondamentales de la science économique ont dû figurer à leur rang.
Puisque j’ai mis vingt-cinq ans à interjeter appel de la première sentence, il va sans dire que je ne compte pas, quoi qu’il arrive, user d’une autre voie de recours. Si je perds une seconde fois mon procès, il ne me restera que la consolation qui n’abandonne guère les auteurs disgraciés : celle de penser que l’arrêt qui les condamne sera un jour cassé dans l’intérêt de la loi, c’est-à-dire de la vérité.
Au reste, j’ai voulu que l’étiquette ne pût tromper personne, et que le titre du présent ouvrage indiquât nettement qu’il s’agit toujours de principes et de théorie. La théorie ne doit pas être confondue avec les systèmes, quoique nécessairement, dans l’enfance des sciences, l’esprit de système se charge d’ébaucher les théories. J’ajouterai que la théorie doit toujours avoir sa part, si petite qu’on veuille la lui faire, et qu’il doit être permis à un vétéran du corps enseignant, plus qu’à tout autre, d’envisager exclusivement du point de vue de la théorie un sujet d’intérêt général, qui a tant de faces diverses.
À chacun sa tâche. J’ai cru que la mienne était de soumettre à une critique nouvelle, non des faits, mais des idées, en rapprochant dans ce but des idées que la marche du travail scientifique tend trop à isoler, comme on rapproche dans un herbier, pour les mieux connaître, des plantes que la Nature a fait naître à de grandes distances. C’est un genre de spécialité comme un autre, et qui a aussi son utilité. Dans le cas présent, j’ai donc dû m’attacher de préférence à bien caractériser la nature de cette science à laquelle on donne communément le nom d’économie politique (et qu’Aristote avait bien mieux désignée par le mot de chrématistique, dont notre titre n’est que la traduction française), à montrer ses affinités avec d’autres sciences, sa place dans le cadre scientifique, les idées sur lesquelles elle se fonde, les procédés qu’elle emploie, la valeur des résultats auxquels elle peut atteindre, la part qu’elle laisse nécessairement à l’empirisme et aux entraînements de l’opinion. J’espère que ceux qui auront pris la peine de me lire attentivement comprendront mieux tout ce qui nous manque pour donner la solution vraiment scientifique d’une foule de questions que la polémique quotidienne tranche hardiment, et sur lesquelles il faut bien que la pratique gouvernementale prenne un parti.
Toutefois, je n’ai pas entendu faire seulement une œuvre d’analyse et de critique : il y a aussi dans mon travail une partie dogmatique, un essai de synthèse nouvelle, une méthode de calcul substituée à d’autres que je regarde comme inexactes, ou dont je crois même avoir démontré l’inexactitude. J’ai fait tous mes efforts pour être à la fois clair et succinct, pour conserver la rigueur de l’esprit géométrique sans employer l’appareil de démonstration des géomètres : mais les calculs sont toujours arides, les raisonnements sont parfois subtils, les causes d’erreur sont nombreuses ; j’ai donc bien des motifs de réclamer l’indulgence et la patiente attention du lecteur.
Paris, mai 1863.
N.B. Les chiffres entre parenthèses indiquent les nos du texte auxquels on renvoie.
1. – La racine tudesque rik ou reich, qui a passé dans toutes les langues romanes comme un signe de la conquête, exprimait vaguement une idée de supériorité, de force, de puissance. Los ricôs hombres se dit encore en espagnol des nobles de distinction, des grands seigneurs ; et telle est l’acception des mots riches hommes dans le français de Joinville. Notre idée moderne de la richesse ne pouvait être conçue par les hommes de race germanique, ni à l’époque de leur invasion dans le monde romain, ni même aux temps bien postérieurs où la féodalité subsistait dans sa vigueur. Les idées analogues qu’avait déjà suscitées la civilisation romaine, quand le poète disait :
Dives agris, dives positis in fœnore nummis,
disparurent avec cette civilisation ; et comme la langue se moule sur les idées, les mots dives, divitiœ, opes disparurent aussi de la langue des vaincus, tandis que le mot pauper y resta. Si, dans notre français moderne, le mot opulence rappelle une de ces racines oubliées, il n’appartient pas à la langue populaire, et il n’a été mis que tardivement en circulation par les lettrés, avec beaucoup d’autres.
Les distinctions de maîtres, de serviteurs et d’esclaves, le pouvoir, la propriété, les droits et les privilèges, l’abondance et l’indigence, tout cela se retrouve au sein des peuplades les plus voisines de ce que nous nommons l’état sauvage, et semble dériver presque immédiatement des lois naturelles qui président à l’agrégation des individus et des familles… On ne conçoit pas non plus que des hommes puissent vivre quelque temps rapprochés les uns des autres sans pratiquer l’échange des choses et des services : do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias. Toutefois il y a loin de cet acte naturel et pour ainsi dire instinctif à l’idée abstraite d’une valeur d’échange : idée qui implique que les objets évalués sont dans le commerce, et qu’en les possédant on possède virtuellement toute autre chose de valeur égale, contre laquelle il plaira de les échanger ! Or, les choses auxquelles l’état des relations commerciales et les institutions civiles permettent d’attribuer une telle valeur d’échange sont celles que, dans le style moderne, on appelle des richesses ; et mieux on précisera cette idée, plus la théorie comportera d’exactitude, plus elle méritera le nom de science : car les conditions de la construction scientifique se trouvent dans la généralité et la précision des idées.
2. – À la rigueur, de toutes les choses que nous apprécions ou auxquelles nous attribuons une valeur d’échange, il n’y en a point que nous puissions à notre gré, et aussitôt qu’il nous plaît, échanger contre toute autre chose réputée d’égale valeur. Dans Pacte de l’échange, comme dans la transmission de la force vive par les machines, il y a des frottements à vaincre, des déchets à subir, des limites que l’on ne doit pas franchir. Le propriétaire d’une grande forêt n’est riche qu’à condition d’aménager ses coupes avec prudence et de ne pas encombrer le marché de ses bois ; le possesseur d’une précieuse galerie de tableaux aura souvent bien de la peine à trouver un acheteur ou des acheteurs : tandis que, dans le voisinage d’une ville, la conversion d’un sac de blé en argent n’exigera que le temps de le porter à la halle, et que, sur les grandes places de commerce, on trouvera tous les jours à négocier une pacotille de cafés à la Bourse.
Mais, de même qu’un habile mécanicien se rapproche des conditions du calcul théorique en atténuant les effets du frottement par le poli des surfaces et la précision des engrenages, de même l’extension du commerce et le perfectionnement des procédés commerciaux tendent à rapprocher de plus en plus l’état réel des choses de cet ordre de conceptions dont la rigueur abstraite est un des postulats de la théorie. En fait de négoce, tout devient de plus en plus susceptible d’évaluation et par conséquent de mesure. Les démarches pour parvenir à l’échange se résolvent en frais de courtage, les délais en frais d’escompte, les chances de perte en frais d’assurance, et ainsi de suite. Les progrès de l’esprit d’association et des institutions qui s’y rattachent, le nivellement des conditions, les modifications introduites dans les institutions politiques et civiles, tout concourt à cette facilité d’échange ou à cette mobilité commerciale qui permet d’appliquer, sans trop de mécompte, aux réalités de la vie sociale, la théorie fondée sur le type idéal d’une mobilité parfaite.
Lorsque les nations cheminent dans cette voie, on dit qu’elles font des progrès dans le système commercial ou mercantile, expressions équivalentes d’après l’étymologie, mais dont l’une se prend en bonne, l’autre en mauvaise part, ainsi qu’il arrive d’ordinaire, selon la remarque de Bentham, pour la désignation de ce qui entraîne avec soi des avantages et des inconvénients moraux. Il ne s’agit pas de disputer sur ces avantages ni sur ces inconvénients : car notre tâche est de constater, non de glorifier ou de maudire les lois irrésistibles qui gouvernent dans leurs développements les sociétés humaines. Tout ce que l’homme peut mesurer, calculer, systématiser, finit par devenir l’objet d’une mesure, d’un calcul, d’un système. Partout où des rapports précis peuvent se substituer à des rapports vagues et indéterminés, la substitution s’opère finalement : ainsi s’organisent les sciences et toutes les institutions sociales.
3. – De même encore que l’art de fabriquer le verre a favorisé beaucoup l’esprit de découverte en astronomie et en physique, sans être foncièrement le principe ni la condition absolument indispensable des plus importantes découvertes, ainsi l’usage des métaux précieux et l’invention des espèces monnayées ont singulièrement contribué à faciliter l’échange, à fixer la valeur d’échange, sans être pour cela absolument nécessaires. La preuve en est qu’aujourd’hui même, au cœur de l’Europe, les habitants d’un grand empire savent très bien évaluer leurs revenus et leurs dépenses, trafiquer, rendre des comptes, toucher des fermages, payer leurs impôts, pratiquer avec succès toutes les branches du négoce et de l’industrie, sans d’autres instruments d’échange que des morceaux de papier. Cela n’apporte même aucun obstacle sérieux au commerce de l’Autriche avec les autres États où circulent des monnaies d’or et d’argent ; et les relations commerciales de l’Autriche avec la France et l’Angleterre ne cesseraient pas si la France et l’Angleterre avaient leurs francs et leurs livres sterling de convention, comme l’Autriche a ses florins de convention. Chaque nation n’en exprimerait pas moins, avec des dénominations diverses et des chiffres différents, le prix ou la valeur vénale des choses, qui serait, pour chaque instant et dans chaque pays, la juste mesure de leur valeur d’échange ou de leur valeur commerciale.
À la vérité, quoique les métaux précieux soient sujets, comme tout autre objet de commerce, à éprouver des changements dans leur valeur commerciale (ce qui sera spécialement examiné dans le second livre du présent ouvrage), la faiblesse ou la lenteur de ces changements font qu’on les peut négliger dans les circonstances ordinaires. La monnaie a joué ainsi un grand rôle dans le système économique des nations, sans qu’il faille pour cela regarder l’organisation commerciale comme dépendant essentiellement de l’emploi de la monnaie. Tous les moyens qui tendent à faciliter l’échange, à fixer la valeur d’échange, lui sont bons ; et l’on a lieu de croire que, dans les progrès ultérieurs de cette organisation, le rôle de la monnaie métallique diminuera graduellement d’importance, jusqu’à réaliser, non dans un sens littéral et grossier qui nous reporterait vers la phrase embryonnaire des sociétés, mais indirectement et par la vertu des institutions de commerce, cette utopie où toutes les choses appréciables s’échangeraient entre elles, comme toutes s’échangent contre l’or et l’or contre toutes.
4. – Le phénomène de la richesse eût été inconnu dans l’Éden : mais, aussi l’homme de l’Éden, exempt de travail et de peines, heureux de son innocence et, si l’on veut, de son ignorance, n’est point ce pionnier intrépide, ce martyr de la science et de la civilisation qui arrose de ses sueurs et parfois de son sang la voie douloureuse du progrès. L’homme que nous connaissons, celui dont nous nous occupons, est né bien moins pour jouir que pour agir. La richesse doit être considérée, pour les individus et surtout pour les peuples, bien moins comme un moyen de jouissance que comme un instrument de puissance et d’action. La mobilisation, la transformation des valeurs par suite des perfectionnements du commerce et de l’industrie, permettent à la volonté individuelle et à la volonté collective ou nationale de diversifier les ressources, de varier les plans, de concentrer les efforts, d’en mesurer la portée, d’en poursuivre indéfiniment les résultats : c’est un accroissement de puissance dont on peut user et mésuser, mais qu’il faut qualifier de progrès, à moins de renverser toutes les idées que nous pouvons nous faire du progrès.
Quoi de plus incertain, de plus vague que notre appréciation des jouissances et des privations ? Comment comparer ce qu’on appellera, si l’on veut, le bonheur du pâtre des Alpes avec celui du fainéant lazzarone ou de l’ouvrier de Manchester ; l’aumône des couvents à la taxe des pauvres ; la servitude de la glèbe à la servitude de l’atelier ; les jouissances d’un chef de clan entouré de sa clientèle, ou d’un noble normand dans son manoir féodal, aux jouissances de leurs arrière-neveux dans un hôtel de Londres ou sur les grands chemins de l’Europe ? Mais, si vous demandez lequel des deux pèse plus dans le monde, débat de plus graves intérêts, traite de plus grandes affaires, du membre de la Chambre des Lords ou du baron de Jean-sans-Terre, la réponse ne se fera pas attendre. Je conviens que tel conducteur de chameaux a pu, dans son temps, agir sur les destinées du monde plus énergiquement encore qu’un lord d’Angleterre ; aussi ne prétend-on pas dire que la richesse soit la seule ni même la plus énergique des puissances dont l’homme dispose ; il suffit qu’elle y tienne un rang considérable et qu’elle se distingue entre toutes par la propriété qu’elle a de s’accroître aux époques où les autres s’affaiblissent. Tant que la poursuite de la richesse aura pour but principal l’exercice des forces acquises et l’acquisition de forces nouvelles, la dignité de la nature humaine sera sauve : elle ne se trouverait gravement compromise que le jour où l’on ne verrait plus dans la richesse que le moyen d’acheter des jouissances.
5. – Outre l’Éden de l’inspiration ou du mythe, dont l’image religieuse ou poétique plane sur le berceau de l’humanité, il y a l’Éden des millénaires et des utopistes de toutes sectes, présenté comme le terme vers lequel tend l’humanité dans son laborieux pèlerinage, Éden d’où le travail ne peut être exclu, mais où ne se retrouveraient plus les institutions sociales que nous sommes habitués à regarder comme les stimulants nécessaires et les principes régulateurs du travail : la propriété foncière, l’appropriation des instruments de travail, le patrimoine, l’héritage. De même que le pasteur des temps primitifs partage avec ses serviteurs, ses esclaves, ses clients, ses hôtes, la viande, le lait, la laine que ses troupeaux lui donnent en abondance, sans être riche selon nos idées modernes ; de même, dans cet ordre de choses dont on nous berce ou dont on nous menace, il y aurait des ouvriers, des contremaîtres, des chefs d’ateliers, des directeurs de travaux, des économes chargés de la distribution des produits ; il y aurait ou il pourrait y avoir de l’abondance, mais il n’y aurait plus de richesse. Comment répartir équitablement les tâches, si l’autorité régulatrice n’appréciait pas elle-même les valeurs comparatives de chaque service ? Comment répartir équitablement les produits, si cette même autorité n’appréciait pas les valeurs comparatives de chaque produit ? Il faudrait donc que l’échange se fit aussi à bureau ouvert, par l’intervention de l’autorité. Voilà ce qui paraît exclure absolument l’idée du libre-échange, du libre louage, de la libre concurrence, tout ce que nous connaissons et étudions sous le nom de phénomènes économiques dans la phase actuelle des sociétés. Mettons qu’il y eût place dans ce futur ordre de choses pour une science de l’agriculture, pour une science des industries manufacturières, pour une science plus générale de l’organisation du travail et de la distribution des produits : il n’y aurait certainement plus lieu d’écrire sur la théorie des richesses et tous les livres qui en traitent seraient des livres passés de mode, comme un traité de jurisprudence féodale ou coutumière. L’inconvénient serait léger, en comparaison de tous ceux qu’on pourrait craindre, par suite d’une révolution si radicale ou d’une transformation si complète.
6. – Dès à présent, une foule de choses éminemment utiles à l’homme n’ont point de valeur vénale, ne figurent point parmi les richesses, parce qu’elles lui ont été données par la Nature avec tant d’abondance ou dans de telles conditions qu’elles ne sont pas susceptibles d’appropriation, d’évaluation, d’échange, de circulation commerciale. En thèse générale, il faut en remercier la Nature. Apparemment l’on ne se plaindra point de ce que l’air respirable ne se paye pas comme le gaz pour l’éclairage, et l’on n’enviera pas pour l’habitant des campagnes le sort de l’habitant des grandes villes où l’eau a une valeur vénale et se débite au profit des Caisses municipales ou des Compagnies. Ce n’est pas un mal pour les défricheurs d’un nouveau continent, que d’avoir des terres qui ne leur coûtent que la peine de les mettre en valeur. La constitution de la propriété et la valeur vénale des choses, principes si utiles quand ils agissent comme stimulants de la production (ce qui est leur fonction habituelle et normale), deviennent nuisibles lorsqu’ils la restreignent ; quoique, même alors, ils puissent conserver une utilité d’un genre plus élevé, comme garanties de l’ordre et de la paix publique, en attendant qu’on en ait trouvé de meilleures. Une caravane qui a plus d’eau que n’en exigent rigoureusement ses besoins actuels rencontre une autre caravane dans le désert et lui vend des outres d’eau. Il vaudrait mieux que la Nature se fût montrée moins avare d’eau dans le désert et que l’eau n’y pût être matière à trafic ; mais, il vaut mieux en trafiquer que de s’égorger pour savoir à qui resteront les outres d’eau. Nous ne regrettons pas le temps où un seigneur obligeait les paysans de moudre à son moulin, de cuire à son four, et aurait pu de même les obliger de prendre à sa source, moyennant finance, l’eau dont ils avaient besoin pour abreuver leurs bestiaux et pour irriguer leurs prés. Cependant, si les débats pour les prises d’eau amenaient des rixes, si les eaux de la source étaient gaspillées faute de l’intervention vigilante d’un propriétaire, il vaudrait encore mieux que l’eau se payât et subir même les exactions du maître de la source.
À côté des choses que leur abondance indéfinie ou l’impossibilité de se les approprier et de les mettre en circulation excluent absolument de la catégorie des richesses, soit que l’homme en fasse usage sous leur forme naturelle, soit qu’il les emploie à en produire d’autres qui comportent une valeur d’échange, il y a des choses dont l’abondance n’est point indéfinie, qui comportent un droit de propriété, que l’on pourrait mettre dans le commerce, et qui pourtant ne circulent point dans le commerce, n’ont point de valeur d’échange, tant que l’industrie de l’homme ne leur a pas trouvé un emploi qui puisse les faire passer dans la catégorie des richesses. Ainsi, cette espèce d’argile distinguée par sa finesse et sa blancheur éclatante, à laquelle nous conservons son nom chinois de kaolin, n’avait pas même de nom chez nous où elle n’est point rare ; ce qui indique bien qu’elle ne possédait aucune valeur vénale, avant que nous n’eussions appris des Chinois l’art d’en faire de la porcelaine. Le guano restait sans valeur avant que l’idée ne fût venue de le transporter à quelques mille lieues de distance, pour l’utiliser comme engrais.
7. – Entre les cas extrêmes de création ou d’anéantissement de valeur, qui font passer une chose dans la catégorie des richesses ou qui l’en retirent, il y a des intermédiaires, suivant que la chose, sans cesser d’être, dans le commerce et de figurer parmi les richesses, hausse ou baisse de valeur. Or, le phénomène de la richesse se produit par le concours de deux éléments : la valeur vénale des choses appréciées et leur abondance. En termes plus précis, deux nombres figurent l’un à côté de l’autre dans tout inventaire : celui qui désigne le prix de la chose ou de l’unité de la chose, et celui qui désigne la quotité ou la quantité. Le produit de l’un de ces nombres par l’autre mesure la richesse accusée par l’inventaire ; si l’un des facteurs varie et que l’autre varie en raison inverse, de manière que le produit ne change pas, la richesse accusée sera la même, soit dans un inventaire particulier, soit dans le grand inventaire qu’un statisticien dresserait, en totalisant les inventaires particuliers. Mais le résultat sera bien différent ; suivant qu’on se placera au point de vue de l’intérêt particulier ou au point de vue de l’intérêt général. Car, tandis qu’il est effectivement indifférent à un marchand, pour le mouvement de ses affaires, de disposer de 1000 hectolitres de blé au cours de 18 francs l’hectolitre, ou de 800 hectolitres au cours de 30 francs, il est certain que, pour l’usage qu’on fait du blé, c’est-à-dire pour la nourriture de l’homme, 800 hectolitres ne valent en réalité que la moitié de ce que valent 1000 hectolitres. Admettons que, par une cause quelconque, tous les approvisionnements en blé aient subi la même réduction que celui de ce marchand, et que telle soit la cause de la hausse de prix, on sera fondé à dire que le pays a éprouvé, sur sa richesse en blé, une diminution réelle de moitié, quoiqu’il n’y ait aucune diminution nominale dans la richesse d’inventaire, telle qu’elle serait accusée par chaque inventaire particulier, ou par l’inventaire général qui est la récapitulation des inventaires particuliers. L’étude de cette distinction importante, qu’il nous suffit ici d’avoir indiquée, sera l’un des principaux objets du livre III du présent ouvrage.
Aux approches d’une récolte, et lorsque les vicissitudes atmosphériques tiennent tout le monde en suspens sur l’abondance ou la qualité des produits qu’on en attend, il y a souvent d’énormes variations dans les cours, auxquelles correspondent de bien grandes différences dans les résultats d’inventaires. Cependant ces perturbations d’inventaires, qui ruinent ou qui enrichissent plus d’un spéculateur, n’ont que peu ou point d’influence sur les résultats du travail combiné de la Nature et de l’homme. Il faudrait que les conditions physiques de la production changeassent d’une manière durable, pour que la société trouvât, dans le changement du prix qui devrait s’accommoder à ces conditions nouvelles, un profit ou un dommage réel.
La spéculation sur de telles oscillations de valeurs est elle-même un bien ou un mal, suivant qu’elle tend à en restreindre ou à en accroître l’amplitude. Le spéculateur qui achète la denrée à bon marché, pour la revendre dans un temps de hausse, que son tact et son expérience lui font prévoir, agit de manière à modérer d’abord la baisse, puis la hausse de la denrée, et la modération en tout est une bonne chose. Que si la soif du gain tourne les têtes et fait que les gens se précipitent étourdiment dans les spéculations, des effets contraires se produiront : le spéculateur nuira à la société en se faisant tort à lui-même. Enfin, si la spéculation ne porte pas sur des transactions réelles, mais sur des payements de différences, elle devient un jeu, un pari : elle a toutes les funestes suites du jeu pour l’individu qui s’y livre, comme aussi les suites funestes pour la société, si elle devient contagieuse.
En temps de révolution ou de guerre, les fermes, les maisons, les fonds publics peuvent être d’un jour à l’autre dépréciés de moitié. Ce mal est grave, sans doute ; toutefois il ne saurait être comparé au dommage qui résulterait de la submersion d’une moitié du territoire cultivé, de l’incendie de la moitié des maisons, d’une banqueroute de la moitié de la rente, Autre chose est d’avoir une jambe emportée ou paralysée, autre chose d’avoir un rhumatisme à la jambe. Le mal qui porte sur un accident ou une qualité de la chose, telle que la valeur d’échange, quoique très réel en ce sens qu’il peut être très douloureux, n’a point le degré de réalité du mal qui affecte la substance même de la chose. Si la perturbation n’est pas d’assez longue durée pour influer très sensiblement sur les forces productrices, les terres continueront d’être cultivées, les maisons d’être habitées, les rentes d’être payées comme par le passé : et le jour où les valeurs reprendront leurs taux habituels, les traces du dommage public seront effacées, quoique bien des fortunes privées aient pu s’engloutir dans cette crise passagère.
8. – Ainsi que nous le remarquions en commençant, l’homme a l’idée des biens et de la propriété longtemps avant d’avoir l’idée précise de la richesse. C’est en partie pour cela que la science des jurisconsultes s’est développée bien avant celle des économistes dont les recherches portent sur les lois qui président à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. On sera bien frappé de ce retard d’une science sur l’autre, si l’on relit les livres XXI et XXII de l’Esprit des lois, et que l’on compare Montesquieu économiste à Montesquieu jurisconsulte et publiciste. Lorsque les peuples sortent de la barbarie, sinon de la sauvagerie, et que leur droit s’organise, on ne connaît guère d’abord que le droit des personnes, les distinctions de maîtres, de patrons, de clients, de serviteurs et d’esclaves ; et pendant longtemps le droit personnel est celui qui tient la plus grande place dans les coutumes ou dans la jurisprudence encore grossière des peuples arrivés à cet état de culture. Plus tard, au contraire, le droit réel acquiert une importance prépondérante dans la pratique et dans la doctrine. Les biens dont le jurisconsulte s’occupe sont physiquement la même chose que les richesses, objet des spéculations de l’économiste ; mais, tandis que le jurisconsulte subordonne tout à l’idée du droit de propriété et le définit volontiers le droit d’user et d’abuser, de ménager et de détruire (utendi et abutendi), même pour la satisfaction d’un caprice, l’économiste est porté à ne voir dans la propriété qu’une sorte de fonction sociale, instituée dans l’intérêt commun, pour la conservation, l’aménagement et l’amélioration des choses qui, sans cette institution salutaire, se conserveraient, s’aménageraient moins bien et n’auraient pas la même vertu productive (6).
9 – De là une autre raison pour que le développement scientifique du droit ait précédé de beaucoup celui des théories économiques : car la jurisprudence touche au vif les intérêts privés, tandis que la science économique s’attaque surtout aux sociétés prises en corps, et dès lors n’acquiert pour chacun de nous, simples particuliers, qu’un intérêt éloigné et indirect. Voyons en effet à quelles conditions se réalisent ou tendent à se réaliser l’idée abstraite de la richesse et toutes les conséquences qui s’en déduisent. Il faut qu’à tous égards on puisse appliquer ce que les géomètres ont nommé la loi des grands nombres. Il faut le concours d’un grand nombre de vendeurs et d’acheteurs pour qu’il s’établisse un prix courant, ou pour que chaque objet acquière dans le commerce une valeur déterminée. Voulez-vous estimer l’influence qu’exercent sur le prix d’une denrée l’assiette ou la suppression d’une taxe, l’élévation ou la baisse des frais de production, l’ouverture ou la fermeture d’un débouché ? Il est clair qu’on ne peut tenir compte des écarts de la fantaisie individuelle, ni de l’exagération des espérances et des craintes selon l’humeur de chacun, et qu’il faut embrasser un temps et un espace assez considérables pour que tous les effets de ces causes irrégulières et accidentelles se soient compensés, de sorte qu’il ne reste plus dans les valeurs moyennes que l’empreinte des causes régulières et des lois essentielles. Ainsi, l’on n’a pu aborder de telles spéculations, sans se placer à un point de vue qui domine incessamment la sphère des intérêts privés.
D’un autre côté, le jurisconsulte, dans l’ordre d’abstractions qui lui est familier, ne perd jamais de vue la personnalité humaine et les actes de la volonté individuelle : ce qui fait que, tout en traitant de la propriété et des biens qui sont matériellement la même chose que la richesse, le jurisconsulte imprime à sa doctrine le caractère d’une science morale, caractère que ne peut avoir la doctrine scientifique de la richesse, où l’on considère des agrégations, des foules, des masses, et non des personnes. Aussi est-on généralement porté à regarder la théorie des richesses comme une de ces sciences qu’on appelle matérialistes ; mais elle n’est pas plus matérialiste que l’arithmétique et la géométrie, dont elle se rapproche en tant qu’elle procède des idées du nombre et de la mesure. Sans être une science morale comme la jurisprudence, elle offre, au même degré, les caractères d’une doctrine abstraite. Enfin, de même que les mathématiques, elle admet, elle provoque, dans toutes les parties susceptibles d’une construction scientifique, le contrôle du raisonnement par l’expérience, tandis qu’il n’y a nul moyen d’appliquer ce contrôle à la déduction juridique le plus généralement acceptée. On peut bien constater par l’expérience que les effets d’une loi sont salutaires, mais non pas qu’un jurisconsulte a raisonné juste.
10. – Pour mieux faire sentir ces contrastes, prenons une question (non de droit privé, mais de droit public), la plus grave assurément de toutes celles qui agitent le monde au moment où nous écrivons, celle de l’abolition ou du maintien de l’esclavage. Voilà une question juridique au premier chef, pour la solution de laquelle le jurisconsulte, le publiciste feront appel à la religion, à la morale, à la politique, à l’histoire du genre humain et même à l’histoire naturelle ; de sorte que, pour cette question au moins, la jurisprudence mérite le titre qu’elle s’arroge, celui de science des choses divines et humaines.
L’économiste envisage la question par des côtés différents. Sous le régime de l’esclavage, l’esclave est une chose vénale, évaluée, cotée à ce titre dans l’inventaire des richesses privées et publiques ; c’est une valeur qui s’évanouit, qui se trouve rayée de l’inventaire si l’esclavage est aboli : soit que l’on condamne les propriétaires d’esclaves à supporter la perte sans indemnité, soit que l’on répartisse la perte sur la société tout entière en indemnisant les propriétaires d’esclaves, soit qu’on l’atténue en imposant aux esclaves affranchis des redevances temporaires.
À cela d’autres économistes répondront que si l’abolition de l’esclavage fait actuellement disparaître de l’inventaire des richesses une valeur considérable, elle provoque un accroissement ultérieur de richesse ; parce que le travail des hommes libres est une cause de production plus énergique que le travail servile, et parce qu’il coûte moins cher, tout compte fait de l’intérêt et de l’amortissement du capital engagé. D’autres pourront répliquer que si le travail de l’ouvrier libre coûte moins cher, c’est apparemment que le sort de l’ouvrier libre n’est guère préférable à celui de l’esclave, ou qu’il est pire. Ils prétendront que les conditions du travail et du climat condamneraient à une prompte destruction les races qui ont l’instinct du travail libre, tandis que le joug de l’esclavage est indispensable pour tirer de l’oisiveté les hommes d’autres races. Et, pour vider toutes ces disputes, il faudra bien arguer des expériences faites, sauf à disputer encore sur les conditions de l’expérience.
Mais (ce qu’il importe de remarquer) toutes ces controverses économiques laisseront intacte la question juridique ; et même, dans ce cas particulier, c’est par une certaine appréciation du sens juridique de la question que l’opinion publique sera maîtrisée, et que telle solution prévaudra, selon les circonstances des temps et des lieux.
11. – Le nom même d’économistes, donné à ceux qui se consacrent à l’étude scientifique du phénomène de la richesse, indique assez que la théorie des richesses rentre dans la science de l’économie des sociétés humaines, ou de l’économie sociale dont l’objet est bien autrement vaste. Que de choses à considérer dans l’économie des sociétés humaines ! Est-ce qu’il n’y a pas une économie (souvent d’autant plus admirable qu’elle est le produit plus immédiat des instincts naturels) dans ces sociétés où l’organisation commerciale et par conséquent l’idée de la richesse sont encore à l’état rudimentaire ? Est-ce qu’il n’y aurait pas encore une économie dans le plan de ces sociétés rêvées ou pressenties par les utopistes de tous les siècles, et où le phénomène de la richesse, tel que nous le concevons, ne trouverait plus de place ? Supposerait-on que, pour avoir rigoureusement résolu (ce qui ne pourra se faire de longtemps) les problèmes épineux que présente la théorie des richesses, on aurait par cela même vidé toutes les questions auxquelles donne lieu l’économie des sociétés ? Quand la statistique aura justifié les prévisions de la théorie, en constatant que l’on a brûlé plus de houille, bu plus de bière, mangé plus de viande et filé plus de coton, s’ensuivra-t-il que le peuple est plus heureux, plus sage, plus instruit de ce qu’il lui importe de savoir ? Questions bien autrement importantes, que chacun résout à sa manière : ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait dans ces appréciations discordantes ni vérité ni erreur (nous n’avons garde d’être sceptique en ce sens, ni d’accepter les éloges et le blâme que ce prétendu scepticisme nous a déjà valus), mais ce qui veut dire seulement que nous manquons d’un critère formel pour dissiper forcément nos illusions et pour mettre la vérité à l’abri de toute contradiction sophistique.
Au contraire, s’agit-il de savoir comment, par suite de changements dans les conditions de la production ou dans les relations commerciales, les prix hausseront, baisseront, se nivelleront ; comment les profits ou les pertes se répartiront entre les propriétaires, les entrepreneurs, les ouvriers : chacun sentira que de telles questions sont purement scientifiques, autant que pourrait l’être un problème de mécanique ou de chimie ; qu’elles comportent une solution fondée sur l’application du calcul à certaines données de l’observation, quoique peut-être nous ne soyons pas actuellement en état de la trouver par un calcul direct ou par le seul raisonnement, sans le secours de l’expérience ; que cette solution très positive (de quelque manière que nous l’ayons trouvée) ne dépend pas de la manière d’entendre des questions d’un autre ordre, en religion, en politique, en philosophie, en morale ; et que réciproquement on doit accepter les solutions positives que le raisonnement ou l’expérience donnent, sans craindre que d’autres en puissent valablement tirer des conclusions contraires à des principes qui nous sont chers, en morale, en philosophie, en politique, en religion.
12. – Il sera bon de séparer ainsi, autant qu’on le pourra, ce qui admet une preuve positive, formelle, d’avec ce qui ne comporte qu’une application contestable. Certaines parties de la théorie des richesses, et par cela même certaines parties de la science de l’économie, sociale acquerront de la sorte une rigueur scientifique qui les recommanderait à la curiosité des philosophes, lors même que l’on ferait abstraction de toute utilité pratique. Que l’on regarde, avec les scolastiques du Moyen Âge, la philosophie comme la servante de la théologie ; que l’on regarde, avec les utilitaires de notre siècle, les sciences comme les servantes de l’industrie : toujours est-il que ces servantes ont des mérites et des attraits qui leur permettent de rivaliser à bien des égards avec leurs maîtresses.
Mais la théorie des richesses n’est pas avec l’économie sociale dans les rapports de servante à maîtresse ; elle est plutôt dans les rapports de fille à mère, et c’est une fille qui, tout en se mouvant et en se développant, ne peut jamais se détacher entièrement du sein maternel. Pour parler sans figure, les divers chapitres de la théorie des richesses, susceptibles de rédaction scientifique, ne peuvent se coordonner, s’unir, que par des considérations tirées de l’économie sociale, dans celles de ses parties qui sont incapables d’acquérir ou qui n’ont point encore acquis la forme scientifique ; et de là résulte pour la théorie de la richesse une constitution sui generis : elle reste à l’état fragmentaire si elle veut conserver sa rigueur et sa pureté scientifique ; elle perd en rigueur logique et laissé en quelque sorte la science flotter au gré des fantaisies de l’opinion, si l’on veut absolument en réunir les fragments en système, et accommoder ce système à tous les besoins de l’économie sociale. Nous reviendrons sur ces considérations importantes à la fin du présent ouvrage, lorsque nous pourrons mieux en faire apprécier le sens et la portée.
L’économie sociale embrasse tout à la fois la physiologie, l’hygiène et la pathologie du corps social. Prise dans son ensemble, elle a donc avec les sciences médicales autant de ressemblance que la théorie des richesses peut en avoir avec les sciences mathématiques (9). Il ne faut ni la décrier ni se méprendre sur la nature de sa constitution scientifique. Il n’appartient qu’à des esprits étroits de décrier la médecine parce qu’elle va de système en système, et qu’on n’a pas pu soumettre à des formules les phénomènes physiologiques aussi bien que les mouvements planétaires ; mais, d’un autre côté, il ne faut pas que la médecine prétende à devenir jamais une science constituée comme l’astronomie.
Or, pourquoi l’astronomie est-elle une science si voisine de la perfection mathématique, et pourquoi la médecine est-elle relativement si imparfaite ? Parce que celle-ci ne peut se passer de l’idée de force vitale, idée si obscure pour nous, tandis que l’astronomie n’emploie que les idées de forme, dont la clarté intuitive est le principe de la rigueur mathématique, ou que, si elle emploie aussi l’idée de force, c’est en la dépouillant de tout ce qu’elle a d’obscur, et en la ramenant, par une définition formelle, à n’être que l’expression d’une loi mathématique. De même, et par une analogie frappante, on peut dire que la théorie des richesses n’atteint à la précision scientifique que quand il est possible de dégager l’idée d’une loi mathématique, à travers les combinaisons innombrables auxquelles donne lieu le jeu des forces et des fonctions de la vie, dans toutes les parties du corps social. Il ne s’agit plus que de savoir dans quels cas et dans quelle mesure on peut se permettre un tel isolement, une telle abstraction, sans sortir des conditions de la réalité et sans rendre inapplicables les déductions de la théorie. C’est encore là un point sur lequel nous ne manquerons pas d’appeler l’attention du lecteur, chaque fois que l’occasion s’en présentera.
13. – Comme la politique a passionné les hommes bien avant que leur attention ne se portât d’une manière suivie sur le mécanisme de la société et sur les fonctions de la vie sociale dont les institutions politiques ne sont point le principal ressort, on a confondu le corps social avec le corps politique, l’économie sociale avec l’économie politique, et même affecté spécialement le nom d’économie politique à la branche de l’économie sociale qui devait arriver plutôt que d’autres à la forme scientifique, c’est-à-dire à la théorie des richesses. On reconnaît généralement ce que cet usage a d’incorrect, mais il a passé jusque dans le langage officiel, jusque dans l’énoncé de certaines prescriptions ou défenses légales ; et il serait présomptueux, peut-être ridicule, d’entreprendre aujourd’hui de le réformer.
Il y a toujours eu, il y aura toujours deux manières d’envisager les rapports des nations avec les pouvoirs politiques qui les gouvernent, du peuple avec l’État. Dans l’une, on ne tient compte de la population, de ses richesses, de ses forces productrices, de ses ressources de tout genre, que comme d’autant d’éléments de cette grande individualité qu’on appelle l’État, qui a sa vie, ses organes et ses intérêts propres, de richesse, de force, de gloire et de grandeur ; qui lutte ou qui contracte au dehors avec d’autres individualités du même ordre. Voilà l’idée essentiellement politique, celle qui a prévalu dans l’antiquité et jusque dans des temps très voisins de nous. Sous un autre aspect, plus en rapport avec les tendances de l’esprit moderne, les institutions politiques ne sont qu’un instrument de la prospérité publique ; les Gouvernements ne doivent avoir de force, de puissance, de richesse, que ce qu’il leur en faut pour remplir leur mission, qui est de protéger, d’encourager au besoin le déploiement de toutes les activités individuelles, et de favoriser dans la société les améliorations de tout genre. Or, une science telle que la théorie des richesses, qui n’a pris que dans des temps très récents la consistance d’un corps de doctrine, a dû naturellement s’imprégner de l’esprit moderne ; elle doit donc se rattacher à l’économie publique ou sociale plutôt qu’à l’économie politique, dans le vrai sens du mot. Autre chose est la prospérité de l’État et l’abondance de ses ressources, autre chose est la prospérité et la richesse du pays. Tous nos administrateurs savent bien que nous avons en France des communes pauvres dont la population est riche et des communes riches dans des pays pauvres. À la vérité, nos communes n’ont de force que celle que l’État leur prête, tandis que la force coactive dont l’État est pourvu le pousse naturellement à mettre sa propre richesse au niveau de la richesse de la société. Cependant, en thèse générale, il n’est pas impossible que les institutions ou les mœurs mettent obstacle à ses entreprises, et qu’un peuple riche se contente d’un Gouvernement à bon marché.
14. – On a dit que les institutions politiques, en influant sur le génie des peuples, influent puissamment sur les forces productrices de la richesse, dont il faut tenir compte bien plus encore que des richesses mêmes, livrées à une consommation, c’est-à-dire à une destruction continuelle, et qui s’épuisent bientôt, pour peu que les forces destinées à les régénérer tombent dans la langueur. Cela est vrai, quoiqu’il soit vrai aussi que le génie des peuples contribue, plus encore que les accidents de leur histoire, à former leurs institutions politiques. Personne donc ne contestera que l’économiste ne doive tenir compte des considérations de la politique en même temps que le politique devra tenir compte des résultats acquis à la science de l’économie sociale et notamment à la théorie des richesses. Ces mutuels emprunts, ces rapports réciproques ont lieu entre toutes les sciences, entre tous les arts, sans qu’il faille pour cela les confondre, ni déranger par des rapprochements forcés l’ordre des affinités naturelles.
Mais, dira-t-on encore, ce lien qui cimente les sociétés et qui en fait autant d’êtres collectifs, doués de leur vie propre ; ce lien à la faveur duquel peut s’établir un concert de mesures si favorable à l’énergique déploiement des forces productrices (vis unita fortior), n’est-il pas un lien politique ? Votre économie sociale a-t-elle la prétention d’embrasser le genre humain tout entier, d’être une économie cosmopolite ? Et, jusqu’à ce qu’elle puisse devenir telle, pourra-t-il y avoir autre chose qu’une économie politique, à l’usage de chaque nation particulière ?
Ces questions sont pressantes, et pour les bien résoudre, il y a plusieurs distinctions à faire.
1° Sans doute, les sociétés ne peuvent pas se passer d’un lien politique. À l’extérieur, elles ont besoin d’un Gouvernement qui les représente et qui dirige, quand il le faut, leurs forces agressives et défensives ; à l’intérieur, elles ont besoin d’une force politique qui assure le libre jeu de toutes les institutions et de toutes les forces sociales. Mais pourtant le Gouvernement, force politique par son origine, remplit aussi des fonctions purement sociales, que remplissent de la même manière, en se remplaçant les uns les autres, des Gouvernements dont l’origine et les principes politiques offrent le plus de différences : à peu près comme les monnaies qui remplissent la même fonction économique, de quelque symbole politique qu’elles portent l’empreinte. Or, la théorie et l’observation nous montrent que plus la civilisation fait de progrès, plus les Gouvernements sont obligés de se dépouiller de leur égoïsme politique, et de se considérer comme les serviteurs de la société, en attachant plus d’importance à la partie purement sociale de leur mission.
2° L’institution politique n’est pas le seul ni même le principal lien qui constitue l’unité des sociétés. La communauté d’origine, d’idiome, de mœurs, de religion, de coutumes juridiques, d’intérêts économiques, concourt, au moins autant que la politique, à la formation des nationalités. Elle tend souvent (de nos jours surtout) à séparer ce que la politique a réuni, à réunir ce qu’elle a séparé. La communauté des intérêts économiques tend notamment à former des confédérations économiques entre des populations que ta politique désunissait, et qui dès lors ne forment plus qu’une seule société, au sens économique. Il ne serait donc pas convenable de donner à la science économique le nom d’économie politique, parce qu’elle aurait à tenir compte des intérêts propres aux populations ainsi groupées.
3° Chaque peuple a ses coutumes et son droit national, en même temps qu’il obéit à des règles juridiques d’une application universelle : en ce sens donc il y a une jurisprudence cosmopolite et une jurisprudence locale ou nationale. De même pour la science de l’économie sociale, qui comprendra des chapitres d’une application générale, et d’autres exclusivement ou plus spécialement applicables aux peuples de tel tempérament, placés dans telles conditions déterminées. Ce n’est pas un motif pour se dispenser de faire figurer l’économie sociale, dans un tableau philosophique des connaissances humaines, comme on y fait figurer la jurisprudence. Ce n’est surtout pas une raison pour changer le nom d’économie sociale en celui d’économie politique : car, à ce compte, il faudrait aussi rattacher à la politique toutes les parties de la science du droit, même celles qui sont les plus étrangères à la politique.
En même temps cependant l’on doit reconnaître que l’influence des habitudes, et des idées nationales se fait sentir, aussi bien pour l’économie sociale que pour le droit, jusque dans la manière d’exposer les théories d’une application universelle. Il faudrait être bien fin connaisseur pour s’apercevoir, à la lecture d’un traité de géométrie ou de chimie, qu’il a été écrit par un Français ou par un Anglais, tandis que le cachet de la nationalité sera très apparent dans l’œuvre d’un jurisconsulte ou d’un économiste.
4° Il y a une branche du droit qu’on appelle le droit international, et qui a pour objet les rapports des nations entre elles, au point de vue juridique. Le droit international s’est beaucoup modifié avec les progrès de la civilisation générale, et des règles diverses y ont successivement prévalu, selon le degré de civilisation et de force des nations appelées à les faire prévaloir. Comme l’intérêt le plus général doit prévaloir à la longue, à mesure que les nations se rapprochent et ont plus de moyens de se concerter, le droit international a nécessairement une tendance cosmopolite. De même il y a une partie de la science de l’économie sociale dans laquelle on étudie les rapports des nations entre elles, au point de vue du commerce international et du concert des forces productrices de toutes les nations. Ce sera, si l’on veut, l’économie internationale qui aura aussi ses tendances cosmopolites, contrariées par les résistances des intérêts nationaux. Pour le moment, il ne s’agit pas encore de juger de ces tendances et de ces résistances : il faut seulement noter que les intérêts mis en jeu sont pour la plupart très distincts des intérêts politiques de sorte que la dénomination d’économie politique donnée à la science économique, ne se justifie pas, même à ce point de vue.
15. – Il est toujours instructif de voir comment un grand esprit, quand il trouve sur son chemin des questions étrangères à ses études habituelles, les tranche à sa façon, avec plus de risque de s’égarer, mais aussi avec plus d’indépendance et d’originalité. Dans son essai de classification encyclopédique, Ampère admet un groupe ou un embranchement (le dernier de tous), qu’il appelle l’embranchement des sciences politiques, et qui se ramifie comme tous les autres en quatre sciences du premier ordre ;
La Nomologie, – l’Art militaire, – l’Économie sociale, – la Politique.
Remplaçons le terme inusité de nomologie par celui de jurisprudence, avec d’autant plus de motifs que, dans l’ordre naturel du développement des idées au sein des sociétés humaines, l’idée du droit prime l’idée de la loi. Mettons aussi de côté l’art militaire, dont nous n’avons que faire ici s’il s’agit de l’art du général, qui brille sur les champs de bataille et qui rentre dans la politique, s’il s’agit de la science qui a pour objet de préparer, d’organiser, d’évaluer les forces militaires d’un État. La liste d’Ampère sera réduite à trois termes ;
La Jurisprudence, – l’Économie sociale, – la Politique ;
et elle se trouvera ainsi, nous le croyons, simplifiée et améliorée. Mais l’ordre n’y vaudra rien encore : car l’histoire nous montre clairement que l’économie sociale ne s’intercale pas entre la jurisprudence et la politique. Les peuples développent d’abord parallèlement leur droit civil et leurs institutions politiques, en fondant celles-ci sur l’idée du droit : après quoi, dans une autre phase et dans une phase tardive des sociétés humaines, l’idée d’une utilité sociale, d’une économie sociale apparaît et tend à se subordonner les institutions du droit civil et les institutions politiques. Pour exprimer ces rapports de dépendance mutuelle, cet ordre de parallélisme et de succession, nous écrirons la formule ainsi :
Jurisprudence, – Politique,
Économie sociale ;
et nous croirons avoir assorti, autant qu’il se peut, le signe graphique à l’idée qu’il s’agit de rendre.
16. – Reprenons, pour les détails, cette science de premier ordre que nous nommons avec Ampère l’économie sociale. Fidèle à son principe de division dichotomique (d’ailleurs fort artificiel, quoi qu’il en dise), Ampère la divise en deux sciences du second ordre, dont chacune se subdivise en deux sciences du troisième ordre, de manière à donner le tableau suivant :
La chrématologie (de χρήμα, richesse) n’est pas autre chose que la théorie des richesses. Le mot paraît bien fait ; mais quand il s’agit de la facture d’un mot grec, l’autorité d’Ampère doit le céder à celle d’Aristote ; et puisqu’Aristote a pris la peine de forger lui-même le mot de chrématistique (χρηματίστοίή), il est convenable de l’adopter si l’on veut éviter les embarras d’une dénomination complexe. En même temps, il faut convenir que la statistique, dont l’unique fonction n’est pas, à beaucoup près, d’inventorier des richesses, et qui relève les naissances, les mariages, les morts, les hôpitaux, les maisons d’école, les nombres de conscrits, de soldats, d’accusés, de condamnés, etc., ne saurait être considérée comme une dépendance, ni même comme une annexe de la théorie des richesses ou de la chrématistique. D’un autre la côté, dianémétique (de διανέμησιςpartage ou distribution) a apparemment pour but d’étudier les lois de la distribution des richesses, dont la chrématogénie étudie la génération : ce sont donc deux parties de la chrématistique, et même deux parties inséparables. Car, ainsi que nous le verrons, on ne produit pas d’abord des richesses, sauf à aviser ensuite au mode de distribution ; mais la demande même règle la production ; et cette demande se trouve intimement liée au mode de distribution de la richesse. Enfin, le mot de cœnolbologie par la dure association de ses trois racines (λοινός, λόγος), exprime la théorie du bonheur commun, ce qui a l’inconvénient de trop rappeler le bonheur commun de Babeuf et d’autres sectaires. De longtemps, sinon jamais, on ne pourra réduire en science ni inscrire parmi les sciences la théorie du bonheur commun, pas plus, hélas ! que la théorie du bonheur particulier. Toute cette partie de la classification d’Ampère est donc absolument défectueuse ; nous y substituerons la classification suivante :
Économie Sociale : Statistique, Chrématistique ou Théorie des richesses, sociale, Police, Finances, Administration,
Dans sa simplicité, ce tableau indique nettement les trois branches de l’économie sociale qui ont pris assez de consistance et d’autonomie pour figurer dans les livres, dans le monde et dans les académies comme autant de sciences particulières qui se font mutuellement des emprunts et se rendent mutuellement des services, tout en conservant un cachet de spécialité par lequel se distinguent leurs amateurs et leurs adeptes. Une telle liste ne saurait prétendre à être définitive : elle doit au contraire s’étendre, par voie de dédoublement ou d’adjonction, à mesure que les sciences font des progrès et que les travaux scientifiques se spécialisent davantage.
17. – Après avoir parlé des richesses en général, il est naturel de dire quelque chose de la classification des richesses, et puisque les biens dont s’occupe le jurisconsulte sont substantiellement la même chose, que les richesses, objet de la science économique, il paraît convenable de comparer les classifications des économistes à celles des jurisconsultes. Quelques-unes ont en économie la même importance que dans le droit. Telle est la distinction des biens en meubles et en immeubles : car, en général, plus une chose est mobile, mieux elle se prête au commerce et à l’échange, plus, vite elle acquiert les caractères essentiels de la richesse. Les métaux précieux, qui sont, à l’état de lingots ou de monnaies, des corps éminemment mobiles, ont été regardés de bonne heure comme la richesse par excellence ; et leur grande mobilité est le premier et le principal caractère qui les désigne pour la fonction qu’ils remplissent dans le système économique.
Le jurisconsulte au contraire a une prédilection marquée pour la richesse immobilière qui, mieux que d’autres, se prête à une organisation savante du droit réel (8). En effet, dans l’état primitif des sociétés, avant les progrès de la culture et de l’art des constructions, quand il n’y a encore pas plus de docteurs en droit que de docteurs dans la science économique, le droit de propriété (ou plutôt de possession) ne porte guère que sur des choses mobilières. Le sol qui n’appartient d’abord à personne, est ensuite pour les tribus une propriété commune, longtemps avant que de se fractionner en propriétés particulières. À une autre phase de la civilisation, la propriété immobilière devient au contraire prépondérante et la base du droit public et privé ; la propriété des objets mobiliers eux-mêmes, des instruments de culture, du bétail, des esclaves, s’incorpore à celle du sol et en prend fictivement l’immobilité. Les jurisconsultes (dont le règne est alors arrivé) consolident tant qu’ils le peuvent cette immobilité fictive qui donne un appui sensible et saisissable à leurs conceptions savantes. Enfin vient une époque où, comme de nos jours, on s’ingénie au contraire à trouver des moyens par lesquels les biens immeubles puissent prendre une mobilité commerciale et une facilité d’échange qui approchent de celles dont jouissent les choses naturellement mobiles et manuellement transportables.
18. – Voyez ce qu’était chez nous le droit en matière de succession, et ce qu’il est devenu. Grâce à la prépondérance de la propriété immobilière, la conservation des familles et la hiérarchie sociale avaient pour base ou pour garantie le mode de transmission héréditaire des biens immeubles, les substitutions, les retraits. De là des biens nobles et des biens de roture, des acquêts et des propres, qui faisaient retour aux diverses lignes de parenté. Nos idées philosophiques, notre amour de l’égalité, de l’uniformité, de la symétrie, ont fait disparaître de notre droit renouvelé toutes ces classifications compliquées, et même aboli la distinction des immeubles et des meubles en matière de succession. Or, quand bien même un entraînement philosophique et politique ne nous eût pas conduits là, nous y aurions été amenés à la longue par le seul développement des faits commerciaux et économiques qui atténuent sans cesse l’importance relative de la propriété immobilière, et qui dès lors tendent à faire regarder comme inutilement compliqué l’échafaudage juridique fondé sur la prééminence de ce genre de propriété, et destiné à la maintenir.
En dehors de la matière des successions, les auteurs de la législation nouvelle, au commencement du siècle actuel, ont accueilli la plupart des distinctions juridiques entre les biens immeubles et les biens meubles, telles que les leur avaient transmises les interprètes du droit romain et de nos anciennes coutumes ; et déjà l’on peut voir, si l’on y prend garde, que la plupart des entreprises, réputées novatrices en jurisprudence, tendent à l’effacement progressif de ces distinctions juridiques.
En veut-on un exemple ? Notre droit n’admet d’hypothèques que sur les immeubles, les meubles ne pouvant être l’objet que de ce qui s’appelle en droit civil un privilège : mais, sous un nom ou sous un autre, il s’agit toujours pour le créancier, du droit d’être payé de préférence sur le prix d’une chose. D’un autre côté, notre droit donne à la femme une hypothèque sur les immeubles de son mari pour assurer le recouvrement de ce que son mari lui doit : aura-t-elle de même un privilège sur les biens meubles, ou (pour dégager la question de toute subtilité) la jurisprudence étendra-t-elle au prix des biens meubles, à l’aide d’une fiction quelconque, le droit de préférence que la loi a explicitement reconnu à la femme sur le prix des immeubles du mari ? Telle est la question qui a beaucoup occupé nos jurisconsultes et nos tribunaux, il y a quelques années, et l’on en sent bien la raison ; car, il peut venir un temps où l’importance relative de la propriété immobilière ait tellement décru, qu’une garantie assise sur les immeubles seulement deviendrait illusoire dans la plupart des cas. Alors il faudrait, ou renoncer à la garantie que la coutume et les mœurs exigeaient dans d’autres temps, ou changer la législation, ou l’amender par voie d’interprétation juridique, comme faisait le préteur romain quand la distinction entre les choses acquises selon le vieux droit des Romains (le droit des quirites), et les choses acquises selon le droit commun des peuples civilisés (jus gentium), n’avait plus sa raison d’être.
19. – Une autre distinction familière aux jurisconsultes est celle des biens corporels et des biens, incorporels : les économistes l’adoptent, en reconnaissant des richesses matérielles et des richesses immatérielles





























