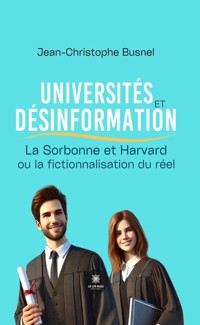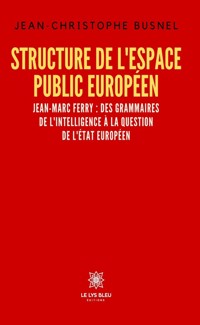Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La réflexion amorcée dans "Structure de l’espace public européen" et poursuivie dans "Universités et désinformation" se prolonge ici. La démocratie présuppose un espace public unilingue ; le monde, lui, est irréductiblement multilingue. Dès lors, comment la démocratie peut-elle se penser à l’échelle mondiale ? La théorie des registres de discours apporte une réponse décisive : ce ne sont pas les langues, mais les modes argumentatifs qui structurent l’espace public mondialisé. Peu importe la langue parlée, seul compte le présupposé argumentatif sous-jacent. Ce constat, manifeste en philosophie, permet de démontrer l’efficacité de cette théorie, de décrire la structuration de l’espace discursif global et, ce faisant, d’établir les conditions de possibilité d’une démocratie mondiale.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Christophe Busnel explore depuis plus de vingt ans les grands bouleversements géopolitiques contemporains. De l’invasion de l’Irak à la chute de Daesh, son parcours de terrain nourrit une réflexion rigoureuse sur les causes profondes de la violence mondiale. Dans ses travaux, il interroge les fondements du débat public international et plaide pour une démocratie réellement globale, fondée sur des registres d’argumentation partagés.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Christophe Busnel
Qu’est-ce qu’un argument ?
Pour une reconstruction des discours
de l’espace public mondialisé
Essai
© Lys Bleu Éditions – Jean-Christophe Busnel
ISBN : 979-10-422-7555-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Introduction
Selon les langues, différerait par hypothèse l’expérience de verbalisation du mot qui sert en français à signifier l’acquisition d’une connaissance, à savoir comprendre. L’expérience en espagnol serait celle d’entendre (entender) ; de se tenir devant ou de faire se tenir debout en allemand (verstehen) ; de se tenir parmi ou de se tenir debout dessous en anglais (understand) ; de cevoir en italien, ancienne racine que le français a conservée dans les verbes concevoir, apercevoir, recevoir (capire). De même, l’expérience française du mot comprendre serait celle de comprender en espagnol et comprendere en italien, mitgreifen* en allemand, to take with en anglais, qui comprend aussi le verbe to comprehend.
Faut-il en déduire que les langues germaniques font de comprendre une extériorisation du sens par l’organisation de choses autour de soi ; que l’italien accueille ce qu’il faut comprendre ; que l’espagnol se réserve la possibilité de ne pas comprendre ce qui s’entend ? Quelles seraient les conséquences si toutes les langues s’accordaient à proposer la même expérience verbale, à la française par exemple, qui par comprendrefait sien, prend avec soi ?
Il est amusant de même de relever la manière dont droit s’exprime selon les langues : droit, derecho, diritto, right, Recht s’accordent à désigner ce qui est légal (le Droit). Selon les langues, le mot sert aussi à accorder la validité d’un jugement. Ainsi l’allemand en fait un prédicat : Du hast Recht, tandis que l’anglais en fait une ontologie : you are right. On comprendra sans doute dans un cas quelque chose comme : tu as le droit pour toi ; et dans l’autre : tu es droit dans ta réflexion. Avoir le droit pour soi engage l’idée d’une norme objective, d’une référence à laquelle se rapporter pour valider de l’extérieur la licéité de la réflexion. On jugerait la conformité du raisonnement aux règles partagées. Être droit dans sa pensée convie l’idée du conservatisme, des habitudes, ou bien de l’honnêteté, de la respectabilité ; plus que son raisonnement, on jugerait la personne, son comportement ; si sa posture ne dévie pas du droit chemin – serait-il alors tout tracé ?
En français, espagnol et italien, on dit : tu as raison, tienes razón, hai ragione ; qui se comprendraient comme : tu as la raison pour toi. Ces dernières formulations laissent une forte place à la subjectivité et accordent les opinions à un niveau d’abstraction plus élevé : c’est convenir que le sens évalué accorde le raisonnement personnel aux principes de la raison universelle, plus libre que le droit, qu’il soit issu des conventions du passé ou définisse un système objectif de règles établies – éventuellement produit lui-même par l’usage de la raison. J’ai le droit ne donne aucun droit à avoir raison et l’on ne peut pas non plus avoir raison d’avoir le droit. Je suis droit pourrait forcer la raison et priver de la recherche d’une entente raisonnable ; et J’ai raison excéder le cadre des conditions d’une entente possible.
Avoir le dernier mot serait donc une affaire de prescriptions objectives auxquelles ne pas contrevenir en allemand ; de principes à poursuivre en anglais ; d’une capacité à fournir des motifs valables en français, espagnol et italien. On en infère que rien ne garantit que la notion d’argument ne diffère pas d’une langue, d’une culture à l’autre.
Pour expliquer ces intuitions, des locuteurs de chaque langue pourraient produire un discours explicatif de la manière dont ils reçoivent, entendent, établissent, présentent ou assujettissent le sens. Saurons-nous jamais si nous aurons compris ? Sans doute pas, puisqu’il faudrait, pour faire la pleine expérience des mots que présenteraient les explications être un locuteur natif de chaque langue – ce qui ne se peut. En outre, puisque c’est par une expérience interindividuelle qu’est visée la compréhension de l’objectivité d’une expérience collective, il faudrait, dans le but de produire une expérience généralisante, multiplier les expériences auprès d’un grand nombre de locuteurs – de tous ? – ce qu’est le registre interprétatif vis-à-vis du narratif. La compréhension de l’expérience collective par le témoignage de l’expérience individuelle paraît difficile.
Un autre type d’intercompréhension aurait-elle lieu à un niveau de désubstantialisation supérieur ? Si tel n’était pas le cas, l’intercompréhension resterait perpétuellement brouillée. Comment pourrions-nous justifier l’organisation d’une structure démocratique multilingue puisque la démocratie implique la constitution par le principe de délibération de sens communs partagés ?
C’était le but de Structure de l’espace public européen que de rechercher de quelle manière des sociétaires vivants dans des espaces linguistiquement séparés pourraient néanmoins s’entendre, se comprendre ; accueillir, établir ou poser ensemble un sens commun raisonnable, licite et respectable. Il en était ressorti, par la reprise de la théorie reconstructive des registres de discours, une structure polarisée des modalités expressives qui avaient trouvé à se justifier en disqualifiant, dans Universités et désinformation, une théorie concurrente visant et échouant à atteindre cet objectif. Il restait cependant à confirmer la validité des résultats obtenus en les mettant à l’épreuve d’énoncés réels. C’est l’objet de cette présente étude.
Il s’agira d’abord de relever que pour argumenter, certains cherchent, par le langage, à faire voir ce qui ne se voit pas : les choses invisibles, ce qu’ils pensent. Les métaphores sont comme autant d’arguments qui attesteraient la valeur de la réflexion. Il faut pourtant douter de ces méthodes : qu’est-ce qui est réel si ce qui est réel se dit avec des mots dont la vérité du sens serait supposément justifiée par le recours à l’expression du réel ? Les métaphores décrivent davantage les images qui paraissent en pensée qu’elles ne démontrent la vérité du réel. À l’inverse, la pensée en mouvement se dit sans images (I).
D’autres, pour attester leur réflexion, insinuent des références et des citations. Puisqu’il faut encore aller chercher le sens là où on le signale, il s’ouvre parfois plus qu’on ne le ferme. Certains auteurs en joueraient pour énoncer sans asserter. Les citations d’autorité sont aussi des preuves de réalisation de consensus que la lecture juge parfois audacieux de contester. L’exemple est un moyen de solliciter la mémoire du lecteur pour obtenir sa participation à la validation de principes généraux, mais ils ne valent que si les situations sont culturellement partagées. Une extrapolation parfois périlleuse mène à prendre pour un exemple le déroulement d’une expérience qui n’est faite qu’en pensée. L’hypothèse engage dans des déductions parfois hasardeuses. Des exemples ou des hypothèses se changent en fictions : des fictions exemplaires, des fictions hypothétiques (II).
Le discours est une situation d’interlocution. Puisqu’on écrit seul, les narrateurs se font narrataires. Ils s’interrogent, se donnent du « tu », se déguisent en « je », qui devient un « il ». Ainsi se créent des personnages, des « vous » ; des « nous » aussi, lorsque le narrateur, unilatéralement, décrète que son destinataire s’accorde à son propos. Le « nous » permet aussi de parler entre soi en excluant un « vous » importun. Plus simplement, le narrateur fait intervenir dans ses fictions un tiers, un « il » qu’il manipule à son idée. Ou bien, s’il veut le convier dans sa simulation perceptive, l’auteur crée par un « je-universel » une communication fusionnelle » où se confondent son « je », celui de son narrateur et celui du lecteur. Il ne s’agit plus que de se convaincre soi-même : le lecteur se fait le discours que lui tient l’auteur. Il garde toutefois la liberté de conclure (III).
La complexité s’accroît lorsque les auteurs cessent de parler en leur nom, qu’ils renoncent à porter la responsabilité du sens de leur propos. Ils se mettent à produire des raisonnements sur la supposition qu’ils font des opinions d’un tiers, dont ils font les prémisses de leur discours – suspect d’évidence puisque l’auteur ne peut préjuger des pensées d’autrui. Les changements de focalisation ruinent les arguments. Les déclarations d’incompétences, les attentes démenties, les prétéritions et les métalepses contribuent à faire décliner la valeur argumentative (IV).
Avec ces expériences de pensées, ces fictions exemplaires, ces hypothèses fantaisistes, ces créations de personnages, ces changements de focalisation, on se prend au jeu de succomber à l’écriture d’un roman, au synopsis d’une tragédie classique. Il ne manque en effet dans ces essais ni la mise en récit, ni la dramatisation, ni la création de suspense (V).
On croirait qu’on a tout dit, mais ce n’est pas si simple. Certaines vérités passent sans être dites – et les auteurs s’y connaissent pour glisser des indices, qui leur servent d’arguments, pour faire comprendre ce qu’ils ne disent pas. Les paradoxes éveillent l’attention du lecteur et mène à comprendre un sens différent de celui qui paraît en première lecture. Attention toutefois à manipuler cette technique avec prudence, car l’absence de fiabilité du narrateur ne paraît pas toujours intentionnelle – et elle emporte parfois, pour son malheur et le nôtre, celle de l’auteur (VI).
Reste que le discours qui rebute ne sera pas lu, ou pas écouté, et, n’étant pas lu, ne pourra convaincre. L’analyse des arguments de refus des thèses d’autrui ou de poursuite de la lecture de leurs énoncés mène à concevoir que certaines formes de discours sont, selon chaque lecteur.e, plus attendues que d’autres (VII).
Avec une telle diversité, on en viendrait à conclure, comme disait Voltaire, que « tous les genres sont bons sauf le genre ennuyeux ». Pour donner raison au grand homme, il faudrait toutefois tenir que l’ennui n’est pas à comprendre comme ce qui endort, car en étendant la maxime aux essais, on relève que les énoncés qui endorment ne sont pas les moins criants de vérité : c’est au cours du sommeil que se déduisent les vérités premières et que se vivent les expériences les moins douteuses. L’espoir se maintient pour ceux que ces méthodes rebutent ou indiffèrent car une extrême acuité à l’état de veille est tout autant requise pour parvenir à une même connaissance (VIII).
Puisse ce parcours par un choix d’énoncés et de situations d’interlocution retenues égayer les lecteur.e.s ; puisse-t-il aussi instruire et, par un cheminement voulu progressif, permettre de faire saisir à quel point la production et la réception du sens est complexe : on déjoue parfois des manœuvres frauduleuses, on doute de l’efficacité de la méthode relativement à l’objet du discours, on s’émerveille de la subtilité et de la diversité des techniques employées pour faire passer le sens. Il faudrait surtout retenir que nous avons affaire à des spécialistes. Comme les objets, les techniques littéraires sont les mêmes pour tout le monde. Certains en usent à bon escient et d’autres jouent les faussaires. Que veut celui qui me parle, au-delà de ce qu’il me dit ? Comment m’assurer que la situation d’interlocution n’est pas par avance biaisée et comment m’épargner chaque fois l’effort d’une analyse profonde et engageante ? Dans notre société mondialisée où le mêlement des discours brouille le sens, la classification des énoncés selon la théorie des registres de discours démontrerait en conclusion sa pertinence.
Nous ne pourrions envisager plus grande satisfaction que l’obtention de l’assentiment des présents lecteurs sur ces conclusions. Ainsi commencerait à se former les bases d’un consensus pour l’organisation de l’espace public qui manque à notre Union cosmopolitique pour poursuivre son projet démocratique d’une union toujours plus étroite. Ce serait, sur ces bases, un espace public, certes unique, mais articulé. Quelle autre perspective, finalement, pour organiser l’expression de langues articulées qu’un espace public articulé ? Par hypothèse, nous n’aurions pas d’autre manière de nous faire comprendre.
I
Les tropes et la perception
Imaginer
Il est simple de maîtriser un lexique qui désigne des choses. Mais comment nommer ce qui ne se perçoit pas ? Les auteurs emploient des mots qui désignent des choses perceptibles. De là, les tropes.
Chez Quine, au sujet de l’apprentissage : « l’enfant grimpe à l’intérieur d’une cheminée intellectuelle, s’appuyant de chaque côté en exerçant des pressions contre les autres côtés » (Le mot et la chose, p. 145). Il le reproche : « des gens naïfs font la chasse aux licornes » (Ibid., p. 197). Or, par un abus de langage qui masque la littéralité de ce dont on parle : « siffler dans la nuit pour se masquer le danger n’est pas une bonne méthode en philosophie » (Ibid., p. 290). Par paradoxe, le théoricien exprime donc par une métaphore la prescription principielle en philosophie d’exclure l’expression imagée.
L’analogie serait incontournable pour évoquer l’imperceptible :
« C’est grâce à l’analogie que l’on peut décrire de manière intelligible les choses non perceptibles et spécialement grâce à cette forme particulière d’analogie qu’est l’extrapolation : considérons par exemple les molécules qu’on décrit comme des objets plus petits que tous ceux qui ont jamais été vus. Ce mot : “Plus petit” est, dès le départ pourvu de signification pour nous, en vertu de certaine sorte d’association avec des contrastes observables comme celui qui oppose l’abeille à l’oiseau, le moucheron à l’abeille, le grain de poussière au moucheron » (Le mot et la chose, pp. 42-43).
On ne peut pourtant « décrire » les « choses non perceptibles ». Le mot « décrire » serait donc lui-même abusif. Reste que ce qui ne se voit pas – ou pas encore – doit bien être nommé. Le quanta, l’atome sont des néologismes qui permettent à la raison de poursuivre son discours.
La lumière elle-même s’appréhende à la façon dont le regard fait l’expérience des choses. Qu’est-ce que la lumière ? Avec ses mots, John Locke explique par anticipation son caractère doublement ondulatoire et corpusculaire : « supposons que la sensation ou l’idée nommée blanc soit produite en nous par un certain nombre de globules qui tourbillonnent autour de leur centre et frappent la rétine et l’œil avec un certain degré de notation et une vitesse progressive » (Essai sur l’entendement humain, p. 51).
Qu’est-ce que la morale ? Si la Critique de la raison pure présente un vocabulaire souvent abstrait, Kant retrousse ici ses manches et se fait maître d’œuvre pour en parler. La morale un édifice majestueux que la raison personnifiée tente par un travail de sape de déstabiliser :
« Il s’agit de déblayer et d’affermir le sol qui doit porter le majestueux édifice de la morale, ce sol où l’on rencontre des trous de taupe de toutes sortes creusés par la raison en quête de trésors, sans succès, malgré ses bonnes intentions, et qui menacent la solidité de cet édifice. » (Critique de la raison pure, p. 1031).
Abuser des images peut faire perdre le sens. Le langage, chez Quine, est une énigme qui s’appréhende préférablement en empruntant au langage de la végétation. Sans doute faut-il comprendre ici que l’usage d’un lexique familier permet de discriminer les formulations singulières :
« La méthode des hypothèses analytiques est une façon de se catapulter soi-même dans le langage de la jungle par la vitesse du langage domestique. C’est une manière de se greffer des greffons exotiques sur le vieux buisson familier jusqu’à ce que seuls les greffons exotiques frappent la vue. » (Le mot et la chose, p. 115).
Comme chez Hume, les mots se confondent avec les sensations et donc, les choses qui provoquent ces sensations. Ils s’assemblent en arche. Un travail important de reconstitution du sens est nécessaire. Littéralement, l’énoncé n’a aucun sens :
« Ce qui naît de ces associations de phrases à phrases est une vaste structure verbale qui est liée d’innombrables manières à la stimulation non verbale. Les liens relient (pour chaque personne) des phrases séparées, mais les mêmes phrases sont liées les unes aux autres et à d’autres phrases de manière telle que les liens non verbaux eux-mêmes peuvent se détendre ou même céder sous la tension. De façon manifeste, cette structure de phrases interconnectées est un édifice unique incluant toutes les sciences et même, en fait, tout ce que nous ne disons jamais au sujet du monde. Car tout au moins, les vérités logiques, et ceci vaut sans doute également pour la plupart des vérités de sens commun, sont communes à toutes les matières et assurent ainsi des connexions. » (Le mot et la chose, p. 40).
Le sens verbal serait ainsi soumis aux principes que les sciences physiques ont nommé la causalité : des liens se détendent, cèdent « sous la tension ». Les phrases forment un édifice, une structure, un réseau (association, liens, relient, interconnectées, incluant, connexions). Il en ressort que des choses sont « en lien » avec des choses. C’est finalement une image impressionnante qui justifie cet énoncé, que le narrateur tente de décrire (vaste structure, innombrables liens, toutes les sciences, de façon manifeste, cette structure, un édifice unique, toutes les matières). Il s’agit manifestement d’une vision synthétique (une image). Le vocabulaire est vague (innombrables manières), ne précise pas ces manières et les fait seulement apparaître grouillantes, insaisissables ; nous ne savons pas de quelle « tension » il est question ni en quoi la façon est « manifeste » ; ne ce que signifie « toutes les sciences ». Il faut comprendre ici que « disons » ne signifie pas « énoncer par la parole », mais « penser en mots » ; « des connexions » reste indéterminé. De quelle nature seraient les « liens » entre les phrases ?
Les contradictions sont multiples : on ne comprend pas comment des « phrases » incluraient « ce que nous ne disons jamais », car une phrase peut-elle inclure autre chose que des mots (qui se disent) ? De même, pourquoi isoler les stimulations verbales des stimulations non verbales ? Que serait une stimulation verbale sinon une stimulation sonore, c’est-à-dire non verbale ? Enfin, comment comprendre « les mêmes phrases sont liées les unes aux autres et à d’autres phrases » ?
Avec tout cela, le narrateur n’est pas sûr de lui (ceci vaut sans doute, pour la plupart). C’est que l’énoncé s’écrit en même temps que se dévoile la vision. « De façon manifeste » est un témoignage et non une attestation de véridicité ; « et même, en fait » témoigne encore que la pensée vient de surgir dans l’esprit du narrateur. La démarche de l’auteur est mieux comprise si le texte est relu non comme une explication, mais comme la proposition d’un modèle que fait naître l’association d’images qui s’enchaînent les unes aux autres. L’auteur se décharge de l’expression des pensées qui lui viennent en esprit sur son narrateur, missionné expressément, et responsable de la qualité de la transcription de ce que pensait (ou plutôt imaginait) son auteur. C’est ici que l’analogie rendrait la réflexion confusante.
Le mode argumentatif, ici, ne repose pas sur un témoignage des sens du narrateur. Il décrit cependant à la manière dont il rapporterait ce qu’il a vu d’une structure matérielle – le registre de discours, puisqu’il s’agirait d’un témoignage, serait narratif –, mais qu’il est le seul à avoir « vue » puisqu’il l’a imaginée – la polarisation, hallucinée parce que l’expression est isolée du réel, sans que l’auteur témoigne s’en rendre compte, serait dogmatique. Son témoignage est l’expérience intérieure qu’il fait de ne pouvoir s’affranchir du biais de l’image pour s’exprimer. Les images, ici, précèdent le mot ; l’image précelle le langage.
Des pensées similaires d’une sédimentation des mots se développent certes chez Merleau-Ponty qui use également de métaphores et de comparaisons, mais sans obédience à des principes mécaniques. Par ailleurs, l’incapacité à nommer littéralement l’expérience faite, qui reste ineffable, mène à la formulation d’un principe indéfinissable : « une nouvelle dimension à notre expérience » :
« Les grandes œuvres déposent en nous à la première lecture tout ce que nous en tirerons ensuite. L’opération d’expression, quand elle est réussie, ne laisse pas seulement au lecteur et à l’écrivain lui-même un aide-mémoire, elle fait exister la signification comme une chose au cœur même du texte, elle la fait vivre dans un organisme de mots, elle l’installe dans l’écrivain ou dans le lecteur comme un nouvel organe des sens, elle ouvre un nouveau champ ou une nouvelle dimension à notre expérience. » (« Phénoménologie de la perception », in Œuvres, p. 869).
Par une personnification, « les grandes œuvres » réalisent un geste (déposent) que le lecteur reconduit (tirerons). La signification se spatialise (au cœur même du texte). Personnifiée elle aussi, elle est vivante (fait vivre). S’agirait-il d’un microbe ? Elle vivrait en effet dans le texte, « organisme de mots ». L’écriture (opération d’expression) est elle aussi personnifiée, elle agit (installe). L’expression de l’écrivain serait réussie quand l’auteur sent que la signification crée dans son corps un nouvel organe. Rien n’est visible, mais tout est vivant. L’auteur est conscient des effets de styles puisqu’il isole ce qu’il ressent de ce que l’intuition lui donne à « voir » (comme une chose, comme un nouvel organe). Et les sujets et agents, désubstantialisés, restent difficiles à « voir » (les grandes œuvres, le texte, l’opération d’expression, aide-mémoire, signification, champ, dimension, expérience). L’écrivain refuse de réduire à des choses, voire même à des mots, ce qu’il ressent et qu’il évoque. Il lui importe de mettre en mouvement. Il ne s’agit pas d’un témoignage des sens, mais plutôt d’une évocation (poétique puisque les effets de styles sont assumés) née de ce qu’on pourrait nommer l’intuition. Il s’agit d’exprimer un principe plutôt que de décrire une structure. Une part de mystère, d’inconnu et d’indicible se maintient. Puisque l’expression puise à l’intuition plutôt qu’au regard, la polarisation serait interprétative. L’auteur est conscient des effets de style auquel il recourt et marque d’autre part ne pas souhaiter conclure au-delà de ce que l’intuition lui donne à ressentir. Sa polarisation serait critique. Conclura-t-on que ce paragraphe a ouvert « une nouvelle dimension à notre expérience » ? Un résumé critique serait-il : « la lecture des grandes œuvres subtilise la sensibilité, n’est-ce pas ? »
Il écrit encore : « Le corps propre est dans le monde comme le cœur dans l’organisme » (première phrase de la deuxième partie « Le monde perçu » de La phénoménologie de la perception).
Le corps humain sert souvent d’analogie quand il s’agit d’évoquer un système organisé, complexe, peut-être adaptatif. Souvent, dans le Capital, l’usine est un animal, souvent repoussant, une pieuvre, un moloch. L’analogie ne vaut pas tant pour faire coller un système à un autre que pour rendre repoussantes les organisations dévorantes. Plus que ses formes, c’est, chargée d’émotions, sa substance qu’apporte l’image. Corps vivant, la société économique n’aspire pourtant qu’à fonctionner paisiblement :
« Cependant, les moyens mécaniques, dont l’ensemble peut être nommé le système osseux et musculaire de la production, offrent des caractères bien plus distinctifs d’une époque économique qui ne servit qu’à recevoir et à conserver les objets ou produit du travail, et dont l’ensemble forme comme le système vasculaire de la production, tels que, par exemple, vases, corbeilles, pots et cruches, etc. » (Capital, Livre I, p. 731).
L’être humain ressent avant de voir. C’est avec cette manière de ressentir – et de vivre – qu’il investit toute chose, le monde, qui s’anime. C’est pourquoi toute réalité est un corps animé par la vie. Les monothéismes peinent à expliquer comment l’invisible, le transcendant devient corps. Puisque c’est inexplicable, le christianisme en a fait un dogme.
Dans le Léviathan, la lecture du titre fait surgir en pensée le hideux monstre biblique. La seconde image est imprimée sur la page de couverture et représente un géant couronné tenant un sceptre et une épée. Le buste du géant, mais pas son visage, est composé d’innombrables corps humains plus petits formant une foule. Elle illustre les postulats nominalistes qui ne saisissent l’unité qu’en tant qu’elle est composée de parties. La troisième image est la métaphore filée de l’introduction qui associe, comme chez Quine, de manière mécanique et causale, sans mystère de ce qu’est la vie, les organes du corps, le corps et une totalité plus grande (le Commonwealth). À l’inverse de Marx, Hobbes propose que le corps humain soit un automate : « Qu’est-ce que le cœur, sinon un ressort, les nerfs, sinon autant de courroies et les articulations autant de roues, toutes choses qui, selon l’entente de l’artisan, inspirent le mouvement à tout le corps ? » (Léviathan, p. 63) ; le Commonwealth « n’est autre chose qu’un corps artificiel » (Ibid., p. 64). Il explique ensuite que les magistrats sont les articulations, la récompense et le châtiment les nerfs qui mettent le corps en mouvement, la richesse en est la force, les conseillers la mémoire, les lois la raison, la sédition sa maladie, la guerre sa mort, etc. Il ne précise pas s’il n’est pas lui-même un automate.
Pour quelle raison faire de mots (les mots étant des abstractions) qui distinguent ce qui est perçu (le corps, les nerfs, etc.) la référence de ce qui ne se voit pas (le corps des magistrats, des conseilleurs, etc.) ? Et non l’inverse ? Le fonctionnement du corps humain n’était pas si bien connu il y a quatre siècles (qui ne l’est toujours pas entièrement aujourd’hui), tandis que la mécanique est maîtrisée puisque la machine est construite à dessein.
Ce serait une question de registre argumentatif : associer des mots à des choses exprime sans interroger. Il serait spontané de nommer l’évidence ce que l’on voit pour aborder l’énigme de ce que l’on ressent. À l’époque baroque, le corps est un automate et la vie une représentation théâtrale ; il est réduit à un programme informatique aujourd’hui. La pensée en image est par nécessité conservatrice : elle nomme ce que le corps voit qui existe déjà. Faire du monde un corps rendrait le monde sensible, mais faire du corps une mécanique en retirerait-il la vie ?
Quine rangerait Hobbes parmi ceux qui « sifflent dans la nuit ». Ce dernier, comme son homologue ultérieur, après avoir introduit son ouvrage par ces trois métaphores, monumentales, veut exclure les métaphores de l’expression et juge sot qui y recourt pour raisonner. Le paradoxe dévalue l’ensemble de l’ouvrage :
« Lors d’une démonstration que l’on fait ou d’un conseil que l’on donne, comme en toute recherche rigoureuse de la vérité, c’est le jugement qui fait tout, sauf quand, parfois, il est besoin pour se faire comprendre de les introduire en recourant à une analogie appropriée ; et ainsi il y a de quoi faire usage de l’imagination. En revanche, en ce qui concerne les métaphores, elles sont, dans ce cas, complètement exclues. En effet, étant à l’évidence destinées à tromper, ce serait manifestement de la sottise que d’y recourir pour donner des conseils ou pour raisonner » (Léviathan, pp. 150-151).
L’intuition qui prélude à ces images, comme à toute métaphore est que toute chose est liée à toute autre ; que le tout comprend les parties, et que les parties forment le tout. La métaphore implique la pensée métonymique, c’est-à-dire l’esprit de synthèse.
L’inspirateur de la pensée analytique, Bertrand Russell, dans son ouvrage La philosophie de Leibniz, offre ainsi une très belle image synthétique. Le passage suivant pourrait se résumer par : « subitement, je compris les postulats de la philosophie leibnizienne ». Russell préfère l’allégorie :
« J’en étais là quand je lus le Discours de Métaphysique et les lettres à Arnauld. Soudain un flot de lumière inonda jusqu’aux recoins les plus retirés de l’édifice philosophique de Leibniz. Je vis comment ses fondations étaient creusées et comment la superstructure jaillissait d’elles. Il m’apparaissait que ce système qui semblait fantastique pouvait se déduire d’un petit nombre de prémisses simples que, sans les conclusions que Leibniz en a tirées, bien des philosophes, sinon presque tous, eussent volontiers admises1. » (pp. VII-VIII).
Il s’agit d’un discours enchâssé dans un discours premier. L’auteur qui témoignait (j’en étais là quand je lus) se dédouble en narrateur qui décrit à sa place, et de l’extérieur ce que « je » ressent pourtant de l’intérieur (Soudain un flot de lumière). Le narrateur intradiégétique devient homodiégétique et intègre le personnage Russell dans sa diégèse. Il décrit à la manière de choses (recoins, édifice, fondations, superstructure) qui apparaissent subitement (soudain, inonda, jaillissait). C’est une subjectivité qui objective (me semblait). L’effet synthétique est renforcé par le champ sémantique de la vue (je vis, il m’apparaissait), l’hypallage (système mécanique et système philosophique) et l’émotion par la qualité exceptionnelle de ce qui se produit et se ressent (jusqu’aux recoins, fantastique, pouvait se déduire, presque tous). Un lecteur qui ne percevrait pas le changement de focalisation se demanderait : « Qui a allumé la lumière ? ». Le paradoxe d’une structure qui jaillit de la page révèle le changement de focalisation.
La révélation portée par cette idée claire et distincte où la lumière a son rôle est éblouissante : ce n’est pas un paradoxe pour le héraut de la philosophie analytique puisque cette pensée subcontraire implique la pensée en synthèse. La métaphore révèle le mode argumentatif du narrateur : par la structure, le système, la déduction, les prémisses, il pense en associant le raisonnement logique à la substance. Raisonner en images est un enchantement.
Leibniz lui aussi recourait souvent aux métaphores et aux comparaisons :
« Tous les corps sont dans un flux perpétuel comme des rivières, et des parties y entrent et en sortent continuellement. » (« Principes de la Philosophie », in Principes de la Nature et de la Grâce, p. 258).
« Toute substance est un monde entier et comme un miroir de Dieu ou bien de tout l’univers, qu’elle exprime chacune à sa façon, à peu près comme une même ville est diversement représentée selon les différentes situations de celui qui la représente » (Discours de métaphysique, p. 32).
« C’est pourquoi tous les esprits, soit des hommes, soit des génies, entrant en vertu de la raison et des vérités éternelles dans une espèce de société avec Dieu, sont des membres de la cité de Dieu, c’est-à-dire du plus parfait état, formé et gouverné par le plus grand et le meilleur des monarques » (« Principes de la Nature et de la Grâce », in Principes de la Nature et de la Grâce, p. 212).
L’analogie mécaniste qui s’entend au monde social entraîne naturellement une forme sociale hiérarchisée :
« Dieu qui tient lieu d’inventeur et d’architecte à l’égard des Machines et Ouvrages de la nature tient lieu de Roi et de Père aux substances qui ont de l’intelligence et dont l’âme est un esprit formé à son image. Et à l’égard des Esprits, son Royaume, dont ils sont les citoyens, est la plus parfaite Monarchie, qui ne s’attire quelque châtiment, et point de bonne action sans quelque récompense. » (« Considérations sur les principes de vie et les natures plastiques », in Principes de la Nature et de la Grâce, p. 101).
Le mode argumentatif engage le type de réalité sociale. Dieu aurait créé l’homme à son image et, par voie de conséquence, le plébiscite des images et des métaphores fait dire que la réalité sociale humaine serait à l’image de la Création. Les mêmes associations se repèrent chez Hobbes, qui, dans le Léviathan, n’évoque jamais l’« État » (Commonwealth) que par des métaphores mécanistes. Il y théorise donc sans surprise la monarchie absolue.
La dérive politique, toujours inspirée par le registre argumentatif, s’insinue parfois subrepticement chez Quine (nous soulignons) :
« Ici la tâche est de rendre explicite ce qui a été laissé tacite, et de rendre précis ce qui a été laissé vague ; la tâche est d’exposer et de résoudre les paradoxes, de raboter les aspérités, de faire disparaître les vestiges des périodes transitoires de croissance, de nettoyer les bidonvilles ontologiques. » (Le mot et la chose, p. 378).
Quine évoque la continuité dans l’image empruntée à Neurath qui lui-même la tenait de Plotin d’un navire qui vogue et dont il faut remplacer les planches. Cette conception est en accord avec l’assimilation moniste de l’âme et du corps et le goût pour l’harmonie et la continuité du monde. D’autres philosophes suggèrent que la vérité soit une maison qu’il faut abattre et reconstruire :
« Et enfin, comme ce n’est pas assez, avant de commencer à rebâtir le logis où on demeure, que de l’abattre, et de faire provision de matériaux et d’architectes, ou s’exercer soi-même à l’architecture, et outre cela d’en avoir soigneusement tracé le dessin : mais qu’il faut aussi s’être prouvé de quelque autre, où on puisse être logé commodément pendant le temps qu’on y travaillera ; ainsi, afin que je ne demeurasse point irrésolu en mes actions pendant que la raison m’obligerait de l’être en mes jugements, et que je ne laissasse pas de vivre dès lors le plus heureusement que je pouvais, je me formerai une morale par provision, qui ne consisterait qu’en 3 ou 4 maximes, dont je veux bien vous faire part. » (Discours de la méthode, 3e partie).
Rupture ou continuité ? Conservatisme ou progressisme ? Continuation ou refondation ? Réparation ou reconstruction ? La culture et l’organisation sociale ne seraient-elles elles-mêmes issues que d’une manière de dire ?
L’importance du regard et des sens perceptifs
Le vocabulaire des sens est d’évidence omniprésent dans les énoncés : il est sensible, il semble, il paraît, il apparaît, il est visible que ; nous avons montré, comme nous avons vu, nous entrevoyons, nous voyons bien que ; comme il s’entend, nous sentons bien, nous touchons au but ; il est saisissant que, prenons cette hypothèse, derrière ce phénomène, sous-entendu, au-delà nous pouvons dire. Ces expressions paraissent aussi métaphoriques que le sont, par exemple : nous verrons dans quelle mesure, cette idée est claire, nos pensées s’éclaircissent, elles ouvrent la voie ; nous apporterons à nos réflexions l’éclairage de ; les pensées des auteurs s’articulent, le pivot/l’axe/le versant de la réflexion reste, nous aborderons ce paragraphe, nous ferons un tour d’horizon ; le coût de cette hypothèse est élevé ; au cœur de cette entreprise, au fondement de cette réflexion ; la thèse s’infléchit sous, cette conclusion s’appuie sur, cette opinion est confortée par, la rigidité de cette conclusion paraît, notre hypothèse se renforce, etc. Il faut le reconnaître : spontanément, la pensée se spatialise et se temporalise, devient phénoménale.
Le constat est le suivant : Il est clair que nous entendons la majorité du sens d’un discours comme une métaphore du fait de la sédimentation du contenu de l’expérience sensorielle qui s’est accumulé dans notre bagage cognitif et que nous acceptons de payer le prix de ce qui est le gage de notre investissement dans le monde, à savoir que notre esprit appuie ses réflexions sur l’articulation de mots qui font image. Continuons : Le fait est que le réel n’est pas si étranger à la pensée que celle-ci ne puiserait pas pour se former à l’expérience sensible. Bien au contraire, si les expressions imagées sont si nombreuses dans l’expression de la pensée au point que la métaphore, comme dans le terme « expression », est parfois difficile à caractériser de manière univoque, c’est du fait que la réalité se conçoit prioritairement comme sensible et que la pensée n’a d’autre choix que de s’y adapter. En conséquence, la pensée « voit » et cherche à être « claire » autant que le regard a besoin de lumière pour discerner distinctement la réalité. Lorsque la lumière est trop vive, la précision du regard s’atténue de même que devient confuse la pensée illuminée. Tout est donc, en perception et en pensée imagée, jeu de lumière, car tout est ressenti – et mis en mouvement.
Ces phrases ont été écrites pour le besoin de la cause, mais on lit cet énoncé suivant chez Kant (nous soulignons) :
« Quand on part d’une pensée bien fondée, quoique non développée, qu’un autre nous a transmise, l’on peut bien espérer, grâce à une méditation soutenue, la porter plus loin que l’homme pénétrant auquel on devait la lumière2 » (Prolégomènes à toute métaphysique future, p. 23).
Kant poursuit. Selon lui, Hume
« ne pressentait en rien la possibilité de cette science formelle, mais il sait accoster sa barque, pour la mettre en sécurité, sur un rivage (le scepticisme) où elle peut donc demeurer et pourrir, au lieu qu’il m’importe de lui donner un pilote qui, suivant les principes certains de son art tirés de la connaissance du globe, muni d’une carte maritime complète et d’une boussole, puisse la conduire sûrement là où bon lui semble. » (Ibid., p. 25).
La raison est peut-être un guide, mais ni Hume ni Kant ne sont des marins. Le recours à l’image requiert donc toujours un effort de compréhension. Cette opération consiste à généraliser, c’est-à-dire à désubstantialiser ce dont il est question d’abstraire des mouvements des corps mentionnés. Il s’agit ici d’exprimer l’idée que l’argumentation sceptique prive de l’énonciation de tout sens positif puisqu’elle se départit de la responsabilité d’une énonciation sensée. Mais toute expression étant par principe suspecte d’être allégorique, puisque rien ne vient garantir par avance qu’elle soit littérale, existe-t-il une échappatoire à la recherche du sens chaque fois qu’il est question de discours ? Comprendre signifierait-il toujours s’interroger ? Mais il faut bien conclure : comment, selon quelles règles et avec quelle certitude de réussite ?
Les énoncés sans images se lisent en mouvement
La vue est le sens le plus important chez l’être humain. Faire voir capte l’attention – et divertit du cadre qui produit le spectacle : bien que l’on sache la présence de l’auteur, c’est ce que nous présente le narrateur qui intéresse. Les textes imagés, comme ceux listés ci-dessus, favorisent fortement l’accès à la lecture parce qu’ils donnent spontanément à voir. Les réalités sont simples, les expériences rapportées sont quotidiennes et perceptives. L’effort de concentration est faible. Si l’on ne fait pas l’effort d’abstraire le sens, on se laisse facilement entraîner à parcourir les lignes sans s’aviser qu’on ne les comprend pas. Les images sont en effet un moyen de passer le temps et de capter l’attention en ravissant l’esprit sans fournir aucun sens. Les énoncés abstraits, composés de mots qui ne réfèrent pas à des objets perceptibles, désubstantialisés, se lisent en mouvement. Ils sont plus difficiles à lire. Au contraire des précédents, on ne peut les parcourir avec enchantement. Si le sens se perd, la lecture s’arrête :
« L’expérience est une connaissance empirique, c’est-à-dire une connaissance qui détermine un objet par des perceptions. Elle est donc une synthèse des perceptions, qui elle-même n’est pas contenue dans la perception, mais contient l’unité synthétique du divers de ces perceptions dans une conscience, unité qui constitue l’essentiel d’une connaissance des objets des sens, c’est-à-dire de l’expérience (pas seulement de l’intuition ou de la sensation des sens). Or, dans l’expérience, les perceptions ne se rapportent les unes aux autres, il est vrai, que d’une manière accidentelle, de telle sorte qu’aucune nécessité de leur liaison ne ressort ni ne peut ressortir des perceptions elles-mêmes, car l’appréhension n’est qu’un assemblage du divers de l’intuition empirique, et l’on n’y saurait trouver aucune représentation de la nécessité d’une liaison dans l’existence des phénomènes qu’elle rassemble, au sein de l’espace et du temps. Mais comme l’expérience est une connaissance des objets par perceptions, que, par conséquent, le rapport dans l’existence du divers doit être représenté en elle, non tel qu’il est assemblé dans le temps, mais tel qu’il est objectivement dans le temps, et comme le temps lui-même ne peut être perçu, la détermination de l’existence dans le temps ne peut se produire que par leur liaison dans le temps en général, par suite seulement par des concepts qui lient a priori. Comme ces concepts impliquent toujours en même temps la nécessité, l’expérience n’est possible que par une représentation de la liaison nécessaire des perceptions3. » (Critique de la raison pure, pp. 915-916).
Dans ce passage, tous les mots à l’exception de « objets » (qui reste toutefois une catégorie générique) sont abstraits, c’est-à-dire désubstantialisés : ils ne se réfèrent pas aux sens. Il est donc exempt d’images ; mais non de mouvements. Le mouvement, ce serait « quelque chose qui va au-delà ».
Certains mots évoquent la liaison (rapportent, liaison, rapport, lient, et, qui, que, « est » en tant que copule, les unes aux autres, « ce » en tant qu’il désigne) ; le rapatriement (appréhension, perceptions) ; le regroupement (synthèse, unité, constitue, assemblage, rassemble, assemblé) ; l’inclusion (contenue, contient, y trouver, dans, au sein de, en) ; la vacuité (aucune) ; la distribution ou multiplicité (divers, des) ; l’exclusion (ressort, ressortir) ; le dédoublement (représentation, représenté, tel qu’) ; la conséquence (donc, détermine, de telle sorte, par conséquent, par suite, impliquent, détermination) ; l’opposition (or, mais) ; la réduction (n’est qu’un, seulement, n’est que) ; l’induction (car, comme, a priori, que [rappel du comme]) ; l’appartenance (elle-même, elles-mêmes, lui-même, leur, se) ; l’effectivité ou opération (manière, produire, possible, peut, doit, phénomène, saurait [sens de possibilité rationnelle]) ; l’extension (c’est-à-dire) ; la traversée (par).
On remarque aussi que l’on peut associer ces mouvements par couples de contraires : entrer/sortir (inclusion, appartenance, exclusion) ; opposer/lier (opposition, liaison) ; regrouper/éparpiller (groupement, réduction, distribution, extension) ; s’éloigner/revenir (conséquence, antécédent) ; dédoubler/traverser ; opérer/vider (effectivité, vacuité). Il appartient à chacun de déterminer si le mouvement fait plus sens sous la forme d’un verbe (opérer) que d’un nom (opération) ; ou des adverbes, par exemple, dedans/dehors à la place de entrer/sortir. Il semble cependant que l’adverbe pose plus qu’il ne déplace.
Une fois cette classification effectuée, il ne reste plus que des concepts statiques, des articles (singulier et pluriels), des négations (que l’on peut d’ailleurs plus ou moins assimiler à la « vacuité »), des insistances (il est vrai). Si l’on reprend le texte en surlignant les mots dénotant un mouvement, le texte se traduit presque intégralement en mouvements. Certains mots restant peuvent encore être assimilés à des mouvements : « essentiel » pourrait rejoindre l’ensemble « regroupement » dans le sens où l’essence est au « cœur », « nécessité » pourrait être un mouvement vertical, comme celui de l’épée de Damoclès, « temps » pourrait être une extension ou bien une opération, « existence » peut briller et gonfler ou rayonner, etc.
L’opération de mise en mouvement des mots se fait en réalité naturellement au cours de la lecture et la catégorisation proposée ici a posteriori n’est rendue nécessaire que pour les besoins de l’explication. Elle ne saurait être ni définitive ni même définitoire, les mots employés comme métalangage n’ayant pour vocation que de tenter d’exprimer d’une manière synthétique le mouvement commun à un groupe de mots, lesquels pourraient très bien être classifiés différemment. Il importe seulement de s’assurer que le mouvement général est le même, quelle que soit la classification que l’on se donne. Il s’agit de comprendre a posteriori le travail de la lecture et, en l’occurrence, la manière dont les mouvements supportent le sens d’un texte.
Peu importe, le principe n’est pas de catégoriser les mots, mais de démontrer que l’on peut comprendre un texte par ses mouvements en y surimposant la substance spécifique du terme concerné. Le support qu’il représente aux contenus de sens est une aide à la lecture. En un sens, le texte est rendu vivant, spatial, mondain.
Ainsi tout est pôle et liens dans le langage, ou autrement dit, intérieur et extérieur : passage. Le langage est articulation parce qu’il formé par la jonction (grammaire) de délimitations (les mots substantiels, dont les substantifs). Mais la spatialisation n’est possible que parce que le vécu, l’expérience intérieure, a lui-même été préalablement singularisé en mots. Les phrases répartissent en mots les émotions dans le corps – et ce n’est que la négligence d’une attention superficielle portée à se comprendre soi-même qui mène à tenir que les mots répartissent des choses à l’extérieure de soi. La naïveté de prendre les mots pour des choses vient de là : l’assimilation de l’expérience vécue à la perception d’un ensemble de choses.
C’est la raison pour laquelle les textes sans images se comprennent par le mouvement, y compris ceux, substantiels, qui désigneraient des choses. Il suffit que ces choses soient inconnues pour que l’on s’avise que ce sont les mouvements qui sont compris. Ainsi : « les slictueux torves gyraient sur l’alloindre et vriblaient ».
Il ne s’agit pas de poésie : John Gribbin dans son ouvrage de vulgarisation scientifique sur la mécanique quantique Le chat de Schrödinger (pp. 115-116) mentionne ces propos du prix Nobel de physique Arthur Eddington : « tous les principes fondamentaux de la physique sont susceptibles d’être transformés en “Jabberwocky” ». Ce dernier citait lui-même le poème de Lewis Caroll pour signifier le fonctionnement des électrons dans l’atome : « the slithy toves did gyre and gimble in the wabe » (The nature of physical world). De fait, cette phrase est immédiatement comprise sans que personne ne puisse pourtant dire ce qu’est un slictueux torve et un (une ?) alloindre : le mouvement est compris, signe que pour l’expression du mouvement la nature des choses importe moins que leurs relations.
Se concentrer ne signifie donc pas tant observer plus en détail les tâches qui forment les lettres des mots et les espaces entre eux, que de réaliser l’opération de sa propre pensée sur elle-même. Dit métaphoriquement, la concentration est un regard interne de l’esprit sur lui-même, et cette expérience de la lecture concentrée invalide définitivement les thèses d’une pensée fondée exclusivement sur la production d’images et d’une activité cognitive abstraite, paradoxalement, sans objet.
II
Raconter une histoire, exemples et hypothèses
Références et citations
Référencer atteste le propos. On peut paraphraser un énoncé et ne le référencer que par un nom propre : « dit Leibniz », « comme le soutient Kant », « selon Descartes », « Husserl a tort de », « Carnap reprend Neurath », etc. Ces mentions sollicitent la mémoire du lecteur qui, malgré lui, sent se former ce qu’il rattache, dans ses connaissances, sa mémoire, ses souvenirs, à ce nom propre. Sans précision supplémentaire, il se peut toutefois que ces derniers diffèrent du sens que visait l’auteur.
Certains auteurs en jouent. Citer une référence peut masquer le sens et pallier l’expression juste qu’on ne produit pas. On feint de se prêter à croire qu’il suffit de référer pour rendre compréhensible. Des références arbitraires, incongrues ou laconiques déportent l’attention du lecteur vers les énoncés d’une autorité tierce sur qui l’auteur décharge la responsabilité de ses propos. L’auteur se réfère à autrui, mais sans présenter le sens précis auquel il se réfère. La référence n’a donc rien dit de précis non plus. L’auteur a parlé, un énoncé a été lu, mais rien n’a été dit.
Par exemple : « Le fait que la logique ait dominé la philosophie médiévale est, comme le rappellent Kenny, Kretzman et Pinborg (1982, préface) largement un accident historique » (La norme du vrai, p. 422, note 10). Des auteurs sont cités. Ils « rappelleraient » eux-mêmes une vérité. Elle aurait donc été attestée préalablement ; mais on ignore par qui. Ainsi, la vérité est indubitable, mais personne ne l’a assertée.
Ailleurs, le lecteur est informé qu’une information serait à saisir quelque part, mais elle ne lui est pas fournie, le lieu où la retrouver non plus ; on l’oriente seulement vers une direction, sans lui fournir l’assurance d’aboutir : « cela est très clair d’après Strawson 1985 » (La norme du vrai, p. 422, note 13).
Ou encore ce passage suivi d’une note, mystérieuse :
« Il faut bien entendu distinguer les mondes logiquement possibles (le monde composé du nombre 2 est logiquement possible) et les mondes physiquement possibles d’un monde avec des constantes légèrement différentes est possible mais un monde composé uniquement d’objets en chocolat est physiquement apparemment impossible). » (L’anti-Hume, pp. 21-22).
La note précise les références du contenu, mais ne l’aborde toujours pas : pour avoir l’explication d’un monde « composé du nombre 2 », le lecteur est prié de s’y rapporter de manière autonome, s’il le souhaite ; en l’occurrence, il faut se référer à « Tegmark et spécialement l’univers IV composé de structures mathématiques ». C’est tout. Le lecteur ne saura donc pas quel argument, dans la réflexion de Tegmark, aura séduit le narrateur qui lui fasse admettre qu’un « monde composé du nombre 2 [soit] logiquement possible », mais qu’« un monde composé uniquement d’objets en chocolat [soit] physiquement apparemment impossible ».
La mention d’un auteur dont il est prétendu qu’il fasse autorité parce que son argument serait imparable, ou établi sans conteste, est ainsi une échappatoire à l’argumentation : la conclusion est établie comme certaine – mais n’a pas été démontrée. L’argument est d’autorité. La méthode est douteuse.
Un moyen plus rapide encore de se priver d’explication sur l’expression d’un sens, sans paraître péremptoire, consiste à employer une appellation qui désigne tout un ensemble vague, incertain et non délimité d’auteurs qui l’auraient prétendument tous abordé de manière univoque : les réalistes, les mentalistes, les empiristes, les idéalistes, les métaphysiciens, les continentaux… L’attention du lecteur est portée sur le sens d’un nombre possiblement illimité d’énoncés parce que non circonscrits auxquels il songe dans l’instant à rattacher ces appellations. Les auteurs impliqués forment une masse indifférenciée parlent d’une seule voix, ou qui sont supposés avoir exprimé des sens qui relèvent de prémisses identiques ou formulables elles-mêmes selon des conditions similaires – ce qui signifie qu’elles ne seraient pas premières. Cela revient à citer le sens général d’un ensemble de monstrations singulières – ce qu’est le registre interprétatif vis-à-vis du registre narratif. Mais rien n’assure que ces catégories soient objectivement comprises, que le sens qu’elles recouvrent soit limpide pour l’auteur qui les cite, partagé par le lecteur – et qu’un travail critique ait été mené. Les catégories peuvent être un moyen de cibler, plus que le sens que l’on retient, les principes que l’on rejette ; d’évincer une catégorie d’auteurs de son discours : de parler entre soi.