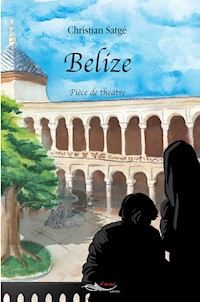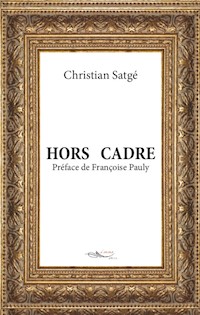Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Si par la force des mots on ne peut changer le monde, on peut le lire et le dire, y compris dans ce qu’il a de plus beau… ou de moins bon. Ainsi, en posant la plume pour que les vers s’envolent, on en fait un tableau à sa façon en brossant une nature que nous n’avons pas encore rendue totalement morte, ou en peignant des caractères brouillonnants malgré nos convenances et nos conventions, voire en esquissant un moment ou en estompant un instant de notre monde crayonné, pressé et pressant. Pour croquer sensations et sentiments, à dessein, sans rien farder, avec leurs ombres et leur lumière, il suffit d’encrer des lignes inégales, de « composer ». Mais jouer avec des sons pour tons et teintes, des traits pour lignes… c’est là que le cadre, parfois, blesse. Aussi, avec Nicolas Boileau (À M. de Molière, Satire II, Satires, 1666) je serine : « … Maudit soit le premier dont la verve insensée / Dans les bornes d’un vers renferma sa pensée, / Et, donnant à ses mots une étroite prison, / Voulut avec la rime enchaîner la raison ! / Sans ce métier fatal au repos de ma vie, / Mes jours, pleins de loisirs couleraient sans envie, / Je n’aurais qu’à chanter, rire, boire d’autant, / Et comme un gras chanoine, à mon aise et content, / Passer tranquillement, sans souci, sans affaire, / La nuit à bien dormir, et le jour à rien faire… »
À PROPOS DE L'AUTEUR
Christian Satgé, rimailleur rimant pourtant ici, propose, sa soixantaine approchant, un second volet de vers parés de vair et d’hivers vêtus de vert. En rien condamné à un exil poétique qui l’éloignerait de nous, il évoque ses paysages, intérieurs ou non, qu’on semble connaître, et les peuple d’êtres – réels ou bien fictifs ? – que l’on croit (re)connaitre. Peu ou prou…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Satgé
RECADRÉ ?
LA FAUTE AU TEMPS ?
Ce n’est pas le temps qui passe
C’est, hélas !, nous qui passons…
Le temps jamais rien ne casse
Mais nous, parfois, nous cassons…
Le temps pas plus ne se lasse
Quand nous, souvent, nous lassons…
INTRODUCTION
Lecteur, d’abord merci d’avoir entrouvert
Ces pages qui mettent notre monde en vers.
Mais sois indulgent, mon ami, à ce livre
Si, par malheur, il ne t’aide pas à vivre.
Réserve la sévérité ou le rejet
À de bien plus conséquents et nobles objets.
Croyant fuir l’hiver qui jà coule en mes veines,
Blanchit mes tempes de douleurs et de peines,
Pour feuiller mes jours à l’encre de mes mots
Et fleurir mes nuits à l’âcre de mes maux,
Il ne témoigne que des instants qu’on vole
À la vie si pressée comme au temps malivole.
C’est pour toi que je ne connais pas que j’écris.
Ton regard fera de ces chants et de ces cris
De la poésie et je prie, lors, pour qu’ils t’aident,
Que les lire soit un salutaire intermède,
Pour voir le monde tel qu’il est ou tel qu’il va
Au-delà de ses trames et de son canevas.
Bouts du monde
DANS LE LIT DU CIEL
Quand vous meublez de bruits le vide de vos vies
Et peuplez de feux sans joie des jours sans chaleur,
Aux heures étirant des nuits vivant sans envie,
Moi, je m’envole aux nues assécher ma douleur.
Sous la couverture de nuages roulés,
Parfois froissés d’ombres, souvent d’ambre ridés,
Je plonge et me vautre : ah, ces coins de ciels noueux
Ou écumeux qui font écho aux sols boueux !
Seul, dans une trouée, éclaboussé d’azur,
Frôlé de vagues floues, je vais aux dieux ocieux.
Mes draps blancs se heurtent à l’éther qui fut plus pur
Sans leurs plaies et bosses, divins reliefs des cieux.
Dans ce fatras fatal se pend la voix du vent ;
En atteste un voile de crêpe noir mouvant.
Voilà où je me perds, comme il n’est plus permis,
Au baldaquin griseux des mondes endormis !
AUPRÈS DE MON CANAL
Cycle toulousain
Au beau pays d’hier, auprès de mon canal,
Mes souvenirs s’en vont, d’un pas lent, machinal,
Pour me rappeler, ô combien, hélas !, me manquent
Ses si vieux platanes aux écureuils saltimbanques.
Moi, c’est là-bas que j’ai mes pas perdus,
Sur un chemin qui s’est un jour lassé
De voir haler des péniches assidues
À lier deux mers… et sans bardasser.
Sa poussière n’avait pas de prise
Sur mes godasses foulant la verdure,
Dans la solitude d’une déprise
Qui en faisait lors terre d’aventures.
Tout seuls, ma chienne et moi, sous son ombrée,
Nous marchions dans les bruits qui nous venaient
De ces routes déjà fort encombrées
Qui pouvaient, sous d’autres cieux, nous mener.
Moi, ne m’intéressaient que ses troncs, ses fourrés.
Je savais les chansons de ses oiseaux
Qui ridaient des flots toujours calmes, savourais
D’être hors du temps, lès massettes et roseaux.
Auprès de ce chenal laissé aux canes
Qui, déjà, le sillonnaient en silence
Et au néon des libellules, crânes,
Je vivais, un moment, dans l’indolence.
J’ai revu la tonnelle des feuillées.
Sous ce dais, en foule on s’amasse et crie
Ou on s’agite à petites foulées …
« La ville » aux rives désormais s’inscrit.
Nul ne voit sa verrière que vitraille
Des bleus paisibles, des verts sereins, l’ombrage
Qui appelle à des réflexions qui raillent
Un temps vil et vain qui serait notre “âge”.
Au beau pays d’hier, auprès de mon canal,
Ma mémoire revient, car vient le point final,
Pour me rappeler, ô combien, hélas !, me manquent
Ses si vieux platanes aux écureuils un brin branques.
BRUMEUX
DameBrume, ballerineauxbrasblancs,
Effacenotreforêtàpaslent
Aveclafatiguedecetteterre
Auxsillonsnus, auxsentierssolitaires …
Quandlanuitlisseglisseainsi, toujours
Àcevoiles’élimeunfildejour
Translucide. Ellefaitunedemeure,
Drapvaporeux comme seull’estunleurre,
Au-dessusdetout, au-dessusdenous,
Suspendantletempsqui, lors, sedénoue
Àcelinceul cru. Aussi, onoublie
Touteschoses, lesplusnoiresetlesroses,
Danscesévanescentsdrapsd’outrelit,
Quifontunnidentrelesnuesmoroses
Etnous. Ah, délicesdutempsperdu
Qui, soudain, semblecommesuspendu !
DameBrume, ballerineauxbrasblancs,
Inciteausongeloindesfaux-semblants
Quandtoutsedevine, toutsedessine,
Enesquisse, sanslueurassassine…
PRÉMICES DE PRINTEMPS
La source sourd dans le sous-bois,
Fatiguée par l’effort,
Déjà usée par le sort :
Aux vents doux qui jouent du hautbois,
Et à deux pas de nous,
Elle se perdra en boue.
Le ciel, de souffles sillonné,
Attise le vert neuf
D’un pré encore veuf
De ces troupeaux aiguillonnés
Qui, sans faim, y paîtront
Ou, sans fin, passeront.
Emmaillotées en bourgeons, feuilles
Et fleurs pointent leur nez
En ce printemps qui nait,
Lui promettant du chèvrefeuille
Les capiteux parfums
Dès les frimas défunts.
SEIZAINDESAISON
Unprintempsnousrenaîtdansl’haleinedesroses
Lesmontssedéfontdeleursoripeauxmoroses.
Lesversantsontdestonsd’ocre, debruns, deverts …
Quel’Artvoudraitavoirenfinredécouverts.
L’eaurivaliseaveclesoiseauxvirtuoses.
Sousl’égided’uncieltoutenmétamorphoses,
Phœbusrevienttrônersurceboutd’univers :
Jà, desombrestissent, àl’endroit, àl’envers,
Auxarbresreparésneprenantpluslapose.
Jouraprèsjour, lesprésremettentlecouvert.
Matin, unefraîchedouceuraentrouvert
Lesportesdubeautempsquel’Hivergardaitcloses.
Quelquestroupeauxpaissent, çàetlà, parlestravers
Alorsqueleursbergerscomposentchantsetvers
PourdesNinonquandunlitfleurisepropose.
Un printemps nous renaît dans l’haleine des roses…
APPARUT LE VISAGE DE POSÉÏDON
D’après une photo de Marc Rivrin
La tempête faisait rage, battant la côte
D’embruns déchaînés, de trombes d’eau tourmentées…
Quand le visage du Vieux surgit, oui cet hôte
Des flots encolérés, des flux désorientés.
Avec sa couronne en folles gerbes d’écume,
Il a une tête bonhomme, mais ce roi
Assaille un rivage éteint, en plein désarroi,
Le fracassant comme un marteau frappe l’enclume.
Écrasant ce monde las de sa majesté,
D’une ire divine qui tourne au fou délire
Dans un tumulte qui fait cesser d’exister.
Et puis, il disparut, comme au temps où les lyres
Rythmaient sacs et ressacs, dans son Antiquité,
Plus fort et plus loin… mais sa démence est restée.
À L’OUEST D’ÉDEN
À l’heure où, de tout mon corps, j’étais confiné
Sous un ciel qui grisait, vain, quand il ne pleurait,
Prisonnier d’écrans où peurs et mort affleuraient,
Mon coeur là-bas, en ce paradis, retournait…
Là-bas, c’est Bormes, où de blanches pierres s’endorment
Au soleil de Midi pile en points scintillants,
Éclats d’or relevant la grise ombre de l’orme,
Animant l’ocre de traits chauffés et brillants.
Mes mains vides caressent en pensée, comme ladre,
La serpentine qui, moirée, à fleur, encadre
Ces portes entr’ouvertes qui ont l’accent d’antan,
Que gardent des heurtoirs de fer d’un autre temps.
Là-bas, dans ces moments-là, même l’ombre est sèche,
Au pied de ces façades aux couleurs d’Italie,
Appuyées sur l’azur, où nul souffle ne crèche.
Aux venelles en lacis, c’est tout hier qu’on lit.
Mais dans ce dédale de ruelles montantes
Et tournantes, n’aie pas la démarche hésitante
Par les cuberts, ces rues de passé encombrées
Ou leurs calmes paliers descendants, pénombrés.
Là-bas, résonnent des tons fleuris sous les voûtes,
À l’heure où les volets repoussant la chaleur