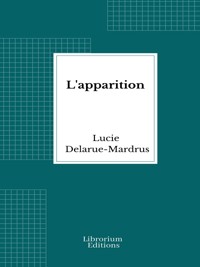Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Rédalga, roman captivant de Lucie Delarue-Mardrus publié en 1928, plonge le lecteur dans l'univers fascinant de la Belle Époque normande. L'héroïne éponyme, Rédalga, est une jeune femme passionnée en quête d'identité et d'émancipation. Élevée dans un milieu bourgeois étouffant, elle aspire à une vie plus libre et authentique. Sa rencontre avec la nature sauvage de la Normandie et un mystérieux étranger va bouleverser son existence, l'entraînant dans un tourbillon de passions et de découvertes. Le roman s'ouvre sur la vie monotone de Rédalga dans sa famille bourgeoise, où les conventions sociales et les attentes familiales pèsent lourdement sur ses aspirations. La jeune femme étouffe dans ce carcan et rêve d'une existence plus intense, plus vraie. C'est lors d'une escapade dans la campagne normande qu'elle fait la rencontre déterminante d'un homme énigmatique, qui éveille en elle des sentiments jusqu'alors inconnus. Delarue-Mardrus, avec sa plume sensible et poétique, dresse un portrait saisissant de cette femme en devenir, symbole d'une génération en pleine mutation. Elle décrit avec finesse l'éveil des sens de Rédalga, sa découverte de la passion amoureuse, mais aussi sa prise de conscience progressive de sa propre identité. Le conflit intérieur de l'héroïne, tiraillée entre ses désirs d'émancipation et le poids des conventions sociales, est au coeur du récit. La Normandie, avec ses paysages sauvages et sa nature luxuriante, joue un rôle crucial dans l'évolution de Rédalga. L'auteure utilise la description lyrique de cet environnement comme miroir des émotions tumultueuses de son personnage. La mer, les falaises, les prairies deviennent le théâtre d'une transformation intérieure profonde. Le roman, qui s'inscrit dans la catégorie « Littérature française », offre une réflexion profonde sur la condition féminine au début du XXe siècle. À travers le parcours de Rédalga, l'auteure explore les thèmes de l'émancipation, de l'amour et de la quête de soi, faisant de ce livre un incontournable des « Romans féminins » de son époque. Rédalga séduit par son analyse fine des tourments de l'âme, offrant aux lecteurs une plongée dans l'intimité d'une femme en lutte contre les conventions de son temps.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TABLE DES MATIÈRES
(ne fait pas partie de l’ouvrage original)
I —
Un orage de toute beauté…
II —
Personne ne l’attendait chez lui…
III —
Le joyeux dîner s’achevait…
IV —
Huit jours après cela…
V —
Jude n’avait pas pu s’empêcher…
VI —
Attablé devant un rond de galantine…
VII —
Samadel et son aide…
VIII —
Il avait dû la froisser…
IX —
Sans cesse « habiller »…
X —
Sa matinée du lendemain…
XI —
La fontaine s’achevait…
XII —
Des affaires de sentiment…
XIII —
Elle fumait, douloureuse et taciturne…
XIV —
Mary Backeray pouvait se demander…
XV —
Il s’était dépêché de finir le buste…
XVI —
Il était plus de onze heures…
XVII —
Harlingues dès le matin…
XVIII —
Il fallut bien reprendre le jeu…
XIX —
Que la pluie continuât à tomber…
XX —
La nouvelle figure de terre…
XXI —
Je vous arrachais à votre vice…
XXII —
Seule chose restée claire…
XXIII —
L’automne feutrée…
XXIV —
Pour expliquer l’affaire…
XXV —
Enfoncé dans l’auto d’Alvaro…
I
UN orage de toute beauté se déchaînait sur Paris.
Jude Harlingues ramassa le coussin crevé pour le mettre sur la table à modèle, et, dans sa longue blouse blanche, il s’étendit.
Sa tête s’abandonnait au creux des paumes. Elles parurent déborder de grappes de raisin violet. Il avait des petits yeux comme de cristal dans un maquis de cils noirs. Entièrement rasé, son masque était rude et sain.
La contemplation du spectacle électrique sur l’écran des vitrages reposa son grand corps. Il sentit du même coup qu’il était très fatigué. Jamais on ne s’en aperçoit pendant le travail.
Une nuit subite ayant envahi, les éclairs furent bleus et leurs brisures pointues se dessinèrent avec exactitude. Parmi ces géométries lumineuses, les éclats, roulements et déchirures de la foudre exagérèrent longtemps leur fracas de Jugement dernier, jusqu’à cette pluie formidable écrasée sur le verre.
En se redressant pour s’asseoir :
« C’est drôle un pareil éreintement !… pensait Harlingues. Je finirai par me claquer, moi ! »
Il regarda son atelier, étonné comme s’il eût fait connaissance. Désordre et saleté. C’est le décor ordinaire de la sculpture.
La meilleure moitié de sa jeunesse, déjà, s’était passée là-dedans, à piétiner dans le plâtre. Il fixa longuement, au centre de la cuve de glaise, la pelle fichée à même et restée debout. Une chaise de cuisine boitait, un petit poêle se rouillait dans le fond. Sur des planches, des maquettes et des moulages montaient jusqu’au haut des quatre murs. Il y avait des selles, armatures, blocs d’argile neuve, des boîtes sans couvercle pleines d’outils boueux, des caisses d’emballage démolies, de la paille, des loques, un seau d’eau sale.
Quatre immenses plâtres, statues dont deux terminées, faisaient les fantômes au milieu.
Les coudes sur les genoux, voici Jude Harlingues. Il hoche la tête, et son visage amer est celui d’une dupe.
Art ingrat, tu ne trouves ton expression finale qu’à travers toutes les fatigues de l’homme de peine.
C’est peu d’être un architecte muni de ses savants calculs, un dessinateur parfait, un érudit en anatomie, il faut encore être le maçon dans son chantier, le forgeron battant l’enclume, le bûcheron maniant la cognée. En proie aux difficultés d’une technique qui va des violences de la boxe à des méticulosités de manucure, pendant des mois de patience va se glacer le lyrisme du sculpteur, partagé sans cesse entre la fougue désinvolte de l’artiste et le labeur mesquin de l’ouvrier.
Harlingues n’a pas souvent, comme ce soir, le goût de bougonner assis sur une table à modèle les mains inoccupées.
« Les trois dimensions !… continue sa pensée, voilà le drame. La brutalité du cube, son réalisme ne permettent aucun trompe-l’œil, nul effet fixe imposé par l’artiste ; et sur cette matérialité si grossièrement évidente, se font et se défont, pourtant, d’après les éclairages, tous les châteaux de Morgane de la lumière jouant avec l’ombre. Décourageante fantasmagorie ! Il faut se garder à droite, à gauche, en haut, en bas, partout ! Je n’ai qu’à tourner ma statue d’un seul centimètre sur son support mouvant, et je verrai se détruire ce qui me semblait définitif, je constaterai qu’après des heures de travail et d’ardeur, tout est à recommencer. »
Ses dents se serrent. Il rage.
« Voilà. La longueur, la largeur et l’épaisseur, domaine mathématique, doivent s’entendre pour réaliser l’harmonie complète, s’entendre jusqu’au miracle, et, bloc sans couleur, devenir le royaume même de la nuance. Allez vous arranger avec ça ! »
Ce thème fut, d’autres fois, un enchantement pour lui. Le plaisir de vaincre constitue la moitié des joies artistiques. C’est peut-être une forme d’alpinisme. Mais il ne faut pas interrompre le travail, s’allonger la tête sur un coussin, laisser refluer la pensée. Le voilà malheureux. Alors, il cherche d’autres raisons de l’être.
Outre les quotidiennes déceptions du métier, les autres…
Il y a la cherté des matières premières, il y a les incessants débours qu’on doit faire avant même d’être sûr de rien praticiens, mouleurs, modèles, et marbre, et bronze si l’on va jusque-là, vastes dépenses qui n’ont chance d’être récupérées, sans même songer à des gains, que si l’acheteur surgit ou si la belle commande arrive, du fond d’un horizon plus encombré que d’autres par les intrigants, les malins, les protégés.
Et, quand l’œuvre est enfin debout, en face de cette accumulation de déboires et d’efforts que représente la moindre statue, voici le public, son ignorance, son indifférence pire.
Par un accord universel et tacite dirait-on, il est convenu que les statuaires sont voués à l’anonymat, comme jadis les constructeurs de cathédrales. À part deux ou trois initiés, qui connaît les auteurs des statues des Tuileries ? Quel journaliste, lorsque s’élève, en France, un monument à la gloire d’un grand civil ou des pauvres morts de la guerre, songea jamais à publier, près des noms des hommes politiques l’inaugurant et des femmes de théâtre y récitant des vers, celui de l’artiste qui l’a fait ?
« Je sais… Il y a les grands noms. Combien sont-ils ? Et puis tout cela n’est pas encore le plus triste. »
Écoutant la pluie, bruit du ciel tombant sur la terre, Harlingues se grise à répéter l’un de ses mots : « l’éternel désolé ».
Ses statues, à ses yeux, ne sont à peine que des ébauches. Sur chacune, il voudrait travailler avec cet acharnement solitaire qui finit sans doute par être une espèce de vice.
Une à une, il regarde sa Grande Initiée d’Eleusis, figure sans lendemain prévu, sa Notre-Dame du Nord, laissé-pourcompte d’une basilique reconstruite, et les deux allégories en chantier commandées par la Belgique. Ces quatre géantes, elles sont dans le plâtre, comme des infirmes. Reproche permanent, grandes comme ça, les maquettes, oubliées dans les coins, ont gardé pour elles une flamme non transmise. Cette chaleur du génie, comment la communiquer à l’amas de glaise froide qui fait craquer les phalanges, les menace de rhumatismes noueux, puis finit par s’aveulir jusqu’à ne plus rien conserver, pas même l’équilibre du monument ? Des semaines et des semaines de courage et d’éreintement n’ont pu donner à ces grandes machines la vie des toutes petites choses sorties en un quart d’heure de dix doigts fiévreux façonnant des rêves.
Il conclut brusquement en se disant qu’au bout du compte il vaudrait peut-être mieux crever tout de suite.
L’envie de la mort est déjà venue le chercher. C’était à de certaines heures d’ironie ou de colère. Les colères d’Harlingues sont rares, mais effrayantes. Il a une statue au Luxembourg, oui. À force de tergiversations de la part de l’État avare, il a fini, dégoûté, par lui en faire cadeau.
Médiocrement, il vit de quelques bustes, de quelques commandes provinciales ou religieuses. Avec un regard comme le sien, on est un innocent. Son art, qu’il aime jusqu’à vouloir en mourir, il ne sait en tirer argent ni gloire. Il est seul. À son départ pour la guerre, fils unique, il était orphelin de fraîche date. Son deuil et ce qu’il a vécu dans les tranchées n’ont formé qu’une seule mélasse d’horreur. Au retour, il aurait pu se marier pour refaire un nid humain et s’y réchauffer. Il n’a pas eu le temps. Il s’est jeté trop vite sur sa sculpture abandonnée.
Quand passe le banal amour, c’est sous les espèces de quelque modèle, unique occasion d’étreindre, vivante, une de ses statues.
Sa passion et sa pauvreté, c’est, en temps ordinaire, un beau destin. Ce soir, on ne sait pas pourquoi, c’est la défaite.
Il gronda tout haut, avec un regard de haine à ses deux allégories : « J’en ai assez ! Je m’en vais !… » et se leva pour ranger ses outils, petits outils de dentiste qui fouillent le plâtre exaspérant.
Celui qu’il tenait hésita dans ses doigts.
— Tiens ! tiens !… Dans ce jour-là, je vois, là-haut, des bavures qui m’avaient échappé…
La vraie nuit venait enfin dans un ciel riche d’ozone et couleur d’absinthe, belle soirée de juin après l’orage. Un petit brillant y brûlait déjà. Juché sur l’échafaudage, sans avoir la force de descendre pour allumer l’électricité, Jude Harlingues était encore là, noyé dans la pénombre, repris depuis plus de deux heures par son vice.
II
PERSONNE ne l’attendait chez lui. C’était un quartier sans charme, assez loin de l’atelier. Dans son intérieur drôle de célibataire, la concierge faisait le ménage quand elle avait le temps.
Mais, chaque soir, ponctuellement, un petit repas froid. Harlingues, en rentrant, trouvait cela sur la table de son salon ; car, n’ayant que deux pièces, il ne possédait pas de salle à manger.
C’était souvent à neuf ou dix heures du soir. S’arracher à son atelier devenait de plus en plus difficile.
Selon les jours, on peut répéter la même phrase sur deux modes : « Personne ne m’attend… quel bonheur !… » ou bien : « Personne ne m’attend… Quelle tristesse ! »
« Quelle tristesse » accompagna longtemps le va-et-vient du grattoir sur le plâtre ; puis tournoyèrent les obsédantes divagations que ressasse l’esprit pendant le travail des mains.
Quelle importance cela a-t-il dans l’univers, si je suis découragé de tout ? Artiste génial ou pauvre primaire, on n’en est pas moins un microbe de microbe. La terre, après tout, est une cellule dans le système solaire qui n’est lui- même qu’une cellule d’un autre système inconcevable, Quel enfer ! Et un enfer éternel, éternel !… Savoir… Comprendre… Je voudrais être un croyant. Quand je modelais ma Vierge du Nord, j’en étais un, presque. Mais le mysticisme s’évanouit trop souvent dès qu’apparaît un prêtre : Ils nous le rappellent tout de suite : l’Église n’est pas seulement encens, manteaux d’or et tout le beau cérémonial déployé devant l’Invisible, mais il y a aussi la bureaucratie de la religion, il y a le guichet comme dans toute administration. Il le faut, sinon rien ne marcherait, évidemment. Mais des prêtres qui seraient sacrés, qui seraient les vestales du culte !… Tant pis ! Il y a encore un culte, un peu de merveille sur la terre, et c’est déjà beau. J’aurais peut-être mieux aimé les dieux que Dieu, mais puisqu’ils n’est plus de grandes panathénées, vivent les processions ! Qu’au moins cela nous reste, Le jour où la religion disparaîtrait, rien ne nous sauverait plus de la férocité primordiale sur laquelle l’univers est établi. Car la nature, d’un bout à l’autre, n’est que cela : Férocité. Le monde animal s’entre-dévore, le monde végétal s’entre- étouffe, et ainsi de suite. Il n’y a, dans tout cela, que l’humain pour avoir inventé des idées comme : idéal, justice, prière… Ce ne sont peut-être que des mots. Cependant, les foules en vivent tant bien que mal. En dépit des accrocs (Oh ! quels accrocs !) ça tient tout de même. Pourquoi ça tient-il ? Faire des statues, par exemple, est-ce assez bête, aux yeux de la nature ! Pourquoi faire des statues ? Le chien qui lève la patte dessus est sans doute dans le vrai. Boire, manger, dormir, reproduire, respirer, fonctionner, voilà la vie : La férocité, voilà la vie… Heureux les féroces. Hélas ! J’en suis bien loin ! Pas si loin que ça ! Si l’on alignait toutes les bêtes que j’ai mangées depuis ma naissance, tout en cultivant l’art, l’idéal et le reste, quel cheptel ! Je suis aussi féroce que les fauves, puisque je me nourris des mêmes viandes qu’eux ; mais plus hypocrite. Pour rester logique, je devrais être végétarien. Mais qui nous a dit que les végétaux ne souffraient pas aussi ? Alors, quoi ? Boire du lait ? Je vole : la nourriture des pauvres petits veaux… Comme je suis fatigué ! Je vais rentrer décidément. Je crois aussi que je crève de faim. Lâchons notre statue pour aller manger notre tranche de jambon. Malheureux porc, on t’a assassiné pour moi. Quel mot sinistre : charcuterie… Je n’y vois plus du tout. C’est ridicule : je m’esquinte les yeux quand je pourrais allumer… Non. Il faut rentrer. Encore ce petit rien de grattoir ici… Microbe de microbe… Grandes panathénées… Férocité… Férocité…
Un coup dans la porte.
L’atelier donne directement, cahute perdue, sur la vieille rue silencieuse. Ils savent tous que Jude Harlingues y reste très tard.
Un praticien ? Un architecte ? Un mouleur ? Un camarade de collège ou de guerre ? Il y en a tant qui tournent dans sa vie, des humbles et des grands. Au hasard, il répond : « Entre ! La porte n’est pas fermée ! » Car, ouvriers ou riches amateurs, le tutoiement réciproque est toujours de mise. Le sculpteur est un tâcheron en même temps qu’un monsieur.
— Jude, écoute donc, dit, essoufflée, musicale, une voix d’étranger. Quelle veine que tu sois encore là. J’ai pensé que tu pouvais venir diner avec quelques amis et moi, ce soir, à Montparnasse.
— Comment ! Toi, Alvaro ? Tu es donc à Paris ? Attends que je descende et que j’allume !
— Oh !… dit l’autre devant l’immense statue subitement éclairée.
Il oublie qu’il est pressé, le but de sa visite.
— C’est-beau, tu sais, ce que tu fais là.
À ces mots, Harlingues met sa tête de côté pour regarder de bas en haut l’allégorie. Bienfait d’une petite louange qui tombe juste à temps sur le découragement de l’artiste !
— Tu trouves ?… C’est curieux ! Moi, depuis tantôt, je me dis que c’est du mauvais travail.
— Tues fou ! Je te surprends, au contraire, en plein génie. Quelle envolée, mon cher !… Et regarde comme tu as bien fait ta palette de lumière et d’ombre !… C’est admirable !
Alvaro parle sur un ton monocordes, sans aucun éclat, et qui donne plus de prix à ses paroles quand il s’exalte, ce qui n’est pas fréquent.
Il reprend, après contemplation :
— Et voilà ces belles choses que : j’aime depuis longtemps. Ta Vierge du Nord… et-ta Grande Initiée… Ah ! celle-là ! Si j’étais Français… Mais j’espère toujours la faire prendre par le musée de Lisbonne. Tu viendras voir le Portugal !… Ah ! voilà le plâtre du buste de Raul da Silva. Il en est si fier de son buste, si tu savais ! Il te rendra célèbre au Portugal. Et Olga, donc ! Elle ne parle que de toi, depuis qu’elle est retournée là-bas. Quant au mien, tu sais s’il a des admirateurs.
— C’est grâce à toi, tout ça, grand ami…
— Qu’est-ce que c’est que ça, à côté de ce que je voudrais pour toi ! Si seulement j’étais riche…
Être riche, pour le comte Alvaro, qu’est-ce que c’est ? Sa vie, distribuée entre Paris, Lisbonne et d’immenses voyages, a l’air d’être celle d’un millionnaire.
— Allons ! Je rêve, et le temps passe. Vite, Jude, défais ta blouse, et viens. Nos amis nous attendaient à huit heures. Il en est neuf. Ça ne fait rien, du reste !
— Mais je ne suis même pas rasé ! dit Jude en se dépêchant, et j’ai mon vieux veston de travail.
— Eh bien ! Je te jette chez toi et je t’attends dans la voiture. Je l’ai laissée au coin de la rue, On ne s’habille pas.
Tu vois, je ne suis pas en smoking. Nous sommes entre hommes. Il y a Ayrès, que tu connais, Rodrigo (un poète brésilien), et un Français, le peintre Lévesque qui m’a dit que vous étiez amis. |
— Lévesque ?… Je crois bien, c’est un copain ! Là… Me voilà ! Passe ! Je te suis pour éteindre derrière nous.
Le rythme de la partie de plaisir est déjà dans ses gestes vifs. Avec son admiration et son dîner imprévu, Alvaro, qu’il n’a pas vu depuis plus d’un an, ne se sait pas un sauveteur. Microbe de microbe… Mais s’amuser à Montparnasse en compagnie charmante, un soir que tout allait mal, voilà qui remet le cœur en place — et le système solaire aussi.
III
LE joyeux diner s’achevait aux premières explosions du jazz. Les couples allaient se mettre à danser. La parole coupée, Alvaro prit le parti de se taire. Il discutait comme du bout des lèvres avec le jeune poète brésilien. Les autres prenaient parti.
— Nous sommes l’avenir, nous !… s’écriait Rodrigo, regard de feu, dents éclatantes. Vous autres, vous êtes le passé. Nous ne méconnaissons pas vos droits d’aînesse. Nous vous respectons. Nous vous aimons.
— Oui, comme une grand’mère un peu gaga… L’Europe est pour vous une pourriture, rien de plus. Mais, au fond, comme vous êtes jaloux de nous, la vieille race blasonnée, jaloux de nos cathédrales, de notre histoire… Ce jazz est odieux, décidément !
Rodrigo ayant remarqué : « Comme ce serait mieux de t’entendre dans tes compositions !… » l’autre fit son petit sourire nostalgique.
Pâle, rasé, les yeux en grains de café sous un vaste front aux grands sourcils rapprochés et calmes, le nez gros, la bouche sans lèvres, le menton petit, avec ses cheveux lisses comme un plumage d’ébène, Alvaro, mince et sinueux, assez hautain, ressemblait à un cygne noir.
Harlingues se le disait en le considérant, Depuis que les hasards de l’art les avaient liés, il goûtait la culture universelle, la courtoisie de qualité, toutes les élégances de son camarade intermittent, et aussi ce qu’il répandait de fluides exotiques, malgré ses faux airs de snob parisien.
C’est le charme de certains étrangers de nous enchanter par des manières policées que nous n’avons plus entre Français parce qu’en famille on n’a pas besoin de se gêner.
Les Portugais, parmi toutes les nationalités qui ont choisi notre Paris, y apportent l’âme d’une race distinguée et mélancolique, peu connue chez nous qui n’avons pas étudié sur place les racines d’un pays accolé à l’Espagne et lui ressemblant si peu.
Quand Alvaro se met au piano pour y jouer en maître les choses les plus déchirantes avec l’air le plus indifférent, comment devinerions-nous que cette musique vient naturellement sous ses doigts, du fond des tavernes de Lisbonne et d’ailleurs où ceux du bas peuple, la guitare aux mains, improvisent, en même temps que l’air, les paroles désespérées qu’ils chantent pour se reposer du labeur quotidien, et s’intoxiquent de leur fado national, véritable morphine ? Comment nous douter que sa démarche et l’adresse de son moindre geste ont pour base ces danses ibériques que presque tous les Portugais du grand monde savent danser comme leur populaire ? Et pourquoi, lorsque son regard rêve, saurions-nous de quel romantisme à la Musset vit parfois chez lui ce peuple que nous n’allons jamais voir ?
Entre deux catastrophes de l’orchestre :
— Allons au bar, maintenant. Nous avons assez vu le charleston. En bas, il n’y a pas de jazz, et le public est tout de même plus drôle.
Consentants, ils se levèrent tous pour suivre Alvaro. Dans le café d’en bas la géographie entière est représentée par des consommateurs de tous pays. On y parle les langues les plus inconnues, très peu le français. La bohème étrangère est là chez elle, et ce sont les Parisiens qui y jouent le rôle d’intrus.
Harlingues, ne sortant jamais, croyait, en ce lieu bondé, si vite banal, faire un voyage autour du monde. Il avait bu beaucoup de champagne à table et la vie lui paraissait magnifique, surtout après sa journée en plein pessimisme. Dès le premier verre de la chose inconnue qu’on lui servait, ses yeux plus que pâles devinrent extrêmement tendres, et le bar tangua.
Lévesque, un peu moins gris que lui, s’intéressa beaucoup à la petite bonne femme qui circulait entre les tables, fille de dix-huit ans coiffée comme la Sarah Bernhardt de Bastien Le Page, très jolie, et dont les yeux cocaïnés, la pâleur transparente, la peau tendue sur les pommettes achevaient l’allure : une dame aux Camélias de 1927, personnification assez pathétique du romanesque moderne, qui ne va pas sans drogues, gouape et sens pratique.
— Regardez-la ! C’est la même Coco ! Elle va en mourir, ce n’est pas difficile à voir ! J’aimerais la peindre, avec son air de jeune martyre du vice et l’expression canaille de sa belle bouche qui doit dire tant d’horreurs à la minute !
— Démande-lui de poser !… fit Alvaro. Veux-tu que je te l’amène ?
— Non ! non !… Elle est plus mystérieuse d’un peu loin. Oh ! vous voyez comment elle s’est placée ? Debout sur cette marche, immobile et silencieuse, avec ses bras ! comme ça… On dirait qu’elle est crucifiée. Quel beau Rops !
— Moi, dit Rodrigo, j’aimerais mieux l’étudiante française (penchez-vous un peu, vous la verrez), qui emboîte ces deux Américains ; j’entends à peu près tout ce qu’elle dit, avec des phrases pédantes et pas mal d’éloquence.
Ayrès, seul de son bord, étudiait attentivement une tablée de Japonais. Jude Harlingues regardait tout et rien, heureux de se sentir heureux :
Les petits yeux intelligents d’Alvaro, depuis un moment, surveillaient la table mitoyenne. Il finit par attirer l’attention des autres.
Péremptoire et musical :
— Il y a quelque chose, à notre droite, de bien plus curieux que tout le reste : c’est cette femme pas jeune, toute seule à une table, et qui siffle des petits verres en monologuant. Vous voyez ce que je veux dire ? On croirait une pauvresse de Londres. Taisez-vous un peu que j’essaie d’entendre dans quelle langue elle parle, et ce qu’elle dit.
Ils tendirent l’oreille en affectant d’allumer leurs cigarettes.
Alvaro triompha tout bas :
— C’est bien ça !… De l’anglais. Vous entendez ?
Au bout d’un moment, les prunelles de Rodrigo jetèrent un éclair.
— Ce sont des vers !… murmura-t-il. Je saisis bien qu’elle les scande, mais je ne peux pas attraper les mots,
La rumeur du café, pâte épaisse comme l’air qui s’y respirait, étouffait les syllabes à mesure sur la bouche pâle de cette Anglaise évidemment ivre-morte.
— Alvaro ?… Va nous la chercher !… supplia le petit Brésilien. Il faut absolument savoir ce que c’est.
Et, tranquille comme toujours, Alvaro se leva, mince gentilhomme aux belles manières. Il s’inclina devant la buveuse et lui demanda dans sa langue si elle ne désirait pas des cigarettes, car il remarquait qu’elle n’avait plus devant elle qu’une boîte vide. Une seconde plus tard elle quittait sa place pour venir s’asseoir au milieu des cinq garçons. Elle le fit avec un front bas et des yeux peureux sous son vieux chapeau d’homme. Jupe courte devant, longue derrière, veste élimée, cache-col crasseux, ; mèches tortillées et rouges traînant dessus, elle était grande, raide, large d’épaules. L’ombre du feutre très descendu sur les yeux ne laissait en lumière que le bout de son nez et sa mâchoire, les deux bien britanniques, c’est-à-dire d’une brutalité fort distinguée.
Toutes les boîtes de cigarettes se tendirent à la fois vers elle. Elle choisit, hésitante, puis se mit à fumer en silence. Alors chacun à son tour posa sa question.
— Qu’est-ce que vous voulez prendre ? demanda en anglais Alvaro.
Elle exprima du geste : « N’importe quoi. »
Rodrigo dit, également en anglais :
— Ce sont des vers que vous récitiez, tout à l’heure ?
Le regard par terre, elle répondit :
— Yes.
Harlingues, qui ne savait d’anglais que ce qu’on en apprend au collège, cria comme à une sourde :
— Parlez français, vous ?
— No.
Lévesque en savait encore moins qu’Harlingues :
— Pas un seul mot ? Non ? Pas comprendre ?
— Une tû pétit piou.
Et Ayrès, pour finir :
— What verses where you reciting ? (Quels vers récitiez- vous ?)
Elle parut gênée par cette interrogation directes Son menton tomba plus bas encore, et, comme honteuse, elle murmura :
— Mine ! (les miens !)
— Ça, s’écria Rodrigo sans se gêner, puisqu’elle ne comprenait pas, ça devient tout à fait intéressant, par exemple !
— Il reprit l’anglais :
— Are you a poet ? (Vous êtes poète ?).
Elle renvoya sa fumée par le nez, et son menton répondit oui.
— Do recite us some of your verses, please ! We all are artists. I am myself a poet.
(Récitez-nous de vos vers, voulez-vous ? Nous sommes tous des artistes. Moi je suis poète aussi.)
Mais, sans regardez personne, elle secoua la tête :
— Not here ! (Pas ici !)
— You were just reciting some of them ! (Vous en disiez bien tout à l’heure !)
— It is because I was all alone. (C’est parce que j’étais toute seule.)
— Why are you alone ? (Pourquoi êtes-vous seule ?)
— Nobody in my life. (Il n’y a personne dans ma vie.)
— Ah ?…
Elle avala d’un seul trait le verre d’effroyable alcool que le garçon vint lui servir après les signes d’Alvaro.
— Enncôre !… dit-elle.
Et tous se mirent à rire de bon cœur.
À partir de cet instant, Jude, Alvaro, Rodrigo se firent un jeu de lui verser des choses dans ce verre, tout en essayant de la faire parler. Ce pantin tombé dans leur soirée leur avait fait à tous oublier le reste.
— Qu’est-ce que ça peut être que ce numéro-là ?… répétait sans cesse Lévesque.
— Elle est gentille, ta poétesse ! gouaillait Alvaro.
Le Brésilien rétorquait :
— On ne sait jamais. Je vais lui donner ma carte et prendre son adresse. Je tiens à connaître ses vers. Ils sont peut-être très beaux.
Ayrès, lui, faisait une moue de dégoût. Quant à Jude Harlingues, pris d’un sommeil de petit enfant, pour finir il assistait au reste de la séance sans y prendre part. Et son intelligence plongeait dans un rêve de plus en plus vague.
IV
HUIT jours, après cela, passèrent sans nouvelles d’Alvaro : Mais le sculpteur ne se fût guère étonné de le savoir retourné subitement dans son pays ou parti pour quelque Amérique.
Depuis les années qu’il projetait ce tendre travail, n’avait-il pas mieux fait de longuement penser l’œuvre avant d’oser y mettre la main ?
Une pâle photographie d’amateur était son unique document. Cependant il lui semblait que sa vieille morte posait pour lui dans l’invisible.
Pourquoi ne sait-on pas prévoir la mort possible de ceux qu’on aime ? Tant qu’elle avait vécu, la présence de sa mère, naturelle comme l’air qu’on respire, le laissait sans inspiration artistique.
Il regrettait, et jusqu’aux larmes, cette négligence. La petite dame âgée, toujours de noir vêtue, si proprette sous ses frisettes blanches, il ne s’habituait pas encore, malgré ce qu’il avait traversé depuis, à sa disparition totale.
Elle lui avait donné sa ressemblance. Ses yeux trop clairs, qu’en restait-il, sous la terre ? Ce n’était pas sans frisson qu’il essayait de les ressusciter dans la glaise opiniâtre. En tournant autour du buste, il ne se répétait qu’un seul mot : Maman. Et cela voulait dire, comme pour beaucoup d’hommes, tous les charmes de sa vie.
À cause d’elle, il avait fait le-petit gosse à la maison bien après l’âge où les garçons s’en vont mener à part leur existence d’homme. Son père, médiocre médecin de quartier, toujours dur et maussade pour cette femme de choix, ne pouvait l’admettre supérieure à lui.