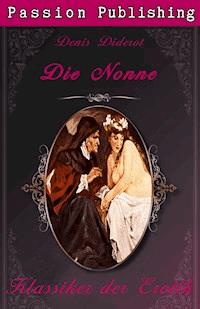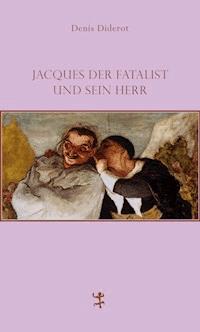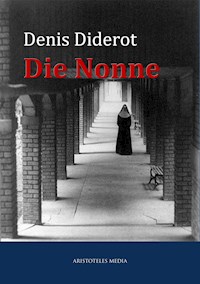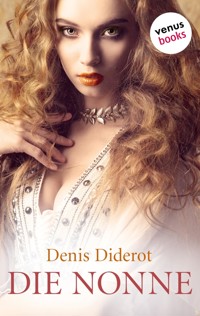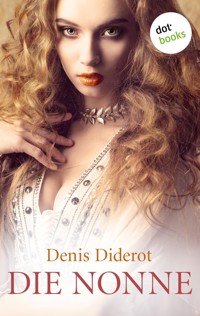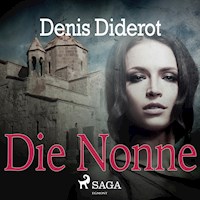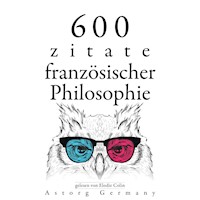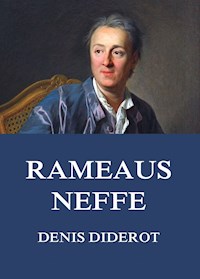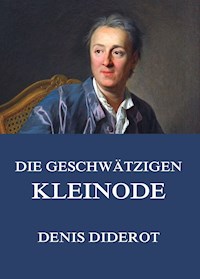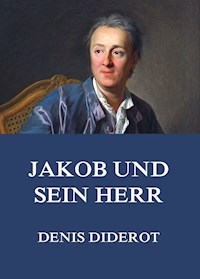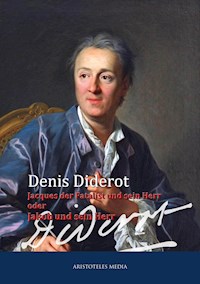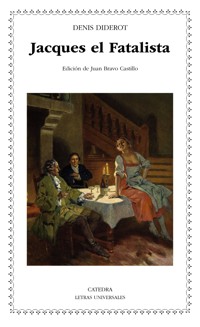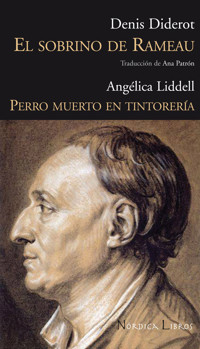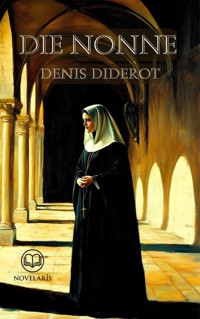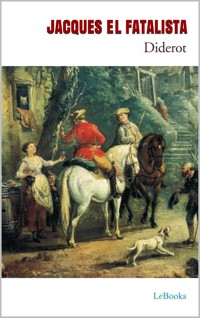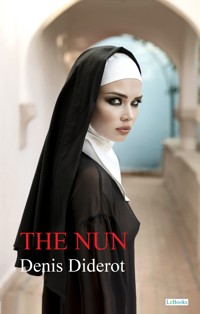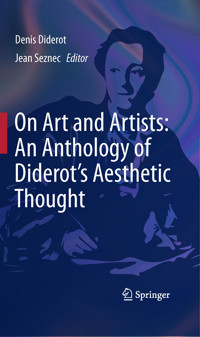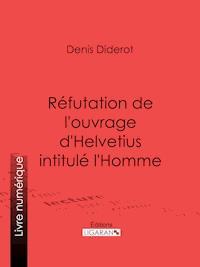
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait de la notice préliminaire : "On a dit que Diderot avait collaboré activement au premier ouvrage d'Helvétius: De l'Esprit. Il est difficile et de nier cette collaboration et de la prouver. Il a sans doute fourni des pages. Il a certainement donné le point de départ: le paradoxe, comme il l'appelle ; mais il a dû laisser Helvétius employer ces matériaux à sa façon et les mettre lui-même dans l'ordre méthodique qu'il affectionnait."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335001334
©Ligaran 2015
Aucun ouvrage n’a fait autant de bruit. La matière et le nom de l’auteur y ont contribué. Il y a quinze ans que l’auteur y travaille ; il y en a sept ou huit qu’il a quitté sa place de fermier général pour prendre la femme qu’il a, et s’occuper de l’étude des lettres et de la philosophie. Il vit pendant six mois de l’année à la campagne, retiré avec un petit nombre de personnes qu’il s’est attachées ; et il a une maison fort agréable à Paris. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il ne tient qu’à lui d’être heureux ; car il a des amis, une femme charmante, du sens, de l’esprit, de la considération dans ce monde, de la fortune, de la santé et de la gaîté… Les sots, les envieux et les bigots ont dû se soulever contre ses principes ; et c’est bien du monde… L’objet de son ouvrage est de considérer l’esprit humain sous différentes faces, et de s’appuyer partout de faits. Ainsi il traite d’abord de l’esprit humain en lui-même. Il le considère ensuite relativement à la vérité et à l’erreur… Il paraît attribuer la sensibilité à la matière en général ; système qui convient fort aux philosophes et contre lequel les superstitieux ne peuvent s’élever sans se précipiter dans de grandes difficultés. Les animaux sentent, on n’en peut guère douter : or, la sensibilité est en eux ou une propriété de la matière, ou une qualité d’une substance spirituelle. Les superstitieux n’osent avouer ni l’un ni l’autre… L’auteur de l’Esprit réduit toutes les fonctions intellectuelles à la sensibilité. Apercevoir ou sentir, c’est la même chose, selon lui. Juger ou sentir, c’est la même chose… Il ne reconnaît de différence entre l’homme et la bête, que celle de l’organisation. Ainsi, allongez à un homme le museau ; figurez-lui le nez, les yeux, les dents, les oreilles comme à un chien ; couvrez-le de poils ; mettez-le à quatre pattes ; et cet homme, fût-il un docteur de Sorbonne, ainsi métamorphosé, fera toutes les fonctions du chien ; il aboiera, au lieu d’argumenter ; il rongera des os, au lieu de résoudre des sophismes ; son activité principale se ramassera vers l’odorat ; il aura presque toute son âme dans le nez ; et il suivra un lapin ou un lièvre à la piste, au lieu d’éventer un athée ou un hérétique… D’un autre côté, prenez un chien ; dressez-le sur les pieds de derrière, arrondissez-lui la tête, raccourcissez-lui le museau, ôtez-lui le poil et la queue, et vous en ferez un docteur, réfléchissant profondément sur les mystères de la prédestination et de la grâce… Si l’on considère qu’un homme ne diffère d’un autre homme que par l’organisation, et ne diffère de lui-même que par la variété qui survient dans les organes ; si on le voit balbutiant dans l’enfance, raisonnant dans l’âge mûr, et balbutiant derechef dans la vieillesse ; ce qu’il est dans l’état de santé et de maladie, de tranquillité et de passion, on ne sera pas éloigné de ce système… En considérant l’esprit relativement à l’erreur et à la vérité, M. Helvétius se persuade qu’il n’y a point d’esprit faux. Il rapporte tous nos jugements erronés à l’ignorance, à l’abus des mots et à la fougue des passions… Si un homme raisonne mal, c’est qu’il n’a pas les données pour raisonner mieux. Il n’a pas considéré l’objet sous toutes ses faces. L’auteur fait l’application de ce principe au luxe, sur lequel on a tant écrit pour et contre. Il fait voir que ceux qui l’ont défendu avaient raison, et que ceux qui l’ont attaqué avaient aussi raison dans ce qu’ils disaient les uns et les autres. Mais ni les uns ni les autres n’en venaient à la comparaison des avantages et des désavantages, et ne pouvaient former un résultat, faute de connaissances. M. Helvétius résout cette grande question ; et c’est un des plus beaux endroits de son livre… Ce qu’il dit de l’abus des mots est superficiel, mais agréable. En général, c’est le caractère principal de l’ouvrage, d’être agréable à lire dans les matières les plus sèches, parce qu’il est semé d’une infinité de traits historiques qui soulagent. L’auteur fait l’application de l’abus des mots à la matière, au temps et à l’espace. Il est ici fort court et fort serré ; et il n’est pas difficile de deviner pourquoi. Il y en a assez pour mettre un bon esprit sur la voie, et pour faire jeter les hauts cris à ceux qui nous jettent de la poussière aux yeux par état… Il applique ce qu’il pense des erreurs de la passion à l’esprit de conquête et à l’amour de la réputation ; et en faisant raisonner deux hommes à qui ces deux passions ont troublé le jugement, il montre comment les passions nous égarent en général. Ce chapitre est encore fourré d’historiettes agréables, et d’autres traits hardis et vigoureux. Il y a un certain prêtre égyptien qui gourmande très éloquemment quelques incrédules, de ce qu’ils ne voient dans le bœuf Apis qu’un bœuf ; et ce prêtre ressemble à beaucoup d’autres… Voilà en abrégé l’objet et la matière du premier discours. Il y en a trois autres dont nous parlerons dans la suite.
Après avoir considéré l’esprit en lui-même, M. Helvétius le considère par rapport à la société. Selon lui, l’intérêt général est la mesure de l’estime que nous faisons de l’esprit, et non la difficulté de l’objet ou l’étendue des lumières. Il en pouvait citer un exemple bien frappant. Qu’un géomètre place trois points sur son papier ; qu’il suppose que ces trois points s’attirent tous les trois dans le rapport inverse du carré des distances, et qu’il cherche ensuite le mouvement et la trace de ces trois points. Ce problème résolu, il le lira dans quelques : séances d’Académie : on l’écoutera ; on imprimera sa solution dans un recueil ou elle sera confondue avec mille autres, et oubliée ; et à peine en sera-t-il question ni dans le monde, ni entre les savants. Mais si ces trois points viennent à représenter les trois corps principaux de la nature ; que l’un s’appelle la terre, l’autre, la lune, et le troisième le soleil ; alors la solution du problème des trois points représentera la loi des corps célestes : le géomètre s’appellera Newton ; et sa mémoire vivra éternellement parmi les hommes. Cependant que les trois points ne soient que trois points, ou que ces trois points représentent trois corps célestes, la sagacité est la même, mais l’intérêt est tout autre, et la considération publique aussi. Il faut porter le même jugement de la probité. L’auteur la considère en elle-même, ou relativement à un particulier, à une petite société, à une nation, à différents siècles, à différents pays, et à l’univers entier. Dans tous ces rapports, l’intérêt est toujours la mesure du cas qu’on en fait. C’est même cet intérêt qui la constitue : en sorte que l’auteur n’admet point de justice ni d’injustice absolue. C’est son second paradoxe… Ce paradoxe est faux en lui-même, et dangereux à établir : faux parce qu’il est possible de trouver dans nos besoins naturels, dans notre vie, dans notre existence, dans notre organisation et notre sensibilité qui nous exposent à la douleur, une base éternelle du juste et de l’injuste, dont l’intérêt général et particulier fait ensuite varier la notion en cent mille manières différentes. C’est, à la vérité, l’intérêt général et particulier qui métamorphose l’idée de juste et d’injuste ; mais son essence en est indépendante. Ce qui paraît avoir induit notre auteur en erreur, c’est qu’il s’en est tenu aux faits qui lui ont montré le juste ou l’injuste sous cent mille formes opposées, et qu’il a fermé les yeux sur la nature de l’homme, où il en aurait reconnu les fondements et l’origine… Il me paraît n’avoir pas eu une idée exacte de ce qu’on entend par la probité relative à tout l’univers. Il en a fait un mot vide de sens : ce qui ne lui serait point arrivé, s’il eût considéré qu’en quelque lieu du monde que ce soit, celui qui donne à boire à l’homme qui a soif, et à manger à celui qui a faim, est un homme de bien ; et que la probité relative à l’univers n’est autre chose qu’un sentiment de bienfaisance qui embrasse l’espèce humaine en général ; sentiment qui n’est ni faux ni chimérique… Voilà l’objet et l’analyse du discours, où l’auteur agite encore, par occasion, plusieurs questions importantes, telles que celles des vraies et des fausses vertus, du bon ton, du bel usage, des moralistes, des moralistes hypocrites, de l’importance de la morale, des moyens de la perfectionner.
L’objet de son troisième discours, c’est l’esprit considéré, ou comme un don de la nature, ou comme un effet de l’éducation. Ici, l’auteur se propose de montrer que, de toutes les causes par lesquelles les hommes peuvent différer entre eux, l’organisation est la moindre ; en sorte qu’il n’y a point d’homme en qui la passion, l’intérêt, l’éducation, les hasards n’eussent pu surmonter les obstacles de la nature, et en faire un grand homme ; et qu’il n’y a pas non plus un grand homme, dont le défaut de passion, d’intérêt, d’éducation et de certains hasards n’eussent pu faire un stupide, en dépit de la plus heureuse organisation. C’est son troisième paradoxe. Credat judæus Apella… L’auteur est obligé ici d’apprécier toutes les qualités de l’âme, considérées dans un homme relativement à un autre ; ce qu’il fait avec beaucoup de sagacité : et quelque répugnance qu’on ait à recevoir un paradoxe aussi étrange que le sien, on ne le lit pas sans se sentir ébranlé… Le faux de tout ce discours me paraît tenir à plusieurs causes, dont voici les principales : 1° l’auteur ne sait pas, ou paraît ignorer la différence prodigieuse qu’il y a entre les effets (quelque légère que soit celle qu’il y a entre les causes), lorsque les causes agissent longtemps et sans cesse ; 2° il n’a pas considéré ni la variété des caractères, l’un froid, l’autre lent ; l’un triste, l’autre mélancolique, gai, etc. ; ni l’homme dans ses différents âges ; dans la santé et dans la maladie ; dans le plaisir et dans la peine ; en un mot, combien il diffère de lui-même en mille circonstances où il survient le plus léger dérangement dans l’organisation. Une légère altération dans le cerveau réduit l’homme de génie à l’état d’imbécillité. Que fera-t-il de cet homme, si l’altération, au lieu d’être accidentelle et passagère, est naturelle ? 3° il n’a pas vu qu’après avoir fait consister toute la différence de l’homme à la bête dans l’organisation, c’est se contredire que de ne pas faire consister aussi toute la différence de l’homme de génie à l’homme ordinaire dans la même cause. En un mot, tout le troisième discours me semble un faux calcul, où l’on n’a fait entrer ni tous les éléments, ni les éléments qu’on a employés, pour leur juste valeur. On n’a pas vu la barrière insurmontable qui sépare l’homme que la nature a destiné à quelque fonction, de l’homme qui n’y apporte que du travail, de l’intérêt, de l’attention, des passions… Ce discours, faux dans le fond, est rempli de beaux détails sur l’origine des passions, sur leur énergie, sur l’avarice, sur l’ambition, l’orgueil, l’amitié, etc… L’auteur avance, dans le même discours, sur le but des passions, un quatrième paradoxe ; c’est que le plaisir physique est le dernier objet qu’elles se proposent ; ce que je crois faux encore. Combien d’hommes qui, après avoir épuisé dans leur jeunesse tout le bonheur physique qu’on peut espérer des passions, deviennent les uns avares, les autres ambitieux, les autres amoureux de la gloire ! Dira-t-on qu’ils ont en vue, dans leur passion nouvelle, ces biens mêmes dont ils sont dégoûtés ?… De l’esprit, de la probité, des passions, M. Helvétius passe à ce que ces qualités deviennent sous différents gouvernements, et surtout sous le despotisme. Il n’a manqué à l’auteur que de voir le despotisme comme une bête assez hideuse pour donner à ces chapitres plus de coloris et de force. Quoique remplis de vérités hardies, ils sont un peu languissants.
Le quatrième discours de M. Helvétius considère l’esprit sous ses différentes faces : c’est ou le génie, ou le sentiment, ou l’imagination, ou l’esprit proprement dit, ou l’esprit fin, ou l’esprit fort, ou le bel esprit, ou le goût, ou l’esprit juste, ou l’esprit de société, ou l’esprit de conduite, ou le bon sens, etc. D’où l’auteur passe à l’éducation et au genre d’étude qui convient selon la sorte d’esprit qu’on a reçue… Il est aisé de voir que la base de cet ouvrage est posée sur quatre grands paradoxes… La sensibilité est une propriété générale de la matière : Apercevoir, raisonner, juger, c’est sentir : premier paradoxe… Il n’y a ni justice, ni injustice absolue. L’intérêt général est la mesure de l’estime des talents, et l’essence de la vertu : second paradoxe… C’est l’éducation et non l’organisation qui fait la différence des hommes ; et les hommes sortent des mains de la nature, tous presque également propres à tout : troisième paradoxe… Le dernier but des passions sont les biens physiques : quatrième paradoxe… Ajoutez à ce fonds une multitude incroyable de choses sur le culte public, les mœurs et le gouvernement ; sur l’homme, la législation et l’éducation ; et vous connaîtrez toute la matière de cet ouvrage. Il est très méthodique ; et c’est un de ses défauts principaux : premièrement, parce que la méthode, quand elle est d’appareil, refroidit, appesantit et ralentit ; secondement, parce qu’elle ôte à tout l’air de liberté et de génie ; troisièmement, parce qu’elle a l’aspect d’argumentation ; quatrièmement, et cette raison est particulière à l’ouvrage, c’est qu’il n’y a rien qui veuille être prouvé avec moins d’affectation, plus dérobé, moins annoncé qu’un paradoxe. Un auteur paradoxal ne doit jamais dire son mot, mais toujours ses preuves : il doit entrer furtivement dans l’âme de son lecteur, et non de vive force. C’est le grand art de Montaigne, qui ne veut jamais prouver, et qui va toujours prouvant, et me ballottant du blanc au noir, et du noir au blanc. D’ailleurs, l’appareil de la méthode ressemble à l’échafaud qu’on laisserait toujours subsister après que le bâtiment est élevé. C’est une chose nécessaire pour travailler, mais qu’on ne doit plus apercevoir quand l’ouvrage est fini. Elle marque un esprit trop tranquille, trop maître de lui-même. L’esprit d’invention s’agite, se meut, se remue d’une manière déréglée ; il cherche. L’esprit de méthode arrange, ordonne, et suppose que tout est trouvé… Voilà le défaut principal de cet ouvrage. Si tout ce que l’auteur a écrit eût été entassé comme pêle-mêle, qu’il n’y eût eu que dans l’esprit de l’auteur un ordre sourd, son livre eût été infiniment plus agréable, et, sans le paraître, infiniment plus dangereux… Ajoutez à cela qu’il est rempli d’historiettes : or, les historiettes vont à merveille dans la bouche et dans l’écrit d’un homme qui semble n’avoir aucun but, et marcher en dandinant et nigaudant ; au lieu que ces historiettes n’étant que des faits particuliers, on exige de l’auteur méthodique des raisons en abondance et des faits avec sobriété… Parmi les faits répandus dans le livre de l’Esprit, il y en a de mauvais goût et de mauvais choix. J’en dis autant des notés. Un ami sévère eût rendu en cela un bon service à l’auteur : D’un trait de plume, il en eût ôté tout ce qui déplaît… Il y a dans cet ouvrage des vérités qui contristent l’homme, annoncées trop crûment… Il y a des expressions qui se prennent dans le monde communément en mauvaise part, et auxquels l’auteur donne, sans en avertir, une acception différente. Il aurait dû éviter cet inconvénient… Il y a des chapitres importants, qui ne sont que croqués… Dix ans plus tôt, cet ouvrage eût été tout neuf ; mais aujourd’hui l’esprit philosophique a fait tant de progrès, qu’on y trouve peu de choses nouvelles… C’est proprement la préface de l’Esprit des lois, quoique l’auteur ne soit pas toujours du sentiment de Montesquieu… Il est inconcevable que ce livre, fait exprès pour la nation, car partout il est clair, partout amusant, ayant partout du charme, les femmes y paraissant partout comme les idoles de l’auteur, étant proprement le plaidoyer des subordonnés contre leurs supérieurs, paraissant dans un temps où tous les ordres foulés sont assez mécontents, où l’esprit de fronde est plus à la mode que jamais, où le gouvernement n’est ni excessivement aimé, ni prodigieusement estimé ; il est bien étonnant que, malgré cela, il ait révolté presque tous les esprits. C’est un paradoxe à expliquer… Le style de cet ouvrage est de toutes les couleurs, comme l’arc-en-ciel : folâtre, poétique, sévère, sublime, léger, élevé, ingénieux, grand, éclatant, tout ce qu’il plaît à l’auteur et au sujet… Résumons. Le livre de l’Esprit est l’ouvrage d’un homme de mérite. On y trouve beaucoup de principes généraux qui sont faux ; mais, en revanche, il y a une infinité de vérités de détail. L’auteur a monté la métaphysique et la morale sur un haut ton ; et tout écrivain qui voudra traiter la même matière, et qui se respectera, y regardera de près. Les ornements y sont petits pour le bâtiment. Les choses d’imagination sont trop faites : il n’y a rien qui aime tant le négligé et l’ébouriffé que la chose imaginée. La clameur générale contre cet ouvrage montre peut-être combien il y a d’hypocrites de probité. Souvent les preuves de l’auteur sont trop faibles, eu égard à la force des assertions ; les assertions étant surtout énoncées nettement et clairement. Tout considéré, c’est un furieux coup de massue porté sur les préjugés en tout genre. Cet ouvrage sera donc utile aux hommes. Il donnera par la suite de la considération à l’auteur ; et quoiqu’il n’y ait pas le génie qui caractérise l’Esprit des lois de Montesquieu, et qui règne dans l’Histoire naturelle de Buffon, il sera pourtant compté parmi les grands livres du siècle.
Page 1. –Si j’eusse donné ce livre de mon vivant, je me serais exposé à la persécution, et n’aurais accumulé sur moi ni richesses, ni dignités nouvelles.
On verra dans la suite combien cet aveu est contraire aux principes de l’auteur. Et pourquoi l’aurait-il donc donné ?
Page 10. –La nation (française) est aujourd’hui le mépris de l’Europe. Nulle crise salutaire ne lui rendra sa liberté ; c’est par la consomption qu’elle périra. La conquête est le seul remède à ses malheurs ; et c’est le hasard et les circonstances qui décident de l’efficacité d’un tel remède.
L’expérience actuelle prouve le contraire. Que les honnêtes gens qui occupent à présent les premières places de l’État les conservent seulement pendant dix ans, et tous nos malheurs seront réparés.
Le rétablissement de l’ancienne magistrature a ramené le temps de la liberté.
Nous avons vu longtemps les bras de l’homme lutter contre les bras de la nature ; mais les bras de l’homme se lassent, et les bras de la nature ne se lassent point.
Un royaume tel que celui-ci, se compare fort bien à une énorme cloche mise en volée. Une longue suite d’enfants imbéciles s’attachent à la corde, et font tous leurs efforts pour arrêter la cloche dont ils diminuent successivement les oscillations ; mais il survient tôt ou tard un bras vigoureux qui lui restitue tout son mouvement.
Sous quelque gouvernement que ce soit, la nature a posé des limites au malheur des peuples. Au-delà de ces limites, c’est ou la mort, ou la fuite, ou la révolte. Il faut rendre à la terre une portion de la richesse qu’on en obtient ; il faut que l’agriculteur et le propriétaire vivent. Cet ordre des choses est éternel, le despote le plus inepte et le plus féroce ne saurait l’enfreindre.
J’écrivais avant la mort de Louis XV : « Cette préface est hardie : l’auteur y prononce sans ménagement que nos maux sont incurables. Et peut-être aurais-je été de son avis, si le monarque régnant avait été jeune. »
On demandait un jour comment on rendait les mœurs à un peuple corrompu. Je répondis : Comme Médée rendit la jeunesse à son père, en le dépeçant et le faisant bouillir… Alors, cette réponse n’aurait pas été très déplacée.
L’auteur emploie les quinze chapitres qui forment cette section à établir son paradoxe favori, « que l’éducation seule fait toute la différence entre des individus à peu près bien organisés » condition dans laquelle il ne fait entrer ni la force, ni la faiblesse, ni la santé, ni la maladie, ni aucune de ces qualités physiques ou morales qui diversifient les tempéraments et les caractères.
Page 2. –J’ai regardé l’esprit, le génie et la vertu comme le produit de l’instruction.
– Seule ?
–Cette idée me paraît toujours vraie.
– Elle est fausse, et c’est par cette raison qu’elle ne sera jamais assez prouvée.
–On m’a accordé que l’éducation avait sur le génie, sur le caractère des hommes et des peuples plus d’influence qu’on ne l’aurait cru.
– Et c’est tout ce qu’on pouvait vous accorder.
Page 4. –Si l’organisation nous fait presque entier ce que nous sommes, à quel titre reprocher au maître l’ignorance et la stupidité de ses élèves.
Je ne connais pas de système plus consolant pour les parents et plus encourageant pour les maîtres. Voilà son avantage.
Mais je n’en connais pas de plus désolant pour les enfants qu’on croit également propres à tout ; de plus capable de remplir les conditions de la société d’hommes médiocres, et d’égarer le génie qui ne fait bien qu’une chose ; ni de plus dangereux par l’opiniâtreté qu’il doit inspirer à des supérieurs qui, après avoir appliqué longtemps et sans fruit une classe d’élèves à des objets pour lesquels ils n’avaient aucune disposition naturelle, les rejetteront dans le monde où ils ne seront plus bons à rien. On ne donne pas du nez à un lévrier, on ne donne pas la vitesse du lévrier à un chien-couchant ; vous aurez beau faire, celui-ci gardera son nez, et celui-là gardera ses jambes.
Page 5. –L’homme naît ignorant, il ne naît point sot ; et ce n’est pas même sans peine qu’il le devient.
C’est presque le contraire qu’il fallait dire. L’homme naît toujours ignorant, très souvent sot ; et quand il ne l’est pas, rien de plus aisé que de le rendre tel, ni malheureusement de plus conforme à l’expérience.
La stupidité et le génie occupent les deux extrémités de l’échelle de l’esprit humain. Il est impossible de déplacer la stupidité ; il est facile de déplacer le génie.
Page 6. –En fait de stupidité il en est de deux sortes : l’une naturelle, l’autre acquise.
Je voudrais bien savoir comment on vient à bout de la stupidité naturelle. Tous les hommes sont classés entre la plus grande pénétration possible et la stupidité la plus complète : entre M. d’Alembert et M. d’Outrelot ; et en dépit de toute institution, chacun reste à peu près sur son échelon. Qu’il me soit permis de tâter un homme, et bientôt je discernerai ce qu’il tient de l’application et ce qu’il tient de la nature. Celui qui n’a pas ce tact, prendra souvent l’instrument pour l’ouvrage, et l’ouvrage pour l’instrument.
Il y a entre chaque échelon un petit degré impossible à franchir, et pour pallier l’inégalité naturelle, il faut un travail opiniâtre d’un côté, et une négligence presque aussi continue de l’autre.
L’homme que la nature a placé sur son échelon s’y tient ferme et sans effort. L’homme qui s’est élancé sur un échelon supérieur à celui qu’il tenait de la nature, y chancelle, y est toujours mal à son aise ; il médite profondément le problème que l’autre résout tandis qu’on lui attache des papillotes.
Ici l’auteur confond la stupidité avec l’ignorance.
Page 7. –L’esprit s’est-il chargé du poids d’une savante ignorance, il ne s’élève plus jusqu’à la vérité ; il a perdu la tendance qui le portait vers elle…
Et cette tendance naturelle ou acquise est la même dans tous ?
L’homme qui ne sait rien peut apprendre il ne s’agit que d’en allumer en lui le désir.
Et ce désir, tous en sont également susceptibles ?
Page 8. –Que fait un instituteur ? Que désire-t-il ? D’éjointer les ailes du génie.
Il y a donc du génie antérieur à l’institution.
Les anciens conserveront sur les modernes tant en morale qu’en politique et en législation, une supériorité qu’ils devront non à l’organisation, mais à l’institution.
Et qu’est-ce que cela prouve ?
– Qu’une nation diffère peu d’une autre nation.
– Qui vous le nie ?
– Que les Français, élevés comme les Romains, auraient aussi leur César, leur Scipion, leur Pompée, leur Cicéron.
– Pourquoi non ? Donc chez quelque nation que ce fût, la bonne éducation ferait un grand homme, un Annibal, un Alexandre, un Achille, d’un Thersite, d’un individu quelconque ! Persuadez cela à qui vous voudrez, mais non pas à moi.
Pourquoi ces noms illustres sont-ils si rares chez ces nations même où tous les citoyens recevaient l’éducation que vous préconisez.
Monsieur Helvétius, une petite question : Voilà cinq cents enfants qui viennent de naître ; on va vous les abandonner pour être élevés à votre discrétion ; dites-moi combien nous rendrez-vous d’hommes de génie ? Pourquoi pas cinq cents ? Pressez bien toutes vos réponses, et vous trouverez qu’en dernière analyse elles se résoudront dans la différence d’organisation, source primitive de la paresse, de la légèreté, de l’entêtement et des autres vices ou passions.
Page 12. –Les vrais précepteurs de notre enfance sont les objets qui nous environnent.
– Il est vrai : mais comment nous instruisent-ils ?
– Par la sensation.
– Or est-il possible que l’organisation étant différente, la sensation soit la même ?
Telle est sa diversité, que si chaque individu pouvait se créer une langue analogue à ce qu’il est, il y aurait autant de langues que d’individus ; un homme ne dirait ni bonjour, ni adieu comme un autre.
– Mais il n’y aurait donc plus ni vrai, ni bon, ni beau ?
– Je ne le pense pas ; la variété de ces idiomes ne suffirait pas pour altérer ces idées.
Page 13. –Plus les chutes sont douloureuses, plus elles sont instructives…
– J’en conviens. Mais y a-t-il deux enfants au monde pour qui la même chute fût également douloureuse, en général, pour qui une sensation quelconque puisse être identique ? Voilà donc une première barrière insurmontable entre leurs progrès ; et cette barrière où est-elle placée ? Dans l’organisation. L’un reste étendu sur la place et s’écrie : Je suis mort. L’autre se relève sans mot dire, se secoue, et s’en va.
Il y a certaines actions de l’enfance où toute la destinée d’un homme est écrite. Alcibiade et Caton ont répété toute leur vie deux mots de leurs premières années : Gare toi-même… Lâche … Si Helvétius eût bien pesé ces expressions de caractère, antérieures à toute éducation, de l’âge de la jaquette et des osselets, il eût senti que c’est la nature qui fait ces enfants-là, et non la leçon. L’art de convertir le plomb en or est une alchimie moins ridicule que celle de faire un Régulus du premier venu. Toutes ces lignes-là de l’auteur ne sont que de la poudre de projection.
Page 15. – Deux frères voyagent, l’un à travers des montagnes escarpées, l’autre par des vallons fleuris. À leur retour, ils s’entretiennent de ce qu’ils ont vu, et il se fait entre eux un échange de sensations. L’image de l’horreur de la nature passe de la tête de l’un dans le cerveau de l’autre ; et le premier s’enivre de la peinture de ses charmes. L’un veut aller frémir à son tour à l’aspect des abîmes, au fracas des torrents ; l’autre se coucher mollement sur l’herbe tendre et s’endormir au murmure des ruisseaux. C’est que l’un est brave, et que son frère est voluptueux. N’allez pas contrarier ces penchants naturels, vous n’en feriez que deux sujets médiocres.
Page 17. –On enferme un enfant dans une chambre, il y est seul ; il voit des fleurs, il les considère …
J’y consens. Mais un autre enfant diversement né, ou s’endormira s’il est lâche, ou grommellera entre ses dents des mots injurieux contre son père ou son instituteur, s’il est vindicatif. Lâche ou vindicatif, il ne saura pas seulement s’il y avait à côté de lui un pot de fleurs.
Page 18. –Des idées dépendantes du caractère … – Monsieur Helvétius, vous écoutez-vous ? et le caractère n’est-il pas un effet de l’organisation ?
Page 19. –Deux frères élevés chez leurs parents ont le même précepteur, ont à peu près les mêmes objets sous les yeux, ils lisent les mêmes livres. La différence de l’âge est la seule qui paraisse devoir en mettre dans leur instruction. Veut-on la rendre nulle ? suppose-t-on à cet effet deux frères jumeaux ? Soit. Mais auront-ils eu la même nourrice ? Qu’importe ? il importe beaucoup, comment douter de l’influence du caractère de la nourrice sur celui du nourrisson ?
Non, monsieur Helvétius, non, il n’importe rien, puisque, selon vous, l’éducation répare tout. Tâchez donc de vous entendre. Vous raisonneriez juste, si vous conveniez que la diversité de la première nourriture affectant l’organisation, le mal est sans remède ; mais ce n’est pas là votre avis.
Page 20. –Dans la carrière des sciences et des arts que tous deux parcouraient d’abord d’un pas égal, si le premier est arrêté par quelque maladie, s’il laisse prendre au second trop d’avance sur lui l’étude lui devient odieuse.
Si le premier est arrêté par quelque maladie ? Et en est-il une plus constante, plus incurable que la faiblesse ou quelque autre vice d’organisation ?
S’il laisse prendre trop d’avance ? Et n’y a-t-il pas des enfants naturellement avancés ou retardés ?
Et rien n’est-il plus décourageant pour un enfant que de suppléer par le travail à la facilité qui lui manque ? et n’est-ce pas alors que le châtiment est injuste, et souvent même impuissant ?
Page ibid. – C’est l’émulation qui crée les génies, et c’est le désir de s’illustrer qui crée les talents.
Mon cher philosophe, ne dites pas cela ; mais dites que ce sont les causes qui les font éclore, et personne ne vous contredira.
L’émulation et le désir ne mettent pas le génie où il n’est pas.
Il y a mille choses que je trouve tellement au-dessus de mes forces, que l’espérance d’un trône, le désir même de sauver ma vie ne me les feraient pas tenter ; et ce que je dis dans ce moment, il n’y a pas un seul instant de mon existence où je ne l’aie senti et pensé.
Page 22. –Le hasard a la plus grande part à la formation du caractère.
Mais à trois ans un enfant est sournois, triste ou gai, vif ou lent ; têtu, impatient, colère, etc. ; et dans le reste de sa vie, le hasard se présenterait sans cesse avec une fourche, qu’il repousserait la nature sans la réformer : Naturam expellas furcâ, tamen usque recurret.
Page 23. –Les caractères les plus tranchés sont quelquefois le produit d’une infinité de petits accidents.
C’est une grande erreur que de prendre la conduite d’un homme, même sa conduite habituelle, pour son caractère.
On est naturellement lâche, on a le ton et le maintien d’un homme brave ; mais est-on brave pour cela ?
On est naturellement colère, mais la circonstance, la bienséance de l’état, l’intérêt commandent la patience, on se contient ; est-on patient pour cela ?
Les caractères d’emprunt sont plus tranchés que les caractères naturels.
Interrogez le médecin, et il vous dira que le caractère qu’on a n’est pas toujours celui qu’on montre, et que le premier est le produit de la fibre raide ou molle, du sang doux ou brûlant, de la lymphe épaisse ou fluide, de la bile âcre ou savonneuse, et de l’état des parties dures ou fluides de notre machine. Votre enfant est-il voluptueux ? Faites-le chasser tout le jour, et faites-lui boire le soir une décoction de nénuphar ; cela vaudra mieux qu’un chapitre de Sénèque.
Helvétius a dit plus haut : Si l’organisation nous fait presque en entier ce que nous sommes, à quel titre reprocher au maître la stupidité de son élève ?
Lorsqu’il prononce ici que le hasard a la plus grande part à la formation du caractère, ne voit-il pas qu’on peut lui rétorquer son raisonnement et lui dire : « Si le hasard a la plus grande part à la formation de notre caractère, à quel titre reprocher au maître la méchanceté de son élève ? »
Se proposer de montrer l’éducation comme l’unique différence des esprits, la seule base du génie, du talent et des vertus ; ensuite abandonner au hasard le succès de l’éducation et la formation du caractère : il me semble que c’est réduire tout à rien, et faire en même temps la satire et l’apologie des instituteurs.
Donnez-moi la mère de Vaucanson, et je n’en ferai pas davantage le flûteur automate. Envoyez-moi en exil, ou enfermez-moi dix ans à la Bastille, et je n’en sortirai pas le Paradis perdu à la main. Tirez-moi de la boutique d’un marchand de laine, enrôlez-moi dans une troupe de comédiens, et je ne composerai ni Hamlet, ni le King Lear, ni le Tartuffe, ni les Femmes savantes, et mon grand-père avec son plût à Dieu n’aura dit qu’une sottise. J’ai été plus amoureux que Corneille, j’ai fait aussi des vers pour celle que j’aimais ; mais je n’ai fait ni le Cid, ni Rodogune. Oui, monsieur Helvétius, on vous objectera que de pareils hasards ne produisent de pareils effets que sur des hommes organisés d’une certaine manière, et vous ne répondrez rien qui vaille à cette objection.
Il en est de ces hasards comme de l’étincelle qui enflamme un tonneau d’esprit-de-vin, ou qui s’éteint dans un baquet d’eau.
Page 26. –Le génie ne peut être que le produit d’une attention forte. .. (et page 27) Le génie est un produit de hasards.
On conviendra que voilà d’étranges assertions. Je me rongerais les doigts jusqu’au sang que le génie ne me viendrait pas. J’ai beau rêver à tous les hasards heureux qui pourraient me le donner, je n’en devine aucun.
Mais accordons à l’auteur qu’avec une attention forte et concentrée dans un seul objet important, on acquerra du génie. Vous verrez que, de quelque manière qu’on soit organisé, on est maître de s’appliquer fortement ! Il y a des hommes, et c’est le grand nombre, incapables d’aucune longue et violente contention d’esprit. Ils sont toute leur vie ce que Newton, Leibnitz, Helvétius étaient quelquefois. Que faire de ces gens-là ? Des commis.
Page ibid. – La seule disposition qu’en naissant l’hommeapporte à la science est la faculté de comparer et de combiner.
Soit. Mais cette faculté est-elle la même dans tous les individus ? Si elle est variable d’un enfant ou d’un homme à un autre, est-il toujours possible d’en réparer le défaut ? S’il arrive que cette inégalité se compense à la longue, ce ne peut être que par l’exercice, le travail et des frais qui retardent d’autant les progrès dans la carrière. L’un de ces coursiers aura atteint le but avant que l’autre ait délié ses muscles inflexibles et ses jambes raides. Entre ces derniers, combien garderont toujours une allure lourde et pesante !
Page 27. –Lui-même cependant (Rousseau) est un exemple du pouvoir du hasard… Quel accident particulier le fit entrer dans la carrière de l’éloquence ? C’est son secret ; je l’ignore.
Moi, je le sais et je vais le dire. L’Académie de Dijon proposa pour sujet de prix : Si les sciences étaient plus nuisibles qu’utiles à la société. J’étais alors au château de Vincennes. Rousseau vint m’y voir, et par occasion me consulter sur le parti qu’il prendrait dans cette question. « Il n’y a pas à balancer, lui dis-je, vous prendrez le parti que personne ne prendra. – Vous avez raison, » me répondit-il ; et il travailla en conséquence.
Je laisse là Rousseau, je reviens à Helvétius et je lui dis : Ce n’est plus moi qui suis à Vincennes, c’est le citoyen de Genève. J’arrive. La question qu’il me fit, c’est moi qui la lui fais ; il me répond comme je lui répondis. Et vous croyez que j’aurais passé trois ou quatre mois à étayer de sophismes un mauvais paradoxe ; que j’aurais donné à ces sophismes-là toute la couleur qu’il leur donna ; et qu’ensuite je me serais fait un système philosophique de ce qui n’avait été d’abord qu’un jeu d’esprit ? Credat judæus Apella, non ego.
Rousseau fit ce qu’il devait faire, parce qu’il était lui. Je n’aurais rien fait, ou j’aurais fait tout autre chose, parce que j’aurais été moi.
Et lorsque Helvétius finit le paragraphe de Rousseau par ces mots : Rousseau, ainsi qu’une infinité d’hommes illustres, peut donc être regardé comme un des chefs-d’œuvre du hasard… : je demande si cela peut avoir d’autre sens que le suivant : c’était un baril de poudre à canon ou d’or fulminant qui serait peut-être resté sans explosion sans l’étincelle qui partit de Dijon et qui l’enflamma ?
Prétendre avec l’auteur que ce fut l’étincelle qui fit la poudre à canon ou l’or fulminant, cela ne serait ni plus ni moins absurde que de prétendre que ce fut l’or fulminant ou la poudre à canon qui fit l’étincelle.
Rousseau n’est non plus un chef-d’œuvre du hasard, que le hasard ne fut un chef-d’œuvre de Rousseau.
Si l’impertinente question de Dijon n’avait pas été proposée, Rousseau en aurait-il été moins capable de faire son discours ?
On sut que Démosthène était éloquent quand il eut parlé ; mais il l’était avant que d’avoir ouvert la bouche.
Il y a des milliers de siècles que la rosée du ciel tombe sur des rochers sans les rendre féconds. Les terres ensemencées l’attendent pour produire, mais ce n’est pas elle qui les ensemencera.
Combien d’hommes sont morts, et combien d’autres mourront sans avoir montré ce qu’ils étaient ! Je les comparerais volontiers à de superbes tableaux cachés dans une galerie obscure où le soleil n’entrera jamais, et où ils sont destinés à périr sans avoir été ni vus ni admirés.
Soyons circonspects dans notre mépris ; il pourrait aisément tomber sur un homme qui vaut mieux que nous.
Ce que je pense de ces petits hasards auxquels Helvétius attribue la formation d’un grand homme, je le penserais volontiers de ces autres petits hasards auxquels on attribue tout aussi gratuitement la destruction des grands empires.
Les empires mûrissent et se pourrissent à la longue comme les fruits. Dans cet état, l’évènement le plus frivole amène la dissolution de l’empire, et la secousse la plus légère la chute du fruit ; mais et la chute et la dissolution avaient été préparées par une longue suite d’évènements. Un moment plus tard, et l’empire se serait dissous et le fruit serait tombé de lui-même.
Veut-on une comparaison plus juste encore ? Un homme est sain et vigoureux en apparence. Il lui survient un petit bouton à la cuisse ; ce petit bouton est accompagné d’une démangeaison légère : il se frotte, voilà le petit bouton écorché, et l’écorchure, qui n’a pas le diamètre d’une ligne, le centre d’une gangrène dont les progrès rapides font tomber en pourriture et la cuisse et la jambe et la machine entière. Est-ce l’écorchure légère, est-ce le petit bouton ou l’intempérance continue de cet homme que je regarderai comme la véritable cause de sa mort ?
Page 28. –Faut-il, pour défendre son opinion, soutenir que l’homme absolument brute, l’homme sans art, sans industrie et inférieur à tout sauvage connu, est cependant et plus vertueux et plus heureux que le citoyen policé de Londres et d’Amsterdam ? Rousseau le soutient.