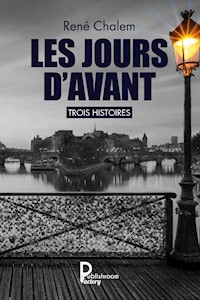Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
« Dans cette ville au bruit incessant, comme celui d’un moteur qui ne s’arrête jamais, merveilleuse de lumière quand il fait beau, ténébreuse quand le vent et la pluie s’engouffrent dans ses avenues bordées d’immeubles gigantesques, comme les falaises d’un canyon ; j’ai toujours l’impression de me retrouver sur un autre continent, une autre planète, qui vit sa vie en dehors de notre temps, maîtresse d’un destin dont nous ne pouvons être que les spectateurs incrédules. »
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né au Caire, René Chalem quitte l’Égypte pour Paris juste avant l’avènement de Nasser. Après quelques années en France, il part pour l’Amérique Latine où il s’installe de longues années. À quarante ans, poussé par son désir d’une nouvelle vie, il revient à Paris où il s’enracine. Il partage actuellement son temps entre Paris et Barcelone.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
René Chalem
Rendez-vous à Manhattan
Les écrivains, comme les êtres humains
en général, se divisent en deux catégories,
« ceux qui savent écouter et ceux qui n’en
sont pas capables ».
Philip Roth
Pour Sylvia, comme toujours
Pour Albert, et le téléphone
qui ne sonnera plus
À Ylana et Claude
Remerciements
Je tiens à remercier affectueusement Josep A. Vidal pour l’aide et les encouragements apportés dans l’écriture de ce livre.
Mes remerciements aussi à mon fils Claude pour avoir pallié les carences de ma mémoire.
Rendez-vous à Manhattan
I
Il est assis en face de moi. La lumière rentre par les grands carreaux biseautés de la porte d’entrée. L’hiver est presque là. Le temps est gris, mais, curieusement, assez lumineux.
L’endroit est plus vaste que je n’aurais pensé ; quelques tables, quatre ou cinq, vides pour l’instant, ce n’est pas encore le Happy Hour, mais ça ne saurait tarder. Un grand bar, en angle, sur tout le fond de la salle. Un bonhomme, bien musclé, y trône, le crâne rasé, la mine joviale, en bras de chemise, col ouvert, gilet rouge, étincelant, boutons dorés, les mains bien appuyées sur le zinc. Il nous accueille avec un large sourire, “Hi there, come onin.”
Deux clients à la barre, des habitués sans doute, en discussion animée, proprets, costume gris foncé, les deux, chemises blanches, cravatés.
Le barman est seul, mais je crois qu’il aura bientôt de l’aide, pour l’heure de pointe.
Sur les étagères, derrière lui, dans une lumière éclatante, des bouteilles et des bouteilles encore, de toutes les étiquettes, de toutes les couleurs. Les alcools en beauté.
Sur les murs, des photos, la plupart en noir et blanc. Les Twin Towers avant, dans leur gloire. Les Twin Towers après, ce qu’il en reste, dans les décombres. Une pensée fugace : je me rappelle, j’étais allé me recueillir sur le site à l’époque où nous étions tous Américains, avant la guerre en Irak, et le discours enflammé de Villepin au Conseil de sécurité, avant le French Bashing et les Liberty Fries. D’autres photos, des portraits de pompiers, casqués, les yeux hagards, la poussière des ruines sur le visage, les héros de Manhattan.
Comme toujours, me reviennent en mémoire les vers désespérés de mon amie Helen McCullough : The stones they fell/Like broken words/That cannot tell. Les mots sont inutiles. Devant l’atroce et l’inexplicable, ils se taisent.
Sur les murs, des photos encore, l’une d’entre elles, en couleurs, dédicacée : un robuste motard bien assis sur sa Harley-Davidson, une bouteille de bière à la main. Une autre, d’un jeune gars, tenant fièrement une batte de baseball, ou encore, celle d’un solide gaillard, noir bien entendu, souriant de toutes ses dents blanches, sous un panier de basketball qu’il atteint presque de latête.
Nous sommes allés jusqu’au comptoir passer notre commande : un café et un Perrier pour lui et un verre de vin blanc pour moi. Le Perrier est maintenant passé de mode aux É.-U., mais il n’aime pas leurs sodas, douçâtres m’a-t-il expliqué. « Je ne bois plus, » et, remarquant ma surprise, « pas d’alcool. Sauf le vin, quelquefois, pour égayer le repas. » Il a mis quelques dollars sur le bar, me gagnant de vitesse ; j’avais oublié qu’ici on paye aussitôt servi, cash on delivery.
Distraitement, j’entends un des deux compères se plaindre : “Fucking day! It tumbled down! Nearly three points. Caught me with my hands full.” Un jour difficile à la bourse. Dépité, il repose son verre.
À part ces deux, debout au comptoir, l’endroit estvide.
“Will you need help?” interroge gentiment l’homme au gilet rouge. Carlos fait non de la tête. “But I’ll have a sandwich, please. Cheese.”
“Toasted?” veut savoir notre ami. Carlos lui fait oui. “And some cream for my coffee, please. I’ll come back for it”. Il se tourne vers moi, « Tu veux quelque chose ? Pour moi, un sandwich, je n’ai pris qu’un café ce matin. »
Nos mains pleines de tasses, de bouteilles et de verres, nous nous trouvons une table dans un coin, le plus éloigné possible du comptoir et de sa lumière tapageuse.
J’ai posé mon verre, avec précaution parce qu’il est plein à ras bord, et je me demande quel vin ils auront pu me servir. J’ai vaguement entendu le barman parler d’un chardonnay. En fait, cela m’est un peu égal. Je peux ne pas le boire. C’est juste pour avoir quelque chose devant moi, pour m’occuper les mains et écouter mon ami Charles, ou Carlos comme il aimait se faire appeler Dieu seul sait pourquoi ; il ne connaît pas un mot d’espagnol. La revendication de ses lointaines origines mexicaines. Un ancêtre du côté maternel, m’avait-il affirmé un jour, la main sur le cœur, grand combattant aux côtés de Pancho Villa. Je n’en croyais rien, mais ça donnait des couleurs à son passé.
La porte s’ouvre. Des buveurs précoces. Il est encore tôt. Des familiers, certainement, à juger par l’accueil jovial et quelque peu bruyant qui leur est réservé.
“Howdie, Gus ! Hello, George! Good to see you guys.”
“ Hi Mike,” on lui répond. “So, it’s red today! You look good.” L’homme en rouge éclate de rire. “Yeah, my boy, red is beautiful!”
Carlos se lève ; il va chercher son sandwich et son pot delait.
Un groupe de quatre jeunes gars a fait son entrée et se dirige vers le bar passer commande avant d’aller s’asseoir à une des tables. Grand sourire du barman — “Hello fellas” — qui leur sert leurs verres sans même leur demander ce qu’ils souhaitent boire.
La porte s’ouvre de nouveau pour une belle fille brune dans un long manteau noir, des bottes, noires aussi, avec des boucles d’un or rutilant. Elle détonne un peu dans cet univers essentiellement masculin, machiste sans doute — quand on boit, c’est du sérieux, on aime être entre mecs — mais elle connaît bien son chemin. Elle se dirige droit au bar sans hésitation, et c’est le brouhaha général. Des wows admiratifs fusent de partout. Je vois que même Carlos arbore un sourire. Je me dis qu’une jolie femme, ça ajoute du piment à la vie. Un des hommes applaudit joyeusement. “Gee whiz,” il s’exclame, “you look like a million bucks ! Who’s the lucky dude?”
Le gilet rouge est content. “Lay off, gentlemen, let her be. What’ll it be, Ruth baby,” il lui demande, “the usual?” Elle n’est pas mécontente des réactions enthousiastesqu’elle a suscitées. Elle est de dos, mais je suis persuadé qu’elle affiche un large sourire. “Nope,” elle fait non de la tête, “just a vodka on the rocks, with a drop of lemon. I’m minding my breath tonight.” Ce soir, la belle fait gaffe à son haleine. Et tout ce petit monde s’esclaffe bruyamment, “The luckydog!”
Carlos revient avec son sandwich. Il reprend sa place en face de moi. Il a retrouvé sa mine austère et renfrognée.
Au bout d’un moment, il s’agite un peu. Il va chercher son briquet dans sa poche. Il l’allume, il l’éteint. Un vieux briquet Ronson qui a connu des jours meilleurs, mais auquel il tient, je suppose, comme on tient à une relique. Je ne sais même pas comment il fait pour dénicher de l’essence de nos jours.
« On ne peut plus fumer ici, » me dit-il, « c’est insupportable. » Je souris, « À Paris non plus maintenant, » je luidis.
Moi, en fait, je n’y pense plus, je ne fume pas, sauf pour un cigare de temps en temps, ou ma pipe quand je travaille, qui s’éteint tout le temps et que je rallume quand je cherche mes mots. En fin de soirée, un cigare lorsque je suis content de ma journée, avec un verre d’armagnac, ce qui fait hurler Gabrielle qui ouvre toutes grandes les fenêtres de l’appartement. Quand il fait beau, je fume mon Cohiba sur le balcon. Mon petitluxe.
Je regarde Carlos ; son exaspération m’amuserait si je ne le sentais pas aussi tendu.
« Mais on peut aller au Café de la Paix, ce n’est pas loin, s’il existe toujours. Ils avaient une terrasse ouverte sur le trottoir, comme à Paris. » Mais peut-être pas en automne, je ne m’en souviensplus.
J’ai souvent logé au Saint-Moritz sur Central Park, l’hôtel qui abritait, ou abrite toujours, le Café, mais ça fait de longues années que je n’y vais plus. C’était avant, quand les prix étaient encore abordables.
Il fait la moue et un geste de dépit de lamain.
« Peine perdue, » affirme-t-il, « même dans la rue c’est devenu laborieux, il faut se cacher pour tirer sur sa clope. Infernal ! Le pays de la démocratie, mon cul oui ! »
Je m’étonne, surpris, Carlos était peut-être le seul de la bande qui ne disait jamais de gros mots. Mais les choses changent, et le français lui remplit sans doute la bouche quand il a l’occasion de le parler.
Il semble rêveur, mon copain Carlos, mon pote, mon poète du pinceau, faiseur d’images, qui savait faire rire les filles.
« Allez, mon vieux, » je lui dis, « demain il fera beau, » et je pousse mon verre de vin contre son verre de Perrier. « Rappelle-toi Charlot dans Les lumières de la ville. »
Il lève les yeux, un peu humides peut-être. « J’en ai ma claque, » dit-il. Il observe sa tasse de café, hésite, y verse un filet delait.
« C’est du jus de chaussette, imbuvable si tu n’ajoutes pas un peu de lait ou de cream, comme ils disent ici. Et même comme ça… » fait-il après y avoir goûté. « Je ne sais pas pourquoi je m’entête. » Il repousse sa tasse et regarde monter les bulles dans son verre de Perrier. Je souris, je ne peux rien faire de plus. J’essaye de deviner pourquoi cette hargne. Il n’y a, semble-t-il, de la place pour rien d’autre, sa fureur et son dépit. Je pourrais lui rappeler qu’ils ont découvert l’expresso depuis quelque temps déjà, qu’il y a maintenant des Starbucks un peu partout à New York, mais je me retiens. Il le sait certainement mieux que moi, mais il ne veut pas contenir sa colère. Je me tais. Se rend-il même compte que nous sommes tous les deux, assis à la même table ? Après tant d’années de séparation.
J’ai envie de le secouer. Bon Dieu, nous avons d’autres choses à nous dire, je n’en ai rien à foutre de leur café insipide ! Nous avons des années à combler, le trou béant de l’absence ! Mais je me retiens. J’ai une peine énorme qui monte en moi. Je le regarde. Il retrousse les lèvres. Il ne trouve rien à son goût. Tout lui déplaît. Même l’accueil amical du barman, ou l’apparition de cette jolie fille qui lui a éclairé un moment le visage.
« On leur apprend ça à leur école d’hôtellerie, » il me dit, « tu comprends, il faut sourire au client, lui montrer que tu es heureux de le voir, que tu n’attendais que lui. Du pipeau, du commerce. Tu consommes ou tu te barres. Et c’est la même chose dans leurs foutues boutiques, tout sourire, ils regorgent d’amitié, mais ce n’est que ton portefeuille qui les intéresse. Avec leurs sourires béats. »
Je ne peux pas m’empêcher de sourire moi aussi, mais, très vite, je tourne bride. Je lui prends la main. « Tu ne crois pas que tu déconnes un peu l’ami, est-ce que tu connais un seul commerçant, ici ou ailleurs, qui ne soit pas attiré par ton porte-monnaie ? »
Il lève vers moi des yeux de reproche, il éclate, « Tu ne comprends pas ! Tu ne vis pas ici, tu ne peux pas comprendre. Ils ont ça dans le sang ! »
Je sens tout le poids de sa tristesse et de son désespoir. J’ai envie de le secouer, de le rudoyer, mais je me freine.
J’ai peur de le voir s’écrouler au moindre soubresaut, comme un château de cartes. La panique me gagnerait, presque. Je m’oblige à la patience. Je lève mon verre. Je ne veux pas de ce vin blanc qui, je le pressens, va me donner un haut-le-cœur. J’en prends une gorgée quand même. Le vin est fade, comme flétri. C’est idiot, je le savais ; j’aurais dû commander un whisky ou un bourbon. On ne demande pas du vin dans un bar à NewYork.
J’attends d’en apprendre plus. Ça fait longtemps, des années que je ne vois pas mon ami Carlos et des années que je n’ai plus de ses nouvelles. Nos souvenirs ne sont plus les mêmes. Et pourtant nous avons été très proches, cul et chemise, pour ainsi dire. Nous avons tout fait ensemble, quand il était jeune et moi aussi. Il était beaucoup plus festif que moi. Je le suivais, accrochés à ses basques et à son succès auprès des filles, qui l’aimaient bien parce qu’il était drôle et qu’il les faisait rire. Partout, il était reçu comme un gage de gaieté et de bonne humeur. Mais il n’abusait jamais de sa popularité, il ne s’incrustait pas, il savait partir quand il sentait qu’il était temps. Et je le suivais, peut-être pour le protéger. J’avais pour lui une amitié de tendresse, comme pour un jeune frère, et pourtant nous avions le même âge. C’était le genre de personne à qui l’on ne veut pas que du mal arrive. Je me dis c’était. Je le regarde, je ne sais pas ce qu’il est à présent. Ce faiseur d’images lumineuses. Ce qu’il est devenu.
Solange, notre amie d’enfance, maintenant relectrice chez mon éditeur, s’était écriée victorieusement : Ça y est, on l’a enfin trouvé ! Puisque tu vas à New York, essaye de levoir.
Nous en parlions fréquemment. Nous avions perdu sa trace depuis un bout de temps, plusieurs années. Et il était devenu comme une inquiétude lancinante. Elle m’avait appelé aussitôt retrouvée sa trace. Par Philippe, son mari, qui lui-même l’avait appris par Norbert, un peintre que je connais et que j’aime bien. Il ne décolle pas encore tout à fait et prête parfois ses pinceaux à des boîtes de publicité pour boucler les fins de mois. Solange ayant réussi à dégoter l’adresse mail de Carlos, j’ai pu lui écrire. Il m’avait répondu aussitôt et il avait eu l’air content d’avoir de mes nouvelles, malgré son message assez laconique Salut David, content de te revoir bientôt, et il m’avait donné son numéro de téléphone. J’ai aussitôt appelé Solange qui a poussé un ouf de soulagement, Tu l’embrasses et tu me tiens au courant.
À New York, pas de réponse à son téléphone fixe et il ne m’avait pas donné son numéro de portable. Je me suis demandé s’il en avait un. Il se peut très bien, maintenant que je le vois là devant moi, qu’il en rejette l’idée, se refusant à utiliser cet outil diabolique, symbole d’une société dans laquelle il semble ne pas se retrouver. Il faudra que je lui pose la question. Toujours est-il que je n’ai pas réussi à l’avoir, malgré mes appels répétés. Je lui ai écrit à nouveau en soulignant que je n’en avais plus que pour quelques jours à New York et il m’a finalement donné rendez-vous dans ce bar à deux pas duMoMa.
Avant qu’il ne parte pour les États-Unis, nous vivions l’un chez l’autre, nous nous voyions pratiquement tous les jours. Gamins, après l’école, pour un pain au chocolat chez lui, avec sa mère, la belle Coralie, ou chez moi, pour un des gâteaux de ma mère, dont il raffolait. Plus tard, dans des écoles différentes, il ne se passait pas un jour sans se voir ou se téléphoner. Et maintenant, il faut qu’on se retrouve dans ce bar anonyme. Pourquoi pas chez lui ? Je n’ose pas encore le lui demander.
Je lui dis « Pourquoi ce troquet ? À cause du MoMa ? »
Il fait oui de la tête, « J’y venais de temps en temps, après une visite au musée quand j’étais à New York, prendre un verre et manger un morceau. C’est un des seuls troquets où tu peux grignoter quelque chose. Et à chaque fois, je me jurais que ce serait la dernière. Leurs sandwiches étaient dégueulasses, du congelé, et le pain, du papier mâché. Le proprio a changé. Avant, c’était un vieux bonhomme, bougon, mais accueillant. » Il sourit, « En bras de chemise, toujours blanche, avec de larges bretelles qui changeaient de couleurs chaque fois que j’y allais. Je suppose qu’il en avait des dizaines. Un peu comme Larry King. De jeunes artistes y venaient. Ils lui payaient peut-être leurs consommations avec leurs croûtes qu’il exposait sur ses murs. »
Il sourit avec tristesse, « Il se disait peut-être qu’un de ces jours il tomberait sur le pactole qui lui garantirait sa retraite. »
Il revient au présent et regarde son sandwich avec dédain, « Mon vieux bonhomme est parti, il a, qui sait, finalement décroché le jackpot. La clientèle a changé, le patron aussi, mais la bouffe est toujours aussi exécrable. » J’en rigole, « Alors pourquoi tu viens ? » Mais il prend ça au sérieux. Il réfléchit « Par habitude peut-être…, et puis ici ou ailleurs… » Le barman avait, en effet, semblé le reconnaître.
Je comprends mal ; serait-il devenu masochiste ? Pour expier peut-être des crimes imaginaires. Mais je ne pousse pas plus avant.
D’autres habitués arrivent, saluent bruyamment le barman, et vont s’installer, les uns debout devant le bar, les autres, j’imagine, à leur table habituelle, après avoir pris leur verre aubar.
Un moment, je n’ai pas très bien suivi ce que Carlos me disait, j’avais la tête ailleurs. Je continuais à me demander ce qu’il venait faire dans ce troquet qui lui était si étranger. Il y en avait certainement d’autres, plus avenants, à New York, et pas loin d’ici. Des bars, il n’en manque pas dans ce quartier.
Lui, il réfléchit, le nez dans son Perrier. Il contemple les bulles s’élever avant d’aller éclater en surface. Peut-être qu’il y vient pour attiser sa colère. Mais il m’avait dit quelque chose et maintenant il lève son regard vers moi « … ils s’appellent par leur prénom, ils se disent tu sans réellement se connaître. C’est du pipeau, de la guimauve, de l’ersatz de camaraderie. »
Amusé, je souris, mais je suis quand même un peu troublé par cette amertume exacerbée et cette animosité tous azimuts. « Tu cherches vraiment la petite bête, » je luidis.
Il relève la tête, il regarde autour de lui, « Non, non, mon vieux, ils se voient tous les jours, ils s’appellent par leur prénom, mais c’est tout ce qu’ils savent l’un de l’autre. Ah, bien sûr, ils se montrent des photos, de leurs enfants, de leur gonzesse, de leur chien. Ils satisfont au rituel et peuvent continuer à boire en bonne conscience, entre mecs, loin de chez eux. »
Il me dit, « Tu comprends ? Je n’ai rien à leur dire, ils n’ont rien à me dire, et ils n’ont rien à se dire. La religion, ça ne se discute pas, et encore moins la politique. Que veux-tu faire avec des gens qui ont In God we trust sur leurs billets de banque, la vérité inébranlable ? » Il sirote son Perrier, d’un air dégoûté. « Dieu veille sur Wall Street et sur nos comptes en banque ! »
Je suis désemparé. Ma visite à New York, c’était une fête pour moi. J’adore cette ville, elle me ravigote. Je suis venu voir Eliot Ellenstein, mon éditeur américain, pour la traduction de mon bouquin. Il souhaitait que je la révise, qu’en quelque sorte, je lui donne ma bénédiction. Je m’y étais résisté, comme chaque fois, n’ayant aucun goût pour la relecture de mes œuvres ; une fois publiées, elles ne m’appartiennent plus, elles me deviennent même un peu étrangères ; j’y trouve toujours des choses que je n’aurais pas dû dire ou qui auraient dû être dites de façon différente. J’aimerais effacer, corriger, mais c’est troptard.
J’aime bien voir le bouquin imprimé, et mon nom sur la couverture, mais c’est tout. J’en distribue quelques exemplaires à des amis, à la famille, avec dédicaces affectueuses. Je ne sais pas s’ils le lisent ou si, comme moi, ils le placent sur une étagère avec les autres livres et ils l’oublient. Mais ça m’est égal, c’est fait, il faut passer à autre chose, aux mots, aux histoires, qui se bousculent dans ma tête. C’est Gabrielle qui en fait un évènement, une fête, avec amis, enfants et petits-enfants, champagne et tout le tralala. Je ne comprends pas tout à fait, mais je suis heureux de la voir aussi radieuse, comme pour une naissance ou un mariage. Elle me pousse à participer à des émissions littéraires, aidée par mon éditeur qui a besoin de vendre des exemplaires. Il me dit que chaque émission lui rapporte quelques centaines d’exemplaires, quelquefois plus. Ça me gêne, je n’en dors pas la nuit, parce que je sais que je n’aurai rien à dire, c’est comme parler de soi à la troisième personne. Au cours d’une de ces émissions, un peu perdu, fatigué de ses questions, j’ai proposé à mon intervieweur de s’en entretenir avec mes personnages qui me surprenaient souvent, et qui sauraient certainement mieux lui répondre. Il a éclaté de rire, trouvant que j’avais de l’humour.
Je ne sais pas pourquoi j’écris, je n’ai jamais su. Mais j’y vais, la mort dans l’âme, je vais à leurs émissions et, autant que faire se peut, je laisse parler les autres et souvent je découvre, étonné, le labyrinthe, les méandres secrets et profonds qu’on prête à ma littérature. Je souris, je hoche la tête de façon entendue et je rentre chez moi exténué.
Carlos relève la tête, il écarte son Perrier. Il me dit, « Je vais aller chercher un Canada Dry, j’en ai marre du Perrier. Tu veux quelque chose d’autre ? Tu as à peine goûté à ton vin. » Je l’arrête avec ma main sur son bras. Je lui dis, « Attends, on va ailleurs, à mon hôtel, ce n’est pas loin et c’est moins bruyant. » Mais il se lève quand même. « Plus tard, » il me dit, « tu veux quelque chose ? » Je ne veux pas l’interrompre. Il aura peut-être, enfin, des choses à me révéler. Je repousse mon verre de vin. « Un bourbon, si tu veux, un seul glaçon. »
Il va jouer des coudes jusqu’au bar et revient avec sa commande. « Un glaçon, un seul, » il me dit, l’air narquois, « j’ai dû l’arrêter avant qu’il ne noie ton bourbon dans la glace. »
Il pose les verres sur la table et reprend sa place en face de moi. « Et puis c’est la même chose, ici ou ailleurs, veste de cuir et débraillé, ou trois-pièces cravate. Du pareil au même. Sur un campus universitaire, tu retrouveras peut-être le niveau de nos chauffeurs de taxi. »
Il lève son verre de Canada Dry. « À ta santé, » il me dit avec lassitude. « Regarde ton vin, servi à ras bord. Ils ne savent pas attendre, tout est vite, tout est exagéré, ils ne font que dans l’immédiat, tes amis. Ils ne savent même pas donner le temps à leur alcool, ils ne le laissent pas respirer ; leurs bières sont des blocs de glace. Ils ne goûtent pas, ils ne boivent pas, ils ingurgitent. »
Je le laisse parler, déverser sa bile. Je goûte à mon bourbon. Il est agréable, moelleux, il descend dans la gorge sans agressivité. « Il n’est pas mauvais, » je lui dis. Il sourit. « Encore heureux, c’est du Wild Turkey, je l’ai sauvé de la noyade. »
Il m’attriste, mon Carlos. Il va finir par casser mon image de cette Amérique que j’aime tant, surtout de cette ville que je retrouve toujours dans une sorte d’expectative trépidante. Des surprises m’attendent toujours dans ses rues, dans ses grandes avenues qui bouillonnent, jour et nuit, de cette même vie impatiente, portée par la passion de l’éphémère et de la nouveauté, de l’immédiat. Rien n’est pour toujours, rien n’est immuable. Oh, et puis zut, je me dis, je ne vais quand même pas me laisser emporter par mes envolées d’enthousiasmebéat.
Rien n’est pour toujours, sauf Dieu. Et le dollar, comme dirait Carlos.
Je lève mon verre. Je ne sais plus trop quoi dire à Carlos, sans risquer de déclencher à nouveau ses remarques sarcastiques et désabusées sur ceux qui sont maintenant ses compatriotes, mais qu’il appelle mes amis. Cette colère sourde, omniprésente, doit lui bouffer toute son énergie. Je voudrais savoir ce qu’il a fait toutes ces années, comment il a vécu, que sont devenus sa peinture et ses dessins.
Je lève mon verre et je lui dis, bêtement, « À ta santé, vieux frère, à tes amours. »
Il me regarde tristement, découragé, « Les amours, tu sais… Je suis venu ici, à la poursuite du Far West, des grands espaces de respiration et de liberté, le grand rêve américain, sans impossibles. Tu te marrais, mon bon David. »
Je lui souris largement. Enfin, une ouverture. Il y a de plus en plus de bruit autour de nous. Des gens entrent, d’autres s’en vont. Certains partent et reviennent, sans doute après avoir vite tiré goulûment sur une cigarette.
Je goûte à mon verre. « Il est bon ton bourbon, » je luidis.
« Je rigolais peut-être, Carlos, mais envieux quand même. Moi, mon esprit d’aventure se limitait à des bouts de papier griffonnés. Ça n’allait pas plus loin. Je voulais te retenir. Je te disais que tu n’avais pas besoin de prendre l’avion ou le bateau, que l’aventure est dans la tête, elle est où l’on est. Mais au fond ce n’étaient que des mots, je ne voulais pas que tu partes. »
Il porte tristement son verre à la bouche. Avec dégoût, il me semble. Les souvenirs doivent se bousculer dans sa tête. « Je n’ai pas bien choisi mon aventure. J’ai loupé le coche. » Il retombe dans son silence. Je sens qu’il veut aller plus loin, se raconter peut-être, mais il se tait. Il garde son nez dans son verre. Je me demande ce qu’il serait devenu s’il était resté en France. Il aurait certainement trouvé d’autres raisons de se plaindre et de rouspéter. La lenteur, la bureaucratie, les donneurs de leçon, les gouvernements qui se succèdent et se ressemblent, droite ou gauche, les mêmes, avec un vocabulaire un peu différent, c’est tout. Voilà que je m’y mets moi aussi. La France est un pays de râleurs, bien contents, toutefois, que rien ne change.
Je cherche désespérément le moyen de relancer la machine. Carlos, c’était mon copain des premiers jours, avec qui nous avions refait le monde plus d’une fois. Ensemble sur les barricades en mai 68, à vociférer contre tous les interdits. Le soir dans un épais brouillard de tabac et d’alcool, ivres d’amitié et d’avenirs possibles, nous étions des potes pour toujours. La frousse au ventre par moments, je crois, devant l’ampleur d’un mouvement incontrôlé, incontrôlable, qui prenait les allures d’une révolution dont nous ne saurions que faire, même si nous n’osions pas nous l’avouer.
Je mets ma main sur la sienne pour lui exprimer encore mon affection. Je ne lui parle pas de 68, je lui dis, « Tu te souviens de ton portrait de moi, les cheveux en bataille, les yeux ahuris, avec les grandes taches rouges et bleues ? Il est toujours sur le mur en face de moi quand je travaille. Il n’y a rien d’autre sur les murs de mon bureau, malgré les assauts répétés de Gabrielle qui insiste à égayer le site qu’elle trouve lugubre. Elle me dit que je suis déjà assez triste dans ce que j’écris, qu’il me faut au moins un peu de couleurs sur les murs. »
Il sourit. Il me serre les doigts un instant.
« Tu ne l’avais pas signé, » je lui rappelle, « ta coquetterie du moment. Il faudra que tu viennes remédier àça. »
Il lève les yeux, un peu perdu. Il fait « Oui, peut-être. » Et un instant après, « Je t’en ferai un autre. »
Un nouveau venu s’approche de notre table. Carlos ne le voit pas, il a le dos à la porte d’entrée. Bien sapé, veston-cravate, manteau bien plié sur le bras, beau garçon, pas tout à fait la quarantaine, il se dirigeait vers le bar, mais ayant aperçu Carlos, il revient sur ses pas. Il lui met la main sur l’épaule. “Hello, Charlie,” il lui dit avec un grand sourire, “good to see you, man. Long, long time. Still in Frisco?”
Surpris, Carlos lève les yeux. Il lui rend son sourire, entre heureux et attristé, nostalgique peut-être. “Oh, hello Bob, happy to see you too. No, I’m in New York now. How’re you doing?” L’autre me tend la main. “Robert Bercowitz,” il m’annonce. “Oh, sorry, David,” lui dit Carlos, “my good old friend from Paris.” Je me lève de quelques centimètres sur mon siège et je lui prends la main. “Glad to meet you,” je lui dis, avant de me rasseoir.
“So glad to find Charlie here! I’ll go get myself a drink, » nous informe Bercowitz, “and I’ll be right back if you don’t mind my butting in. Don’t fret, not for long.” Il nous rassure, il ne restera pas longtemps.
Il nous explique. “I’m meeting some friends for dinner, before a concert, Philip Glass, at Carnegie.” Il pose son manteau et son écharpe soigneusement sur une chaise et il part se frayer un chemin jusqu’aubar.
Je regarde Carlos, amusé. Il me dit, « Je suis désolé, un copain de San Francisco. Bon gars. Je crois qu’il est maintenant chez Blumenfeld, une grande galerie pas loin d’ici. J’y allais de temps en temps, il y a des années. Ils avaient quelquefois des trucs intéressants, mais beaucoup de Pop, c’était un peu leur spécialité à l’époque, ils ont dû changer depuis. » Il goûte à son Canada Dry, toujours aussi dépité, et moi à mon bourbon.
« Il a l’air sympathique, ce jeune homme », je lui dis. « Et puis ça me fait plaisir de connaître tes amis. »
Il lève les sourcils, comme étonné. « Mes amis, » il fait en haussant les épaules, « mes amis… »
Notre Bob revient, son verre à la main et un sachet de crackers qu’il pose sur la table. Il écarte un siège pour s’asseoir. Il prend un biscuit et le pointe vers moi avant de le mettre en bouche. “You’re David Choffer, The Orphan Child,” il me dit, “aren’t you ?”
Je lui fais oui de la tête, étonné, je ne suis pas très connu aux États-Unis, c’est le moins qu’on puisse dire. Il lève son verre, “I’ve read about your book, in the New York Times, or the New Yorker, I’m not sure. Long timeago.”
Bien longtemps, en effet, des années que je n’ai plus eu l’honneur de quelques lignes dans le New York Times.
Et ça me revient en flash : à la fin d’un des cours de littérature que je donne à l’Université américaine, Tour Maubourg, une jeune étudiante, toute guillerette, vient me voir. Mes félicitations, monsieur, elle me dit, j’ai lu hier une bonne critique de L’orpheline dans le New York Times, The Orphan Child. » Je lui ai fait un large sourire, pas mécontent. J’avais toujours apprécié la qualité et le sérieux de ses exposés, elle avait même reçu un A+ chaleureux pour son essai sur Tobacco Road d’Erskine Caldwell ; écriture aisée, sans affectation, analyse enthousiaste sur un de mes auteurs préférés, un peu oublié ces dernières années. David, je lui avais répondu, David, ma jeune collègue. Oui, mon éditeur est content, j’espère que les lecteurs suivront. J’avais ramassé mes dossiers sur la table et elle était repartie, en se trémoussant. Le collègue avait dû faire son effet. Qu’est-elle devenue ma Noémie Maillol ? Il faudrait que je voie ça à mon retour à Paris. Prof quelque part ou partie pour un doctorat à Yale ou Princeton ? Elle le mériterait.
“That was quite a while back. Quite a memory, my young friend!” je m’étonne.
“Yes, and proud of it,” il me dit. “I didn’t know you were a friend of Charlie’s. He’s quite a secretive bugger, ain’the?”
Je me fends d’un grand sourire, “Yes, so it seems, but now you’ve met me, maybe you can read my book, it would make my publisher happy. It will boost his sales. One more copy!”
Carlos a l’air plus détendu. On ne parle pas de lui. Bob plaisante à son tour, “But not in French, though. My French is quite basic. It always made Charlie laugh when I tried it on him” et il lui donne une légère tape sur le dos, « N’est-il pas, mon ami ? » Carlos lui sourit, un peu gêné, il me semble, d’être à nouveau sous les feux de la rampe. “No, no, it amused me,” fait-il avec son léger accent parigot, qu’il n’a pas tout à fait perdu. Et il remet son nez dans son verre.
Bob se tourne vers moi, “But where does your English come from? A slightly British accent, maybe?”
“Oh, it’s a long story,” je lui réponds en riant, “a story of the diaspora. But you have a good ear. I did spend a few years in England, as a child, before we moved on to Paris.”
Le jeune Bob m’amuse. Bien américain. Ils veulent tout savoir, tout de suite. Combien tu gagnes, si tu as des enfants, ta femme, ton chien, leurs photos que tu dois avoir sur toi, évidemment. Quitte à faire de même de leurcôté.
Mais Bob a pris un instant l’air songeur. “The diaspora,” il murmure, “the wandering Jews… My grandparents, you know, on both sides, came from Russia, Ukraine rather, Poland. They came with a shipload of poor and hungry immigrants from all over. To the land of the free,” dit-il avec un sourire ironique. “They only spoke Yiddish. My grandfather, the Bercowitz, was a shoemaker, shoe repair, really. I was in my early teens when he passed away, in his late eighties.”
Il a presque la larme à l’œil, notre ami Bob. C’est un tendre, qui en a probablement bavé quand il était jeune. Il retourne vers Carlos, qui médite toujours dans son coin. Il porte son verre à la bouche pour cacher peut-être son émotion.
“I remember him in his small shop, in Brooklyn. He refused to let go, although he didn’t have many shoes to repair anymore. The Blacks, sorry, the African-Americans, had moved and so had the Jewish poor, when they had climbed up the ladder. By then, shoes were not repaired, they were thrown away. You work hard, Moishe, my Hebrew name, he used to tell me in his battered English, over a cup of strong dark tea, and always a doughnut or some kind of cracker for me. You work hard, he would exhort, you study good. One day you be a doctor, Moishe. But anyway,” fait-il en retournant à son verre, “here I am, a doctor, but not the kind Shmuel Bercowitz had dreamed forme.”
Il tourne son verre dans la main, il le pose sur la table, il le repousse devant lui. “But enough with the Bercowitz saga,” il me dit avec un sourire qui éclaire des yeux espiègles, “what about you? How so England? And why Frenchnow?”
Je le regarde longuement, un peu ému malgré moi. Ils en ont bavé, ces braves miséreux. De mon côté, peu de choses à raconter. Je voudrais en savoir plus sur ces réfugiés du désespoir, en guenilles, une main devant, une main derrière, à la recherche d’impossibles espérances. Pas pour eux. Je crois qu’ils ne se faisaient aucune illusion, sans instruction, ne parlant que le yiddish, ne sachant lire que leur Talmud, mais pour leurs enfants et les petits à venir, les doctors encore à naître. J’ai lu leurs histoires, bien sûr, Cholem Aleichem, Bernard Malamud, Bashevis Singer, mais je n’ai jamais vécu leursvies.
Ma grand-mère venait bien d’Ukraine, d’Odessa. Elle avait épousé mon grand-père Abraham en Palestine, lui-même ayant abandonné ou fuit la Grèce, avant d’atterrir en Égypte, à Mansourah, je n’ai jamais su ni pourquoi ni comment. Je n’ai jamais rien su de leur odyssée. Une maîtresse femme, m’avait-on vaguement raconté, élevant avec rigueur ses sept enfants, tandis que son mari ressassait, probablement, sa liturgie dans son coin. J’invente peut-être ou ce sont des souvenirs lointains et nébuleux de mots entendus çà et là. Mais la Rébecca, avec son arabe cassé, entremêlé de yiddish, n’était qu’une anecdote exotique dans l’histoire résolument séfarade de la famille.
Je ne les ai pas connus, ni Rébecca, ni Abraham, et je déplore ne jamais avoir demandé à mon père de me relater la genèse de sa famille, ses premières années dans ce Mansourah mythique que je n’ai finalement jamais visité. Que faisait son père pour pourvoir aux besoins de sa nombreuse tribu ? Comment la Grèce ? Pourquoi la Palestine ? Pourquoi l’Égypte et le choix incongru de Mansourah, petite ville, ou rien qu’un village à l’époque, loin du Caire ? Et aussi, et surtout, pourquoi et comment ce mystérieux accouplement hétéroclite de Rébecca et Abraham, l’une ne parlant que le yiddish, peut-être le russe ou l’ukrainien, et l’autre, sans doute, que le grec ? Deux univers disparates, culturellement à des lieues de distance, n’ayant en commun qu’une religion différemment comprise et suivie. Je ne le n’ai jamais demandé à mon père et lui n’en a jamais parlé ; il était tout à fait à l’aise dans son Égypte natale, n’ayant aucun doute sur ses appartenances. Mon père lisait l’Ahram — une espèce de Le Monde en arabe, on le décrirait maintenant — et laissait La Bourse égyptienne ou Le Journal d’Égypte, qu’il trouvait frivoles, pour le reste de la maisonnée. Nous ne parlions que le français chez nous, l’arabe de ma mère n’étant que rudimentaire, à peine suffisant pour ses rapports avec la domesticité.