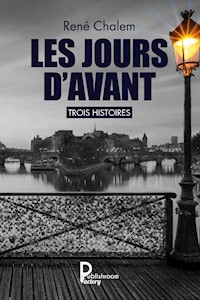
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Un voyage à travers les jours passés...
« Il avait tout brûlé derrière lui. Quelques images renaissent des cendres et chacune d’entre elles est comme un petit coup de poignard. Il avait peut-être vécu. [ …]
Serait-il capable de retrouver pour un instant les moments intenses de joie ou de douleur qu’il avait peut-être vécus ?
Il a dépassé, sans s’en apercevoir, malgré les bruits et les lumières, la place Saint-André des Arts, et la place Saint-Michel. Il traverse le quai des Grands Augustins et se fait engueuler par les automobilistes – hé vieux con ! – parce qu’il est passé sans regarder et, en plus, pas dans les clous. Il rit, il veut leur faire un bras d’honneur, mais il baisse le bras. Pour tout dire, il s’en fout et il se dit que ça ne l’ennuierait pas de se faire percuter par une voiture et d’en finir avec ces moments qui n’en finissent pas de finir. »
Dans ce roman, René Chalem raconte trois petites histoires inspirées de sa vie.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né au Caire,
René Chalem est parti pour Paris juste avant l’avènement de Nasser.
Après quelques années en France, il a immigré en Amérique du Sud où il a travaillé pour l’industrie pharmaceutique.
A 40 ans, poussé par la menace de l’enlèvement de ses enfants dans un pays pris par une frénésie de rapts et de séquestrations, et son besoin soudain d’une nouvelle vie, il revient à Paris – ville à laquelle il se sent attaché comme à un premier amour – où il entame une entreprise d’édition.
Il écrit en français et en anglais, mais
Les jours d’avant est son premier livre à paraître en français.
Il partage actuellement son temps entre Paris et Barcelone, ville aux multiples couleurs qu’il a redécouvert avec bonheur il y a une trentaine d’années.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
René Chalem
Les jours d’avant
Trois histoires
En fait, écrire, ne serait-ce pas une douleur qui masque les autres souffrances ?
Pour Sylvia,un peu tard
Un voyage en métro
Beaucoup de monde. Le métro est bondé. À cette heure, c’est assez insolite. Il a l’avantage de pouvoir choisir ses horaires — maigre avantage venant compenser les inconvénients d’un âge avancé —, mais apparemment, cette fois-ci, il a fait le mauvais calcul, il aurait dû attendre le métro d’après. Il avait hésité un instant, mais il s’était dit que ça n’en valait pas la peine, les probabilités étant fortes que la rame suivante soit aussi encombrée et il avait espéré qu’avec un peu de chance son wagon se désemplirait lors d’un prochain arrêt. Ce n’est pas le cas. Les gens descendent peu et montent beaucoup et se retrouvent tassés, serrés les uns contre les autres, dans un mélange d’odeurs indéfinissables et d’haleines défraîchies.
Il se demande ce qu’il est venu fiche dans ce fouillis. Il a envie de descendre, de rebrousser chemin ou d’attendre sur le quai un moment plus propice. Il pourrait lire ou regarder, assis, passer les trains. Il s’y est pris très en avance, il a le temps avant son rendez-vous avec le médecin. Il avait prévu d’arriver tôt et de prendre son temps à la terrasse d’un café — il y en a un rue des Dames augustines, pas loin de la clinique — avec un verre de vin, blanc pour ne pas brouiller son haleine, et son livre ou son carnet de notes, l’un ou l’autre, ouverts. Ou les deux, pourquoi pas ? Pas nécessairement pour lire ou écrire, mais c’est rassurant de les avoir l’un et l’autre à portée de main, prêts à être utilisés. Ça dédouane, ça permet de laisser filer le regard sur les tranquilles activités urbaines sans se sentir coupable de perdre du temps. Mais, à la réflexion, pourquoi ne se sentirait-il pas le droit de perdre son temps ? Après tout, c’est tout ce qui lui reste et qui lui appartient encore.
Mais il a toujours tenu le temps pour une denrée rare qui ne doit pas être gaspillée ; il a toujours eu la hantise de le voir s’évader. Même si son existence réelle lui échappe, il lui faut à tout moment être conscient de sa présence et mesurer chaque instant de son passage.
Le seul temps dont il pense être sûr est celui qui a déjà fait ses preuves, le passé. Et encore. En fait, on n’en sait trop rien, les souvenirs le transforment de telle façon que, remontant en mémoire, il n’est plus ce qu’il a été. On pourrait alors dire qu’il n’est plus. Ou même qu’il n’a jamais été.
De toute façon, pour le temps présent et celui qui vient, il demande à voir. Il faut creuser un peu plus, mais c’est un sujet qu’il a du mal à appréhender. En fait, présent et futur se mélangent un peu dans sa tête et, par moments, il n’arrive même pas à les distinguer du passé. Il a quelquefois l’impression d’être en présence d’une surface plane, sans aucun relief.
Le présent s’efface très rapidement, et les moments que nous devons encore vivre ne sont-ils pas déjà là, alors que nous ne les avons pas encore vécus ?
Il lui arrive aussi de penser que nous ne vivons pas, mais que nous avons vécu.
Il hésite. Il sent qu’il étouffe. Il est tenté de se rapprocher de la porte pour s’évader aussitôt qu’elle s’ouvrira à la prochaine station. Mais il est rattrapé par ses pensées qui le laissent indécis.
D’autres réflexions se bousculent dans sa tête. Si passé, présent et futur s’entremêlent et s’entrelacent, est-ce que finalement le temps existe ? Mais aussi, ce qui surtout lui taraude l’esprit : est-ce que les autres existent quand il ne les voit pas et qu’ils ne sont pas là en face de lui ?
Son regard, se demande-t-il, n’est-il pas indispensable pour donner leur forme et leur densité aux choses et aux gens ? Mais alors, cela voudrait-il dire que lui aussi n’existe que grâce au regard de l’autre ?Ou encore, peut-être le monde n’existe que parce qu’il en est conscient et qu’il cessera d’être le jour où il aura définitivement fermé les yeux.
Il regarde ses compagnons de voyage. Ils sont bien là, il les voit, il peut les toucher de la main s’il a le courage de le faire.
Mais il n’y peut rien, la question reste posée et parfois, cela lui donne de légers maux de tête et il cligne des yeux ou tourne rapidement la tête d’un côté ou de l’autre pour voir s’il arrive à percevoir un espace blanc ou un vide avant l’apparition ou le retour des images que provoquerait son regard. Peine perdue, mais de temps en temps, il persiste, il continue d’essayer. Il s’en était ouvert une fois à un ami journaliste, qui avait trouvé la pensée curieuse et séduisante, et lui avait demandé s’il avait réussi à développer l’idée quelque part. Il avait vaguement répondu qu’il s’apprêtait à le faire et était rapidement passé à autre chose. Depuis, il n’en avait parlé avec personne.
Il se fichait bien de savoir si l’idée était ou non intéressante, il aurait voulu pouvoir en discuter, en creuser les possibilités, essayer, par exemple, d’établir si deux personnes perçoivent exactement les mêmes choses au même moment ou si chaque personne crée à chaque instant son propre univers. Il aurait voulu examiner ce qu’on voit quand on regarde l’autre, ce qu’on ressent exactement quand on est regardé par l’autre pour ainsi mesurer l’exactitude de cette pensée jugée séduisante par son ami journaliste et qui, lui, le tourmente. Il sait bien que c’est idiot parce qu’impossible : si l’autre est là, il est forcément, lui, là aussi, et s’il ne l’est pas, l’autre ne l’est pas non plus. Le chien qui se mord la queue.
Tout cela est fatigant, il ne se retrouve pas dans cet imbroglio. Et ça se complique encore plus dans sa tête, car les gens répondent bien au téléphone ou au courrier. Il semblerait donc qu’ils sont bien là, même quand lui ne l’est pas. Il n’en sort pas. C’est partir la nuit à la recherche d’un chat noir, mais il n’arrive pas à se faire tout à fait à l’idée que la vie continue, que les gens vivent quand il ne les voit pas vivre.
En fait, le plus difficile, voire impossible, est d’arriver à imaginer ce que fait quelqu’un, n’importe qui, loin de lui et de son regard.
Une station de plus. Une ou deux personnes sont descendues, deux ou trois sont montées. Il aimerait pouvoir leur demander d’où elles viennent, qui elles sont. Il aimerait bien, plutôt, qu’on l’aide à y voir plus clair. Est-ce que l’autre existe ? Est-ce que son voisin est vrai ? Et lui-même l’est-il ? Mais il s’égare. Il ne sait plus où il en est et cela commence à l’irriter sérieusement. Ce tourner en rond qui ne sert à rien et les questions idiotes qui n’ont pas de réponse. Ça le fatigue. Il s’empêche d’y penser, mais il n’y arrive pas tout à fait : aussitôt que se libère son cerveau un moment, c’est reparti, ça n’arrête pas dans sa tête. Sa seule défense contre ces pensées intruses et exaspérantes, est d’ouvrir son livre ou de griffonner quelque chose, n’importe quoi, sur son calepin. Mais ici, comment faire ?
Il y a quelques mois, lors d’une visite chez son psy, il lui a demandé Docteur Machin — il ne se souvient pas de son nom, là, tout de suite —, comment fait-on pour s’arrêter de penser ?Peut-on de temps en temps se réserver des plages de silence mental ? Ça a dû être une colle. Le psy a pris quelques secondes pour répondre. Ce n’est pas possible, a-t-il enfin dit , pour certaines personnes ce n’est pas possible. Les quarante-cinq minutes allouées touchant à leur fin, il n’avait pas pu savoir qui étaient les personnes qui avaient la capacité d’arrêter de penser. Certains y parviennent-ils grâce à une ascèse mentale leur permettant de faire le vide dans leur cerveau ou faut-il simplement être un pauvre d’esprit, incapable de réfléchir ?
Déjà gare de Lyon. Il ne s’est pas rendu compte des arrêts. Les gens sont toujours entassés, le groupe est encore compact. Quelques personnes sont descendues, mais beaucoup sont montées.
Il se demande ce qu’il fait là, avec tous ces gens. Ils vont, viennent ou reviennent, il ne sait pas. Quelqu’un les attend. Leurs amis, leurs enfants, leurs parents, une personne qui leur est chère ? Il regarde autour de lui, autant que le permet la situation, c’est-à-dire pas beaucoup. À gauche, à droite, droit devant, mais sans pouvoir se retourner pour regarder derrière, et pourtant c’est peut-être là qu’il serait le plus intéressant d’observer : derrière, peut-être que ça n’existe pas. Mais quelle connerie ! S’il se retourne, l’arrière devient devant et devant, bien entendu, l’arrière. Tout se mélange dans sa tête.
De toute façon, comme il ne peut pas lire, comme tous ces gens collés à lui l’empêchent de lire, il ne lui reste plus qu’à regarder autour de lui, à s’efforcer de faire le vide dans sa tête.
Son voisin pousse un soupir, mais se reprend rapidement. Il jette un regard effaré autour de lui, comme si il vient de se rendre compte qu’il n’est pas seul. Il se redresse, il ne tourne plus la tête, il regarde droit devant.
Lui, il sourit, il se dit C’est bon, il s’est repris en main et il se demande à quoi ils pensent lui, et les autres, ses autres compagnons de voyage. À quelqu’un qu’ils aiment ? Aux premiers mots qu’on va leur dire quand ils arriveront chez eux ? Construisent-ils déjà dans leur tête la réponse qu’ils vont donner, la description, un peu enjolivée ou quelque peu dramatisée, qu’ils vont faire de leur journée ? Ou peut-être ne diront-ils rien.
Peut-être ne pensent-ils qu’à la délicieuse sensation de défaire les lacets de leurs chaussures pour glisser voluptueusement les pieds dans de confortables charentaises. Ou peut-être ne pensent-ils pas et attendent-ils qu’on leur parle pour commencer à penser. Peut-être sont-ils là uniquement parce qu’il est là lui-même. Mais alors, que deviennent-ils quand ils s’en vont ? Que deviendront-ils quand lui-même descendra du métro ?
Un peu las, il sourit bêtement. Sottises que tout cela, ils sont là parce qu’ils sont là.
Qu’il soit là ou non ne changerait donc rien à la situation ? Son poids ne modifierait-il en rien l’inclinaison de la balance ?
Tout cela lui semble vraiment absurde. Tous ces gens seraient-ils là par hasard ? Et lui aussi ?
Que se serait-il passé s’il était parti quelques minutes plus tôt ou plus tard de chez lui ?
Ou si l’un de ses compagnons de voyage avait décidé de prendre le bus au lieu du métro ?
Pour en avoir le cœur net, il faudrait pouvoir vérifier chacune de ces hypothèses. Impossible, bien entendu. C’est impossible.
Il se perd dans le dédale de ces réflexions saugrenues et fait tous les efforts pour qu’elles arrêtent de caracoler dans ce désordre affligeant.
Il essaye de sortir le livre de sa poche ; il n’y parvient pas et cela l’exaspère. Que leur a-t-il pris, à tous, de choisir cette rame et ce wagon à ce moment précis ?
Par jouissance anticipative, il s’était vu assis sur son strapontin, coupé du monde, s’octroyant la petite joie confortable de continuer la lecture du livre que lui avait conseillé sa fille. C’est à ça que servent les transports en commun, train, avion, paquebot et, pour les citadins, le bus et surtout le métro. C’est en cela qu’ils sont irremplaçables.
Tu es entre deux ports, se dit-il pour meubler l’instant, tu n’es ni dans l’un ni dans l’autre, tu es entre deux temps, celui du départ et celui de l’arrivée, et entre les deux, tu flottes dans une espèce de no man’s land de béatitude. Tu te retrouves dans une sorte de flou horloger, d’éternité flottante, tu t’efforces de ne pas regarder le cadran de ta montre sur ton poignet gauche et, quand malgré toi, tu le fais, tu remarques avec étonnement, et peut-être quelque rancœur, que les aiguilles ont bien avancés. Elles ont couru, elles t’ont laissé sur place, mais quand même, pendant un moment que tu ne veux pas mesurer, tu t’es affranchi d’elles, pendant un moment tu as pu surseoir à la dictature du temps.
Il regarde son poignet gauche, mais sa montre est cachée sous la manche de son blouson. Il se dit Tant mieux et il ajoute, un brin malicieux, Pour éviter la tentation du cadran, quelquefois tu enlèves ta montre et tu la glisses dans ta poche, loin de ton regard inquisiteur.
Pour lui, quand il voyage seul, le métro a le goût d’un tranquille bonheur hors du temps, et c’est avec un peu de désespoir qu’il se voit arriver à la fin du trajet. Quand il s’oublie et laisse passer la station, s’en apercevant quelques arrêts plus tard, il se sent un peu nigaud, mais au fond pas mécontent du tour qu’il vient de se jouer.
Le temps qu’on passe dans le métro est un temps qui n’existe pas et qu’on ne vole donc à personne, encore moins à soi. Mais encore faut-il pouvoir en jouir pleinement. Pour cela, il faut pouvoir disposer d’un minimum d’espace, pas énorme, mais un espace qui permet de s’asseoir sur un de ces petits sièges à bascule, un livre ouvert dans les mains, sans avoir la désagréable impression de gêner tout le monde.
Les bruits, les conversations, les enfants qui braillent, même la musique assourdissante des accordéonistes qui font la manche et à qui il donne volontiers la pièce, tout cela ne le gêne aucunement. Tout ce qu’il lui faut, c’est un peu d’espace pour pouvoir profiter de ce temps merveilleux que seuls les transports en commun, et surtout les transports souterrains, ont le secret.
Il rêve parfois de passer une bonne partie de sa journée dans le métro, voyageant sans relâche d’un bout à l’autre de Paris, depuis un terminus et de retour jusqu’à son opposé. Pensée idiote, bien sûr, le temps ne se laisserait pas berner, il reprendrait très vite les choses en main.
Il faut vraiment jouer le jeu, il faut réellement aller quelque part et, ensuite, entre la station de départ et celle d’arrivée, laisser se créer cette espèce d’intervalle neutre qui n’existe pas vraiment et où l’on peut s’installer confortablement pour un temporaire définitif, un livre à la main. Et quelquefois pas même cela, pas de livre, rien, rien que la tranquille satisfaction de savourer ce moment entre deux moments — et c’est peut-être au cours de ces épisodes qu’on parvient à ne penser à rien —, ce moment qui n’existe peut-être pas, dont on ne garde pas le souvenir. Les mains sagement sur les genoux, la bouche entrouverte, on regarde distraitement se succéder les stations et monter et descendre les passagers qui doivent eux aussi se trouver dans ce monde entre deux mondes, cet espace évanescent, entre deux pensées, entre deux volontés. Mais le savent-ils ?
Tout le monde se plaint des transports en commun et le temps qu’on y perd un jour après l’autre pour aller de chez soi au boulot et le même bazar au retour. En fait, lui aussi a souvent ajouté sa voix à ce chœur plaintif et gémissant. Mais c’était probablement pour faire comme tout le monde et pour qu’on ne le prenne pas pour un joyeux demeuré.
Gamin, il devinait déjà que les transports lui offraient les seuls moments de liberté réelle, ces moments que personne ne pouvait lui retirer. Au Caire, c’était le tramway ou encore, et surtout, le train du baron Empain qui l’emmenait de la station de Kasr El Nil à son école près d’Héliopolis. Trente ou quarante minutes qui lui appartenaient complètement.
Le Caire, il y repense, des années de lenteur et, un peu, d’oubli, des trous qu’il n’arrive pas à combler. Deux petites années au Lycée français, lui a-t-on dit, mais il ne s’en souvient pas. Ensuite l’école anglaise à Qubbeh Gardens parce que son père pressentait déjà que l’anglais serait la langue forte de demain. École de missionnaires anglicans, rigides, corsetés dans des principes du siècle dernier, avec l’école des filles séparée par un mur de celle des garçons, comme des mondes interdits qui ne pouvaient pas se rejoindre. Deux heures de français par semaine, se souvient-il, une petite heure d’arabe que personne ne prenait au sérieux et plusieurs heures d’étude biblique dans laquelle il excellait, se retrouvant pleinement, goulûment, dans la version King James de la bible et la richesse foisonnante de cette langue du XVIIe siècle. Mais à part ça, il pense se souvenir, il s’ennuyait, à l’école et dans la vie. Il passait d’une année scolaire à l’autre sans effort et sans enthousiasme, il allait au cinéma de temps en temps le samedi avec ses amis Victor et André, et quelques sorties avec les filles de l’école, qu’ils avaient réussi à connaître malgré le mur de séparation. On se tenait par la main, on s’embrassait un peu à la sauvette, mais à part ça, la platitude, des conversations insipides et malgré les remontrances d’André — Oh, l’intello, lui disait-il, on n’est pas là pour écrire une thèse ! — il s’ennuyait ; comme à l’école, il s’ennuyait. Et, plus tard, grâce toujours au même André, le plus déluré de la bande, et après de strictes économies sur leur argent de poche, des visites — très espacées — à Clot Bey, le bordel local, dont il gardait un souvenir affligé, malgré leurs rodomontades à propos de leurs exploits virils.
À la maison, c’était le calme. Sauf pour quelques bagarres avec un de ses frères avec qui il n’était jamais parvenu à s’entendre, à la maison c’était le calme, le dîner du vendredi soir, avec toujours quelques invités, des cousins, des cousines, les grandes fêtes, Kippour, Pessa’h, avec vingt-cinq à trente personnes à table, les prières vite dites, suivies des repas plantureux qui ont fait partie des légendes de la famille. Mais hormis ce qu’on pouvait appeler ces moments forts, il s’ennuyait et très tôt, il a voulu partir. Après son diplôme de fin d’études, il ne voulut rien entreprendre, se considérant en sursis de départ. Il travailla quelques mois chez son père et quelques mois dans un grand magasin de tissus d’ameublement, propriété d’un millionnaire syro-britannique qui parlait l’anglais avec l’accent d’Oxford et l’arabe comme le charretier du coin et qui, disait-on, jouait au poker dans un club privé rue Soliman Pacha en compagnie, entre autres, du jeune roi Farouk. Et lui, Emmanuel Dayan, attendait.
Quelques années après la guerre, celle qu’on appela la Seconde, et quelques mois après celle qui opposa Israël, le nouveau-né, à ses voisins arabes, la fratrie commença à s’éparpiller de par le monde : son frère ainé partit pour l’Argentine, rejoindre un cousin qui y était installé depuis longtemps et qui y avait fait fortune dans le textile ; l’autre, celui avec lequel il ne s’entendait pas, choisit la chimie et l’UCL à Londres et un oncle maternel qui s’y était installé depuis peu. Sa sœur, qui venait de se marier, se décida pour Israël et l’agriculture pionnière. Ils y allèrent, son mari et elle, en passant par la France, la route directe leur étant interdite. Le dernier frère, Richard, la grosse tête de la famille, son préféré, son ami, ne voulut rien savoir, il resta au Caire pour terminer ses études de médecine et ne partit qu’après la mort de son père et le départ de sa mère pour Buenos Aires chez son fils aîné ; il y resta jusqu’à son éviction à la suite de l’invasion manquée du canal de Suez. Grâce à des amis, médecins comme lui, il réussit à se faire embaucher par le Mount Sinaï à New York et il y restait jusqu’à sa mise à la retraite, bien que, la médecine étant sa seule passion, il ne puisse s’empêcher d’y retourner deux ou trois jours par semaine, gracieusement, pour le plaisir. Quant à lui, après le départ de ses deux frères et de sa sœur, on lui proposa Londres aussi, bien entendu, son frère y étant déjà et du fait de sa connaissance de l’anglais, mais il s’obstina, ce serait Paris ou rien. Avec l’aide d’un professeur du Lycée français, ami de la famille, il réussit à s’inscrire en cours de droit, et ce fut Paris, ville de ses rêves, où fermentaient, il en était sûr, toutes les idées nouvelles ; Paris, les Lumières, quatre-vingt-neuf, la Commune, la Résistance, le Chant des Partisans qui lui donnait la chair de poule, Paris, les Droits de l’Homme et du Citoyen ; la Terreur, Dreyfus, les massacres insensés de 14-18, la reddition honteuse de 40, le Vél d’Hiv, Pétain, Laval, ce n’était pas la France, ce n’était pas Paris, mais tout juste des moments de folie de l’histoire.
Les croyances, la foi, se dit-il, on ne s’en débarrasse pas facilement. Peut-être jamais.
Et son amour pour la France, sa tendresse pour Paris, sont demeurés intacts.
Il regarde autour de lui, les années lui pèsent comme autant de souvenirs inutiles. Il voudrait que ce voyage ne se termine jamais ; malgré cette promiscuité qu’il ressent comme une agression, il voudrait que le temps s’arrête.
Combien de fois, pour prolonger ces entractes de tranquille félicité, n’a-t-il pas interrompu son voyage et n’est-il pas descendu de son wagon pour s’asseoir sur un banc ou un des sièges que proposent les stations de métro et continuer avidement sa lecture, malgré les regards de curiosité ironique ou amusée qu’il croit deviner chez les voyageurs en proie à leur hâte coutumière ? Mais le regardent-ils vraiment, ou ne laissent-ils pas tout bonnement glisser leur regard sur lui, sans plus d’intérêt que cela ? N’est-ce pas lui qui, pour exister, veut trouver à tout prix la curiosité ou l’ironie dans leur regard ?
Plus tard, les longs voyages en avion ont été comme des vacances qui le coupaient du monde, et c’est avec appréhension qu’à chaque voyage, il attendait que le personnel de bord annonce l’arrivée prochaine et la fin du trajet.
Le livre attend toujours dans sa poche. Dès les premières pages, il lui avait signifié son blâme. Découverte tardive, douloureuse, quasiment inutile à son âge, car cela ne pouvait déboucher sur rien. Qu’avait-il fait toutes ces années pour que ce livre et son auteur soient maintenant une découverte ?
Il s’était retrouvé soudain devant un abîme de solitude, devant un passé figé à jamais, une vie dont il ne pouvait plus rien faire, un vide impossible à combler.
Il en voulait presque à sa fille de lui avoir enfoncé le nez dans ses démissions, de l’avoir obligé à jeter ce regard alarmé sur ces années vides de sens, sur ce temps qui n’était plus récupérable. Il a été pris alors d’une angoisse quasiment incontrôlable, d’un fort désir d’effacer sa vie. Il a cherché avec un sentiment de désespoir une cigarette égarée, sa pipe depuis longtemps éteinte, un cigare quelque part oublié, pour combler ce vide impossible dans la poitrine. Il a pensé à l’alcool, refusant la tentation, ne voulant pas s’abrutir ou anesthésier ses sens. L’idée d’en finir l’a effleuré un instant, mais tout interrompre avant d’avoir tenté de redonner un peu de sens à ces années perdues lui a été insupportable. Ou peut-être est-ce l’angoisse devant ce vide encore plus insensé qui l’a mené à rechercher une autre issue.
Il a appelé sa fille. Elle était occupée, prise entre deux réunions. Il lui a dit très vite Il est formidable ton bonhomme, admirable ! Elle a tout de suite su de qui il s’agissait et elle lui a répondu en riant Ah, ça me fait plaisir ! Lui, bien que la sachant pressée, n’a pu se retenir, il lui a lancé Tu vois, ton vieux père, il est encore capable de surprise et de découverte !
Il fallait bien qu’il se dédouane de son ignorance, auprès d’elle et surtout de lui-même. Mais c’était quand même vrai, malgré tout, malgré ces années désertes, vides, insipides, il était encore capable d’admirer et de s’émerveiller.
Toutes ces longues années qu’avait-il fait, sinon tous les jours remettre à demain sa reprise en main ? Il sentait son cerveau s’engourdir et la dérive l’accompagner, comme un chien d’aveugle, dans le médiocre quotidien, d’un roman policier à l’autre, d’un thriller au prochain avec, comme excuse, le poids monotone et abrutissant de son travail.
C’était vrai, sans doute, son travail — la promotion et la vente de produits pharmaceutiques — prenait beaucoup de temps et occupait son esprit, avec toujours en sourdine ce sentiment lancinant de faire du commerce avec la santé. Mais son travail servait surtout d’échappatoire, de cache-misère de la pensée.
Il se promettait tous les jours de changer de métier, comme on se promet tous les jours de cesser de fumer, sachant bien, toutefois, que l’aversion pour son travail n’était pas la seule raison, ni même la cause principale, de son désarroi mental. Il aurait fallu remonter plus haut pour retrouver les premières concessions, les premiers compromis, les signes prémonitoires de cette espèce de déliquescence morale qui s’ensuivit.
Mais il se résistait à cette exploration, craignant que cela ne provoque un effondrement total. Il franchissait les années jour après jour, par petites étapes, comme les obstacles qu’il faut enjamber un à un. Il refoulait ses envies de mots. Il les laissait naître et disparaître dans son cerveau, murmures éphémères, petites musiques silencieuses, qui lui donnaient un instant l’impression d’exister.
Bloqué, debout, suffoquant pratiquement entre tous ces gens indifférents à ce qui les entoure, le vertige le prend quand il pense à tous ces mots qui n’ont pas été dits, ou qu’il a volontairement étouffés.
Comment a-t-il pu s’abandonner aussi longtemps à ce massacre des idées et de la parole ?
Il ressent le besoin urgent de jouer des coudes, de crier Réveillez-vous ! Il voudrait bousculer ses voisins, les vitupérer, leur asséner de grands coups de pied dans les tibias, leur hurler au visage Vous êtes des morts-vivants, des zombies ! Prenez-vous par la main, bande d’idiots, la mort n’est pas loin !
Il s’efforce de repousser les années de grottes lugubres, de pensée lente et rare, sachant, toutefois, que cela n’est même pas vrai : ce n’était pas une époque sans lumière. Il veut s’en souvenir comme d’une période de ciel bas, d’un gris uniforme, de silencieuse monotonie, de jours sans relief, mais c’est pour trouver des excuses à sa léthargie. Ces années, il le sait, ont été parsemées de jours où tout paraissait clair, lumineux, des jours d’euphorie quasiment incontrôlable, de joies, d’affection, d’amour, des jours quand il aimait et se savait aimé. Il les savait éphémères, mais qu’importe, cela n’aurait pas dû l’empêcher d’en goûter la transparence. Et peut-être l’a-t-il fait. Mais il ne s’en souvient plus.
Il ne veut pas penser à ces années piétinées, mais elles ressurgissent, elles refont surface. Elles lui rappellent qu’elles sont irrécupérables. Il voudrait demander à ses voisins de s’éloigner un peu, de lui donner un brin d’espace. Chaque jour, il remettait au lendemain ; sans vraiment savoir quoi, il remettait au lendemain. Une sensation d’irrémediabilité le saisit.
Quand il y pense dans la rue, il lui faut hâter le pas, presque courir pour gagner de vitesse les ombres insidieuses d’un passé nébuleux qui le prend à la gorge. Chez lui, il lui faut boire un peu d’eau, du vin, ou appeler quelqu’un au téléphone, n’importe qui, pour parvenir, un tant soit peu, à assourdir la clameur de ces heures qui se refusent à mourir. Il sent comme un gouffre l’envahir, un insupportable sentiment d’inutilité.
Il pense à ce qu’aurait été sa vie s’il était parti rejoindre sa famille en Argentine, comme le lui avait proposé avec insistance Raul, son frère aîné, bien installé à Buenos Aires, à la tête d’une teinturerie industrielle, et qui y avait déjà fait venir son frère le chimiste, diplôme anglais en main, ainsi que sa sœur, avec mari et enfants, qui avaient bien dû se rendre compte, après quelques années d’enthousiasme patriotique en Israël, que l’agriculture n’était vraiment pas leur tasse de thé. Il avait refusé l’invitation de son frère, restant attaché à la France, et surtout à Paris, son premier amour.
Ma vie aurait été différente, se dit-il, je n’aurais pas rencontré Gabrielle et si j’avais eu des enfants, ils auraient été autres. Mes enfants n’auraient pas existé, ni l’un ni l’autre.
Et cette pensée lui est insupportable.
C’est comme si moi je n’étais pas moi, se dit-il encore. Mais c’est impossible, on ne peut pas se penser autre que soi-même.
Enfin, maintenant il faut faire vite — on verra bien ce que dit le médecin — pendant les moments qui restent, pour tout lire, peut-être écrire, et rattraper le temps qui s’est bêtement évadé, une journée vide après l’autre.
Il se dit On ne récupère pas le passé, mais il faut faire comme si.
On n’emporte rien avec soi pour le dernier voyage, mais ne faut-il pas, au moins, avoir fait ce qu’on avait à faire ? On ne peut pas partir avec des valises dégarnies, les bras ballants, les mains dans les poches. Il faut essayer de meubler l’espace et de combler le vide.
Il faut pouvoir sentir en soi le poids des choses, il insiste, des jours, des mots, des désirs, des envies, de l’amitié, de l’amour, des haines aussi, si on est capable de haïr, il faut avoir connu la blessure des remords, la mélancolie des regrets, l’émerveillement des découvertes, il faut avoir vécu, même si tout cela, finalement, n’a jamais été, puisqu’avec soi disparaît la mémoire.
On est et on n’est plus ; on n’aura donc jamais été. Rien n’aura jamais existé. Ce n’est pas effrayant, c’est incompréhensible. Comment trouver les mots pour décrire ce rien définitif ? On peut imaginer le silence, le silence absolu, mais pas l’absence de tout, même de silence.
La position debout, entouré de corps agressivement inertes, commence à lui peser sérieusement. Le temps perdu lui devient tout à fait intolérable. A-t-il vraiment besoin de continuer ? Qu’aura-t-il encore à lui dire, ce cher médecin, avec ses airs de courtoise sympathie ? Votre épouse vous accompagne ? Non, non, rien de particulier, c’est pour savoir. Il lui en veut soudain. D’être jeune, d’être propre sur lui, d’être bien portant, de donner l’impression de toujours savoir ce qu’il faut faire, d’avoir un regard de commisération retenue, d’avoir ce geste de sympathie quand il vous tend la main. Il se dit avec rancœur Tu n’as pas encore vu assez de gens mourir autour de toi, mon bonhomme. Mais il se rattrape, Tout cela n’est probablement pas vrai, je laisse parler ma rancune. C’est certainement un brave homme qui essaye d’accomplir son travail du mieux qu’il peut.
Cela fera sa troisième visite et il n’a vraiment pas à s’en plaindre. Mais cette fois-ci, ce sont les résultats des analyses qui l’attendent. Le médecin les a depuis une semaine ou dix jours, le labo les lui a fait parvenir directement. Lui, il n’est pas allé les chercher ; il a voulu retarder le moment de savoir.
Il avait pensé, mais finalement ne l’avait pas fait, il avait pensé prendre l’avion pour New York et s’en remettre à son frère Richard. La gastro n’est pas sa spécialité, mais il aurait pu le remettre entre de bonnes mains et l’accompagner d’un examen à l’autre, discuter du diagnostic avec ses collègues et le lui expliquer avec ménagement et même avec optimisme, comme à son habitude. Rien, jamais, n’était définitif pour Richard, la médecine était là pour résoudre les problèmes, pas pour dicter des arrêts de mort. Son destin aurait été pris en main, il se serait senti accompagné. Mais au bout du compte on est toujours seul. Il s’était dit que personne ne pouvait vivre ou mourir à sa place. Il était resté à Paris et n’en avait parlé à personne.
Maintenant, avec ce métro inopinément bondé il se sent fatigué.
Il n’avait pas voulu d’un taxi, savourant par avance l’entre-deux temps du métro, pour maintenant se retrouver comme il est, debout, fortement agrippé à un tuyau métallique pour essayer de compenser le balancement du train et ne pas écraser ses voisins ou se laisser écraser par eux. Il se demande à nouveau ce qu’il est venu fiche dans ce fatras.
Tout cela a vraiment peu de sens. Mais rien n’a vraiment beaucoup de sens. Il pense tu vas, tu viens, tu dors, tu aimes, tu souffres, tu travailles, tu fabriques, tu détruis, tu perds, tu gagnes, tu pleures, tu attends. Il se dit Et alors ? Qu’est-ce que tout cela t’aura donné ? Est-ce que cela aura changé en quoi que ce soit le dernier moment de ta vie ?
Le dernier moment est toujours le même. Qu’on ait vécu vingt ans ou cent, le passé aura rattrapé l’avenir et on aura toujours besoin d’un peu plus de temps.
Pour se calmer, il revient à sa fille. Elle lui avait dit Lis, tu vas voir, mais elle ne lui avait pas donné son exemplaire, ajoutant avec un petit sourire espiègle. Achète-le en anglais, puisque, comme chacun sait, tu ne supportes pas les traductions. Il a beau lui répéter qu’il n’a rien contre les traductions, bien au contraire, mais qu’il trouve idiot de ne pas lire l’original quand on peut le faire, elle ne peut s’empêcher, depuis qu’elle l’a surpris faisant la moue devant le roman traduit de l’anglais qu’elle lui avait offert pour un anniversaire, de ressortir la même rengaine, soulignant ainsi, elle en est persuadée, son élitisme invétéré et primaire.
Elle le fait rire, sa fille, elle égaye sa journée, elle le rajeunit, bien qu’elle le traite souvent de vieux ronchon arrêté dans ses idées pré soixante-huitardes. Quand elle l’appelle, elle veut toujours savoir, très vite, comment il va et s’il s’en sort, elle veut tout de suite être rassurée, totalement, universellement, pour le toujours du moment où elle l’appelle Est-ce que ça va, tu ne t’ennuies pas trop, tu es content ? Et quand elle reprend enfin son souffle et qu’il lui répond invariablement Ça va, ça va, tout va elle se fâche Oui, tu me prends pour une idiote, tu ne veux rien me dire, tu crois que je ne sais pas ?
Il a toujours envie de lui demander Tu ne sais pas quoi ? Les silences de la vie, les réveils impossibles, les envies, le besoin d’en finir ? Mais il ne le fait pas.
Madeleine, sa fille, c’est son printemps.
Et quand il pense à ses enfants, il a parfois envie de mourir vite avant qu’il ne leur arrive quelque chose.
La station debout, l’inconfort, la promiscuité par moments embarrassante — on ne sait pas où mettre la main ou que faire de son bras — l’obligent à la réflexion qu’il s’efforce depuis un bon bout de temps d’éviter, l’introspection, ce retour sur soi-même, toujours présent, comme le bruit de fond d’une autoroute lointaine, et qui de temps à autre remonte des profondeurs, t’agrippes à la gorge et te secoues comme une vieille poupée de chiffon.
Quand l’angoisse le prend, s’il laisse remonter la panique, il lui faut bousculer tout le monde, descendre, marcher à grands pas apparemment volontaires, parler à quelqu’un.
Chez lui, il lui faut rapidement appeler son fils ou sa fille, ou les deux, pour leur dire n’importe quoi, leur demander des nouvelles des enfants, du travail, de leurs amis, ou inventer quelque chose qu’il lui faut absolument leur dire, n’importe quoi. Personne n’est vraiment dupe. Il les sent essayer de lui sourire. Son fils lui dis, Tu ne veux pas venir dîner ce soir ? Viens, ton petit-fils, s’il sait que tu es là, il nous fera peut-être l’honneur de se joindre à nous. Sa fille, à ces moments d’angoisse, il évite de l’appeler, sachant qu’elle va se faire un sang d’encre et que ça va lui fiche en l’air sa journée, et elle se débrouillera pour passer le voir à un moment ou à un autre et qu’alors ce sera sa fête. Est-ce que tu ne veux pas enfin venir vivre chez moi ? Au moins pour quelques jours ? Tu t’entends bien avec Vincent, et les gamins. Elle n’attend pas, elle continue Pourquoi ne pas voyager, te changer les idées ? Aller voir ton frère Richard, ton bon copain, la famille en Argentine ? Et ainsi de suite pendant un bon bout de temps. Qu’est-ce que tu nous fais là ? Tu ne te rends pas compte ?
Il évite sa fille et essaye d’appeler son fils en premier. Ou, si cela échoue, un des quelques amis qu’il lui reste encore, Pierre, Jean-Pierre, avec qui il a construit une partie de sa vie, André, son ami d’enfance qui vit à Chicago et qui, de temps en temps, passe par Paris. Bien qu’avec eux ce soit un peu plus difficile, à leur intimité passée s’étant substituée une distante affection qui ne permet plus un épanchement libérateur. Mais cela a-t-il jamais été le cas ? Il ne sait pas.
Ou encore Dimitri, blessure brûlante d’il n’y a pas si longtemps, blessure toujours ouverte. Il est parti quand tout était encore à dire, il est parti vite avant de ne pouvoir rien se dire. Il se dit Je ne cicatrise pas, j’ai laissé s’enfuir le temps.
Mais avec le bon Dimitri, plus que des mots au bout du fil, il fallait une présence, il fallait pratiquement se toucher pour mieux se comprendre.
Dimitri, c’était ce roc fragile des collines de la Grèce, cet ami chaleureux qui devait venir le retrouver à Paris et qui était mort quelques jours avant de prendre l’avion.
Mais que ce soit avec Dimitri ou avec les autres, il pense avoir été un bon écouteur, mais pas un raconteur efficace. Il n’a jamais su parler de lui-même.
Parler de soi, c’est vraiment trop compliqué, il faut à tout bout de champ ouvrir des parenthèses, faire des retours en arrière, expliquer des choses qui semblent pourtant évidentes, revenir sur des évènements souvent sans importance pour, à nouveau, les expliquer. Enfin, comme diraient les jeunes maintenant, c’est la galère.
Écouter les autres a été comme un remède à ses doutes et ses angoisses. A été ? Mais n’est-ce pas encore le cas ?
Si ce n’est pas un remède, c’est au moins un palliatif, se dit-il.
Écouter empêche presque toujours l’angoisse de ce que tu es ou tu n’es pas, de t’envahir. C’est l’anxiété et l’appréhension d’un autre qui s’emparent de toi et prennent, pour un temps, toute la place. Ce sont des mots étrangers qui font leur chemin et remplissent le cerveau et repoussent les images sournoises du passé qui, le plus souvent, toutefois, ne se laisse pas abuser. Alors reviennent les envies de disparaître, les prières d’en finir.
Il pense à Pierre. D’Alessandro. Quand se sont-ils vus la dernière fois ? Peut-être un an. Plusieurs mois de toute façon, puisqu’il ne lui a rien dit de ses problèmes de santé et de ses visites chez le médecin. Mais s’ils s’étaient vus, le lui aurait-il dit ? Peut-être après un verre ou deux, et peut-être pas. Il vaut mieux, pour entretenir l’amitié, ou la mémoire qu’on en a conservée, garder les relations sur le plan du quotidien, ne parler que de l’immédiat, du banal, de ce qu’ils font l’un et l’autre tous les jours, bien que là encore lui ne soit pas trop disert. Ils parlent de livres, du dernier roman de Jean-Pierre, d’expositions de peinture, mais comme ça, à la va-vite, sans trop s’attarder, tout juste pour se dire qu’ils vivent au même moment, dans le même monde.
Définitivement, il préfère écouter. Peut-être aussi n’a-t-il vraiment rien à dire. Par moments, il veut croire que, lisant ce qu’il écrit, on peut découvrir ce qu’il a à dire. Et à d’autres, le plus fréquemment, il s’en fiche. Ce sont des mots qui lui montent à la tête, pas des messages. Des sonorités, pas des témoignages. Quelquefois, il ne comprend pas tout à fait lui-même ce qu’il écrit et il y cherche un sens après coup. Quand il n’en trouve pas, il se contente de la musique des mots, de la cadence.
Il a toujours affirmé qu’on écrivait pour être lu, mais il n’en est plus très sûr. On écrit parce qu’on ne peut pas faire autrement et que les mots, bien que douloureux, libèrent. C’est comme ça, et même s’il se considère un peu comme un usurpateur, il continue à pousser un mot devant l’autre. En fait, il n’a rien ou peu à dire, car en règle générale, il ne trouve pas de sens aux choses.
Pierre. Le photographe, son ami. Ils se sont connus à la faculté de droit, rue Saint-Jacques, où ils avaient péniblement suivi les cours de première année avant de bifurquer, lui vers la faculté de lettres, Pierre vers l’école des beaux-arts où il avait réussi, contre toute attente, à se faire admettre. À l’époque, peut-être aussi maintenant, la fac de droit était le bastion de l’extrême droite et leurs noms de métèque, l’un à résonance ritale et l’autre résolument youpine, prêtaient à raillerie. Pierre était un fort en gueule, lui aussi à l’époque ; ça les avait rapprochés. Et puis Pierre avait l’avantage, dont lui aussi tirait parti, d’être bâti comme une armoire à glace, héritage de ses gènes de paysan toscan, affirmait-il. Lui ne pesait pas lourd, mais avait le verbe rapide — malgré son accent de la Méditerranée, rive africaine s’entend — et ils formaient tous les deux un solide tandem. Ils avaient allègrement cassé de l’Action française, verbalement surtout, la formidable carrure de Pierre leur évitant le plus souvent des affrontements physiques. Mais tout cela les avaient éloignés de la logique beauté du droit et ils étaient partis, chacun de son côté, après en avoir débattu des nuits entières dans les âcres effluves d’alcools bon marché.
Ils avaient continué de se voir presque tous les jours, avant de se perdre de vue pendant quelques semaines, quelques mois, — il ne s’en souvient plus — et s’étaient retrouvés, il ne sait plus trop comment, au cours d’une vague sauterie, bien que n’étant pas des habitués, ni l’un ni l’autre, de ce genre de manifestation.
Pierre était un amoureux de l’amour et, sans vraiment le vouloir, un tombeur de ces dames, il les attirait comme la fleur attire l’abeille et, le plus souvent, avec des conséquences cataclysmiques. Il se frappait la poitrine comme un gorille à grands coups de ses grandes paluches en criant à tue-tête La vie est belle, Manuel, lavie est belle ! Ça, c’est de la femme, mon bon Manu, c’est du gigantesque, c’est du jamais vu ! Et quand, en souriant, il lui faisait remarquer qu’il lui avait déjà connu des enthousiasmes tout aussi ardents, Pierre jurait ses grands dieux en le tapant comme un sourd dans le dos que cette fois-ci c’était différent, que c’était définitif, qu’il le sentait dans ses os — Cette fois-ci, Manu, c’est la bonne ! Ce qui ne l’empêchait pas, bien entendu, de l’appeler à la rescousse quelques jours ou quelques semaines plus tard, ne sachant pas comment se défaire du grand amour de sa vie sans provoquer trop de dégâts.
En une occasion, à la demande pressante du bon gorille, il avait réussi — il ne sait toujours pas comment — à séduire une des filles qui avaient fait saigner son cœur, pour que Pierre, cocufié, la larme à l’œil et le cœur brisé, puisse s’en séparer. Et, pendant quelques semaines, Pierre lui en avait été éternellement reconnaissant.
Pietro ! lui avait-il crié en apercevant sa grosse tignasse bouclée qui flottait d’une bonne tête au-dessus de la mêlée, et ils étaient tombés dans les bras l’un de l’autre, heureux de se retrouver. C’est là aussi, qu’est apparu l’autre Pierre, Jean-Pierre, qui devint très vite et pour de nombreuses années son alter ego, son frère d’armes, son frère tout court, son copain de toujours, mais d’un toujours brusquement et stupidement interrompu.
Jean-Pierre, une amitié comme un amour de jeunesse que rien ne doit salir, dont rien ne doit venir altérer l’image, peut-être idéalisée, qu’il en a conservée. Il ne veut pas penser à lui. Il ne veut pas revenir sur ce qui, soudain, est venu briser cette magie entre eux. Un mot, un mot mal dit à un mauvais moment. Il avait mis en doute sa loyauté.
Après un accrochage avec Marie-Anne, sa femme, Jean-Pierre lui avait lancé, furieux, au téléphone Emmanuel, qu’est-ce que tu as encore été lui dire, à Marie-Anne ? Il savait qu’ils s’entendaient bien, Marie-Anne et lui et, dans un moment de colère ou de dépit, il en avait déduit qu’il lui avait dévoilé ses incartades. C’était ça, Jean-Pierre, c’est encore ça il en est sûr, il dit tout tout de suite, il ne se donne pas le temps de réfléchir. Sauf quand il écrit. Qu’est-ce que tu raconterais comme conneries, lui avait-il dit plus d’une fois en rigolant, mais exaspéré aussi, si tu écrivais comme tu parles. Il ne peut pas s’en empêcher, Jean-Pierre. Il le regrette tout de suite après, il présente ses excuses, il prie qu’on le pardonne, il jure que cela ne se répètera plus, mais il est quelquefois difficile de complètement effacer ce qui a été dit. Il ne lui en avait pas voulu, il ne sait pas garder rancune, mais il n’a jamais réussi à oublier que Jean-Pierre avait pu penser, ne fût-ce qu’un instant, qu’il fût capable de le trahir.
Ils s’étaient connus lors de la soirée des retrouvailles avec Pierre. Dans le brouhaha infernal, un verre à la main, ils avaient parlé des grèves et des manifestations, celle des cheminots, celle des fonctionnaires, de la marche pour la paix, et surtout des Rosenberg, de Beloyannis, dont il gardait le portrait accroché au-dessus de son lit, celui de Picasso, l’homme à l’œillet, découpé dans l’Huma, et ils avaient parlé de poésie, pourquoi, il ne sait trop pourquoi, et Jean-Pierre avait alors cité les vers d’Eluard sur le mont Athos dont les pentes sont rudes, mais que les hommes adoucissent et Eluard était alors son poète de chevet.
Pierre étant en train de roucouler dans un coin avec une grande et belle fille blonde, sa conquête du moment, ils étaient partis Jean-Pierre et lui, finir la soirée ensemble et réinventer le monde dans un bouiboui du 6e. Par la suite et pendant longtemps, ils ne s’étaient plus quittés.
Pierre, le photographe, lui, faisait dans la peinture, dans sa chambre de bonne au sixième étage sans ascenseur d’un vieil immeuble bourgeois, rue du Cherche-Midi. Il lui disait Viens, tu vas voir, c’est amusant. Pierre ne s’était jamais pris au sérieux. Il peignait selon de vieilles cartes postales, couleur sépia, sales et racornies, qu’il achetait chez les bouquinistes et qu’il reproduisait ou interprétait avec zébrures et craquelures, ajoutant çà et là des taches de couleur. Il a encore un de ces tableaux chez lui. C’était, pour ainsi dire, intéressant comme travail, amusant comme Pierre le disait lui-même, mais ça n’allait pas beaucoup plus loin. Et il le savait. Il lui disait Manuel, viens, tu regardes, mais ça n’aura pas sa place dans un musée, et ils se buvaient une bouteille de corbières avec un morceau de camembert et la baguette qu’il avait ramenée sous le bras. Quand Pierre avait réussi à vendre un tableau, ou que lui, avec son salaire, avait reçu une prime pour avoir travaillé quelques heures de plus pour parer aux urgences, ils remplaçaient le corbières par du pommard et c’était la fête.
Peu après, Pierre hérita d’un oncle paternel, Dieu seul sait pourquoi, un vieil appareil photo dont on se servait pour tirer les portraits de familles endimanchées dans les foires ou sur les places publiques, et d’un Leica flambant neuf.
Ce fut pour Pierre la découverte et l’émerveillement. Il commença par prendre des photos pour ensuite les peindre, et suivirent de longues séances de pose pour chacun de ses amis, mais très vite il laissa tomber la peinture, et l’on ne le vit plus qu’avec son Leica en bandoulière. Plus de séances de pose ou quelques portraits à la sauvette : Pierre, c’était la rue qui l’intéressait. Il l’accompagnait quelquefois quand, cigarette au bec, casquette vissée sur le crâne, Pierre guettait la scène qu’on ne pouvait pas laisser se perdre. Le clochard — à l’époque, on ne parlait pas de SDF — prenant le soleil sur un banc et à qui il donnait ensuite la pièce ou un petit billet, l’invalide de 14-18, si seul, si abandonné, dans son petit kiosque de la Loterie Nationale sur le trottoir, son copain, le vendeur de L’Humanité Dimanche un large sourire sur les lèvres, les amoureux qui se donnent goulûment un baiser au beau milieu du trottoir, ou encore, les deux vieux se tenant tendrement par la main, les bateliers prenant l’air sur le pont de leur péniche paresseuse. Du déjà vu certainement — il est peut-être impossible de prendre des photos de Paris qui n’aient pas déjà été prises, Doisneau ou Cartier-Bresson ayant déjà tout dit — mais il traitait ses sujets avec une telle délicatesse, une telle affection — la photo du clochard devenait le portrait d’un ami, celle de l’invalide, la photo de son oncle, de son père, d’un proche de toute façon, les bateliers sur les péniches, des amis à qui on dit adieu — qu’on en oubliait la redite. Là, il n’avait plus eu de réserve, c’était déjà, malgré quelques gaucheries et quelques maladresses, du beau travail. Il n’avait plus eu besoin de le lui dire, Pierre le sentait bien à son regard.
C’est alors qu’avait commencé à germer le projet de livre commun, auquel ils avaient tout de suite voulu associer Jean-Pierre. S’ensuivirent des séances mémorables de travail et d’amitié intense et irradiante dans la poursuite d’un but commun et d’une entreprise partagée avec ferveur. Il se disait que c’était ce que doivent ressentir les musiciens d’un orchestre de chambre ou les chanteurs dans un chœur ou, surtout, en plus grand, en plus immense, ce qu’ont dû ressentir, il en était persuadé, les bâtisseurs de cathédrales. En y repensant, cet épisode, certainement, avait été la période la plus exaltante de sa vie. Pour le livre, ils avaient envisagé les vendanges et leur travail collectif qu’ils imaginaient joyeux, la danse pieds nus pour faire éclater le raisin, le charbon aussi parce que Jean-Pierre, selon la légende, venait d’une famille de mineurs, et tous les trois se sentaient déjà des accents héroïques à l’odeur de la houille. Mais ils avaient surtout parlé de l’Algérie où les communautés s’élevaient l’une contre l’autre. Et Pierre traçait les lignes de ses photos futures comme un architecte dessine les plans d’une maison, tandis que Jean-Pierre et lui, fébriles, jetaient sur le papier leurs ébauches de poèmes.
Plus tard, Jean-Pierre lui avait avoué, avec un sourire espiègle, qu’il ne descendait pas d’une lignée de mineurs. Son père, employé de la voirie à Clermont-Ferrand, était mort très jeune des suites d’une pneumonie mal soignée. Mais il n’avait rien voulu savoir et il lui avait conservé son auréole.
Le livre prenait corps, jour après jour, page après page. Pierre partait à la poursuite de visages maghrébins, à la recherche des accents authentiques de l’abandon et la déshérence tandis que les deux autres jetaient sur le papier les mots enflammés de liberté et de fraternité en attendant d’aller sur place retrouver les images et les épreuves du quotidien. Ils souhaitaient parvenir à une poésie du réel, comme un reportage pour un journal. Ils retenaient leur lyrisme, ce qui était plus dans les cordes de Jean-Pierre que dans les siennes, plus enclin à se laisser aller à des incantations de type biblique.
Jean-Pierre lui disait Pense à Francis Ponge, pense à Guillevic.
T’es marrant, toi, il lui répondait pompeusement, Je viens des rives du Nil, mon cher, où, à la tombée du jour, on entend chanter le muezzin.
Les deux comptaient sur lui Tu leur parleras en arabe, le bougnoule, ça nous ouvrira des portes. Et il avait beau leur expliquer que ce n’était pas la même langue, ils ne voulaient rien entendre C’est comme le français et le québécois, insistaient-ils, et lui, emporté par l’enthousiasme, se laissait à moitié convaincre, On verra sur place. Et il se disait que, tout au moins, ça montrerait leur bonne volonté.
Il ne s’était jamais, depuis, senti aussi proche de qui que ce soit. C’était une symbiose quasiment amoureuse. Il rentrait chez lui dans une sorte d’ébriété heureuse et toute la journée, il ne pensait qu’à leurs séances nocturnes où les paroles sonnaient comme les clairons du réveil.
Quelquefois, Pierre, impatient, les attendait sur le pas de la porte pour leur dire ses dernières trouvailles ou pour leur parler de sa rencontre dans un café à Billancourt avec un algérien, ouvrier chez Renault et pour vite leur montrer le portrait de ce visage buriné qu’il venait de développer dans son laboratoire de fortune.
Quant à lui, il ne pouvait plus attendre, les mots tout de suite s’enflammaient dans sa tête : Mon ami des lenteurs/mon arabe généreux/j’ai laissé passer les jours/j’ai laissé passer le temps/mon ami patient.
Il allumait une cigarette nerveusement et continuait : Je n’ai pas oublié/ni les mots ni le vent/Nous sommes nés sous la même tente/mon ami riant/Tu es le fils de ma tante/mon arabe rêveur/celle à la chevelure brillante/noire comme la fraicheur/des nuits murmurantes.
Jean-Pierre, qui lisait par-dessus son épaule, ne pouvait se retenir de rire. Il s’esclaffait





























