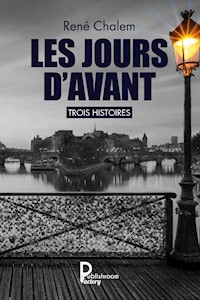Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Au fond, tout cela n’est pas bien grave. Il faut vivre un jour après l’autre, se laisser émouvoir par un soleil qui se lève, un arbre qui soudain fleurit, un vieux et sa compagne qui se promènent en se tenant par la main, le vent du soir dans le feuillage, un gamin qui joue avec mon chien. Le monde nous réserve encore des splendeurs sans que nous ayons à nous démener. Sur le pas de ma porte, il suffit d’attendre.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né au Caire, René Chalem part pour Paris juste avant l’avènement de Nasser.
Après quelques années, il quitte la France pour l’Amérique latine où il s’installe de longues années.
À quarante ans, poussé par son désir d’une nouvelle vie, il revient à Paris où il s’enracine.
Il partage actuellement son temps entre Paris et Barcelone.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
René Chalem
Sur le pas de maporte
Pour Sylvia, comme toujourset pour tous ceux qui sont partisÀ Claude et Ylana
L’absence est une ride du souvenir.C’est la douceur d’une caresse, unpetit poème oublié sur la table.Tahar Ben Jelloun
Remerciements
Un grand merci à Josep A. Vidal à qui ce récit doittant.
Et à mon amie Monique Glorieux, ma gentille voisine basque, pour ses précieuses indications.
Mes remerciements aussi à Brigitte Jansen pour sa relecture avisée.
Sur le pas de maporte
Le fauteuil enosier
Comme chaque matin quand il fait beau, même s’il fait un peu froid, Blandine a installé mon fauteuil sur le pas de la porte et aussi le tabouret en bois blanc qui me sert de petite table pour mon café et un croissant, quelquefois un pain au chocolat.
Gorki, mon fidèle ami, lève la tête vers moi dans l’attente de sa friandise du matin, son petit bout de croissant.
Le fauteuil m’a suivi partout, il semblerait depuis toujours. Un vieux machin en osier, léger, facile à déplacer, confortable, auquel je me suis habitué comme à de vieilles chaussures dans lesquelles les pieds se sentent à l’aise, comme chezeux.
Plus d’une fois, Hélène a voulu le mettre à la poubelle — elle affirmait que même Emmaüs n’en voudrait pas — mais je m’y suis opposé bec et ongles et je l’ai sauvé d’une mort humiliante.
Les enfants ne comprenaient pas mon attachement obstiné à cette relique d’un autre âge. Témoins de nos disputes de chiffonniers, Hélène et moi, ils se marraient comme des singes.
Ça m’amusait de taquiner Hélène, mais je dois aussi admettre que j’y tenais à ce fichu fauteuil, c’était le seul objet que je pouvais considérer comme étant tout à fait à moi. Il venait d’avant, avant notre rencontre et notre vie àdeux.
Chaque matin, quand il fait beau, je prends place dans mon vieux fauteuil et je pense à Hélène. Quand elle a finalement bien voulu s’installer chez moi, mon appartement étant plus grand que le sien, elle a pris tout en main ; rejetant mon penchant pour un minimalisme un peu trop rustique à son goût, elle a tout remeublé dans un mélange d’ancien et de moderne. Ça lui a demandé de longs mois de visites dans les brocantes du quartier, le marché aux puces, porte de Clignancourt, un canapé Casina qui a coûté un bras et la moitié de l’autre, des fauteuils de style Bauhaus. La table Knoll pour la salle à manger, elle l’a ramenée de chez elle avec ses chaises tulipes. Je dois admettre que le résultat était chaleureux et accueillant. Elle a conservé mes quelques tableaux et mes livres en y ajoutant les siens propres.
Mon fauteuil en osier a été le seul rescapé du grand chambardement. Lui, et ma vieille veste en tweed aux coudes rapiécés qu’Hélène détestait avec ferveur.
Les souvenirs se bousculent dans ma tête. Je bois mon café lentement. Le temps est là et je faisavec.
Les vieux, c’est ce qu’ils ont, le temps pour remonter le temps. Ils essayent d’oublier ou d’ignorer que la fin n’est plus très loin. Ils se lèvent tôt, expulsés du lit par les pensées difficiles de la nuit ou par la morose grisaille de l’aube. Ils répètent les mêmes gestes, ils allongent la toilette du matin, ils choisissent avec soin les vêtements pour la journée, ils prennent tous les jours leurs repas, toujours à la même heure, sauf quand une visite vient rompre le cours linéaire d’une journée répétitive et monotone. Ils posent les mêmes questions et reçoivent les mêmes réponses ; ça les rassure, ils sont sur un terrain familier dont ils connaissent déjà tous les recoins, les plis et les replis.
La redondance quotidienne et la répétition sont un gage de continuité, de poursuite de la vie. Comme un train qui fait à chaque voyage une même pause aux mêmes stations et ne s’arrête, essoufflé, qu’en fin de parcours, quand il émet son dernier sifflet.
Blandine est venue voir si tout allait bien. Gorki, qui vient de recevoir son petit bout de croissant, s’est levé et la suit comme son ombre. Il a déjà avalé ses croquettes du matin, mais on ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose à glaner.
Je prends appui sur les accoudoirs pour me caler un peu mieux dans mon fauteuil. Blandine, comme tous les jours, m’a demandé si je ne voulais pas un coussin pour plus de confort. Je lui ai dit que non, que j’étais très bien commeça.
Hélène, têtue, avait trouvé un bon empailleur pas trop loin. En ronchonnant un peu, pour sauver la face, j’avais finalement admis que mon vieil ami avait peut-être besoin que l’on s’occupe de lui refaire une jeunesse. Elle nous a emmenés dans la voiture, lui et moi, à la boutique, rue du Faubourg Saint-Antoine.
Le vieil artisan, grosses moustaches à la gauloise, a mis ses lunettes pour jeter un regard dubitatif sur le fauteuil. En souriant, il m’a dit, Il est plus vieux que moi, votre fauteuil, vous voulez vraiment qu’on le rafistole ? Ce serait de l’acharnement. Derrière moi, je sentais bien le sarcasme d’Hélène, mais, l’air sérieux, refoulant un éclat de rire, j’ai répondu qu’il me venait de ma grand-mère — ce qui n’était pas vrai — et que j’y tenais beaucoup.
Le soir, à table avec les enfants qui étaient venus dîner chez nous et à qui leur mère avait raconté l’épisode chez l’empailleur, ils se sont tous bien moqués de moi et de mon insistance jugée enfantine. Je leur ai dit que c’étaient des tarés et qu’ils ne comprenaient rien et j’ai continué, imperturbable, à manger ma soupe.
Je termine mon café et je déguste avec une lente délectation le croissant encore chaud que Blandine va chercher tous les matins chez Mathieu, le boulanger, à deux pas, dont les viennoiseries sont les meilleures de la région, selon ce que tout le monde affirme.
Il fait beau. Début mai, un peu froid, venteux, mais le soleil est au rendez-vous. La lumière est douce et ne blesse pas les yeux. Une matinée comme je lesaime.
Je me redresse sur mon siège et j’appelle Blandine pour mon deuxième café du matin. « Avec une goutte de lait, Blandine, s’il vous plaît, pour terminer mon croissant. »
Elle m’apporte le café, le pose sur le petit tabouret et, Gorki à ses trousses, elle revient pour m’entourer les épaules avec un châle. « Vous n’allez pas nous choper un rhume », elle me dit avec son petit air protecteur.
J’ai récupéré Blandine, si on peut dire, dans une des maisons de retraite que j’étais allé visiter avant de décider que ce n’était vraiment pas pour moi et de revenir à la petite maison achetée il y a bien des années avec Hélène, en bordure d’une allée tranquille par où l’on aperçoit la mer, plus bas, à travers les jardins et les espaces laissés libres entre les maisons qui nous fontface.
Infirmière attitrée, toute jeune, divorcée et pas d’enfants, c’est une jolie fille, un peu rondelette, pas très grande, de beaux yeux bleus espiègles, les cheveux noirs bouclés, peu loquace, une bouche aux lèvres généreuses et souriantes, toujours de bonne humeur, mais aussi toujours l’air un peu inquiet. Elle porte d’habitude des pantalons, mais parfois une mini-jupe qui laisse admirer de jolies jambes aux cuisses fermes et rondes. Mais enfin, mon regard sur les femmes n’a plus beaucoup d’importance et moins encore de conséquences.
Elle a sa chambre au deuxième étage — un peu plus petit que mon rez-de-chaussée à cause de la toiture en pente — où je lui ai fait construire une salle d’eau. Elle peut y accéder par l’escalier intérieur où par celui qui donne sur le jardin à l’arrière de la maison, ce qui lui permet une plus grande indépendance et le respect de son intimité quand elle le souhaite. Moi, je ne monte plus les escaliers, sauf si cela est vraiment nécessaire. Elle est donc maîtresse chez elle et je lui ai dit qu’elle pouvait y amener tous les copains qu’elle veut pour qu’elle puisse vivre sa vie et moi la mienne sans avoir à m’inquiéter de son quotidien. Je lui ai aussi dit plusieurs fois qu’elle pouvait utiliser la cuisine à son gré et mettre de la musique et même faire des booms puisque j’étais à moitié sourdingue. Et en plus, j’aime bien sentir autour de moi les vibrations de lavie.
Dernièrement, auprès d’un notaire de Bayonne, je l’ai inscrite sur mon testament pour quelques sous qui lui permettront de voir venir quand le temps viendra. Mes enfants le savent et ils ont trouvé ça très bien. Ils ont beaucoup d’affection pour elle, tous les deux. Je crois que sa présence chez moi les dédouane. Je ne comprends pas bien pourquoi, puisque c’est moi qui ai décidé de m’expatrier loin de Paris. Mais elle les déculpabilise et ils lui en sont reconnaissants.
J’appuie le menton sur mes deux mains qui tiennent ma canne. Ça fait déjà un bout de temps que ma canne me sert de troisième jambe. Ces derniers temps, avant de me coucher, je la pose près du lit ; je ne m’en sépare plus, sauf pour la douche où je me suis fait mettre des barres d’appui un peu partout.
Il y a quelques mois, à peine, j’abandonnais ma canne sur un banc, le temps de finir la partie, quand je jouais encore aux boules sur la place derrière l’église, sous les platanes. Celle qui est devant l’église, abrite le fronton avec ses bancs en bois, la pharmacie, un petit café avec sa terrasse entourée de tilleuls, la boulangerie où Blandine vient tous les jours chercher son pain et les croissants, le boucher qui propose aussi des fromages, et même le cabinet du docteur Levallois et sa vieille infirmière qui s’occupe de son secrétariat et des petits bobos. Elle est gentille, la mère Bagorry dans sa blouse blanche et sa chevelure gris cendré bien ramassée dans un chignon sur la tête. Les petits lui disent Mamijane — elle s’appelle Jeannette — et elle leur donne toujours un bonbon ou une sucette après leur avoir administré une piqûre ou pour faire passer le goût amer d’une potion pour la toux. Nous aussi, nous lui disons Mamijane, même son patron, notre bon docteur.
Le dimanche matin, après la messe, et quand ses ouailles le lui permettent, le curé, abandonnant son col blanc empesé d’homme du culte, sort de son sanctuaire mérovingien, où j’aime trouver refuge les jours de canicule, les manches retroussées, sa sacoche avec les boules de pétanque à la main, vient se joindre à la partie.
La mi-trentaine, souriant, les cheveux drus, noirs, la peau brune, métis vraisemblablement, les tempes déjà légèrement grisonnantes, toujours bien mis dans son costume noir, le col blanc, une petite croix sur le revers du veston, insigne de sa profession, il avait été envoyé, il y a quelques années, par le diocèse de Bayonne, en remplacement du bon père Édouard, qui coulait enfin une retraite tranquille à l’Abbaye Notre-Dame de Belloc et qui venait de temps en temps retrouver son ancienne paroisse, toujours chaleureusement accueilli, même par les plus farouches opposants à la soutane.
Enfin, remplacement c’est beaucoup dire. On ne peut plus, semble-t-il, se permettre le luxe d’avoir un curé à domicile. Le père Urbain était donc un curé voyageur qui avait plusieurs paroisses à sa charge. Un commis voyageur, en sorte, comme au bon vieux temps, qui viendrait écouler sa marchandise, de village en village. Je crois, toutefois, qu’il s’était pris d’affection pour notre patelin qu’il venait visiter aussi souvent que le lui permettait son lourd agenda de ministre, du culte s’entend.
Jugé trop jeune, peut-être un peu métèque, il avait mis du temps à se faire accepter par sa nouvelle paroisse, mais avait finalement réussi à se faire sa place. Ces dames le trouvaient sympathique et avenant et les hommes, ceux qui étaient à l’âge où ils ne pouvaient plus prétendre aux exigences du chistera, avaient finalement admis qu’il se défendait bien à la pétanque et l’accueillaient avec bonhomie le dimanche matin, quand il était là. « Allez, l’abbé, nous avons besoin d’un quatrième, venez nous montrer comment vous pointez ! »
On me dit que ses sermons ne durent pas plus de dix ou douze minutes et qu’ils sont même drôles quelquefois. Le jeune Urbain prêche l’optimisme et la bonne humeur. Moi, je ne fréquente l’église que lors de grosses chaleurs ou pour les mariages et les enterrements.
Notre jeune curé avait même réussi, grâce à un ami qui connaît bien les gens du Patrimoine et les travaux de rénovation ne devraient pas tarder à commencer. Les fidèles, et même les mécréants, sont aux anges, ils sont tous attachés aux vieilles pierres de leur église.
Pour ma part, je lui ai promis de demander l’aide de mon filleul pour les vitraux de son lieu saint, deux d’entre eux ayant beaucoup souffert. « Mais attention, » l’ai-je averti, « c’est un mécréant. » Il avait ri. « Pas de problème, la demeure du Seigneur est ouverte à tous et Il accueille toutes les bonnes volontés. Et moi aussi. »
De temps en temps, nous prenons un café ou un verre de vin ensemble à la terrasse du café sous le feuillage des tilleuls. Quelquefois, notre verre en main, nous allons nous asseoir sur un des bancs du fronton. Nous prenons notre temps, nous parlons de littérature, de poésie. Grand amateur de philosophie grecque, d’Aristote, de Platon, mais aussi d’écrits plus récents. Nous parlons de Proust, de Bernanos, de Claudel, de Camus, de Modiano, notre dernier prix Nobel, et même, ce qui m’étonne, de Roger Martin du Gard, que je pensais tout à fait oublié. Son éclectisme littéraire me surprend et me ravit. Il a lu un ou deux de mes livres, mais je subodore que je ne fais pas partie de ses auteurs préférés. Je ne lui en veux pas pour autant et j’essaye de le pousser à lire des auteurs américains, Philip Roth, à qui je voue une enthousiaste admiration. « Même en traduction, » je lui dis, « ça vaut la peine. » Mais je ne sais pas si cette lecture lui est permise par son église. Il rigole. « Vous savez, Émile, l’Inquisition n’est plus d’actualité. »
Nous parlons de Mozart, de son Requiem, de ses opéras, de Bach, de l’oratorio, des cantates, des suites pour violoncelle. Je lui dis « Vous savez, mon cher curé, je ne suis pas croyant, sauf quand j’écoute Bach qui me transporte vers une autre dimension. » Il éclate de rire. « Tout ce qui mène à Dieu est bon à prendre. » Et nous nous promettons d’essayer de faire venir un petit orchestre qui jouerait du Bach dans son église. Alain, mon petit-fils, le fils de mon cadet, Amos, est violoniste à la Philarmonique de Marseille et fait aussi partie d’un orchestre de chambre qu’il a formé avec des amis. Je promets à Urbain de lui demander sonaide.
Souvent, s’il nous trouve là un samedi après-midi, le docteur Levallois se joint à nous pour une bière ou un verre de vin blanc.
Amateur de musique, lui aussi, ses préférences vont à Mozart et Beethoven. Il trouve Bach un peu trop répétitif. Tricoteur, comme dit Colette, il ne manque pas de me faire remarquer pour me taquiner. Moi je lui rétorque que la mauvaise foi est un vilain défaut et qu’il oublie volontairement la deuxième partie du jugement de Colette : Tricoteur, mais de génie. Il tape la table de la paume de sa main, Tricoteur quand même. Et l’autre jour, il avait ajouté en se tournant vers le curé : mais notre ami Urbain, à son âge, je suppose que c’est le Rock. Le curé, un grand sourire aux lèvres, lui avait répondu : Le Rock, ce n’est pas exactement la musique qu’on écoute au séminaire, mais les jeunes ont tout fait pour parfaire mon éducation musicale, ils m’ontfait découvrir les Beatles, David Bowie et que sais-je encore. Et en fait, c’est pas mal. Il a levé son verre. Il y a même du Rock chrétien. L’église est en marche, messieurs.Trois célibataires. L’un par exigence de son métier, moi, Hélène m’ayant abandonné cela fait plusieurs années pour un monde qu’on dit meilleur et Levallois, veuf depuis trois ans, vivant seul lui aussi, ses enfants étant partis s’installer ailleurs, l’un dentiste à Biarritz, sa fille aînée infirmière cheffe à l’hôpital Saint Éloi à Montpellier, la cadette, encore plus loin, dans une banque à Paris. En été ou pour les vacances de Pâques, comme dans mon cas, ils lui rendent visite avec les enfants. Son fils de Biarritz, c’est plus souvent, bien entendu. Une ou deux fois par mois, Levallois prend sa voiture pour passer le week-end ou les jours de fête chez lui. Ou quand il a un peu plus de temps, il pousse jusqu’à Bordeaux, pour retrouver ses cousins. Et il ne me reste plus alors que le curé pour tailler la bavette quand il est chez nous et que son office le lui permet.
Depuis le décès de sa femme, Levallois pense à sa retraite, mais ne parvenant pas à trouver preneur pour son cabinet, il hésite à abandonner le village à son désert médical. Et Mamijane n’attend que son départ pour faire demême.
Je lui dis : « Du calme, Victor, il n’y a pas le feu pour ta retraite, laisse-moi prendre la mienne d’abord. » Et il lève son verre de vin ou sa tasse de café. Il rit. « À ta santé, Émile, tu vas tous nous enterrer. » Je lui baisse la main qui tient le verre. « Parle pas de malheur, le carabin, j’en ai marre de voir les gens disparaître autour de moi. »
Ça avait commencé par Léopold, mon peintre torturé par une mémoire impitoyable. Puis Hélène était partie, suivie de près par sa sœur, on pourrait dire par mimétisme. Elles étaient très proches. Plus que sœurs, elles étaient des amies. Ensuite, ça a été le tour de mon frère, à peine plus âgé que moi et, quelques semaines plus tard, mon voisin de toujours. Il venait de temps en temps pour me parler du dernier livre qu’il avait lu, quand celui-ci avait éveillé son enthousiasme, ou pour s’indigner avec moi de la médiocrité de nos politiciens. C’est alors que j’ai dit à mes enfants : ça suffit, je m’en vais, je vais aller voir lamer.
Quelquefois, accoudé à sa vitrine, vêtu de blanc, le boulanger tire sur sa cigarette. Il nous fait un signe de la main. Ça gamberge toujours, les intellos ? Et on lui crie en retour, Intello toi-même ! Demain, pour la pétanque, on verra bien qui est l’intello. Il rit ; il écrase son mégot et il rentre chez lui. Jeune gars, il a récemment repris le négoce des Camusarri et rapidement est devenu une figure incontournable de notre petite agglomération, les meilleures viennoiseries et des baguettes croustillantes. On vient de loin pour lui en acheter le dimanche matin, quand il laisse son apprenti s’occuper de la boutique pour, lui, s’occuper, une heure ou deux, de choses plus sérieuses. Des rumeurs circulent sur son idylle avec Rose, la mignonne petite-fille d’Etcheberry, le propriétaire de la châtaigneraie. Nous attendons tous avec impatience l’annonce des épousailles pour que commencent les festivités. Le cafetier, le bon Jean-Jacques Simeoni, dit Jiji, transfuge de Bastia, prépare en cachette les guirlandes et les lampions. Blandine, qui est une bonne amie de Rose, n’en lâche pas mot, pas plus que le curé qui doit bien être dans les confidences, mais qui est tenu par le secret professionnel.
La pharmacienne, madame Zenika, est souvent assise sur son tabouret à la porte de sa boutique. Elle prend le soleil en attendant son prochain client. Nous lui faisons un bonjour de la main. Elle lève la sienne en retour, accompagné d’un sourire. Elle aussi cherche un repreneur pour sa pharmacie, mais je crois que ça ne se bouscule pas au portillon.
Depuis ma chute il y a quelques semaines — rentrant après l’apéritif, j’ai trébuché sur une grosse pierre qui se trouvait là sans qu’on le lui ait demandé, et je n’aurais pas pu me relever sans l’aide d’une jeune femme qui m’a gentiment donné le bras jusqu’à la maison quand elle m’a vu me débattre contre la gravité — Blandine ne me laisse plus m’aventurer loin de chez moi, où ce qu’elle considère être trop loin, comme la place de l’église, qui n’est qu’à cent ou cent cinquante mètres, guère plus. Elle fait fi de mes objections, elle prend son air sévère et elle me donne le bras, s’assurant que je tiens bien ma canne dans l’autre main, et nous allons à petits pas mesurés, le petit vieux et sa nounou, jusqu’à la place où elle me dépose sur un banc ou à la terrasse du café de Simeoni. Parfois, elle accepte de prendre quelque chose avec moi, un Orangina ou un Schweppes. Pour le retour, il y a toujours quelqu’un pour la rassurer : « T’en fais pas la Blandine, on te le ramène. » Mais quand elle juge que je tarde trop à rentrer, elle vient me récupérer, une écharpe à la main. Mes compagnons de table se marrent. « Fais gaffe, Émile, le gendarme est là. » Blandine rit aussi, mais manu militari, elle me ramène chez moi, mon écharpe autour ducou.
Un petit bout demer
Je regarde le petit bout de mer que j’aperçois depuis le pas de ma porte, assis dans mon fauteuil en osier. L’écume blanche roule paresseusement sur la crête des petites vagues. Un voilier s’évade lentement au loin, suivi par un autre, plus petit, qui tente peut-être de le rattraper. Le vent, qui maintenant s’est assagi, ne lui est pas d’un grand secours. Les surfeurs, de guerre lasse, n’ayant plus que de petites vagues à chevaucher, ont abandonné la partie.
Je ramasse sur mon assiette, pincées entre le pouce et l’index, les dernières miettes du croissant et je les porte à ma bouche. J’hésite à demander un autre à Blandine. Un bon appétit est signe de bonne santé, mais ce n’est pas raisonnable. Je bouge peu, pour ne pas dire pas du tout, et je commence à avoir tendance à l’embonpoint.
Mon ami Levallois, chaque fois que je vais le voir à son cabinet, me rappelle qu’il faut marcher dix ou quinze minutes tous les jours, et me recommande un stepper pour entretenir les muscles de mes jambes. Je le lui promets, et je me le promets, mais je n’en faisrien.
Cet après-midi, après le déjeuner, je proposerai à Blandine, bras dessus, bras dessous, de descendre jusqu’à la plage, regarder les vagues de plus près, et les acrobaties des surfeurs, s’ils sont là. Et je verrai sur Internet pour l’achat d’un stepper en évitant Amazon, à qui je voue une antipathie combative et absolue, bien que je ne puisse pas m’en passer tout à fait, pour cause de Kindle dont mes yeux fatigués en ont de plus en plus besoin. Le Kindle est un ersatz de livre, qui ne peut remplacer la chaleureuse relation avec l’ouvrage imprimé. Un vrai livre, c’est plus que de la littérature, plus que des mots ou des phrases qu’on lit, c’est le contact presque charnel avec l’auteur ; on s’y sent à l’aise, comme à table avec un ami, on sait où retrouver une phrase ou un passage que l’on a lu trop vite et qu’on sait peut mieux dévoiler la trame de l’histoire, un indice qui explique le comportement du personnage, une phrase, des mots, qui éclairent tout ce qui vient par la suite.
La lecture sur Kindle est linéaire. Ce qu’on a lu, on l’a lu et c’est tout. Ce n’est qu’une petite icône sur l’appareil et son écran froid et impersonnel.
Pour mon stepper, je décide, pas d’Amazon ni d’Internet, je demanderai à Blandine de m’en acheter un lors d’une de ses visites à Bayonne ou à Biarritz. Il n’y a pas le feu. Elle est adorable, ma petite Blandine, elle le fera avec plaisir, d’autant plus que Levallois lui a dit me l’avoir prescrit.
Que ferais-je sans Blandine, je me le demande. Je dois avouer que je m’en inquiète. Jolie fille, à peine plus âgée que ma petite-fille qui s’apprête à me donner mon premier arrière-petit-enfant, elle va refaire sa vie. Après sa malencontreuse première expérience, jeune et avenante, intelligente, sachant où elle va, elle va se refaire une famille. Je le déplore, car tôt ou tard, elle me quittera. Mais je le lui souhaite. À contrecœur, peut-être. J’ai un peu honte.
Cela fait quelques petites années qu’elle est avec moi et elle a changé ma vie. Mes moments de dépression n’ont pas disparu, mais ils sont moins fréquents et je ne me réveille plus avec ce sentiment d’impossible et d’invalidité. Je sais que je vais être accueilli avec un café, un croissant et un grand sourire lumineux. C’est une belle façon de commencer la journée.
Je sais bien que ça ne peut pas durer beaucoup plus longtemps. Elle finira bien par trouver chaussure à son pied. Ou la chaussure la poursuivra jusqu’à ce qu’elle consente à y glisser lepied.
Depuis le jardin où je vais souvent m’asseoir en fin d’après-midi, parce ce que c’est plus abrité que le perron qui donne sur l’allée — et, en regardant bien, sur la mer — je l’ai vu, surtout les samedis ou les jours de fête, monter chez elle avec des amis, des sacs et des bouteilles à la main, ou avec un ami seul. Elle me fait un signe de la main et un sourire avant de refermer sa porte. Elle ne m’a rien dit, je ne lui ai rien demandé. Je lui ai tout simplement fait remarquer que nous avions du vin dans la cave et des boissons dans le frigidaire — elle ne boit jamais d’alcool — et qu’elle avait libre accès à la cuisine pour elle et ses amis. Elle n’en a jamais fait usage, mais quand elle s’absente ou quand elle est chez elle avec des amis, mon dîner est toujours prêt pour être réchauffé au micro-ondes, la table mise, avec le vin, une bouteille d’eau, le fromage et un fruit, une pomme, une pêche ou une clémentine, selon les saisons, et une grande salade verte. Le lendemain, elle s’assure que je me suis bien nourri et que j’ai bien avalé la quantité de liquide requise pour un bon fonctionnement rénal. Je suis tenté parfois de vider la bouteille d’eau — du Salvetat, pauvre en sel — dans l’évier pour éviter les remontrances du matin. Mais je n’ose pas, de peur d’être découvert, et je bois en bon petit soldat les quantités prescrites.
De plus, obligé par Blandine et par ma fille Isabelle, je porte au poignet une iWatch que je trouve hideuse, grosse, lourde, comme une horloge accrochée au bras, mais qui doit en cas de chute, m’a-t-on assuré, alerter tout de suite Blandine sur son portable. Et je peux aussi l’appeler en cas d’urgence, à l’aide d’un simple bouton. Je ne suis pas sûr, malgré leurs explications détaillées, de savoir utiliser cet engin grotesque, mais ça les rassure tous, mon fils s’étant mis de la partie. Et tant pis pour l’esthétique.
C’est un peu comme ces bracelets dont on affuble les chevilles des délinquants libérés sur parole. Blandine, ma gardienne, veut pouvoir dormir enpaix.