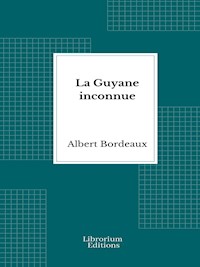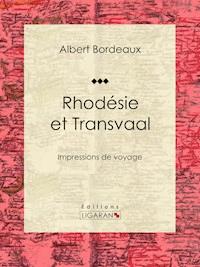
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Nous faisons une traversée magnifique, sur le Norman, le plus beau des bateaux de l'Union line : il a 170 mètres de longueur et jauge 7,300 tonneaux. Ce port de Southampton est une merveille, et les côtes verdoyantes de l'île de Wight, qui le protègent, sont de ce vert si doux, propre aux pays du Nord, que l'on n'oublie plus quand on va vers le Sud. Puis c'est le bleu infini qui commence et qui va durer jour et nuit."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054552
©Ligaran 2015
À mes frères Paul et Henry.
Je vous adresse ce livre, composé avec les lettres que je vous ai écrites pendant un premier séjour dans l’Afrique australe, spécialement au Transvaal et en Rhodésie (1895-1896).
Ce ne sont que des notes pittoresques sur le pays et sur les habitants : je n’ai pas voulu m’occuper ici du point de vue économique, que j’ai traité ailleurs en même temps que les questions minières et métallurgiques.
Il me semble que la connaissance des hommes et de la nature même d’une contrée a une importance réelle : il faut aimer un pays pour s’y consacrer et, vouloir y faire une œuvre utile. Si l’Afrique australe n’a pas la beauté de nos pays du Nord, elle a pourtant des régions intéressantes qui méritent d’être connues et qui ont un charme particulier. J’ai goûté ce charme parfois, et je serais heureux de le faire ressentir à ceux qui ne peuvent venir chez les Boers et chez les Afrikanders.
Mais il y a autre chose que du charme dans les paysages africains : ils offrent un but à poursuivre, bien diffèrent de ceux qui nous agitent dans nos vieux pays d’Europe. Lorsqu’il s’agit de contrées où le sol est riche, les eaux abondantes, le climat admirable, comme en bien des parties de l’Afrique australe, ces pays veulent qu’on les fasse connaître. Il y en a d’autres, comme le Canada et la Sibérie, qui sollicitent aussi notre attention, et qui conviennent peut-être mieux à nos aptitudes et à notre nature ; mais l’Afrique du Sud à son soleil et son beau climat. Si elle est fort en retard au point de vue agricole, c’est que certaines régions sont à peine connues, et que les autres sont, depuis plusieurs années, soumises à des plaies de toute sorte : sécheresse prolongée, sauterelles, peste bovine ; mais on peut surmonter tout cela : n’a-t-on pas ailleurs à lutter contre le froid et les intempéries ?
Quant à l’œuvre de l’ingénieur, l’étude géologique d’un pays et, par suite, la connaissance de ses ressources minières et industrielles, elle ne peut que gagner à être accompagnée de la vue pittoresque des choses, qui fait mieux découvrir leur détail ; et, en revanche, combien souvent ces points de vue n’ajoutent-ils pas d’intérêt à l’étude attentive des paysages ?
En décrivant les luttes et les travaux accomplis par les pionniers de l’Afrique australe, et en faisant connaître la nature du pays auquel ils ont consacré tous leurs efforts, il me semble servir aussi l’œuvre de sa colonisation ; et cette idée m’a encouragé à soumettre au public des pages qui n’étaient à l’origine écrites que pour un cercle de famille. Je voudrais ainsi intéresser ceux qui, prenant une voie souvent pénible, mais souvent aussi hautement récompensée, vont se créer au loin une nouvelle-patrie, où qu’ils la choisissent, tout en restant fidèles de cœur à leur vieille patrie française.
Juillet 1898.
Albert BORDEAUX.
Juin 1895.
Nous faisons une traversée magnifique, sur le Norman, le plus beau des bateaux de l’Union line : il a 170 mètres de longueur et jauge 7 300 tonneaux. Ce port de Southampton est une merveille, et les côtes verdoyantes de l’île de Wight, qui le protègent, sont de ce vert si doux, propre aux pays du Nord, que l’on n’oublie plus quand on va vers le Sud. Puis c’est le bleu infini qui commence et qui va durer jour et nuit. Le temps est superbe, la mer extrêmement calme : je ne croyais pas que l’immense Atlantique put être si calme ; sans une sorte de lame de fond qui est très longue, le Norman serait aussi immobile que sur un lac de la Suisse. Nous passons cependant quinze à seize heures dans un brouillard assez épais ; la sirène fait entendre son grondement assourdissant toutes les deux minutes. Les journées passent vite : on mange trois fois par jour et substantiellement chaque fois ; c’est la plus grande distraction du bord, car on n’a rien à faire ; quelqu’un dit plaisamment : « À bord on ne travaille pas en dehors de ses repas. » À vrai dire, s’il y a du confort sur le Norman, la cuisine, qui paraît bonne les premiers jours, finit par laisser beaucoup à désirer, comme nous le verrons.
Sur le pont on essaye quelques jeux : palets, lawn-tennis, cricket, etc. Dans les salons, on fait de la musique. Un petit orchestre se fait entendre tous les soirs ; il est bien composé, et le chef a beaucoup dégoût.
Fait, extraordinaire sur un paquebot anglais de la ligne du Cap, il y a neuf Français à bord : c’est la première fois qu’il se dessine un sérieux mouvement de nos compatriotes vers les riches contrées de l’Afrique du Sud, et maintenant que le premier pas est fait, cela va continuer. Ce sont les ingénieurs qui vont les premiers en exploration. Il y a celui de la Compagnie de Mozambique, qui a tracé des centaines de kilomètres de routes dans ce pays et, à soixante ans, y retourne pour la quatrième fois.
Il est probable que nous aurons des soirées théâtrales, car nous voyageons avec une troupe d’opérette composée de quarante personnes, qui va au Cap et à Johannesburg ; et nous aurons même des bals et des bals costumés. Il faut déballer tous ses bagages ; les dames du bord s’entendent fort bien avec les actrices, et les messieurs aussi ; d’ailleurs, plusieurs sont fort jolies et parlent couramment le français. Le chef de la troupe, M. Marius, est un ancien acteur français, mais il a pris tout à fait l’accent anglais.
En approchant de Madère, nous passons au milieu de dauphins en troupe serrée, les jeunes sautant au-dessus de l’eau, les plus gros lançant en l’air des jets d’eau les uns sur les autres. Nous ne rencontrons aucun bateau, à peine une fumée à l’extrême horizon ; nous faisons près de quatre cents milles marins en vingt-quatre heures.
À Madère, nous faisons une relâche de trois heures. Nous en profitons pour aller rendre visite à la Melpomène, vaisseau-école des gabiers français arrivés la veille à Madère, venant des Canaries. Le commandant nous fait reconduire au Norman dans son canot à douze rameurs qui fait l’objet de la curiosité des passagers : nous nous éloignons des belles montagnes vertes de Madère à midi, salués par l’équipage de la Melpomène.
Le soir même, grand concert sur le pont : ouverture pour piano par un Français, obligé de se rendre à la gracieuse invitation du capitaine Bainbridge.
Le beau temps continu, nous doublons Ténériffe dans la matinée : nous allons maintenant passer douze jours entre le ciel et l’eau sans voir la terre jusqu’au Cap, aussi les passagers ont tout le temps de faire plus ample connaissance. C’est une occasion pour moi de me lier avec mon compagnon de cabine, qui est employé aux mines de diamants de Kimberley. Il a fait déjà de nombreux voyages en Afrique, où il habite depuis une dizaine d’années, quoiqu’il n’ait guère que trente-cinq ans.
Ce malin, en causant avec lui, j’ai découvert qu’il est très au courant non seulement des affaires du Matabeleland, mais que lui et deux de ses amis de Kimberley ont fait partie de l’expédition des pionniers à Fort Salisbury, dans le Mashonaland. C’est cette expédition qui a assuré l’acquisition du territoire de la Rhodésie par la British South Africa Company ou Chartered Company.
Comme je vais justement parcourir ces pays-là, oh peut comprendre que le récit de cette marche en avant dans des pays inexplorés m’a fort intéressé, et je crois qu’on lira avec plaisir les détails que je vais transcrire : l’on aura déjà une idée de ces pays et de la manière dont ils ont été conquis avant de les parcourir.
L’Expédition des pionniers au Mashonaland. – Cette expédition commença en juin 1800 : elle avait été conçue par Cecil Rhodes et par son fidèle ami le trop fameux docteur Jameson ; mais le succès en est dû principalement à trois hommes énergiques : le major Pennefather, sir John Willoughby et Selous.
Le colonel de dragons Pennefather, qui commandait l’expédition et qui avait acquis l’expérience des indigènes dans la guerre des Zoulous, fut d’ailleurs très bien secondé par le major Johnson, qui commandait l’avant-garde. Les approvisionnements étaient assurés par sir John Willoughby, bien connu par ses charges de cavalerie de Kassassin et de Tel-el-Kebir et par ses exploits de sportsman. Enfin on ne pouvait mieux confier la direction de la marche et le tracé de la route dans ces régions nouvelles qu’au fameux chasseur Selous, qui partit pour l’Afrique en 1871, à l’âge de dix-neuf ans, et depuis cette époque passa sa vie à chasser chez les Matabélès et sur les bords du Zambèze : il avait tué un nombre incalculable d’animaux qui font l’ornement des musées de l’Afrique, et même de ceux de l’Europe et de l’Amérique.
Selous descend, par son père, d’émigrés français huguenots : les Anglais disent de lui qu’il est un sportsman of the first water (de la plus belle eau), un very excellent shot (fusil de tout premier ordre) et le prince of good fellows (roi des bons garçons).
Le corps des pionniers était composé de deux cents hommes, cent cinquante chevaux, soixante-cinq voitures comprenant plus de cent-cinquante têtes de bétail ; il devait non seulement atteindre le mont Hampden, au nord du Mashonaland, mais construire une route jusqu’à ce point depuis le camp de Macloutsie river, c’est-à-dire sur une longueur de quatre cents milles.
Ces pionniers étaient tous des hommes choisis avec soin pour le service que l’on attendait d’eux ; il y avait là des prospecteurs de mines, des mineurs, des fermiers, d’excellents cavaliers ; on a même ajouté des baronnets et des membres du « Pélican club » ; enfin c’était la fleur du Sud-africain. Dans les soixante-cinq voitures du convoi étaient transportés un outillage de campement, des vivres, une pharmacie, quatre pièces d’artillerie, un moteur électrique pour la lumière, et même des jeux de cricket, football, lawn-tennis, et des accessoires de théâtre.
On attendit, pour commencer l’expédition, la fin de la saison des pluies, qui est surtout mortelle pour les chevaux : il y a dans ces régions une maladie de la poitrine qui sévit sur eux et qu’on n’a pas encore réussi à guérir. Ceux qui y ont échappé ne la reprennent plus : on les appelle des chevaux salted, et ils se vendent beaucoup plus cher que les autres. Cette maladie a été une cause de grandes pertes pour la Chartered Company.
Dans le camp de Macloutsie, trois semaines furent consacrées à des exercices d’artillerie et d’escarmouches ; ce camp, à 750 mètres d’altitude, près d’une, eau excellente, est un endroit très sain, parfaitement choisi.
Le départ eut lieu le 25 juin. Les six premiers jours, on poussa la marche avec rapidité, sans prendre d’autre repos que le strict nécessaire. On fit ainsi soixante milles (environ cent kilomètres), soit dix milles par jour, et l’on atteignit l’endroit actuellement désigné sous le nom de Fort Tuli. La route était construite au fur et à mesure de l’avancement, avec des bois abattus et des terrassements ; toute la région est très boisée.
À Matlapulta, on rencontra six sœurs de la Mercy qui furent accueillies avec enthousiasme ; elles eurent déjà l’occasion de montrer leur dévouement en soignant quelques malades. Cette station fut pourvue d’un poste de quatre hommes ; c’est actuellement Fort Matlapulta.
Fort Tuli est défendu naturellement par sa position un peu élevée sur des pentes douces, non loin du Limpopo, qui borde la frontière nord du Transvaal. La rivière Tuli, qui passe au voisinage, y atteint une largeur de 500 mètres ; les bords de cette rivière sont couverts de roseaux de quatre à cinq mètres de hauteur, et le pays est très boisé. On y entend les rugissements des lions et les cris des chacals, des hyènes et des loups ; on sait que l’hyène suit toujours le chacal pour trouver sa nourriture, car elle est totalement dépourvue d’odorat.
La machine électrique fonctionnait toutes les nuits, éclairant les alentours du camp et maintenant les animaux à distance.
À Tuli, les visites d’animaux sauvages furent fréquentes. Les lions abondaient en cet endroit ; depuis lors, on leur a fait une chasse si acharnée qu’ils disparaissent rapidement : dans deux ou trois ans, on n’en rencontrera plus.
Certaine nuit, un des amis de M. X…, qui était de garde avancée, fut surpris par un lion qui parut à vingt mètres de lui à peine, et semblait l’observer avec attention. Le clair de lune était superbe, et l’on y voyait comme en plein jour. Il y avait entre le lion et l’homme un petit arbre dont le tronc avait environ dix centimètres de diamètre, et cette position de l’arbre, précisément devant la tête du lion, empêchait le garde de tirer de manière à blesser mortellement l’animal, et pourtant cela était d’autant plus nécessaire que le fusil était à un seul coup. Il s’écarta donc de sa position pour tirer, et, visant le lion entre les deux yeux, il fit feu. Mais l’animal, lui aussi, avait bougé, et ne fut que légèrement atteint. À peine le coup parti, il se précipita sur l’homme en rugissant, la gueule ouverte et les yeux étincelants. Il était inutile de songer à recharger une arme en ce moment. Le garde eut cependant, dit-il, assez de présence d’esprit pour se rappeler ce mot de Livingstone, « que la blessure du lion est parfois mortelle, alors même qu’elle n’est que légère, à cause des chairs en putréfaction qu’il lui arrive de dévorer et qui restent entrent ses griffes » : il n’eut d’ailleurs pas le temps de l’expérimenter. Il tenait son fusil par le canon, avec la vague idée de le placer dans la gueule du lion, et il poussa un cri d’alarme. Le lion était presque sur lui ; mais, à ce cri, il s’arrêta net, paraissant subitement refroidi dans son ardeur ; il regarda l’homme d’un air assez paisible, et même non déplaisant, selon le mot du garde, et, se retournant tout à coup, il dépassa l’homme de quelques pas, puis, galopant rapidement, il disparut.
À Tuli, 150 indigènes vinrent aider à fortifier la position et à construire la route qui contourne la base du fort. Tuli est un endroit superbe comme végétation, les fruits y abondent, les arbres de dix mètres de circonférence, les baobabs, n’y sont pas rares, et leur pulpe, la crème de tartre, sert à la fabrication d’une sorte de bière très hygiénique et utilisée comme médecine dans le pays. La colonne quitta Tuli le 11 juillet pour faire les 140 milles qui la séparaient de la Lunde river.
Plusieurs ponts furent construits sur cette partie de la route. De Tuli à Bubye Rivers, sur 74 milles, la région est couverte de bois inhabités, interrompus par des clairières où s’élèvent les Kopjes, collines granitiques isolées et près desquelles on trouve fréquemment des sources. Le pays est peuplé d’animaux sauvages : éléphants, girafes, buffles, zèbres, mais surtout de daims et d’antilopes, très appréciés des chasseurs de la petite colonne.
La population indigène des pays de Bubye Rivers est très douce, et reçut très amicalement les Européens. Elle était l’objet des incursions des Matabélés, qui venaient enlever les femmes et les enfants ; aussi les villages étaient-ils perchés dans des endroits très hauts et inaccessibles, sur les rochers des Kopjes. Les huttes n’étaient que des abris de branchages, à couvert seulement des vents les plus violents. Le nom de ces indigènes est Banyans. Trois de leurs chefs vinrent visiter la colonne. Contre des chèvres ou des boucs, ou des farineux, fèves, etc., on leur donna des couvertures ornées, des étoffes voyantes ; aux chefs, on donna même des fusils Martini.
L’arrivée à la rivière Lunde vint mettre en fuite des lions qui jouaient sur le sable. C’est à Lunde que commence la région qui dut autrefois entretenir une nombreuse population. Vers l’ouest, on trouve d’anciennes ruines très importantes, ainsi qu’au nord-est, près de Victoria, où se trouvent les ruines célèbres de Zimbabwe.
Pour arriver à Victoria, il faut traverser une gorge longue et très étroite, qu’on appela le « Providential Pass ». Cette gorge n’avait jamais encore été traversée par des blancs. Longue de 12 kilomètres, elle monte de l’altitude de 870 mètres à celle de 1200 mètres, au sommet du col ; les pentes sont boisées, le site est grandiose mais étroit, et eût été bien favorable à une embuscade. Ce fut pour la colonne un vrai soulagement que d’en sortir sans avoir été attaquée ; elle aurait subi des pertes sérieuses. Au-delà, le paysage se découvre, et l’horizon apparaît lointain, et comme une éclaircie après la tristesse des bois obscurs auparavant traversés.
Victoria est à 1 500 mètres d’altitude, et les environs arrivent à 1 700 mètres. Jamais les indigènes de cette région n’avaient vu un blanc, et les chevaux excitèrent autant d’étonnement que les hommes à la peau blanche. Ainsi les pionniers faisaient vraiment la découverte d’un pays nouveau, encore inexploré, et ils durent éprouver de rares sentiments en y pénétrant. Ils étaient d’ailleurs bien reçus par les indigènes, qui les regardaient comme des êtres supérieurs et ne demandaient qu’à leur obéir. Ceux-ci aidèrent à construire le fort Victoria.
Sur ce plateau de Victoria, la maladie des chevaux disparaît, mais les pauvres bêtes furent soumises à un autre fléau : les lions en enlevèrent plusieurs. La colonne s’installa aussi confortablement que possible à Victoria, en attendant les ordres de sir John Willoughby.
Pendant que les pionniers étaient à Victoria, sir Willoughby avait reçu un ultimatum de Lobengula, roi des Matabélés, qui lui ordonnait de retourner en arrière, sous peine d’avoir à subir les conséquences de son envahissement, c’est-à-dire d’avoir la guerre avec les Matabélés. Willoughby partit aussitôt pour rejoindre les pionniers. Il trouva à Fort Victoria une vraie foire de village, avec jeux de cricket et de football, match à la carabine, balançoires, etc. Et, la nuit, le village était éclairé par la machine électrique.
Après avoir conféré avec les chefs de la colonne, Willoughby décida de ne tenir aucun compte de l’ultimatum et de pousser en avant, en ajoutant seulement au corps des pionniers les deux cents hommes de la police venus avec lui, deux canons Maxim et des munitions. Selous partait en avant à un jour de distance, afin de tracer la route dans le Mashonaland qu’il connaissait déjà. Le 19 août, Victoria était abandonnée, confié seulement à la garde de quelques hommes.
La colonne ne marchait que rarement dans la matinée, à cause des bœufs que la grosse chaleur du jour fatigue beaucoup et prédispose à la maladie. La marche principale se faisait de quatre heures à neuf heures du soir. À dix heures ou onze heures on sonnait le couvre-feu, et l’on dormait autour des voitures, à la garde de nombreuses sentinelles dispersées sur douze ou quinze milles de superficie : la machine électrique projetait ses feux à plus de mille mètres de distance.
À 90 milles de Victoria, à la source des rivières Umgezi et Sabi, fut construit le fort Charter et, à 68 milles plus au nord, le fort Salisbury, à 8 milles du mont Hampden, l’objectif de l’expédition. Salisbury ne fut pas placé au pied du mont Hampden, à cause du manque d’eau en cet endroit. Ce ne fut pas sans une joie hautement manifestée que l’on vit de loin les croupes du mont Hampden se profiler sur le ciel. On arriva à Fort Salisbury le 12 septembre ; c’était sur des collines à la lisière de grands bois, près d’une petite rivière. Un chevreuil égaré avait traversé de bout en bout la ligne de marche de la colonne. Le grand plateau de Salisbury est à 1 700 mètres d’altitude et toujours rafraîchi par la brise.
Pendant cette marche de 400 milles, pas un coup de feu n’avait été tiré par les pionniers ; il n’y avait pas un pour cent de malades, les autres étaient en parfaite santé, à peine fatigués. Depuis Mafeking ils avaient fait 800 milles environ, à raison de 10 à 11 milles par jour avec 65 chars à bœufs pesamment chargés.
Le colonel Pennyfather passa la revue de la colonne, le drapeau anglais fut arboré sur un mât, le révérend Balfour récita une prière d’action de grâces, trois hurrahs furent poussés pour la reine Victoria, et vingt et un coups de canon furent tirés.
Tel est le récit de la marche des pionniers qui a décidé de l’occupation, par l’Angleterre, du Mashonaland et plus tard du Matabeleland. Le récit de la guerre du Matabeleland en 1893 contre le roi Lobengula, guerre dans laquelle les volontaires anglais furent conduits par le docteur Jameson et le major Forbes, est le second chapitre de l’occupation, le troisième étant rempli par la révolte des noirs en 1895. Mais il serait trop long de décrire ici ces évènements, et, après cette digression déjà, longue, mais que l’on n’aura pas, je l’espère, jugée fastidieuse, nous reprenons notre journal.
L’Équateur. – À 8 degrés avant l’Équateur, la chaleur devient assez forte, bien que le ciel soit couvert ; le soir, pendant un concert organisé sur le pont, qui a été tendu de drapeaux, un orage s’élève, mais reste éloigné et ne dure que deux heures.
Nous avons passé l’Équateur par un ciel couvert et un vent tellement frais qu’il fallait plutôt se couvrir. Le lendemain, cependant, le soleil se lève superbe dans un ciel sans nuage, et il fait une chaude journée. Les vieilles plaisanteries de la ligne sont épuisées, mais nous en trouvons de nouvelles : comme notre marche s’était ralentie, nous avons convaincu un brave garçon un peu simple que c’est à cause de la difficulté de monter le renflement de la terre à l’Équateur, et que, passé la ligne, la descente se fera beaucoup plus vite. L’évènement nous donne raison, et c’est tout juste si nous ne nous convainquons pas nous-mêmes.
La mer est toujours d’un calme extraordinaire, et, sans la houle de fond, le bateau semblerait immobile : d’ailleurs il faut y prêter attention pour sentir cette boule, et presque pas une des dames du bord n’a le mal de mer.
Le menu du bord se raréfie et l’on vit de conserves ; il n’y a pas de viande fraîche, et l’on nous sert même des choses qui sont près de nous donner le mal de mer, des blancs mangers et des gélatines de toutes couleurs. Et puis ce sont les sauces impossibles, mélanges de toutes sortes de produits pimentés, toujours les mêmes d’ailleurs. On se rappelle involontairement le mot de Veuillot : » Les Anglais ont une infinité de religions, mais une seule sauce. » Vraiment, ils en sont restés à la cuisine du Moyen Âge, à celle que Guillaume le Conquérant leur a importée de France, et si, comme le prétend un de nos passagers, la cuisine est l’indice de la civilisation, ils sont bien en retard.
Le bal masqué était assez réussi : les dames avaient de brillants costumes. Parmi les hommes, il y avait un costume assez curieux, mais évidemment incommode, c’était un phare électrique. Le bateau est si long qu’on ne sait pas ce qui se passe à 60 ou 80 mètres de distance, dans les salons, le bar, les fumoirs, sur les divers points du pont. C’est une ville flottante.
Je regarde, le soir, la Croix du Sud ; lorsqu’elle commence d’apparaître, elle me semble bien peu brillante, comparée à nos constellations du Nord : mais à mesure que nous allons au Sud, elle monte dans le ciel, et son éclat augmente. Cependant le ciel austral me paraît inférieur au ciel boréal, sauf la Voie lactée, qui a des zones semblables à une poussière éblouissante avec des vides absolument noirs.
Le vent se lève, il a soufflé assez fort les derniers jours avant d’arriver au Cap ; c’est le cas général, à l’extrémité de l’Afrique, la mer est plus agitée. Les jours baissent incroyablement ; c’est le brusque passage de l’été de France à l’hiver du Cap, et il fait froid, il faut se couvrir. La nuit tombe très vite, vers cinq heures, et la lune montre, nous affirme-t-on, une face un peu différente de celle à laquelle nous sommes accoutumés, peut-être voit-on un peu plus le bord du sud, un peu moins celui du nord : la figure qu’on y distingue rappelle celle des deux Amériques, et non plus la tête de bonhomme qu’y voient nos paysans ; c’est sans doute affaire d’imaginations différentes.
Ce dernier soir, il y a soirée et bal d’adieu sur le pont : voilà dix-sept jours que nous sommes sur ce bateau avec les mêmes personnes, et l’on finit par s’y attacher ; demain nous nous quitterons, et Dieu sait si nous nous reverrons : il y a des figures plus sympathiques qu’on a de la peine à quitter. Nous voici enfin en vue des montagnes du Cap, qui font une longue ligne très accidentée dont les sommets dépassent 1 300 mètres ; avec les nuages qui pendent de la Table, on croirait arriver sur les côtes d’Écosse. Le temps a été si beau, et nous avons été si seuls sur le grand cercle si borné de l’horizon de la mer, qu’il ne nous semble pas que nous nous soyons déplacés depuis les côtes de la Manche : depuis hier pourtant, le temps est couvert, et il vente ; la houle est assez forte, mais le bateau est si long qu’on ne sent qu’un fort roulis. Nous avons fait 5 979 milles marins en 397 heures, soit une moyenne de 15 milles à l’heure.
Le Cap. – Tous nos projets sont changés. Nous comptions aller en Rhodésie par Kimberley et Mafeking et en sortir par Beïra, et l’on nous fait entendre qu’il vaut mieux y aller par Beïra et la colonie de Mozambique, parce que ce dernier pays serait en pleine saison des pluies et difficile à traverser en décembre prochain. Nous nous laissons convaincre et nous retenons nos anciennes cabines sur le Norman, qui nous conduira jusqu’à Durban (Natal), d’où le bateau allemand qui fait le service sur la côte est d’Afrique nous transportera à Beïra.
En attendant, nous profitons d’une relâche de trois jours pour visiter Cape-Town. C’est une ville en amphithéâtre devant une baie assez large, enfermée dans une sorte de cirque naturel formé par la montagne de la Table et ses deux contreforts de droite et de gauche, ce dernier appelé Lion’s head, la tête du lion, dont il évoque la forme. La ville a peu de véritables monuments. Il y a des façades très ornées et de grand effet, comme celle du Parlement, de la gare du chemin de fer, et quelques autres. Les artères principales sont larges, et elles sont animées. Les cabs circulent comme à Londres, mais ils sont, peints en blanc, et les cochers sont des nègres ou des Hottentots.
Ce qu’il y a de plus désagréable, c’est la poussière, qui devient une boue rouge épaisse lorsqu’il a plu et rend difficiles les coursés à pied, surtout dans certaines rues : elle fait des taches ineffaçables. Nous avons embarqué à la gare plusieurs compagnons de voyage en route pour Johannesburg : l’un d’eux nous avait amusés par ses mésaventures ; n’ayant jamais fait grand-chose, il allait sans doute continuer au Transvaal, sous le prétexte d’y chercher fortune. Arrivé au dernier moment avec son billet de seconde classe, il s’est rencontré dans son compartiment en face de trois nègres ; passer soixante heures avec ces faces noires et ces peaux noires qui sentent mauvais, il y avait de quoi le rendre plus fou qu’il n’était ; heureusement nous avons réussi à lui trouver une meilleure place.
Nous sommes descendus à l’International Hôtel, une sorte de villa tout en haut de la ville, au pied de la Table, dans des massifs d’arbres et de fleurs. Là nous avons pu nous refaire un peu l’estomac de la nourriture échauffante du bord. Figurez-vous des fraises, des ananas, toutes sortes de fruits sur une table couverte de fleurs, du poisson excellent, des vins du Cap, et cela avec les bains de mer, des promenades charmantes dans une campagne couverte de beaux arbres, et des forêts toutes blanches au soleil du silver tree, l’arbre d’argent. Ces journées au Cap sont merveilleuses ; il ne fait pas très chaud, le vent est frais, ou se refait vraiment dans un pareil climat.
J’ai gravi plus de la moitié de la montagne de la Table ; le reste paraît à pic et inaccessible, il faut connaître les sentiers et les passages qui permettent d’arriver au sommet, et c’est une ascension dangereuse, car il ne se passe guère de journée sans que les nuages viennent couvrir la cime et pendre le long des parois comme de la ouate : il y a eu plusieurs accidents, des gens tombés dans le vide sans l’avoir vu, ou bien n’ayant pu retrouver leur sentier de retour, et obligés d’errer des journées et des nuits dans le brouillard. Mais, au grand soleil, la vue est immense sur les mers du Sud, où, dans un lointain infini, se confondent le bleu du ciel et celui des eaux.
Le long des « Twelve Apostel », les Douze Apôtres, ainsi qu’on appelle les montagnes qui prolongent celle de la Table, une route en corniche borde la mer ; cette route est taillée dans le roc, au pied duquel les vagues viennent déferler avec ces bruits profonds et sans nombre dont parlait Homère. C’est une promenade unique ; on peut la continuer au-delà des montagnes pour aller à Constantia et de là à Wynberg en faisant le tour de la Table, et parcourant les avenues de chênes et de pins, le long desquelles s’étalent les riches villas des habitants de Cape-Town, entourées des vignobles qui produisent les fameux vins du Cap.
Je ne pourrais décrire dignement le jardin botanique de Cape-Town, qui est unique au monde : les plus grands arbres des pays froids y poussent côte à côte avec les grands palmiers des pays tropicaux, sur des pelouses couvertes de buissons et de fleurs de tous les climats. Le sol est si riche et le climat si égal et si doux qu’il se prête aux plus diverses manifestations de la vie. C’est pour cela aussi que tant de malades, dont le plus célèbre est Cecil Rhodes, y ont retrouvé une santé magnifique, après avoir cru leurs forces épuisées.
Cecil Rhodes. – J’ai vu l’honorable Cecil Rhodes, alors dans toute sa gloire, mais cependant d’une simplicité antique. Il nous a reçus, mon compagnon de voyage et moi, pendant quinze à vingt miaules dans son cabinet. Ce cabinet est dans une maison minuscule en face du Parlement ; il est petit, et un grand bureau en occupe la majeure partie. Rhodes est un fort bel homme, très grand et vigoureux, l’air énergique et cependant très doux. Je trouve qu’il ne ressemble pas aux portraits bien connus qu’on a donnés de lui ; sa chevelure devient grise, et il a le front haut et large, très symétrique, le front d’un homme admirablement équilibré et capable d’une immense puissance de travail. J’ai remarqué chez lui une sorte de grâce dans sa pose et son attitude pour écrire une lettre : ce n’est pas seulement une intelligence supérieure et très active, ce doit être un homme séduisant, un charmeur. Il est très jeune, quarante-deux ans environ, et, comme il le dit plus tard, sa carrière ne fait que commencer. Un homme comme lui est une force dont on doit se servir, et d’ailleurs il sait en même temps si bien attirer et retenir la sympathie qu’il devient irrésistible. Jameson lui a été dévoué jusqu’au fanatisme, et il est juste de reconnaître que Rhodes, après la fameuse équipée du docteur dans le Transvaal, n’a pas dit un seul mot pour désavouer Jameson et a pris toute la responsabilité de l’affaire. C’est peut-être un exemple de ce qu’était l’amitié antique, plus forte et plus durable que toutes les circonstances, et dont on peut dire comme Shakespeare :
J’ai vu aussi le docteur Jameson, avec son air sérieux, mais simple et bon enfant. Il nous a reçus assis sur une table dans le salon d’attente de la Chartered Company ; n’ayant jamais encore entendu parler de lui, je n’ai connu sa qualité qu’en sortant des bureaux ; c’est la simplicité anglaise, souvent si charmante. Il est très bon et tous ceux qui ont eu des rapports avec lui gardent de l’amitié et de la reconnaissance, comme je l’ai vu plus tard en Rhodésie.
Avec nos lettres de recommandation de Rhodes et de Jameson, nous sommes sûrs du meilleur accueil partout en Rhodésie, et il est temps maintenant de mettre à la voile pour Beïra, après avoir goûté, mais si peu, les délices du Cap.
De Cape-Town à Beïra. – Nous partons du Cap à quatre heures du soir. Le vent est frais et assez fort, la mer semble devenir houleuse, on a de la peine à passer à l’avant du bateau et à s’y tenir. Quelques ragues arrivent jusque sur le pont, qui dépasse l’eau cependant de cinq à six mètres ; malgré sa longueur, le Norman est fortement balancé. C’est bien là la mer qui devait être d’un passage difficile pour les bâtiments à voiles ; elle semble s’opposer à ce qu’on la franchisse.
À l’arrière, le vent souffle et bruisse dans les cordages, le long des couloirs et des bastingages ; la mer fuit en grinçant et gémissant sous les deux hélices. Ce château d’arrière est un vrai spectacle, on y est abrité du vent et à l’aise pour en jouir.
Le jour baisse, Vénus brille très haut dans le ciel. La côte d’Afrique est une suite de montagnes rocheuses hautes de 1 000 mètres et plus, dentelées, surmontant une berge de terre étroite, ou plongeante directement dans la mer. C’est la prolongation de la Table, et cette longue barrière paraît infranchissable. Je m’amuse à chercher avec une lorgnette les passages possibles entre ces rocs pointus, par des ravins arides. Il y en a quelques-uns, mais fort peu. Là-haut, de ces plateaux étroits au-delà des pointes, on aurait une vue splendide sur la mer ; mais personne ne songe à les visiter, sans doute, balayés qu’ils sont sans cesse par les nuages et les vents. Il ne se passe guère de jour qu’ils ne soient ensevelis dans les nuages.
Une route étroite longe la côte, elle devient ensuite un sentier dans les rochers. Il n’y a pas d’habitations, mais des récifs nombreux, et des bancs de sable parfois remontant les berges. Au sud, des bandes de nuages sortent de la mer à l’horizon et affectent des formes tourmentées de montagnes très hautes et très lointaines ; on aurait la nostalgie d’aller là-bas, vers ce pôle Sud.
Le Cap des Tempêtes. – Il fait très frais, je vais mettre un manteau. Cet arrière du Norman qui oscille de droite et de gauche en s’inclinant vers les abîmes creusés par les vagues, me rappelle certaine gravure du vaisseau de Tristan et Yseult dans la tempête ; et les bruits des vents, ces bruits sourds contre les roofs et sifflant dans les cordages, font une symphonie étrange avec les mugissements des vagues et des eaux qui fuient derrière nous. La nuit est tombée tout à fait ; il n’y a aucune lune, mais les seules étoiles, pour rendre plus saisissants encore les bruits et les sons innombrables de la magnifique symphonie des vents et de la mer.
Après le dîner, je demeure longtemps sur le pont. Nous voyons filer ; plusieurs phares à éclipses. Le dernier qui passe est très haut sur une crête plus noire que l’horizon tout noir. C’est le véritable cap de Bonne-Espérance, autrefois le cap des Tempêtes : son éclat passe par gradation jusqu’à devenir éblouissant, puis il baisse jusqu’à devenir un point à peine visible, et cette révolution se renouvelle, chaque minute. Le fameux ; cap, est franchi, et maintenant il semble se produire une légère accalmie. Bonne espérance pour notre voyage, est-ce là ce que cela veut dire ? Ce passage : des dernières hautes cimes de l’Afrique : du Sud demeurera un souvenir inoubliable.
Ce n’est qu’après minuit que nous passons la pointe extrême de l’Afrique australe, le cap des Aiguilles. Ce sont toujours des montagnes, mais beaucoup moins hautes, et nous en longeons de nouvelles dans la matinée suivante, cette fois à l’est de l’Afrique.
La mer est maintenant presque calmée, et nous sommes bien tranquilles sur le pont devenu solitaire du Norman, car les passagers sont très peu nombreux. Je n’avais pas joui de la mer jusqu’à cette soir ce d’hier ; elle avait été trop calme, et hier encore ce n’était point assez, j’aurais désiré voir une violente tempête, ce doit être extraordinaire.
Le mauvais temps recommence et nous empêche de débarquer à Port-Élisabeth. La ville, qui longe la baie d’Algoa-Bay, paraît toute neuve. Depuis la construction des chemins de fer de Grahamstown et de Graaf-Rcinet, une quantité de propriétés ont été achetées sur cette côte de la colonie du Cap, qui est toute verte et paraît très fertile, en même temps que le climat très tempéré en est excellent. C’est une preuve de plus que les ports et les voies ferrées sont le plus sûr moyen de colonisation.
East-London. – Nous avons été retardés trois jours à East-London ; la mer était mauvaise, et il était impossible de transborder les cargaisons. Là nous avons quitté le Norman pour prendre un autre bateau de la même Compagnie, le Trojan ; il arrive à peine à la moitié du tonnage du Norman, mais c’est un joli bateau de type plutôt français, avec le pont d’arrière entièrement découvert, ce qui offre beaucoup d’espace et d’agrément. S’il y a moins de luxe que sur le Norman, la pension est bien meilleure et l’on jouit de la vue de moutons vivants. Ces pauvres bêtes étaient pourtant bien malades pendant la traversée agitée que nous avons eue jusqu’à Natal.
Durban. – Durban, ou Port-Natal, est la perle de l’Afrique du Sud, avec sa riche campagne, ses collines couvertes de forêts et de villas, ses plages pour les bains de mer et son admirable climat ; on l’appelle déjà, depuis que la voie ferrée est achevée, le Brighton de Johannesburg. Le jardin botanique est fort curieux : mais que cette végétation, toute luxuriante qu’elle soit, avec ses énormes feuilles, sa régularité monotone, sa symétrie, est loin des délicatesses de nos feuillages du Nord ! Tout cela est plus monstrueux que beau, et je lui préfère un coin perdu de nos montagnes de la Savoie ou des Pyrénées.
Nous n’avons pas le temps de séjourner à Durban, et nous repartons pour Delagoa-Bay. Hier nous longions le Zoulouland. Vu de cette distance et vers le soir, il me faisait l’effet des collines du Jura. Je comptais quatre ou cinq rangs de collines étagées et boisées. Nous avons croisé un superbe voilier portant dix-huit voiles aussi blanches que la neige, et peint lui-même tout en blanc ; c’était un resplendissement sur le bleu de l’Océan. C’était là la vraie navigation autrefois, celle où les Portugais, les Hollandais et nous-mêmes avons triomphé. La vapeur a transformé tout cela et changé le sort de bien des colonies. On ne peut revenir en arrière, et c’est presque dommage. Quelle sensation ce doit être de voyager sur un de ces grands voiliers qui glissent sans bruit sur les flots, sous ces grandes voiles pendantes là-haut comme des ailes de grands oiseaux !
À bord, l’on entend les conversations les plus étranges. Ces aventuriers qui voyagent ne paraissent pas toujours avoir grande délicatesse, ni grande élévation d’idées ; ils traitent avec le plus grand sérieux des choses absurdes. Il n’y a pas chez certains d’entre eux ombre de sens philosophique et même moral. S’il faut un certain courage pour s’expatrier au loin, il est des gens pour lesquels c’est devenu une nécessité par leur propre faute, et cela ne les rend pas supérieurs aux gens qui restent dans leur pays, ni ne leur donne le droit de les mépriser. Je ne crois pas que le premier venu verra s’élargir ses idées, parce qu’il ira chercher des aventures en Afrique ou ailleurs. Les voyages ne donnent pas d’idées à ceux qui ne sont pas capables d’en avoir. Par contre nous avons aussi des compagnons de route très intéressants, et j’aurai l’occasion d’en rencontrer d’autres au Charterland et plus tard au Transvaal.
Lorenço-Marquez