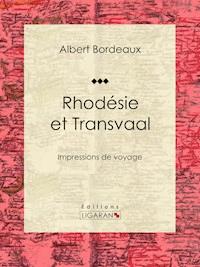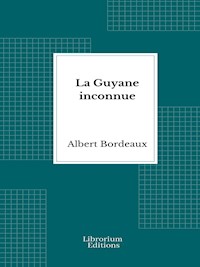
La Guyane inconnue: Voyage à l'intérieur de la Guyane française - 1914- Illustrée E-Book
Albert Bordeaux
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La durée du voyage, de Saint-Nazaire en Guyane, n’est pas aussi courte qu’on pourrait le croire à la seule inspection de la carte. S’il faut huit jours du Havre à New-York, il semble qu’en douze jours, on devrait accoster la Guyane. Or, il faut vingt et un jours. C’est que le grand courrier ne dessert Cayenne qu’indirectement. Après avoir touché la Guadeloupe et la Martinique, il file sur le Venezuela, puis sur l’isthme de Panama et Colon. C’est un paquebot-annexe qui prend les passagers à la Martinique et les transporte à Cayenne par les Antilles anglaises et les Guyanes anglaise et hollandaise. Une fois seulement par an, il y a un service direct de France en Guyane, c’est lorsque le paquebot de l’Etat, la Loire, transporte les condamnés à la déportation. A l’aller, il prend difficilement des passagers ; au retour, il paraît qu’il est toujours rempli. C’est un paquebot très confortable et qui fait le trajet en dix à onze jours ; il est tentant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LA GUYANE INCONNUE
VOYAGE A L’INTÉRIEUR DE LA GUYANE FRANÇAISE
PARALBERT BORDEAUX
14 gravures hors texte
OUVRAGE COURONNÉ PAR L’ACADÉMIE FRANÇAISE
1914
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383835509
A SULLY-L’ADMIRAL
Vous avez été mon guide dans ce voyage en Guyane, dont le but était de vérifier la richesse en or de divers cours d’eau situés à plus de 200 kilomètres des côtes, à vol d’oiseau, et de les prospecter en vue de leur avenir. La courte durée de quatre mois imposée à ma mission ne m’aurait pas permis sans vous de réaliser ce but, tandis qu’avec vous le voyage a été aussi agréable que facile. Je pourrais presque dire que je ne me suis pas douté des difficultés ; vous m’avez fait profiter d’avantages exceptionnels.
J’emporte une impression extrêmement vive de ce passage rapide à travers votre pays. En deux mois, nous avons remonté en canot jusque près d’une des sources de l’Approuague, parcouru à pied à travers la forêt quelques centaines de kilomètres, puis nous sommes redescendus à la côte par la rivière Mana. C’était la première fois que je parcourais à loisir un pays tropical, un de ces pays où l’atmosphère chargée de vapeur d’eau amortit les rayons solaires, et pénètre tout l’être d’une chaleur moite, comme l’atmosphère d’une serre ou d’une salle de bains russes. Mais il y a ici l’incomparable avantage de jouir de l’air libre, saturé de senteurs ; d’entendre les infinis frémissements de la forêt ; de voir dans leur libre développement toutes les variétés de la flore et de la faune les plus puissantes du monde. La Guyane tout entière, c’est la forêt vierge tropicale, c’est un enchantement pour celui qui ne l’a jamais vue ; elle a tout l’attrait du mystère inconnu à découvrir.
Auparavant, j’avais bien parcouru le Mozambique et la Rhodésie. Mais on traverse le Mozambique trop rapidement, en chemin de fer, et les hauts plateaux rhodésiens n’ont pas le caractère tropical des pays chauds et humides. Je vous dois donc de m’avoir fait saisir, sans les soucis du voyage, la beauté des tropiques, et je voudrais pouvoir rendre l’impression que j’en ai ressentie, non seulement pour ceux qui, en France, ne peuvent la connaître que par les livres, mais même pour beaucoup de Guyanais qui ont trop peu l’occasion ou le désir de connaître leur pays.
N’ai-je pas raison d’intituler ce récit : la Guyane inconnue ?
Albert Bordeaux.
LA GUYANE INCONNUE
CHAPITRE PREMIER PREMIÈRES IMPRESSIONS
La durée du voyage, de Saint-Nazaire en Guyane, n’est pas aussi courte qu’on pourrait le croire à la seule inspection de la carte. S’il faut huit jours du Havre à New-York, il semble qu’en douze jours, on devrait accoster la Guyane. Or, il faut vingt et un jours. C’est que le grand courrier ne dessert Cayenne qu’indirectement. Après avoir touché la Guadeloupe et la Martinique, il file sur le Venezuela, puis sur l’isthme de Panama et Colon. C’est un paquebot-annexe qui prend les passagers à la Martinique et les transporte à Cayenne par les Antilles anglaises et les Guyanes anglaise et hollandaise. Une fois seulement par an, il y a un service direct de France en Guyane, c’est lorsque le paquebot de l’Etat, la Loire, transporte les condamnés à la déportation. A l’aller, il prend difficilement des passagers ; au retour, il paraît qu’il est toujours rempli. C’est un paquebot très confortable et qui fait le trajet en dix à onze jours ; il est tentant.
Je partis de Saint-Nazaire sur le Versailles, un excellent bateau construit en Angleterre pour le service transatlantique du Lloyd allemand. Il fut vendu lorsqu’on fit les immenses bateaux actuels, le Deutschland, etc.
Nous eûmes d’abord quelques mauvaises journées, jusqu’au delà des Açores ; c’était en janvier et le vent soufflait furieusement. Les passagers paraissaient peu. J’étais accompagné par Sully-L’Admiral, Guyanais de vieille souche, originaire de la Guadeloupe, et d’ancêtres bretons. De solide constitution, et de vive intelligence, ancien chasseur d’Afrique, depuis sa jeunesse il était aguerri au climat tropical de l’intérieur guyanais et brésilien. Jeune et gai, il fut, dès le bateau, plein de ressources pour amuser les passagers et leur faire passer le temps sans s’ennuyer.
Parmi les autres passagers, je rencontrai un ingénieur, M. Moufflet qui, après neuf ans au Soudan, retournait en Guyane à sa mine de Saint-Elie qu’il avait longtemps dirigée autrefois. Son énergie et ses capacités l’y faisaient revenir malgré ses soixante ans bien sonnés. On voit que les climats tropicaux conservent fort bien la santé et l’entrain du caractère, seulement il ne faut jamais se décourager. Nos climats froids et humides ont bien leurs inconvénients, mais nous les connaissons. M. Moufflet savait se tirer d’affaire également bien dans le froid et la chaleur.
Après les Açores, le voyage s’égaya. Tandis que Sully-L’Admiral amusait les passagers, les dames surtout, avec un infatigable zonophone, je ne perdais pas mon temps avec M. Moufflet, car il me décrivait déjà la Guyane dans des détails tels, me disais-je, que je n’aurais pas le temps d’en voir autant. Cela me servit pour mieux la comprendre dans la suite.
Le dernier port que devait toucher le Versailles était Fort-de-France, après avoir passé devant Saint-Pierre, de cataclysmique mémoire. A Saint-Pierre, il était huit heures du soir ; la nuit était noire et je ne vis rien. Pourtant les passagers nous avaient bourrés de détails sur la catastrophe, ils s’étaient même disputés sur les rapports entre la destruction de Saint-Pierre et celle de Pompéi : l’un ou l’autre avait vu Herculanum et Pompéi. Les détails fourmillaient, quel dommage de ne rien voir !
J’étais accoudé aux bastingages, par la nuit sombre, devant l’ombre noire de la Montagne Pelée, écoutant la description que m’en faisait un ancien chanoine de Saint-Pierre, un méridional, je crois, encore ému d’avoir échappé, par son absence, au cataclysme : « Ici, c’était mon église, disait-il ; là, le théâtre. Cette pointe, c’est le Carbet… La population était excellente… Ah, monsieur, c’est le plus beau pays de la terre. » On eût dit qu’il voyait ce qu’il décrivait ; il voyait parce qu’il savait, car pour moi, je ne distinguais rien. Mais un confrère l’interrompt : « Ah non, mon cher confrère, la Dominique est bien plus belle ! » Et j’admire celui-ci qui s’extasie sur la Dominique : il y est depuis quatorze ans, et il est usé par la fièvre et l’anémie. Comment peut-il la préférer à sa Bretagne, où il vient d’essayer de se remettre par quelques mois de vacances ? Il a une bien belle âme ; et dire qu’on chasse de France les religieux ! « Pour moi, leur dis-je, je crois la Savoie plus belle que la Dominique et la Martinique. » Ils rient, mais ne se rendent pas. Et vraiment je suis bien hardi de les contredire ; je ne connais rien de ces pays tropicaux, la nature y est vierge encore, et chez nous, en Suisse, même en Savoie, n’est-elle pas bien défigurée déjà par le confort, inventé pour gagner de l’argent ?
Un des faits les plus navrants de Saint-Pierre fut de trouver sous les décombres de l’église, à la place de la table sainte, une rangée de corps, ceux des personnes qui venaient communier. Il était huit heures du matin. Bien des victimes furent retrouvées dans la position la plus tranquille, caractéristique de leur occupation habituelle, comme à Pompéi. Bien que Pline n’en dise rien (son récit fut écrit vingt ans après la catastrophe), il dut se produire à Pompéi le même vent de feu qu’à Saint-Pierre, et qui anéantit trente mille êtres humains.
On avait vu la veille les flots de la mer se précipiter dans un gouffre sur le rivage, et l’on devait s’attendre à la catastrophe qui en résulterait, c’est-à-dire à la production de masses énormes de vapeur d’eau, capables ou de soulever le sol, ou de sortir en torrents de feu. Mais on avait négligé l’avertissement, ou plutôt il y avait lutte électorale et l’on avait décidé de faire l’élection : le volcan attendrait. Quelle ironie !
Il y eut un violent raz de marée qui faillit envahir Fort-de-France ; cette ville s’attend un jour ou l’autre à être victime d’un raz de marée. Une autre ville à la Guadeloupe, la Basse-Terre, est menacée par son volcan plus encore que Saint-Pierre. Mais à Saint-Pierre même, on vient déjà relever les cultures, sinon les maisons : il faut bien vivre, la nécessité presse tandis que le danger est douteux !
Le bateau-annexe la Ville-de-Tanger nous prend à Fort-de-France. C’est un rouleur insupportable, quand même la mer est calme ; aussi fait-il regretter le Versailles. Nous descendons une heure ou deux à Sainte-Lucie, île anglaise où l’on parle créole. On nous montre la place sur laquelle on avait logé, ou plutôt parqué deux mille Boërs prisonniers de guerre ; la végétation est superbe sur les collines de l’île, autour de la baie parsemée de jolies villas : les Anglais ont le sens du confort, parce qu’ils ont celui de l’argent, ou inversement.
Nous ne cessons de rouler qu’en arrivant sur les côtes de la Trinité. On pénètre dans un passage étroit et pittoresque, un détroit entre de hauts rochers abrupts peuplés de grands oiseaux, et aussitôt la mer est calme comme un lac. Nous suivons les rives jusqu’à Port-of-Spain, la capitale de l’île, une ville pourvue de tout, confortablement, comme il sied à une ville anglaise pleine de respectability. Nous en repartons pour suivre de nouveau des côtes enchanteresses sous leurs forêts de cocotiers : le pays vraiment de Paul et Virginie. Là derrière on exploite lucrativement un lac de bitume connu des ingénieurs.
Nous entrevoyons au loin les côtes du Venezuela et les bouches de l’Orénoque, la terre ferme, cette fois, la roche solide, sans volcans ni bitume ; la nature vierge va commencer. C’est ensuite la Guyane anglaise : la côte est basse, et autour de la rivière Demerara où nous entrons, la végétation ne me paraît plus si merveilleuse que sur les côtes peu habitées de la Trinité. La civilisation a passé par là, si peu que ce soit.
A Demerari, ou Georgetown, nous sommes mis en quarantaine ; ou plutôt, c’est nous qui refusons d’admettre personne sur le bateau et d’en descendre, car il paraît que si nous avions le malheur de descendre à terre, on refuserait de nous laisser descendre à Surinam et à Cayenne. C’est dommage ; de la rivière où nous sommes ancrés, on ne distingue que des pontons et des quais de bois. Pourtant, dans une échappée entre des hangars, j’aperçois une rue en enfilade : ce sont de jolies maisons blanches bordées de palmiers et de grands arbres. Un tramway électrique file rapidement dans la rue, et rappelle l’idée du confort moderne. La ville paraît riche : on distingue de belles promenades, de superbes jardins, les ressources sont aussi variées qu’à la Trinité, à Port-of-Spain. L’intérieur du pays produit chaque année pour deux à trois cent mille francs de diamants qu’on exporte aux Etats-Unis. La formation diamantifère paraît être la même qu’au Brésil.
Pour arriver à Surinam, ou Paramaribo, capitale de la Guyane hollandaise, il nous faut reprendre la mer une vingtaine d’heures, puis remonter une rivière pendant deux à trois heures. La position de l’embouchure de la rivière est indiquée en mer par un bateau-feu ; il n’y a pas de phare. Ce bateau-feu est agité comme une coquille de noix : il oscille dans tous les sens sans aucune loi, au gré des vents et des lames ; c’est un genre de supplice plus rare et plus pénible que le roulis de la Ville-de-Tanger, et pourtant toute une famille, avec des bébés, habite cette coquille de noix. Si l’on soumettait chez nous des forçats à cette corvée, il n’y a pas de doute qu’on recevrait de toute espèce de journaux humanitaires des plaintes à la Jean-Jacques Rousseau, empreintes d’hypocrite sensiblerie. Car tandis qu’on a l’œil sec pour mettre à la porte des hôpitaux, des écoles, et de leurs demeures même, des religieux et même des femmes, on ne peut retenir ses larmes en parlant des forçats qui balayent les rues de Cayenne. Mais attendons de les avoir vus : il est juste de pleurer sur les forçats en tant que coupables.
A Surinam, pour prendre contact avec la terre et avoir quelques nouvelles, je vais déjeuner à l’hôtel International, une baraque en bois assez propre, avec de grandes chambres bien aérées, abritée par les palmiers de la plus belle avenue de la ville : le marché s’y tient en ce moment. J’apprends — tout en attendant un déjeuner difficile à obtenir, car ce n’est pas l’heure — que le gouvernement hollandais, plus prompt que le nôtre, a décidé la construction d’un chemin de fer de 250 kilomètres pour relier à Surinam les régions aurifères jusqu’à celle de l’Awa. Le tracé est fait, le matériel est en route, on a commencé la voie. Ceci m’intéresse vivement, car depuis que je suis en route, on me rebat les oreilles du chemin de fer de la Guyane française proposé depuis huit ans, sans cesse retardé, et que peut-être on fera trop tard, quand le trafic aura été pris en grande partie par le chemin de fer hollandais qui aboutit à peu de distance du terminus visé par le projet français. Les Hollandais de l’hôtel ont des parents chez les Boërs de l’Afrique du Sud, et cela donne un nouvel intérêt à notre conversation.
Avec la question du chemin de fer, la première qui s’impose à l’attention de ceux qui arrivent en vue de la Guyane française, c’est celle des forçats.
Déjà avant d’arriver, nous pouvons avoir une petite idée, de visu, du régime pénitentiaire. Nous passons en effet aux îles du Salut pour y déposer la poste. Depuis longtemps la sirène nous a annoncés, le commandant du bateau est talonné par l’heure de la marée pour pouvoir franchir la barre du port de Cayenne. Il y a trois jours qu’il manœuvre dans ce but d’arriver à Cayenne au jour fixé, pour l’heure de la marée. Mais l’administration pénitentiaire n’en a cure ; peu lui chaut ! C’est une administration officielle ; elle ne connaît pas la hâte. La Ville-de-Tanger s’arrête, elle siffle, la sirène pousse de longs hurlements, tout le monde est furieux. Lentement un canot se détache du rivage, il est manœuvré par sept forçats, six aux rames, un au gouvernail. Deux fonctionnaires trônent nonchalamment sur le banc d’arrière. Mais cette pompe n’en impose pas à notre commandant. Il leur flanque à la tête le sac des dépêches, leur crie en mots grondants les reproches qu’il tient tout prêts depuis longtemps, et siffle le signal du départ. La Ville-de-Tanger s’ébranle sans se soucier de heurter le canot officiel déjà secoué par les vagues, et où les fonctionnaires penauds ont peine à garder leur équilibre. C’est drôle de voir ainsi traiter l’administration que le bon public français n’aborde jamais que l’air craintif et même ébaubi.
Nous admirons cependant ces îles du Salut, toutes vertes, avec leurs beaux palmiers. Il y a trois îles formant un port : l’île Royale, l’île Saint-Joseph, et l’île du Diable. Dirait-on que c’est l’île du Diable, ce petit paradis terrestre ? Ce serait le digne séjour de Paul et Virginie. Voici la case de Dreyfus, plus belle que celle de l’oncle Tom : on s’attendait plutôt à voir un rocher aride et nu, à en croire ceux qui n’ont jamais vu les îles du Salut. Toute voisine, l’île Royale possède un vaste hôpital tenu par des religieuses pour les forçats : ce sont elles qui travaillent ici. Enfin l’île Saint-Joseph est habitée par les forçats de la catégorie la plus dangereuse. On entend ainsi ceux qui refusent de travailler. Mais le refus de travailler, lorsqu’il n’y a aucun moyen de coercition, ne semble pas indiquer un état d’âme particulièrement dangereux. Si l’on classait les forçats d’après leurs antécédents ou la cause de leur condamnation, le résultat serait peut-être plus concluant. Il est vrai que l’oisiveté est la mère de tous les vices, et c’est un argument. Nous allons bientôt voir un séjour qui contraste avec la verdoyante île du Diable.
A deux ou trois heures de distance des îles du Salut, voici un îlot, un rocher qui sort de la mer comme le dos d’un cétacé, mais ce dos est surmonté d’un bâti en bois portant un phare et d’un mât avec un drapeau : une maison minuscule se blottit sous le phare. C’est l’Enfant-Perdu, le rocher balayé des vagues qui porte le phare de Cayenne. Le séjour y semble peu réjouissant ; il y a pourtant plus de stabilité que sur le bateau-feu de Surinam. Ici les gardiens du feu sont des forçats, on les relaie tous les mois. Ce poste est une punition ; ils y vivent séparés de leurs semblables. Je ne vois pas pourquoi on les plaindrait : le bateau-feu de Surinam n’est pas une punition.
L’Enfant-Perdu mérite bien son nom, ce nom à l’air romantique. Les créoles des Antilles ont gardé le goût du romanesque et du suranné dans leurs dénominations ; nous le verrons pour leurs prénoms. L’un ou l’autre parfois, de ces vieilles familles antillaises, a même conservé le type du Français du moyen âge. Je disais à l’un de ceux-là sur le bateau : « Vous seriez parfait, costumé en mignon d’Henri III. » La barbe en pointe, les cheveux en arrière, sans être longs, l’ovale allongé, le regard qu’on voit aux portraits du duc de Guise, ou de Bussy d’Amboise, il vous reportait de quelques siècles en arrière.
Enfin la côte de Cayenne se déroule devant nos yeux : cette côte est extrêmement pittoresque, beaucoup plus que celles des Guyanes anglaise et hollandaise. Ce ne sont plus des rives basses et d’aspect marécageux, mais des collines accidentées couvertes d’arbres. La ville de Cayenne nous est cachée presque entièrement par la plus petite de ces collines, sur laquelle se trouve un fort, le fort Cépérou : on voit encore quelques canons, mais la plupart ont été emportés à Fort-de-France, qui a été choisi pour devenir notre centre naval dans la mer des Antilles. De la ville de Cayenne on ne distingue que le grand bâtiment de l’hôpital dont les jardins donnent sur la mer, et les anciennes casernes, au pied du fort Cépérou. Au delà, ce ne sont que des cimes de palmiers agités par le vent. L’impression est vraiment agréable. Dès l’abord, on se demande pourquoi l’on a choisi ce joli pays pour y envoyer les forçats. La raison, se dit-on avec conviction, c’est que le climat est malsain : il y a la fièvre paludéenne, et certaines années, la fièvre jaune. Nous aurons le temps d’en juger par nous-mêmes.
Nous franchissons la barre au dernier moment où elle est possible, grâce au retard subi aux îles du Salut, et le bateau jette l’ancre dans la rivière, en face des Douanes, devant un wharf en bois déjà vieux, mais dont il semble qu’on n’a jamais pu se servir.
Cayenne est à notre gauche, à l’est. A droite, c’est la pointe Macouria qui s’avance au loin dans la mer, suffisante pour abriter des vents d’ouest. Le bateau est arrivé exactement au jour fixé par les indicateurs, ni plus ni moins qu’un train-poste européen. Nous sommes au 29 janvier, mais tandis qu’en France il fait froid, ici le soleil est ardent. La brise de mer a cessé ; tout le monde est en blanc et en casque colonial. Des canots viennent nous prendre pour aller à terre. Les rameurs crient et se démènent, à demi vêtus : il y a là des noirs, des coolies de l’Inde, puis surtout des métis de toutes les teintes. Les noirs sont originaires d’Afrique. Les Indiens autochtones ou Peaux-Rouges sont très rares sur la côte ; il faut aller tout à fait dans l’intérieur pour en trouver encore quelques tribus. C’est en vain qu’on en cherche parmi ces peaux cuivrées, basanées, chocolat, grisâtres, jaunâtres, noirâtres. Il faut une bonne heure pour se dépêtrer avec ses bagages au milieu de ce fouillis de gens, de ce tumulte de cris d’appel, de cris de joie de se retrouver. Les créoles surtout m’ont paru être fort portés aux embrassements ; c’est un plaisir visible pour eux, exubérance due au soleil.
On peut dire que tout le monde ici est créole, et non pas, comme on pourrait le croire, les blancs de race pure, descendants des anciens colons. Quant à nous autres Français, on nous appelle des Européens. Il faut bien se garder de la moindre erreur dans les termes. Les créoles sont la race dominante ; les Européens ne font que passer. Les plus apparentes traces de leur passage sont justement les créoles, car la Guyane est restée à l’état de forêt vierge. Il y a bien vingt-cinq mille créoles, la plupart nés en Guyane, et l’on ne peut qu’être étonné qu’avec le triste cadeau de forçats que nous faisons à cette terre depuis soixante ans et plus, la race y possède tant de qualités réelles, ce qui ne veut pas dire qu’elle soit sans défauts. Mais nous la verrons à l’œuvre.
En attendant, je n’ai guère le temps d’étudier Cayenne à ce premier séjour. Je vais en effet repartir le surlendemain de mon arrivée pour aller visiter des placers aurifères à grande distance dans l’intérieur du pays. Il n’y a pas de bons hôtels à Cayenne, mais on a mis à ma disposition une des plus belles maisons de la ville, et pour mes repas, je dois les prendre chez Sully-L’Admiral, qui est un des hommes les plus en vue du pays, par la connaissance approfondie qu’il en a. Il sait être en outre un fin gourmet, ce qui ne gâte rien. Je n’ai donc vu de Cayenne cette fois que des rues régulières de ville américaine, et une belle place, la place des Palmistes.
CHAPITRE II EN VOILIER
Donc, à peine arrivés à Cayenne, nous nous préparons à en repartir.
Nous allons voir de près la beauté de la nature tropicale, dont les environs de Cayenne donnent déjà une idée. Car la forêt vierge commence au sortir de Cayenne. Or, nous devons remonter en canot une rivière sur près de 200 kilomètres de son cours, traverser des chaînes de collines, visiter des ravins, des vallons dont bien peu d’Européens, même de Guyanais, se font une idée. Ce voyage est fascinant. Il a l’attrait du nouveau, autant que l’avenir inconnu : l’inconnu dans le monde et l’inconnu dans le temps, tiennent la pensée captive, surtout quand on est jeune. C’est lorsque la vieillesse arrive que les souvenirs prennent leur valeur.
Le programme est tracé : une goélette nous attend dans le port ; des pagayeurs avec leurs canots ont été avertis de notre arrivée prochaine près de l’embouchure du fleuve Approuague. Nous n’avons que deux mois pour parcourir l’intérieur du pays ; ce serait impossible sans Sully-L’Admiral.
Notre voilier s’appelle la Paulette : elle passe pour être la goélette la plus confortable et la plus rapide de la Guyane. Construite à Nantes, elle est vraiment coquette, et elle a la chance d’avoir un capitaine qui est, comme qui dirait, amoureux d’elle. C’est un créole français, un marin dans le sang ; il parle anglais et commande en anglais, et il sait se faire obéir. On l’appelle le capitaine Boot. Il tient son schooner avec une propreté recherchée ; son équipage bien dans la main, il manœuvre avec autant de sûreté que d’audace. Jamais un cri, tout marche sans qu’il semble s’occuper de rien. Ce sera le plaisir de notre traversée.
Ce petit bateau a quatorze couchettes, il ne jauge guère que cent cinquante tonneaux, et me rappelle le Storge dans la mer du Japon. Celui-là aussi était comme un joujou dans la main de son capitaine ; en plus de la Paulette, il avait un moteur à vapeur, et ce système, utilisable à volonté sur un voilier, serait fort commode sur les côtes de Guyane, où l’on a souvent le vent contraire, car il souffle surtout de l’est et du nord-ouest.
Nous partons à cinq heures du soir. A six heures et demie, nous perdons de vue les côtes, même les trois petits îlots qu’on appelle ici le Père, la Mère, et les Mamelles.
Le vent jusqu’ici était frais, mais voici que brusquement il se met à souffler avec violence, et la Paulette donne du nez dans les grosses vagues. Nous avons largué plusieurs voiles, et cependant nous filons grand train. Il est nuit, et les secousses plutôt dures que nous subissons font que je vais m’étendre avec plaisir dans ma cabine, où je m’endors, après avoir pris le costume créole.
Ce qui me réveille bientôt, c’est la cessation des secousses ; il est minuit, je vais voir le temps qu’il fait. La nuit est noire, mais j’y vois assez pour distinguer que nous ne sommes plus en mer ; déjà nous avons franchi l’embouchure du fleuve Approuague, et nous le remontons contre le courant, grâce au vent et à la marée.
Le costume créole que j’ai, la mauresque, composée d’un pantalon flottant et d’une veste non moins flottante, est idéal dans les tropiques, pour le jour et pour la nuit. Sully-L’Admiral a emporté une douzaine de ces costumes, et c’est toute notre garde-robe. Ces mauresques sont en toile de Vichy, à carreaux ou à rayures écossaises de toutes nuances, du rose tendre au bleu de ciel, des teintes assorties à la douceur du climat et de la nature. La pluie les perce, mais elle est chaude, et l’on est si vite changé. La chaleur ne les traverse pas, car l’air circule au travers. Le costume rappelle Arlequin ou Polichinelle, mais il est si commode ! Sully-L’Admiral a trouvé le costume guyanais, et je m’apercevrai de plus en plus de son sens pratique ; il faut son expérience de la Guyane et du Brésil pour entreprendre le voyage que nous allons faire, dans des conditions de confort que tout autre eût dédaignées. Exemple : nous ne partons pas seuls en expédition dans l’intérieur : nous emmenons un médecin. C’est une femme, créole elle aussi, avec des traits réguliers : l’embonpoint la menace, mais justement la marche lui fera un excellent dérivatif. Emma, c’est son nom, accompagnait Sully au Brésil ; elle a passé des années au fameux Carsewène, où l’on a fait tant d’or, mais pendant si peu de temps. Avec elle, ni la fièvre, ni les coups de soleil, ni les serpents ne sont à craindre, et enfin elle fait la cuisine. Confort et sécurité, voilà un voyage bien compris.
FONÇAGE PAR L’EAU
Les remèdes indigènes sont lents, mais sûrs. Inventés par des gens du pays, pour des affections et des accidents du pays et du climat, ils ont plus de chances d’être efficaces que certaines drogues inventées au loin et débitées à coups de réclame.
Cependant il est minuit, et mes compagnons dorment. Je retourne à ma couchette. Il y a bien quelques cancrelas, mais c’est inévitable sur un bateau ; d’ailleurs ils s’enfuient, et je me rendors jusqu’au jour.
A quatre heures du matin, poussés par une brise légère, nous passons devant l’ancien village de Guizambourg, ayant remonté 30 kilomètres environ depuis l’embouchure de l’Approuague. Il y a une quarantaine d’années, Guizambourg avait des cultures de canne à sucre très prospères et une fabrique de rhum. Le climat y était très sain, bien que la zone cultivée fût au niveau de la mer, et même un peu plus basse, grâce à un système de digues établi par l’ingénieur Guizan. Mais depuis la découverte de l’or vers les sources de l’Approuague, tout a été négligé : les digues n’ont pas été entretenues, l’eau s’est infiltrée partout et a rendu la localité marécageuse et malsaine. Le fondateur de cette colonie, qui s’était donné tant de peine, ne la reconnaîtrait plus. Il paraît qu’il en est de même des anciennes colonies fondées par les jésuites, qui étaient étendues et prospères, et nous verrons qu’il en est encore ainsi de l’ancienne colonie des religieuses de Mana. L’or est un peu cause de tout cela, mais aussi la maladresse administrative après l’émancipation des esclaves, car les Guyanes anglaise et hollandaise ont bien su s’en tirer.
La brise tombe de plus en plus, nous n’avançons presque pas. Cependant voici que nous rejoignons une goélette partie de Cayenne vingt-quatre heures avant nous, mais elle a subi un coup de vent si violent, la veille de notre départ, qu’elle a dû chercher un abri sur la côte, en face des trois îlots que nous avions vus au sortir de Cayenne. Ce petit voilier a marché une quinzaine d’heures de plus que nous, et voici que la supériorité de vitesse de la Paulette et l’habileté de son capitaine se trouvent démontrées.
A deux heures après midi, nous sommes accostés par deux Européens (c’est-à-dire deux Français) dans une pirogue. Cette pirogue est si petite que l’un d’eux, en montant sur la Paulette, détruit l’équilibre ; elle bascule et son camarade tombe à l’eau, perdant son chapeau que le courant entraîne. Nous le repêchons sans chapeau, et il reste au soleil, tête nue, pour se sécher sur le pont de la Paulette. C’est Emma, paraît-il, qui l’a si bien guéri au Brésil des coups de soleil qu’il ne les craint plus. Lui et son camarade ont passé quelque temps dans le contesté franco-brésilien, au Carsewène où ils ont connu Sully. En Guyane ils s’occupent maintenant de l’exploitation d’un placer sur l’Approuague, qui leur donne plusieurs kilos d’or chaque mois, et d’une plantation de cacao, au point même où nous sommes en ce moment. Ils nous invitent à la visiter le lendemain.
Vers trois heures, la Paulette jette l’ancre en face du débarcadère servant aux magasins des placers que nous devons visiter. Ici finit la navigation à voiles et commence celle des pirogues. Un débarcadère s’appelle en créole, un dégrad. Ce mot provient peut-être de ce qu’on a dégradé la terre en cet endroit pour faciliter le débarquement, la berge étant trop haute auparavant. Le chef magasinier a le type chinois ; il est fils, en effet, d’un Chinois et d’une créole, et s’appelle Chou-Meng. Il s’est installé avec sa femme et deux enfants en bas âge dans une hutte en lamelles de bois, confortable pour le pays, et nous en offre une pareille avec deux lits en fer. Ces huttes à jour laissent passer l’air et les vents, seules sources de fraîcheur. La salle à manger est à part, c’est un kiosque ouvert de tous côtés, garanti seulement de la pluie et du soleil par un toit de feuilles sèches. Partout les grands arbres nous entourent, et couvrent tout le sol de leur ombre ; malheureusement les promenades sont impossibles sous ces ombrages, le sol est marécageux en cette saison des pluies, et l’endroit a été choisi justement parce qu’il forme en tout temps un îlot sur ces bords de l’Approuague.
Nous passons le reste de la journée à débarquer nos provisions, et Chou-Meng envoie chercher nos pagayeurs. Deux canots sont préparés pour nous : le milieu a été recouvert, comme pour les grands chefs noirs créoles, d’un pomakary. C’est un abri formé de lianes en arceaux recouvertes de feuilles de palmier, qui protège du soleil et de la pluie. Mais cet abri est bien bas, on ne peut s’établir au-dessous qu’assis ou étendu : on dirait des gondoles vénitiennes pour pays sauvages. Si ce n’était qu’à la longue les pluies torrentielles, bien que tièdes, peuvent finir par donner la fièvre, j’aimerais autant les recevoir que d’être enfermé sous un pomakary. Nous sommes en pleine saison des pluies ; elle dure sept à huit mois en Guyane, de décembre à juillet ou août. Plusieurs fois par jour, il faut s’attendre à des averses tropicales ; parfois la nuit entière elles durent ; le jour, elles sont suivies d’éclaircies où le soleil darde avec violence, ajoutant encore sa réverbération sur la rivière. Un parasol ne suffit pas toujours pour abriter de cette réverbération les gens qui n’y sont pas habitués, mais un pomakary pare à tout, de sorte qu’on ne peut qu’être satisfait, en somme, de recevoir cet honneur, réservé à des chefs créoles qui s’en passeraient mieux que nous.
Il faudra toute une journée pour faire venir nos pagayeurs et embarquer nos provisions. C’est donc le cas d’aller voir les plantations de nos compatriotes. Mais Sully tient à voir lui-même le chargement de nos canots — on dit ici parer les canots — et il restera avec Emma. Pour moi, qui suis inutile, je pars en mauresque et parasol dans une pirogue avec un pagayeur créole, et je redescends la rivière pour rendre visite à MM. B… et S… Je m’aperçois qu’ils ont fait construire un wharf en bois ; ce n’est pas le bois qui manque en ce pays, mais la bonne volonté de s’en servir ; ainsi M. Chou-Meng aurait pu en faire un. Au bout de ce wharf s’allonge une avenue de bananiers, et tout au fond, on aperçoit la hutte principale. Ce serait en tout petit, et dans le bois sauvage, une illusion de Peterhof sur la mer Baltique, où j’étais l’an dernier. Là-bas, l’eau miroitait au fond d’une avenue de pins. Ici la nature est plus belle, et cette hutte vaut un palais. Je commence à croire que les pays tropicaux ont leur charme, et nulle part la vie n’est simplifiée davantage. Si l’on surmonte les difficultés du climat, la nature offre de telles compensations au manque du confort inventé par la civilisation moderne, qu’on oublie celle-ci.
Sous leur hutte, je trouve MM. B… et S…; ils surveillent leurs planteurs. L’administration pénitentiaire avait consenti, grâce à une influence politique, à leur prêter deux douzaines de forçats pour leurs travaux ; on n’a pas idée comme une pareille faveur est difficile à obtenir. La main-d’œuvre est la grande question de la Guyane française. Tous les jeunes gens s’en vont aux mines d’or où ils gagnent plus que sur la côte et à Cayenne, et ils aiment la vie libre des bois. On ne peut leur en vouloir. L’une ou l’autre fois, on a essayé d’imiter les Anglais en amenant en Guyane des nègres d’Afrique ; le gouvernement anglais a fait dire confidentiellement au nôtre : « Vous savez, c’est la traite des noirs. » Et la terreur de l’Anglais qui nous possède a suscité une série d’arrêtés pour arrêter cette traite imaginaire. Le même coup s’est répété pour les coolies de l’Indo-Chine : « La traite des jaunes, cette fois. » Le résultat en est que la Guyane anglaise a quatre cent mille habitants, coolies, noirs ou créoles, et que la Guyane française en a trente mille. Comme notre territoire est aussi grand, on se rend compte de la pénurie de la main-d’œuvre.
Mes deux compatriotes me parlent du contesté franco-brésilien, des fameuses mines d’or de la Compagnie du Carsewène qui, pour une dépense de quatre millions, ont produit 8 kilogrammes d’or, dont la moitié provenait des alluvions de rivière, et l’autre moitié des résidus de lavage d’un tunnel creusé dans du quartz aurifère. On avait construit 100 kilomètres de chemin de fer monorail, aujourd’hui recouvert par la vase. Ne médisons pas trop du monorail, ce n’est peut-être pas lui qui est cause que le kilogramme d’or est revenu à un demi-million à la Compagnie. A côté d’elle d’autres exploitants ont recueilli beaucoup d’or, pour deux cents millions, dit-on ; ils ont amassé des fortunes. La grande crique a 12 kilomètres de longueur, elle a été riche par taches, les petits cours d’eau tributaires étaient pauvres. On dit qu’il reste encore beaucoup d’or dans la région.
C’est une aventure que celle de ce contesté franco-brésilien. Le public français y est demeuré indifférent, il était bien plus occupé de l’affaire Dreyfus. Il s’agissait pourtant d’un immense territoire, riche comme les Guyanes et le Brésil, et dont certaines régions étaient même exceptionnelles pour la facilité des cultures. La France, me dit-on, n’a pas su faire valoir ses droits, tandis que le Brésil n’a pas négligé les siens. En Guyane, l’opinion générale est que l’argent a joué un rôle dans le règlement de l’affaire, car la France n’a absolument rien obtenu. Les arbitres étaient des Suisses. On disait bien autrefois : « Pas d’argent, pas de Suisses. » C’est ce proverbe peut-être qui est cause de l’opinion des Guyanais ! Ce qui est sûr, c’est que le Brésil entend mieux les affaires que nous, au sens pratique.
Depuis que le Brésil est au Carsewène, les affaires de cette région ont été désertées, la confiance est perdue. Il est vrai qu’auparavant une part du succès du Carsewène était due à l’absence de tout gouvernement. L’arrivée des fonctionnaires français aurait peut-être fait le même effet que celle des fonctionnaires brésiliens. En Guyane, la douane fait fuir l’or, c’est un fait, nous avons le temps de nous en apercevoir.
Sur deux douzaines de forçats engagés ici, il n’en reste qu’une ; les autres sont partis, se disant malades, c’est-à-dire ici paresseux. On ne leur a pas reproché autre chose. Ceux qui travaillent en ce moment ont l’air fort calmes, ils sont bien nourris, ils ont du vin. Leurs huttes, qu’ils ont construites eux-mêmes, diffèrent bien peu de celle du propriétaire.
Les plantations sont surtout le cacao et les bananiers. On cherche à faire refleurir la culture du cacao en Guyane, l’administration donne un franc par pied de cacaoyer. En ce moment, on commence ici à les transplanter. Le défrichement n’est même pas tout à fait achevé. C’est là un travail considérable, dans ces forêts de grands arbres enchevêtrés de lianes. On a surtout du mal à se débarrasser des troncs, sur lesquels le feu n’a guère de prise en cette saison des pluies.
Notre déjeuner, préparé par une créole, est excellent : il se compose, comme plat de résistance, d’une tortue de terre préparée au curry. C’est délicieux, mais si j’avais su comment on tue ces pauvres bêtes, j’aurais été, je crois, dégoûté d’en manger. On leur scie la carapace le long des côtes et on taille les muscles de la carapace à coups de hache. Le mieux est de les étouffer, mais c’est bien plus long. On aimerait à croire avec certains naturalistes, comme Darwin, que les animaux souffrent très peu ; pourtant l’homme n’est que trop sensible à la douleur.
Notre salade est faite d’un chou palmiste, découpé en lamelles. D’un blanc appétissant, il serait fade s’il n’était fortement assaisonné. On le coupe au sommet d’un jeune arbre, sans s’inquiéter si celui-ci en meurt : il y en a tant dans la forêt vierge.
Après déjeuner, nous faisons un tour dans la forêt, aux endroits où ni les broussailles, ni les marécages ne nous arrêtent. Voici des fourmis-manioc, un des spectacles les plus faits pour passionner un naturaliste. Elles sont innombrables, et si elles s’attaquent à une plantation, elles ont vite fait de la détruire. Nous suivons leur route : elle a vingt-cinq centimètres de largeur environ et serpente à travers le bois. Le parcours des fourmis est ininterrompu ; par files de dix à vingt, elles cheminent dans les deux sens ; les unes apportent des fragments de feuilles vertes, qu’elles tiennent comme des parasols, elles viennent de les détacher de l’arbre et vont en approvisionner leur logis ; les autres retournent à l’arbre pour continuer de le dévaliser. Sur des centaines de mètres, nous les suivons : un grand arbre est dépouillé de ses feuilles en une nuit.
Une autre espèce de fourmis est plus dangereuse encore. S’il lui prend fantaisie de s’installer dans une maison, il n’y a plus qu’à déguerpir et à la lui abandonner. Elle s’attaque aux serpents et les dévore ; elle ne craint pas les tigres, disent les créoles. L’homme leur échappe en plongeant dans l’eau. C’est bien un des principaux inconvénients de la forêt que ce petit être-là.
Sur la rive, c’est un débordement de palétuviers et de moukou-moukou. Ce dernier végétal a une grosse feuille dont on se sert pour prendre le poisson-torpille. La secousse électrique, qui serait dangereuse, est évitée par cette feuille qui joue le rôle d’un isolant.
Quand je reprends mon canot pour rentrer le soir chez M. Chou-Meng, cette journée m’a paru un rêve. En rentrant, je trouve nos canots parés, nous partirons demain matin entre quatre et cinq heures pour profiter de la marée qui remonte jusqu’au premier saut, — c’est ainsi qu’on appelle ici les rapides et les cataractes des rivières. — Ce premier saut s’appelle le saut Tourépée, un nom indien.
Le soir, nous regardons faire un canot bosch. C’est un tronc ouvert à la hache le long d’une fibre, puis creusé avec un large ciseau. On brûle ensuite du petit bois dans la cavité produite, ce qui l’élargit : le vide augmente de plus en plus sans que le bois se fende. Les deux extrémités sont maintenues fermées, elles feront l’avant et l’arrière du canot. Lorsque l’intérieur est achevé et régularisé au tranchet, on le consolide par des traverses et on lance le canot à l’eau. Il cale vingt centimètres à peine, et peut franchir les passes étroites et peu profondes des rapides. Les créoles ne construisent pas tout à fait comme les Boschs ; leurs canots sont plus larges et les bords sont surélevés pour pouvoir être chargés davantage. Nos canots sont de ce dernier type. Leurs pomakarys ont l’air tout à fait confortables : nous pourrons braver la pluie et le soleil.
Pour les coups de soleil, Emma nous explique qu’elle les guérit très bien au moyen d’une infusion de verveine exposée plusieurs heures au soleil. On se lave la tête avec l’eau de l’infusion, puis on la rafraîchit avec des compresses de la plante de verveine. Ce n’est pas bien pénible, mais mieux vaut encore éviter le coup de soleil par le pomakary.
Nous n’allons dormir dans notre hutte qu’après avoir porté tous nos bagages dans les canots, de façon à être embarqués demain dès le réveil. C’est la navigation en canot qui va commencer : nous ne savons combien de temps elle durera ; entre quinze et vingt jours, nous dit M. Chou-Meng, mais nous espérons aller plus vite que cela : il n’y a pas deux cents kilomètres, et vingt jours ne feraient pas même dix kilomètres par jour. Il est vrai qu’il y a les sauts et ils font perdre beaucoup de temps.
CHAPITRE III EN CANOT SUR L’APPROUAGUE
Il est près de cinq heures quand nous nous levons, et comme on perd encore un certain temps aux derniers préparatifs à la lueur tremblotante des bougies, sur l’eau et sur le rivage, le jour commence à poindre quand nos canots quittent le rivage. Pour moi, j’étais prêt dès quatre heures, prenant à la lettre l’heure fixée la veille, mais je vois bien qu’il faut se faire à l’exagération créole ; elle va me servir de leit-motiv pour mon voyage.
Nous avons deux canots, chacun est muni de quatre pagayeurs et d’un pilote, tous créoles. Le chef pilote est celui de Sully-L’Admiral ; aussi il appelle son canot le bateau-amiral. Il a le plus grand pomakary, pour l’abriter avec Emma. Sous le mien, j’ai pour camarade un placérien créole en route pour son poste. En outre chaque canot transporte un ouvrier créole (il n’y a plus de nègres ici) allant aux placers. Les provisions et les bagages remplissent tout l’espace libre des canots. Chaque pagayeur a emballé ses bagages dans un pagara : c’est la malle indigène, rappelant la malle japonaise ; le couvercle emboîte le fond, télescopant plus ou moins suivant le remplissage. Ce couvercle et ce fond sont imperméables à la pluie, formés de trois enveloppes dont deux en lanières tressées, faites avec les nervures des tiges de feuilles du palmier maripa, et la troisième faite de larges feuilles d’un autre palmier. Une corde fixe le couvercle contre le fond, mais elle est inutile lorsqu’on a fréquemment besoin d’ouvrir son pagara.
Il fait vraiment très bon ; cette température tiède et cette atmosphère humide sont une jouissance. Les pagayeurs ont l’air de s’amuser plutôt que de travailler ; ils causent en langage créole, et j’ai bien de la peine à les comprendre. Mon canot aborde la rive, il va prendre mon quatrième pagayeur ; celui-ci est un Martiniquais de vingt-quatre ans ; pour un créole, c’est presque un blanc, il a ici une hutte avec sa femme et plusieurs enfants.
A sept heures et demie, des collines sont en vue, et rompent légèrement la monotonie des grands arbres feuillus qui bordent l’Approuague. Le fleuve paraît toujours avoir deux cents mètres de largeur. Nous sommes aux hautes eaux, grâce aux pluies ; les eaux envahissent les rives au loin sous les arbres, tandis que flottent les larges feuilles du moukou-moukou dont on me faisait hier la description.
Nous arrivons au saut Tourépée, aux premiers rapides ; ils sont invisibles. C’est l’heure de la marée, qui remonte jusqu’ici : l’eau étale recouvre entièrement les rochers, on ne se douterait pas qu’on franchit une petite chute.