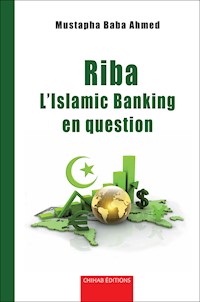
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Institué au milieu des années 1970, l’Islamic Banking est un ensemble d’instruments sensés ne pas faire appel à l’intérêt et ce, par référence à la proscription du Riba dans la Loi musulmane. Le monde musulman n’a pas une lecture définitive consensuelle du Riba : intérêt nominal, intérêt réel ou intérêt usuraire. Le label donné à certains instruments dans l’Islamic Banking n’est pas mérité au regard de la doctrine retenue basée sur l’interdiction de tout intérêt. L’analyse de leur contenu économique montre qu’au mieux, c’est de la cosmétique ; au pire, c’est de la mystification.
L’auteur ne verse pas dans le rigorisme ; le monde musulman dont une partie non négligeable s’accommode de l’intérêt ne doit pas être abusé. Les agents économiques doivent pouvoir choisir en connaissance de cause.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Economiste, l’auteur a partagé sa carrière entre la banque, en Algérie et à l’étranger, la haute administration des finances et le Consulting.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Riba
L’Islamic Banking en question
Mustapha Baba Ahmed
Riba
L’Islamic Banking en question
CHIHAB EDITIONS
DU MÊME AUTEUR
L’Algérie entre splendeurs et pesanteurs, Éditions Marinoor,Alger, 1997.
L’Algérie : diagnostic d’un non développement, Éditions L’Harmattan, Paris, 1999.
Le néomonétarisme, stade suprême du capitalisme-Impasses et désordres, Éditions L’Harmattan, 2012.
La fin de l’âge d’or du dollar ?, Éditions L’Harmattan, 2012.
Hymne à l’intérêt dévastateur, Éditions L’Harmattan, 2014.
Algérie : L’heure de vérité pour la gouvernance, Editions L’Harmattan, 2015.
© Editions Chihab, 2016.
ISBN : 978-9947-39-206-5
Dépôt légal : 2e semestre 2016.
Préface
Ecrire sur l’interprétation de la parole de Dieu expose à des risques d’une grande gravité. Dieu met en garde expressément l’homme contre les tentations de se prononcer sur des choses qu’il ne maîtrise pas. Le verset 36 de sourate Al-Isrâ est explicite à ce sujet : « Ô toi l’homme, ne te laisse pas séduire par les paroles ou les actes que tu ignores ; il ne faut pas dire : « j’ai entendu » alors que tu n’as pas entendu ; ou « j’ai su » alors que tu n’as pas su. Le Jour du Jugement Dernier, chacun aura à rendre compte de ce qu’il a fait des bienfaits de l’ouïe, de la vue et du cœur ».
C’est un dilemme devant lequel se trouve l’auteur : convaincu que la banque dite islamique n’est pas conforme aux préceptes de l’Islam, comme il l’a signalé dans son livre « Hymne à l’intérêt dévastateur »1, il n’a que le choix entre montrer que l’intérêt reste le référent de la banque islamique telle que pratiquée jusqu’ici, ou se taire devant l’épouvantable mystification dont est victime le monde musulman depuis l’officialisation au milieu des années 1970 de l’« Islamic Banking » ; et il devient complice de celle-ci.
Pourtant, dira-t-on, la question a déjà été traitée et réglée par la communauté musulmane dans le cadre de l’OCI (Organisation de la Communauté Islamique). Certes, mais elle a été édulcorée. Les réponses apportées ne sont pas tout à fait appropriées : des instruments utilisés demeurent sous le coup de la transgression. Aussi, m’est-il apparu indispensable de le faire savoir.
Seule la crainte de Dieu me préoccupe: c’est elle qui guide ma démarche. Sans doute, des réactions humaines seront vives. Je ne les appréhende pas. Je me suis efforcé d’apporter à l’écriture du présent ouvrage plus de croyance et de foi que de connaissances ; parce que celles-ci ont pour siège le cerveau, alors que celles-là sont dans le cœur. Je suis, de plus, armé de la célèbre sentence de l’Imam Al-Chafiî : « Mon avis est juste mais il peut être entaché d’erreur ; et l’avis de mon contradicteur est, par construction, faux mais il peut receler sa part de vérité ». Au moins, le livre ouvrira-t-il le débat pour dépasser un « acquis » contestable.
Introduction
Au début 2015, le monde occidental est préoccupé par la crise ukrainienne : la Fédération de Russie ne se contente pas d’avoir annexé la Crimée qui « lui appartient comme l’Alsace-Lorraine appartient à la France » selon Roland Dumas2 ; elle nargue les pays de l’Alliance atlantique et poursuit, avec l’aide des russophones, l’occupation d’autres territoires afin d’éviter un étranglement géostratégique par cette alliance. L’Europe crie au loup au motif qu’elle serait menacée par ces visées-là.
Comme en Ukraine, c’est bien par l’Occident que les guerres civiles ont été fomentées en Libye et en Syrie après l’invasion foudroyante de l’Irak sous le prétexte outrageusement fallacieux – ardemment contesté par certains pays comme la France – que ce pays détenait des armes de destruction massive. Qu’avaient en commun ces trois pays arabes ? Leurs responsables n’étaient pas circonvenus par les puissances occidentales. Saddam Hussein et Kadhafi étaient des dictateurs sanguinaires. Même Bachar El-Assad s’est avéré être du même acabit en dépit de sa formation et de son mode de vie. Roland Dumas raconte comment, en octobre 2010 à Londres où il était en déplacement en qualité d’avocat, il a refusé de prendre part à une rencontre pour préparer la chute de Bachar El-Assad et son remplacement par un général en retraite.
Sous la conduite des Etats-Unis, l’Occident a réussi l’exploit ignominieux de détruire toutes traces de la civilisation arabe. Il a fait, au mépris des conventions internationales, ce que l’Espagne n’a pas fait du temps de la Reconquista : chassant Musulmans et Juifs mais conservant les traces de la civilisation arabe. Les trois pays arabes susvisés ont été désintégrés ; ils ne pourront jamais être réhabilités. Le monde reste sans voix face au carnage censé « établir la démocratie dans les pays arabes » – objectif prétendu de Georges W. Bush. Des larmes de crocodile sont versées sur la Lybie par ceux qui ont assassiné Kadhafi pour des raisons restant à élucider. Le monde arabe divisé est tétanisé ; l’UNESCO peut se lamenter de la destruction par Daeche (l’Organisation de l’Etat islamique) des statuettes du musée de Bagdad.
Cette organisation a été créée, selon les aveux d’anciennes personnalités, dans les laboratoires de l’Intelligence américaine, laquelle a bien sûr partagé les motivations avec d’autres services (occidentaux et israéliens) ; gageons que la volonté de dévaster des (les) pays arabes n’était pas absente de leurs tablettes.
A cette Intelligence, les esprits faibles ne peuvent opposer que la stupidité pour justifier, aux yeux du monde, les agissements dévastateurs des forces du mal. Le prophète de l’Islam (QSSL) a-t-il besoin d’actes de désespoir engagés par des illuminés pour le venger ? Les adeptes de la religion, dont il a été le messager, seraient mieux inspirés de se poser les véritables questions qui doivent interpeller la raison.
Le monde arabe et tout le monde musulman sont absents de la mire de toute l’évolution de l’humanité depuis longtemps : leur dernière contribution a été celle de Ibn-Khaldoun. Celui-ci a mis le doigt sur la plaie : la ʿasabiyya (esprit de tribu) qui prévalait dans le monde arabe bloque encore la société. C’est précisément le déclin du monde arabe qui l’a incité à chercher l’explication des évènements et à dégager « les mécanismes de l’histoire ». En perçant le sens de l’histoire, l’auteur des « Prolégomènes » a, en quelque sorte, anticipé celle du monde arabe. Celui-ci n’a, depuis lors, d’existence que par le vide dans lequel il s’est installé face à l’évolution de presque toute l’humanité. Pour n’avoir pas perçu le changement du cours de l’histoire avec le Haut moyen-âge, qui commençait déjà à dérouler son devenir, le monde arabe, après avoir servi de trait d’union avec la philosophie grecque, a cessé d’en être un acteur : l’accélération exponentielle de l’évolution humaine par les révolutions industrielles qui se sont succédé dans le monde occidental a fini par faire du monde arabe un ensemble d’enclaves moribondes qui n’existent que par les « autres ».
Les Juifs jouent un rôle majeur dans cette évolution, dominant le monde au moyen de l’argent et de l’intelligence. Peut-on taxer d’antisémites Bush père et François Mitterrand ? En juillet 1991, le premier qui avait dirigé la Central Intelligence Agency a dit, à la préparation de la première conférence sur « Les territoires contre la paix au Moyen-Orient » : « Je me heurterai au poids des protestations et de l’argent… L’argent juif coule des deux côtés chez les démocrates comme chez les républicains. J’ai l’air de faire là une observation cynique mais c’est la vérité ».
Roland Dumas, qui rapporte ces propos, fait dire par François Mitterrand à Jean d’Ormesson, à propos de l’affaire Bousquet : « Vous constatez l’influence puissante et nocive du lobby juif en France »3.
Si les Arabes ne sont plus que des sous-hommes au regard de toutes les évolutions humaines auxquelles ils n’ont pas participé, les Juifs sont à la pointe de nombre d’entre elles : grâce à un des leurs, les Etats-Unis (reconnaissants) se sont dotés de l’arme nucléaire, qui leur a conféré le moyen suprême de la puissance.
Le monde arabe est, de longue date, mauvais consommateur de technologies développées ailleurs : les pays dans lesquels il vit ont été délimités par d’autres nations ; les Etats-nations qu’il constituait n’existent que par la volonté de ces autres. Les Etats arabes ne sont pas une construction procédant du génie de leurs peuples ; ils résultent de la « magnanimité » fort intéressée des puissances qui se sont résolues, pour des raisons diverses et aux conditions qu’elles ont fixées, à conférer aux territoires délimités des autorités locales. Celles-ci n’existai(en)t que par la volonté de ces suzerains, et les changements apportés à leur composition sont le fait de ces derniers. Le présent n’est que le prolongement du passé pour une communauté qui n’existe en tant que telle ni en tant que Oumma ni en tant que collectivités auto-organisées.
Aussi, ne faut-il pas accabler outre mesure les « autres » : les despotes locaux ne laissent place à aucun modèle de construction politique et sociale par le génie des peuples ; ils empêchent toute prise en mains par ces derniers de leur destin. A qui imputer la violence en Tunisie après l’espoir ? La rente pétrolière participe à la désintégration des pays arabes. Les monarques et Cheikhs du Moyen-Orient considèrent que c’est à eux personnellement que cette rente appartient, pour ce qui concerne leurs pays respectifs ; s’érigeant en supplétifs de grandes puissances, ils n’hésitent pas à utiliser alors une partie de la rente à des fins de déstabilisation d’autres pays de la Oumma. Dans les Etats dits républicains, les dirigeants recourent à des voies détournées pour se l’approprier. La mauvaise gouvernance fait que la rente n’y est pas exploitée avec davantage de bonheur pour le progrès social.
L’absence de liberté et de dignité enferme alors l’homme – affublé du titre de citoyen – arabe dans un état de « péonage » de type médiéval : la tyrannie se double de l’exclusion de la grande majorité de la population, à laquelle il ne reste que le choix entre l’incivisme larvé et la rébellion déclarée. La religion ou ce qui en fait office,selon les prêches salafistes, constitue alors un refuge quasiment naturel qui prend la forme de vocation pour les faibles d’esprit. Ce n’est, en définitive, qu’un faux retour aux sources : le glaive avait été, avec la poésie et la traduction de philosophes grecs, la principale manifestation des Arabes du temps de leur gloire. Pour avoir sombré dans le tribalisme, les Arabes ont été enfermés dans une cage à double tour : l’intelligence extérieure et la surdité maléfique de leurs dirigeants.
Le problème palestinien vient cristalliser toutes les rancœurs du monde arabo-musulman contre l’Etat juif d’Israël qui nargue la communauté internationale. Assuré de l’impunité totale par ses soutiens occidentaux, Israël n’hésite devant aucun dépassement, avec, comme arme : retourner contre les Palestiniens l’argument du terrorisme auquel il recourt lui-même en tant qu’Etat bafouant toutes les règles internationales. L’Occident est vassalisé par des voies insondables. « L’affaire » Charlie Hebdo est arrivée à point nommé en France, en janvier 2015, pour justifier une nouvelle vague de victimisation de l’Etat hébreux et du monde occidental.
La charge de la preuve que l’Islam est religion de paix pèse sur les Musulmans, lesquels doivent montrer patte blanche pour échapper à la stigmatisation et à la suspicion. C’est cela le lot du faible : le fort est conforté derrière la menace d’antisémitisme ; l’islamophobie est justiciable de la liberté d’expression. Il n’y a plus de ministre pour dire comme Roland Dumas : « … Nous ne sommes pas Israéliens … La France doit conserver sa capacité de dialoguer… ». En 1988, la France avait encore une politique étrangère gaullienne, indépendante ; peut-on reprocher à Sarkozy qui défend ses propres racines d’avoir infléchi cette politique ? Les déchirements insensés autour des clivages sunnites/chiites et islamistes/modernes ajoutent aux guerres dirigeants/oppositions.
Embourbé dans le fracas des armes, le monde musulman est, aujourd’hui, moins disponible que jamais pour prêter attention à d’autres questions qui le concernent au plus haut point. Le Riba, associé, dans le Coran, aux prêts en est une d’importance.
Même si elle reste sourde, la question interpelle tout le monde musulman : à une question véritable autant que redoutable, il a apporté au nom de toute la communauté musulmane une réponse approximative. Il a, ainsi, montré ses limites dans un domaine où il reste maître de la décision. Mais, l’est-il réellement ?
Un problème correctement posé est à moitié résolu. Posons les questions et développons les arguments techniques autorisés par la raison, même si les conclusions peuvent être difficiles à articuler au regard des risques de se tromper et de prolonger les erreurs des exégètes qui ont institué « l’Islamic Banking ». Le débat ne peut être clos au seul motif que des Ouléma, docteurs en Sharia, ont donné l’onction à ce système, parrainé et pratiqué par la Banque islamique de développement (BID).
Peut-on apporter la preuve que ce système ne respecte pas les prescriptions de notre religion ? Il faudra essayer d’identifier la signification de celles-ci et s’efforcer, par la suite, de pénétrer le contenu des types d’opérations bancaires islamiques consacrées à l’aulne du dispositif édicté. La principale difficulté de l’exercice tient au fait que les concepts et instruments d’analyse utilisables sont, les uns et les autres, des produits de conception humaine ; ils doivent éviter de caricaturer, voire, de dénaturer le contenu de la Sharia, laquelle est d’essence divine.
Pour éviter cet écueil, il importe avant tout de bien délimiter l’objet de l’interdit : qu’est-ce que Dieu a décidé de rendre illicite pour les adeptes de notre religion ? L’exercice doit faire appel à la formulation divine elle-même et à la Sunna, donc, à la lecture qui en a été faite par le prophète (QSSL). Cette investigation du message gagne à être mise en perspective avec les pratiques qui prévalaient lors de l’avènement de l’Islam et/ou avaient eu cours auparavant. Mais, dira-t-on, le message divin a-t-il besoin d’être confronté à la vie des hommes telle qu’elle se déroulait alors ? Sans conteste, « Dieu fait ce qu’il veut » ; mais, Ses messagers ont été chargés de véhiculer des règles que devaient respecter les communautés auxquelles elles étaient destinées.
L’éclairage de l’histoire antéislamique sera avantageusement élargi à une question que les anthropologues associent au Riba : l’esclavage ; on ne pourra pas faire l’économie d’évoquer aussi le Djihad puisque celui-ci a également alimenté l’esclavage. Le premier chapitre sera consacré à cet éclairage historique.
Le deuxième chapitre permettra de recenser les prescriptions du Livre et, accessoirement, les dits du prophète pour le Riba : quel est l’objet de l’interdit ? La suite de notre réflexion sera, évidemment, induite par la réponse qui aura été retenue.
C’est ensuite à la lumière des prescriptions ainsi identifiées et précisées que sera apprécié le contenu des pratiques connues de l’« Islamic Banking ». L’exercice consistera à essayer de tester la conformité à la Sharia de ces pratiques, lesquelles seront repérées à travers le contenu économique pour chaque type de transaction bancaire consacrée ; il sera aussi fait appel à l’arrière-plan qui en est donné dans le site de la Banque islamique de développement.
Mais alors, que faire si certaines pratiques ne sont rien d’autre que des formes déguisées de prélèvement du Riba ?
Notre investigation peut-elle se limiter à établir un constat ? Si l’Islamic banking n’est pas une solution tout à fait conforme, le monde musulman doit-il être maintenu dans un ersatz imaginé par des personnes, fussent-elles doctes en Sharia ?
Si la non conformité est établie, quelle alternative envisager ? La moindre amélioration susceptible d’être dégagée gagnerait à être mise en œuvre : le monde musulman ne pourra pas continuer à faire comme si : Dieu punit sévèrement l’hypocrisie. Il ne peut être dupé par les hommes quels que puissent être leur savoir et les procédés auxquels ils recourent.
Toute proposition doit compter avec les impasses et désordres dans lesquels a fini par se trouver le monde essentiellement par le fait d’avoir succombé aux méfaits des pratiques fondées sur les excès incommensurables liés à l’intérêt dans la finance moderne.
Celle-ci est en passe de reconfigurer le cadre géostratégique mondial ; mais elle menace jusqu’aux fondements du modèle de l’Etat occidental moderne qui a émergé des différentes étapes de sa construction historique depuis le XVIIIe siècle. Il nous faudra essayer de faire la lumière sur le rôle qu’a pu jouer l’intérêt dans ce qui apparaît aujourd’hui comme la gigantesque perversion de l’ingénierie financière mondiale. Nos investigations gagneront à être élargies aux conséquences de la sacralisation de l’intérêt.
Pour pouvoir faire la lumière sur le rôle de l’intérêt dans la genèse des différents stades d’évolution de l’économie mondiale, on ne peut faire l’impasse sur aucune phase significative de cette évolution.
Aussi, convient-il de passer en revue les mécanismes de ce qui est appelé capitalisme industriel, lequel a conduit l’humanité depuis le XVIIIe siècle jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle. Sera ensuite visité le capitalisme financier alimenté et justifié par la théorie néomonétariste, ce qui permettra de mettre la lumière sur les excès nés de la financiarisation de l’économie capitaliste et des dangers qui risquent d’en découler.
Il conviendra, après cela, d’expliciter toutes les propositions d’adaptation des instruments utilisés par la banque islamique, en distinguant le financement des activités économiques, d’un côté, et les prêts à la consommation, de l’autre. La spécificité de ces derniers est qu’ils ne sont pas éligibles à des mécanismes basés sur le partage des risques, comme les activités économiques.
Enfin, il faudra tester les instruments proposés en substitution à l’Islamic Banking actuel à l’aulne de la Règlementation dite de Bâle, qui s’impose à tout établissement bancaire.
L’auteur a pleinement conscience de la portée de son travail et de la gravité de ses implications pour le monde musulman ; mais il ne peut se résoudre à taire pareille situation même si, pour certains, le silence aurait été préférable.
Ouvrir la controverse sur le Riba dans la conjoncture actuelle peut sembler choquant et même provocateur : faut-il ajouter aux déchirures dévastatrices du monde musulman de nouveaux sujets de discorde qui risquent d’accentuer les clivages sociétaux en son sein ? L’auteur considère en toute conscience qu’il manquerait à son devoir s’il se taisait sur un sujet aussi grave, convaincu qu’il est que l’Islamic Banking ne remplit pas correctement son rôle ; aussi bien le monde des affaires que le monde intellectuel ont besoin d’être fixés sur le contenu réel de ce qu’on appelle, à tort, l’économie islamique. Le premier pourra alors décider en bonne connaissance de cause du système bancaire qui lui convient et le second sera en situation, quant à lui, de participer à la conception d’une économie qui serait effectivement conforme aux exigences des préceptes divins. S’il permet seulement d’ouvrir le débat, le présent ouvrage aura atteint son but essentiel.
premiere partie :Riba et quasi-Riba
Chapitre premier : RIBA ET ESCLAVAGE
Comme annoncé, ce chapitre permettra de passer en revue les comportements et les pratiques dans les domaines du Riba et de l’esclavage pendant les périodes de vie humaine qui ont précédé l’avènement de l’Islam. La question de la relation entre les deux est centrale pour nous ; la réponse aide à percer la ou les raisons sous-jacentes, s’il y en a, à l’interdiction du Riba.
Mais pour ce faire, on a besoin d’un éclairage sémantique : le Coran utilise le terme Riba pour formuler son interdiction. Dans le lexique économique et financier, deux concepts sont utilisés : l’intérêt et l’usure. Pour l’intelligibilité de ce qui suit, il nous faut défricher le contenu exact des mots afin de clarifier la position de l’Islam dans ce domaine et de dégager les réponses susceptibles d’être retenues à notre investigation.
A. ECLAIRAGE SEMANTIQUE
Les écrits portant sur les périodes antérieures à l’avènement de l’Islam ne distinguent pas entre les concepts « intérêt » et « usure ». Il est fait état d’intérêts prélevés ou exigés sur les prêts accordés, que ceux-ci soient faits en argent ou en produits. Aussi, convient-il d’essayer de dégager une lecture qui tienne compte des réalités vécues par les agents économiques en relation dans le cadre d’opérations de prêts. On ne peut échapper, pour ce faire, à une approche de nature téléologique: étymologiquement le terme usure vient du mot latin « usura » qui signifie intérêt ; mais, dans le langage courant d’aujourd’hui, le terme usure désigne, pour ce qui nous intéresse ici, soit un taux d’intérêt excessif, soit un taux qui dépasse le taux maximum autorisé par la loi.
Dans le passé, il n’y avait pas de taux légal à ne pas dépasser pour les intérêts ; il n’y avait que la perception que l’emprunteur se faisait du taux pour considérer que tel taux était excessif. Nous nous référerons à cette dernière notion ; mais nous le ferons à l’aulne des standards modernes de lecture des opérations.
Ces standards font appel aux concepts d’intérêt « nominal » et d’intérêt « réel » : le premier désigne le taux utilisé exprimé dans la monnaie dans laquelle est libellé le prêt (dans ce qui suit, en l’absence de précision, c’est ce concept qui sera visé) ; le second concept désigne ce même taux déflaté de l’indice des prix calculé dans le pays où cette monnaie est émise et en usage.
Cette lecture – de nature économique – en usage par les temps contemporains n’existait pas dans le passé. Seule l’appréciation de type moral permettait de qualifier un taux d’intérêt d’usuraire. Mais, doit-on considérer que cette appréciation était totalement dénuée de tout contenu économique ? Certes, il n’y avait aucun instrument d’analyse pour comparer le taux d’intérêt nominal au coût de la vie, ni au degré de dépréciation de la monnaie ; même si celle-ci était uniquement métallique durant de longs siècles, elle faisait l’objet de dévaluation soit par la quantité de métal soit par sa qualité. Il reste qu’indépendamment de l’avantage mutuel sous-jacent à toute vie sociale, la morale est toujours sous-tendue par la recherche d’équilibre et de réciprocité dans les échanges, comme le souligne David Graeber4.
Cette réciprocité s’exerce dans le cadre de la propriété privée, fondatrice de toutes les relations économiques et sociales, et qui, même si elle n’a pris son contenu final que dans le droit romain, ou par référence à ce droit, sert de matrice à tous les échanges. Ceci n’exclut pas les situations de partage et de générosité, mais qui obéissent à d’autres mécanismes qu’à ceux qui se fondent sur les échanges strictement économiques. Générosité et bonté sont des qualités qui permettent à l’être humain de s’élever au-delà de la recherche habituelle de contrepartie dans le cadre de relations humaines de type strictement contractuel.
Le clivage économique autant que social gravitait pendant de longs siècles autour du binôme protection-alimentation : l’apport de ces deux éléments constituait la norme d’appartenance au sein de la société et fondait les échanges globaux. Celui qui apporte la protection est en position d’exiger une contrepartie sous forme de biens ou d’argent, contrepartie qui s’est érigée en espèce d’impôt bien avant l’émergence des Etats nations.
Dans la société hébraïque est née une autre catégorie d’acteur qui s’occupe de la religion de sorte que « certains prient, d’autres combattent et d’autres travaillent ». Cette division sociétale des missions se retrouve également dans la religion chrétienne et, à un moindre degré, dans la religion musulmane. Les hommes qui prêchent vivent de dons et/ou de cotisations des croyants.
Le principe est que les obligations à la charge de chacune des parties au pacte social sont acquittées au comptant dans tous les échanges, certaines d’entre elles obéissant à une périodicité liée à celle des flux de revenus : les seigneurs et – depuis l’avènement des temps contemporains – l’Etat prélèvent leur dû annuellement.
Le pouvoir de coercition par la force du seigneur du moyen-âge a été remplacé par le droit de contrainte chez l’Etat ; l’un comme l’autre n’ont, en principe, aucune difficulté à obtenir leur dû.
Il en va autrement dans les relations entre les individus. Tout délai dans la livraison de la contrepartie dans l’échange :
- Prive le prêteur de l’actif (bien ou argent) qu’il possède en toute légalité de la jouissance de cet actif durant toute la durée du prêt et confère à l’emprunteur, par contrecoup, un avantage du même ordre de grandeur ;
- Introduit, en outre, un élément d’incertitude pour la partie créancière qui doit attendre : va-t-elle récupérer son dû et, si oui, quand ?
Les hommes en sont venus à introduire une « compensation » (appelons-là comme cela) au profit de la partie qui est privée de la jouissance du bien et qui doit attendre sa restitution ; cette compensation est à la charge de la partie qui doit s’acquitter de sa dette : c’est cette compensation qui a été appelée « intérêt ».
Ce contrat, appelé aujourd’hui synallagmatique, s’établit entre les deux parties à l’échange : celles-ci sont-elles égales lors de la conclusion du contrat ou, au contraire, l’une d’entre elles profite-t-elle de sa position pour dicter ses conditions à l’autre ? C’est cette deuxième réponse qui prévaut dans les cas de dettes, quelles que soient les parties au contrat : personnes physiques, sociétés commerciales aussi bien que personnes morales de droit public (Etats, collectivités locales et autorités supranationales). Mais il est arrivé que l’emprunteur de ce dernier type impose sa volonté.
Ce déséquilibre général sous-jacent à la relation qui s’établit s’exacerbe avec le temps lorsque des intérêts sont ajoutés à la dette en principal. Et l’exacerbation de ce déséquilibre s’accentue avec le niveau du taux d’intérêt. Les anthropologues considèrent qu’un tel déséquilibre annihile les chances de retrouver, ensuite, un statut d’égaux entre des personnes qui pouvaient être égales et qui ne le seront effectivement qu’à l’issue du remboursement. A défaut, le prêteur acquiert ou conserve la suprématie sur l’autre.
Les controverses sur l’intérêt appliqué aux prêts ont dépassé les débats sur toutes les autres questions de nature économique, mêlant éthique, religion, politique et économie. Rien d’étonnant à cela : le fondement du principe de l’intérêt reste à démontrer en dépit de l’évolution des sciences et des idées. Les économistes recherchent sa justification dans le concept d’actualisation. Mais l’intensité et l’âpreté du débat ne procèdent pas que du principe, elles se nourrissent aussi de la pratique et de ses conséquences.
B. PRATIQUES ANCIENNES DE REMUNERATION
Les antécédents historiques hors le JudaïsmeLes philosophies matérialistes voient dans l’accumulation des richesses la fin ultime de la vie de l’homme ; les religions font, au contraire, de la morale et de la justice sociale les idéaux de l’existence. Bonté, entraide et charité sont professées par toutes les religions monothéistes, lesquelles visent à détourner l’homme de ses penchants pour l’avidité et la cupidité après que Choaïb ait étéchargé du message de l’honnêteté dans les poids et mesures.
Pour Claude Lévy Strauss, des trois sphères qui composent la vie en société, c’est l’économie, qui porte sur l’échange de biens, qui constitue le socle de l’histoire humaine. Pour Nietzche, le sentiment de l’obligation envers autrui « tireson origine des plus anciennes et plus primitives relations entre individus : relations entre acheteur et vendeur, entre créancier et débiteur » (dans Généalogie de la morale-1887).
La pratique de l’intérêt sur dette serait antérieure à l’écriture ; elle correspondait au manque de confiance ; elle supposait même que créancier et débiteur ne se perdent pas de vue – c’est-à-dire qu’ils devaient vivre alors dans la même localité.
Dans une inscription royale datant de 2402 avant Jésus Christ, le roi Enmetena de Lagash aurait ajouté au loyer – non payé des terres agricoles par le roi d’Umma – des intérêts, composés tous les ans (déjà). C’est dire qu’il existait donc des prêts avec intérêt, avant même l’apparition de l’esclavage mais contre nantissement de biens que le prêteur peut évidemment s’approprier en cas de non remboursement. Cela veut-il dire que l’esclavage n’a pas été cause ou conséquence du gonflement de la dette par l’intérêt ?
Depuis fort longtemps, la dette entre riches et pauvres pouvait conduire l’emprunteur défaillant à l’esclavage ; et ce risque était d’autant plus élevé que le prêteur imposait un fort taux d’intérêt. L’esclavage s’alimentait à deux sources : la guerre (et razzias) et ses butins ; et les prêts avec intérêt.
Vingt siècles avant J.-C., si un mari mésopotamien ne pouvait pas vendre sa femme, il pouvait contourner cet interdit en s’en servant – ainsi que ses enfants le cas échéant – comme garanties d’une dette ; et ce, même si le prêt n’était en fait qu’une simple avance sur rémunération d’un travail du mari chez le prêteur.
Pour échapper à la servitude associée soit aux dettes soit à des conquêtes, les pères de familles en étaient réduits à l’exode avec leurs familles et leurs troupeaux. Un code juridique assyrien a eu même recours, dans la seconde partie du IIe millénaire avant J.-C., au voile des femmes afin de les soustraire à la marchandisation.
En Mésopotamie, les opérations de prêts ainsi que les achats importants étaient consignés sur tablettes, en particulier pour les prêts à intérêts. Le code édicté par Hammourabi (1790-1750 avant J.-C.) distinguait trois types de prêts : gratuits, « probablement ceux qui étaient à la consommation », prêts gratuits avec clause pénale en cas de non paiement à l’échéance, et prêts avec intérêt (Cruveilhier 1938, pp.103-4). L’intérêt pour les prêts de céréales était fixé à 33,3% et celui sur les prêts en argent à 20%. Le code interdisait ce que nous appelons, de nos jours, capitalisation des intérêts, mais aussi les dépassements de taux !
En 1761 avant J.-C., Hammourabi, confronté à une rébellion, décide d’effacer les dettes afin de rétablir la justice et l’équité et d’éviter l’oppression du faible par le fort, mais aussi pour éviter la défection des paysans qui, autrement, redeviendraient éleveurs nomades. Le pharaon Bakenranef (720-715 avant J.-C.) aurait, lui aussi, décrété un effacement des dettes pour les mêmes raisons.
Après Alexandre le Grand, la dynastie grecque, qui vivait en Egypte sous Ptolémée, a institutionnalisé l’effacement d’ardoise et Ptolémée a même amnistié les débiteurs et prisonniers en 196 avant J.-C. En Berbérie, Massinissa a compris que, à la différence du sédentaire, le nomade était un mauvais sujet fiscal : c’est ainsi qu’il encouragea la mise en valeur des terres ; il a réalisé, alors, une véritable transformation économique du Maghreb central (de Tunisie jusqu’en Maurétanie) au IIe siècle avant J.-C.
Les relations de prêteur à emprunteur différaient selon qu’ils étaient tous deux des égaux sociaux ou qu’il y avait entre eux un écart social : dans le premier cas, s’il y avait recours à l’intérêt, celui-ci était faible. « Ne me facture pas d’intérêt ; nous sommes des nobles tous les deux » écrit un Cananéen à un autre sur une tablette datée d’environ 1200 avant J.-C. rapporte Léo Oppenheim (in Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization) selon David Graeber5. Mais c’était là des situations d’exception.
La Grèce représente l’exemple emblématique de la société qui s’est constituée en classes : celle des guerriers, utilisés à des fins d’expansion territoriale, ce qui procure des esclaves, et celle des aristocrates qui préfèrent l’autosuffisance alimentaire dans leurs domaines, espaces de leur autorité, au recours à la monnaie.
Aristote observa les troubles sociaux qui se produisaient dans les années de mauvaises récoltes : les paysans pauvres devaient s’endetter auprès des riches propriétaires dont ils finissaient par devenir des métayers ; parmi ces derniers, certains étaient même vendus comme esclaves. Ce sont les crises répétées de la dette et la résistance du peuple qui ont conduit Aristote à vilipender la pratique de l’intérêt, mot qui signifie alors « progéniture ».
Il convient de noter qu’en dépit de la ferme condamnation de l’intérêt par Aristote, l’asservissement pour dette n’a pas disparu totalement en Grèce. La société grecque a continué à pratiquer l’intérêt sur les crédits commerciaux ; mais, pour les besoins de consommation, la société organisait des programmes sociaux qui assuraient des revenus aux pauvres, de manière à les soustraire aux griffes des prêteurs asservisseurs.
Le monde romain a assimilé l’esclave à une chose « res » ; la notion de propriété serait même dérivée du droit sur l’esclave : les créanciers avaient le droit d’exécuter les débiteurs défaillants. L’opportunité de l’expansionnisme a conduit Rome, elle aussi, à reconsidérer la question, à interdire l’esclavage et à canaliser une partie des revenus de l’empire vers le paiement d’aides sociales.
Les deux civilisations ont recouru à des solutions qui étaient de nature à prémunir leurs sociétés des travers liés aux intérêts. C’est dire l’importance de l’intérêt même pour l’ordre public.
L’intérêt chez le monde juifLe monothéisme par Livres révélés n’a commencé qu’avec le prophète Ibrahim. Les Juifs soutiennent que le sacrifice du sang sur son propre fils a été demandé par Dieu à Ibrahim pour Isaac. Cette version – différente de celle évoquée dans le Coran – est mise en avant par les Juifs pour associer l’argent et le sang : le premier doit être utilisé pour éviter la violence, le sang.
Le concept même de propriété est totalement différent de ce qu’on a vu à propos du droit romain : selon la Genèse, Ibrahim a acheté une grotte pour enterrer sa femme Sarah, la mère d’Isaac. Les Juifs se réfèrent à cette histoire pour i) dire que tous les biens matériels sont la propriété de Dieu (c’est ce que vont rappeler la Bible chrétienne et le Coran) et ii) essayer de montrer à travers un raisonnement spécieux « le droit éternel des Juifs sur Hébron et, plus largement, sur la terre de Canaan »6.
La pratique de l’intérêt est interdite par le Lévitique (chapitre 2 et dans le Deutéronome au chapitre 15 entre Juifs. Mais elle est autorisée voire même suggérée sinon conseillée à l’égard des non Juifs. Le Lévitique prohibe même le profit entre Juifs. « Ne lui [ton frère] donne point ton argent à intérêt ni tes aliments pour en tirer profit». Cela fait partie de la solidarité et de la générosité qui s’imposent au sein de la communauté israélite. L’interdiction dans le Deutéronome est complétée par l’obligation de rémission (remise de la créance) tous les sept ans entre Juifs. L’étranger « peut être contraint », mais pas le Juif. Le but expressément formulé est d’éviter qu’il y ait des indigents dans la communauté.
A la solidarité entre Juifs, le Deutéronome ajoute le statut de leur supériorité à l’égard des autres en matière d’argent : « Tu pourras prêter à bien des peuples, mais tu n’emprunteras point et tu domineras sur bien des peuples, mais on ne dominera pas sur toi ». Mais « qui aime l’argent n’en est jamais rassasié ». Payer sa dette signifie aussi en hébreux intégrité et paix, ce qui est bien naturel. Reste la question capitale : avec ou sans intérêt ?
Les jurisprudences priment sur les lois écrites ; celles-ci sont issues de celles-là ; et, au besoin, les tribunaux juifs adaptent les principes éthiques de la Loi. Si les Juifs ne devaient pas pratiquer d’intérêt dans les prêts entre eux, cette règle n’a pas toujours été respectée et a été perdue de vue. Certes, la Loi du Jubilé stipule que « les dettes seraient automatiquement annulées dans l’année Sabbath et les esclaves à cause de ces dettes seraient relâchés » (il ne pouvait s’agir que d’esclaves non juifs). De sorte que, dans la Bible comme en Mésopotamie, la liberté signifiait « libération des effets de la dette ». Au surplus, les Juifs, qui se considéraient comme le monopole obligé en matière de prêts (avec intérêt), ne pouvaient détenir bien longtemps les esclaves, en raison de leur nomadisme ; ils pouvaient (devaient) les vendre.
Il ne manque pas de paraître étrange de lire que l’intérêt, qui est dit « nechekh » en hébreux, signifie morsure et que, malgré tout, il est pratiqué même entre Juifs et de lire que « certains [Juifs] tournent déjà cet interdit en investissant dans une affaire et en partageant les risques et les revenus avec l’entrepreneur.»7 Cela a dû être très exceptionnel.
Notre étonnement s’estompe quand on lit ce que Dieu dit dans sourate Annissaâ : « C’est à cause des injustices commises, en particulier en écartant beaucoup de gens de sa religion [l’Islam] qu’Allah a interdit aux Juifs certaines choses qui leur étaient licites auparavant ; et aussi parce qu’ils pratiquaient le Riba et la corruption. Nous avons préparé pour les





























