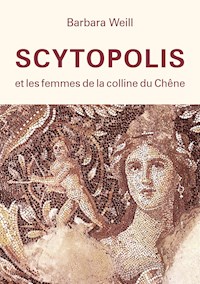
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Découvrez la vie de Levana, crainte et honorée de tous sur la Colline du Chêne, maîtresse et prisonnière du Temple.
On dit que sur la Colline du Chêne des femmes, qui se font appeler "les prêtresses d’Ashéra", partagent une vie vouée à l’austérité et au recueillement, mais qu’elles s’unissent parfois à des hommes au cours de banquets nocturnes. Levana nous révèle la vérité sur cette communauté qu’elle a dirigée pendant de longues années. Mais elle nous dévoile aussi ses doutes : s’agit-il de la meilleure forme d’existence pour les femmes de son temps ? Et vont-elles pouvoir survivre aux menaces du fanatisme religieux qui sévit en Galilée, imposé par les souverains hasmonéens qui règnent sur le pays ?
Un récit passionnant, construit dans un contexte historique précis, sur la vie d'une prêtresse de Galilée, ses croyances, ses doutes et ses peines.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Barbara Weil est née à Paris, où elle a étudié la philosophie. Puis elle s'est installée à Jérusalem et s'est passionnée pour l'histoire d'Israël et la mystique juive. Elle enseigne le yoga, et pratique la méditation kabbalistique ; elle s'intéresse aussi à l'astrologie et au Yi Jing. Depuis sa fondation, en 1998, elle est l'éditrice du site internet du Judaïsme (http://judaisme.sdv.fr) dans lequel elle a rédigé de nombreux articles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCYTOPOLIS
et les femmes de la colline du Chêne
Barbara Weill est née à Paris, où elle a étudié la philosophie. Puis elle s’est installée à Jérusalem et s’est passionnée pour l’histoire d’Israël et la mystique juive. Elle enseigne le yoga, et pratique la méditation kabbalistique ; elle s’intéresse aussi à l’astrologie et au Yi Jing. Depuis sa fondation, en 1998, elle est l’éditrice du site internet du Judaïsme d’Alsace et de Lorraine (http://judaisme.sdv.fr) dans lequel elle a rédigé de nombreux articles.
Retrouvez la sur la page du livre : http://abpw.net/scytopolis/
Barbara Weill
SCYTOPOLIS
et les femmes de la colline du Chêne
REPERES
Chère lectrice, cher lecteur,
Vous trouverez ici quelques repères historiques et géographiques qui vous permettront de mieux suivre les événements évoqués dans ces pages.
Mais avant tout, sachez que cette histoire est un rêve, merci de la lire comme telle.
Le royaume hasmonéen
La dynastie des Hasmonéens, ou Maccabées, parvient au pouvoir en Judée au cours de la révolte contre les Séleucides et leur souverain Antiochus Epiphane, que Mattathias déclenche en 168-167 a.C.n. et à laquelle se joignent les Hassidim. Mattathias meurt un an après le début de la révolte. Son fils Judas Maccabée lui succède. Après plusieurs batailles, il parvient à s’emparer de Jérusalem et rétablit le culte juif dans le Temple (-164). Son successeur Jonathan (152-142 a.C.n.) se fait ainsi accorder non seulement des titres à la cour séleucide, mais aussi la fonction de grand prêtre (à laquelle il n’avait aucun droit) et d’ethnarque (chef du peuple) des Juifs, c’est-à-dire l’unique interlocuteur du pouvoir royal. Profitant de la paralysie du royaume séleucide, il entreprend sur le champ une politique de conquête, qui sera poursuivie par tous ses successeurs. Simon (142-134 a.C.n.) est le frère de Jonathan. En -140, lors d’une assemblée générale à Jérusalem, et à la suite d’un décret voté par cette grande assemblée, il est proclamé "Grand prêtre, stratège et ethnarque" à titre héréditaire. On présente Simon comme un souverain équitable et bienveillant.Jean Hyrcan Ier (134-104), deuxième fils de Simon, lui succède. Après avoir mené une vaste campagne de conquêtes en Transjordanie, il part en guerre contre les Samaritains. L’année suivante, Jean Hyrcan entreprend des conquêtes enIdumée (au nord du Néguev), dont les habitants seront convertis de force au judaïsme. Scytopolis est conquise en 108a.C.n. et ses citoyens non juifs sont expulsés.Dans le vaste territoire contrôlé par les Hasmonéens qui ont su profiter de la faiblesse des Séleucides, la religion juive est loind’être majoritaire, si bien que le pays gouverné par Jean Hyrcan a plus les caractéristiques d’un royaume grec que celles d’un Etat juif.
Notre héroïne, Tamar/Levana serait née en -126. À la mort de Jean Hyrcan, une lutte dynastique s’élève entre ses deux fils Aristobule règne pendant un an, de -104 à -103, avec le titre de Basileus (roi) et conquiert la Galilée qu’il judaïse. L’Etat hasmonéen, devient alors un royaume hellénistique, avec une armée largement constituée de mercenaires, une monnaie imitée des Grecs, une cour, des palais. Aristobule est aussi appelé Philhellène, c’est-à-dire "ami des Grecs" ou "ami del’hellénisme". Malgré la présence du Temple, qui reste dominante, toute l’organisation du pouvoir civil et militaire sefait sur des modèles grecs. Cela choque profondément les Hassidim qui avaient soutenu les Maccabées dans leur révolte contre les Hellénistes. On assiste à une rupture de fait entre ces Hassidim que l’on nomme désormais les Pharisiens, et les Hasmonéens.Alexandre (Jonathan) Jannée [Yanaï], l’autre fils de Jean Hyrcan règne de -103 à -76. Il est proclamé "Grand Prêtre et Roi de Judée" (c’est le premier à se donner officiellement le titre de roi). Sous son règne l’opposition se cristallise entre les Pharisiens et le pouvoir monarchique. Le roi fait mettre à mortles rebelles juifs par centaines, et il utilise des soldats grecs pour combattre les Pharisiens. Il s’appuie désormais sur un autre parti juif, celui des Saducéens.Vers -75 le royaume hasmonéen atteint une étendue comparable à celle qu’aurait eue d’après la Bible le royaume de Salomon.
Salomé Alexandra (76-67), épouse d’Aristobule Ier puis d’Alexandre Jannée va lui succéder. -63 : Campagne de Pompée à Jérusalem. La Palestine devient province romaine.Hassidim, Pharisiens et Saducéens au 1er siècle a.C.n.
Les Hassidim
Ces "croyants", ou "hommes pieux" sont les membres d’un groupe dont l’origine est incertaine. Ils se distinguent par leur observance sans compromis de la loi juive. Ils sont animés d’une haine profonde envers l’esprit étranger, grec, et envers leurs frères juifsqui s’hellénisent. Ils exercent un pouvoir et une autoritéconsidérable parmi le peuple.
Les Hassidim se joignent à la révolte des Maccabées contre les Séleucides, pour imposer la liberté religieuse et combattre le paganisme. Dépourvus d’ambitions politiques, ils se détacheront des Maccabées dès qu’ils auront regagné leur liberté religieuse.Plus tard, ils tomberont en défaveur et se fondront dans le mouvement des Pharisiens.
Les Pharisiens
Le mot "pharisien", d’origine grecque, désigne ceux que l’on appelle en hébreu les Peroushim, "les séparés" ("séparés" de tousceux qui ne connaissent pas ou n'appliquent pas la Torah), mais cemot peut aussi signifier "les exégètes". En effet, ce sont des tenants de la loi orale, qui pensent que les décrets divins peuventêtre influencés par la liberté humaine. On compte parmi eux desmaîtres distingués, de grands interprètes de la Torah, par exempleShimon ben Shatah (le frère de la reine Salomé) et Yehouda ben Tabaï, cités dans le premier chapitre des Maximes des Pères. Ce sont les précurseurs du Talmud.
Ce sont pour la plupart des hommes d’affaires de classe moyenne, qui entretiennent des liens étroits avec le peuple, et qui jouissentdonc d’une plus grande considération que les Saducéens auprès des gens ordinaires. Ils représentent une minorité au Sanhédrîn (l’assemblée législative et le tribunal suprême d’Israël) et ils occupent un nombre minoritaire de sièges en tant que prêtres. Toutefois, il semble que ce sont eux qui l’emportent dans lesprises de décision du Sanhédrîn, parce qu’ils ont les faveurs du peuple.
Lorsque Jean Hyrcan accède au pouvoir, ils apparaissent comme un groupe déjà solidement organisé, qui revendique l’autonomie du champ religieux. Sans contester l’autorité politique de Hyrcan, ils lui demandent de renoncer à la charge de grand prêtre : en effet, sa mère avait été captive des Séleucides à Modiîn, et le filsd’une captive ne peut pas exercer cette fonction. Cela leur vaudrade lourdes persécutions, qui s’accroîtront encore sous le règne d’Alexandre Jannée. Pourtant, sur son lit de mort, celui-ci conseillera à son épouse Salomé de gouverner avec les Pharisiens car elle bénéficiera ainsi de l’appui du peuple.
Les Saducéens
Les Saducéens (Tsedoukim) se considèrent comme "lesdescendants de Tsadok", le premier grand prêtre qui officiait dansle Temple de Salomon Ils sont moins connus que les Pharisiens, etles informations à leur propos proviennent souvent de sources quileur sont hostiles. On dit qu’ils constituent une aristocratie minoritaire, à la ville comme au Temple où ils occupent desfonctions élevées, y compris celles de prêtre et de sacrificateur. On les décrit comme hautains, sectaires, et prêts à pactiser avecl’hellénisme qui règne à la cour, au profit de leurs intérêtspolitiques et économiques. Leurs adeptes se recrutent dans lesclasses fortunées de la société.
Les Saducéens sont partisans de la seule autorité de l’Écriture : tout ce qui saint est écrit, tout ce qui est écrit est saint, la loi orale n’est donc pas légitime. Ils reprochent aux Pharisiens d’observer des règles qui ne sont pas écrites dans les cinq livres de Moïse (la Torah), et réfutent leurs croyances dans la résurrection des corps, l’immortalité personnelle, l’existence des anges et des démons,parce que ces thèmes ne sont pas mentionnés par la Torah, maisseulement dans les livres suivants (les Prophètes et lesHagiographes).
Ce sont les Saducéens qui exercent les fonctions de grands prêtres jusqu’à -175. Mais c’est seulement sous le règne de Jean Hyrcan qu’ils se constituent en instance politique : lorsque le roi romptavec les Pharisiens, il se tourne vers le parti adverse, celui des Saducéens à qui il réserve la majorité des sièges au Sanhédrîn,bien que leur nombre soit inférieur à celui de leurs opposants.
Sources historiques
Cette période du 1er siècle avant notre ère est mal connue et peude sources en témoignent. Nous citerons les principales :
Livres des Maccabées
Le premier Livre des Maccabées relate leur histoire depuis le déclenchement de la révolte en Judée contre les souverains séleucides et jusqu’au règne de Jean Hyrcan. Il couvre une période d’environ quarante ans entre -175 et -135.
Cet ouvrage a été écrit par un juif anonyme, fervent partisan de la dynastie hasmonéenne. Il a été composé aux alentours de 100 a.C.n., après la mort de Simon. Il s’agit de la traduction en grec d’un ouvrage en hébreu, peut-être le Rouleau des Hasmonéens, dont Flavius Josèphe témoigne qu’il était lu à l’époque du second Temple par ses contemporains.
Les Livres des Maccabées, n’ont pas été inclus dans la Bible hébraïque, alors que, dans les canons chrétiens catholique et orthodoxe, ils font partie des livres deutérocanoniques.
Les écrits de Flavius Josèphe
Joseph fils de Matthatias le Prêtre "Yossef ben Matityahou HaCohen", plus connu sous son nom latin de Flavius Josèphe, est né à Jérusalem en 37/38 p.C.n et mort à Rome vers l’an 100. C’est un historiographe romain juif d’origine judéenne du Ier siècle. Son œuvre ‒ écrite en grec ‒ est la source principale, on peut mêmedire l’unique source sur l’histoire des derniers rois hasmonéens.
Dans son introduction à la Guerre des Juifs, commençant àAntiochus Epiphane, il donne un résumé assez court desévénements qui se sont déroulés jusqu’à l’intervention romaine. Mais le chapitre XIII de ses Antiquités judaïques présente un compte-rendu détaillé de cette période.
Le fait qu’il soit le seul auteur classique à retracer les règnes desrois hasmonéens, et ceci plus de cent ans après les événements évoqués, suscite des interrogations sur sa fiabilité auprès des historiens contemporains.
L’œuvre de Flavius Josèphe a été transmise par les Romains, puis par les chrétiens Les juifs eux-mêmes ne s’y sont intéressés qu’à partir du XVIe siècle. Elle ne sera traduite en hébreu qu’au XIXe siècle. Il est assez peu populaire chez les juifs qui le considèrent comme un traître parce qu’il a pris fait et cause pour les Romains contre son peuple et qu’il n’a pas protesté lors du siège deJérusalem. Cependant, l’archéologue Yigaël Yadin, qui a effectué les fouilles de Massada, disait de lui : "Flavius Josèphe fut un très mauvais juif, mais un très bon historien."
Les sources juives
On trouve dans le Talmud quelques échos du règne de ces rois. Mais ces textes ont été rédigés au 6e siècle de notre ère, ce qui met à nouveau en question leur exactitude historique.
Le massacre des Pharisiens est évoqué dans le Traité Kiddoushin [66a]. Le roi Yanaï [Jannée], a invité tous les sages d’Israël 1 à un festin.
"Or, il y avait là un homme railleur au cœur vil, nommé Eléazar ben Pouéra. Et Eléazar ben Pouéra dit au roi Yanaï :
‒ O roi Yanaï, les cœurs des Pharisiens sont tournés contre toi.
‒ Que dois-je faire ?
‒ Présente-toi à eux couronné du diadème de grand prêtre 2.Le roi Yanaï suivit ce conseil. Un vieillard, nommé Juda ben Gréda, se trouvait là. Il dit au roi :
‒ O roi Yanaï ! Que la couronne royale te suffise, laisse la couronne sacerdotale à la descendance d’Aaron.
Le bruit courait en effet que la mère du roi avait été captive à Modiîn 3.
On a fit une enquête, cette rumeur ne fut pas confirmée. Le roi, fort en colère, renvoya les sages d’Israël.
Eléazar ben Pouéra dit au roi :
‒ O roi Yanaï ! Te laisseras-tu juger comme un simple particulier, toi, qui es un roi et grand prêtre ?
‒ Que faire? demanda le roi.
‒ Si tu veux mon conseil, écrase-les.
‒ Mais qu’adviendra-t-il de la Torah ?
‒ Regarde, elle est écrite sur un rouleau et déposée dans un endroit visible. Rien n’empêche quiconque de l’étudier.
Selon Rabbi Nahman ben Isaac, c’est à ce moment même que le doute s’est installé dans l’esprit du roi. Il aurait dû répondre en effet : "cette solution est possible pour la Torah écrite, mais qu’adviendra-t-il de la Loi orale ? 4 " Alors Eléazar ben Pouéra fit éclater le mal. Tous les Sages d’Israël furent massacrés et le monde demeura dans la consternation jusqu’à la venue de Simon ben Shetah, qui rétablit l’autorité de la Torah dans sa gloire originelle. »
On lit aussi dans le Traité Berakhoth [48b] :
"Le roi Yanaï et sa reine mangeaient en tête à tête. Comme le roi avait tué tous les rabbis, ils n’avaient personne pour réciter la bénédiction de la fin du repas. Le roi dit à sa femme :
‒ Comment nous procurer quelqu’un qui dirait pour nous les grâces ?
‒ Jure-moi que si je te trouve quelqu’un, tu ne lui feras pas de mal.
Il le lui jura. Elle fit venir Simon ben Shatah, son frère. Le roi le fit asseoir entre eux :
‒ Vois comme nous te faisons honneur, lui dit-il.
‒ Ce n’est pas toi qui me fais honneur, dit Simon, c’est la Torah, car "Si tu l’exaltes elle t’élèvera, elle t’honorera, si tu l’embrasses" (Proverbes 4, 8).
‒ Tu vois comme ils respectent peu l’autorité royale, dit le roi à la reine.
Il lui servit un verre [de vin] pour la bénédiction. Le rabbi lui dit :
‒ Comment dois-je formuler cette action de grâces ? Dois-je dire : "Sois béni de ce que Yanaï et les siens ont mangé ce qui T’appartient ?"
Et il but la coupe. On lui en servit une autre et il récita la bénédiction. »
La traduction des textes du Talmud est extraite de l’ouvrage : Aggadoth du Talmud de Babylone - ‘Ein Yaakov, ed. Verdier coll. "Les Dix Paroles", 1983.
Les mois de l’année juive :
- Nissan : entre mars et avril
- Iyar : entre avril et mai
- Sivân : entre mai et juin
- Tamouz : entre juin et juillet
- Av : entre juillet août
- Eloul : entre août et septembre
- Tishri : entre septembre et octobre
- Heshvân : entre octobre et novembre
- Kislév : entre novembre et décembre
- Téveth : entre décembre et janvier
- Shevath : entre janvier et février
- Adar : entre février et mars
Repères Géographiques :
- Scytopolis : aujourd’hui Beith Shean
- Tsipori (Sephoris) : porte le même nom aujourd’hui
- Ptolemaïs : aujourd’hui Akko ou Saint-Jean d’Acre
- Le lac de la Harpe : le lac de Tibériade
- La mer de Sel : la Mer morte
Le royaume hasmonéen (en gris foncé) à l’époque d’Alexandre Jannée.
I
Bientôt je vais quitter ce monde. En cette fin d’après-midi, alors que le ciel transparent se pare déjà de teintes rosées, traversés par les nuages mauves, j’offre mon corps à la caresse du vent d’automne, et je dis merci.
Je remercie le Ciel de m’avoir offert une si belle et si longue vie. Merci de m’avoir fait vivre parmi ces femmes admirables, de m’avoir fait connaître des hommes qui m’ont comblée. Et merci, par-dessus tout pour la rencontre de Hadassa, ma mère spirituelle, qui a su avec une infinie bonté m’enseigner tout ce que je sais aujourd’hui.
Sur la Colline du Chêne. J’étais crainte et honorée de tous. On m’appelait "la bonne sorcière", car je savais guérir les maux les plus graves, je pouvais rendre au vieillard sa vigueur de jeune homme, et les habitants de la ville venaient me voir au grand jour pour recevoir mes soins. Les juifs nous pourchassaient et nous appelaient "les putains", mais ils se pressaient aux portes de notre Maison dès qu’ils avaient besoin d’aide.
Je présidais aux fêtes où les prêtresses s’unissaient à des hommes initiés, dans des étreintes savantes que je leur avais enseignées, et j’y prenais ma part. Je portais des robes de voile aux couleurs brillantes, des bijoux en or et en pierres précieuses ornaient mes poignets, mon cou, ma taille, mes chevilles, mon front. On me disait belle. Je n’avais pas la grâce des jeunes filles, mais je savais attirer à moi les hommages. La musique, les chants, les danses, le parfum des fleurs et de l’encens, tel était mon univers. Enchanté.
J’ignore ce qu’est devenue notre Maison depuis que je l’ai quittée brusquement, avec un grand chagrin. J’évoque le visage de mes compagnes, leurs sourires, leurs corps agiles, et je leursouhaite tout le bonheur possible là où elles se trouvent aujourd’hui.
Soudain le soleil se pare d’un rouge flamboyant et s’enfonce peu à peu dans l’horizon. Je vois se lever Noga, l’étoile de l’amour, bientôt rejointe par un mince croissant de lune qui l’entoure comme pour l’enlacer. Chaque soir, à cet instant, mes pensées se tournent vers l’homme que j’aime et qui reste niché dans mon cœur.
Es-tu encore vivant ? Es-tu plus heureux sans moi ? Dans la brise du soir je tends l’oreille de toutes mes forces pour entendre l’écho de ta voix. "Voici que vient voix de mon amant ! Le voici, il vient ! Il bondit sur les monts, il saute sur les collines" dit notre Cantique que j’ai chanté si souvent. Mais le souffle du vent ne m’apporte aucun message. Je dois me résigner : sur cette terre, nous ne nous rencontrerons plus.
Seuls mes souvenirs me permettent de sentir encore un peu ta présence. Mes doigts frôlent ta peau si pâle et les replis de ton corps comme si tu étais toujours à mes côtés. Mes seins se gonflent encore sous tes caresses, et malgré mon âge avancé, je sens une humidité sourdre de moi, comme si j’étais prête à t’accueillir.
C’est pour être encore avec toi que je vais écrire ces lignes. Un jour peut-être quelqu’un déterrera les jarres dans lesquelles j’enfouirai ces feuilles de papyrus, et saura que nous nous sommes aimés, et que si ma vie a connu bien des péripéties, c’est ta rencontre qui en fut le point culminant.
Pour toi je n’étais plus une prêtresse, plus une magicienne, j’étais simplement une femme nue. Et quand tes doigts, tes lèvres, parcouraient mon corps, j’oubliais tous les charmes dont je savais user avec d’autres hommes, je devenais une jeune vierge. Ce dépouillement auquel tu m’as contrainte m’a fait éprouver la vraie joie : celle qui unit le corps, le cœur et l’esprit. Je t’en remercie chaque jour.
Je sais que je te reverrai là où je vais aller, et que nous serons unis pour l’éternité, sous la protection d’Ashéra, la déesse heureuse, celle qui veut le bonheur de tous.
C’est la déesse qui m’a guidée pendant toute ma vie, avant même que je connaisse son existence. Elle a fait de moi, la fille du prêtre de Jérusalem, sa servante dans le sanctuaire que nous lui avons élevé. Elle m’a dévoilé les plaisirs charnels et ceux de l’amitié, et m’a enseigné la pratique de la médecine. A présent c’est elle qui va me conduire dans ce passage vers une autre lumière. A ses côtés je ne crains rien ; j’ai confiance.
II
Autrefois je ne m’appelais pas Levana, mais Tamar. Je suis née à Jérusalem au mois de Tamouz, au cœur de l’été. Mes chers parents m’ont donné le nom du fruit de la datte pour évoquer le verset du chant de David : "le sage grandira comme le dattier" 5. Pourtant ma mère avait hésité : pensant à Tamar, qui se prostituait au bord de la route pour séduire son beau-père, elle avait senti une ombre passer... Mais quel plus beau nom donner à une petite fille, que celui de ce fruit délicieux ?
Mon père était un prêtre du Temple, c’est-à-dire un descendant d’Aaron et de la tribu de Lévi, qui était habilité à procéder aux sacrifices, et qui siègeait au tribunal rabbinique qu’on appelle le Sanhédrîn. On l’appelait "Rabbi Yehuda HaCohen", et quand il traversait les rues de la cité, tous s’inclinaient devant lui, ce qui me rendait très fière.
Seule fille au milieu de cinq frères, j’étais très choyée par mes parents et l’on consacra le plus grand soin à mon éducation. Ma mère Miriam, une femme dont la piété n’empêchait pas la largesse de vues me fit enseigner le tissage, la musique, les onguents nécessaires aux soins corporels et au maquillage. Elle me transmit aussi les secrets permettant de guérir certains maux. Mon père m’enseigna l’hébreu et même un peu de grec, ce qui me permit d’assister aux leçons que recevaient mes frères, qui étudiaient nos textes sacrés et la loi d’Israël sous la férule d’un précepteur.
J’aimais plus que tout assister aux grandes fêtes du Temple, lorsque toute la ville se rendait en foule sur la montagne sainte, pour se joindre aux Juifs qui venaient en pèlerinage de tout le pays. Dans la cour des femmes, serrée contre ma mère qui me tenait fermement par la main dans la foule dense, je pouvais distinguer mon père au loin, vêtu de la toge blanche à la large ceinture de pourpre brodée d’or, et coiffé de sa tiare majestueuse,qui se tenait en haut des marches, pour présider aux cérémonies en compagnie de ses pairs.
Je ne comprenais pas pourquoi les femmes et les petites filles étaient reléguées à l’arrière, dans l’ombre des portiques. Moi aussi j’aurais voulu m’approcher de l’autel et du Saint des Saint, ce lieu sacré et un peu effrayant. Je m’imaginais officiant, vêtue des vêtements sacerdotaux. Mais quand je faisais part à ma mère de ces pensées, elle se contentait de sourire, comme si j’avais demandé la lune.
Ma fête préférée était celle de Soukoth, à l’automne, qui marque la fin des vendanges. Mes frères construisaient sur le toit de la maison une cabane au toit recouvert de branchages, dans laquelle la famille s’installait pendant huit jours. Nous étions réunis dans cet espace réduit, qui créait une chaude intimité. Les gens s’interpellaient d’un toit à l’autre, on pouvait humer les fumets de la nourriture des voisins, et on avait l’impression que toute la ville participait au même festin.
Bientôt venait la fête de la Libation d’eau, la plus belle réjouissance célébrée à Jérusalem. Le Temple, éclairé de milliers de torches, semblait vibrer au son de la musique et des chants. Des jongleurs émerveillaient la foule en lançant des flambeaux en l’air. Les pèlerins se pressaient sur l’autel pour l’arroser d’eau et de vin. Au début de la soirée, hommes et femmes dansaient séparément, mais, plus tard, ils se répandaient dans les rues et se rejoignaient tous en joyeuses farandoles, où jeunes gens et jeunes filles échangeaient des sourires et des plaisanteries. Ainsi s’exprimait l’espoir du peuple d’Israël pour que l’année à venir soit bénie par des pluies abondantes.
Pourtant, la ville n’avait pas toujours été aussi gaie. On rappelait souvent les abominations qui s’y étaient déroulées une quarantaine d’années avant ma naissance : la profanation du Temple par les soldats grecs, la statue de Zeus qu’ils avaient dressée devant le Sanctuaire, les porcs qu’ils avaient obligé les Juifs à sacrifier sur l’autel, les persécutions, les familles déchiréesentre ceux qui soutenaient les Grecs et ceux qui restaient fidèles aux Juifs. Et tous ces morts ! Le ruisseau qui coulait au pied du Temple ne charriait plus que du sang.
On m’avait raconté comment la désolation avait pris fin : la révolte courageuse des fils de Mathatias, la victoire remportée par Juda à Emmaüs, malgré le petit nombre de ses soldats et le manque d’entraînement de son armée. Et la reconquête du Temple, sa purification à laquelle avaient participé tous les Juifs de Jérusalem, la fête de l’inauguration. J’aimais écouter ma grand-mère, qui avait assisté à tous ces événements, me raconter comment on avait ramené le feu sur l’autel : lorsque Juda et ses hommes l’eurent rebâti, ils dressèrent un bûcher dessus. Puis ils égorgèrent un mouton et voulurent le poser sur le bûcher pour le calciner ainsi que le commandait la Loi. Toutefois le feu sacré avait disparu, et l’utilisation d’un feu profane était prohibée. Ils implorèrent Dieu, qui fit jaillir une flamme des pierres de l’autel, qui consuma le bois et le sacrifice qui était posé dessus. C’est le même feu qui était encore jalousement conservé dans le Temple.
Depuis cette grande victoire, on célébrait une seconde fête de Soukoth au mois de Kislev, au cœur de l’hiver. Les réjouissances étaient plus modérées, car à cette époque il faisait généralement très froid, et souvent, même, il neigeait. Mais tous les croyants se rendaient chaque jour au Temple pour y voir allumer le grand candélabre d’or à sept branches qui avait été restauré, à côté duquel on en allumait un autre, à huit branches, qui rappelait la guerre contre les Grecs et qui contribuait bravement à combattre l’obscurité si précoce en cette saison. On chantait sans fin des hymnes de louange.
Lorsque mon père rentrait le soir, après avoir accompli son service, j’entendais les conversations de mes parents et de leurs invités sans vraiment les comprendre. Mais je savais que mon père appartenait à une très ancienne lignée de prêtres, qui datait du retour du prophète Ezra sur la terre d’Israël. Il faisait partie d’un groupe qu’on appelait les hassidim, "les hommes pieux", qui avaient dû se défendre durement pour maintenir leur position dansl’enceinte sacrée avant qu’elle ne soit délivrée par le fils de Mathatias. A cette époque un grand nombre des servants pactisaient avec le pouvoir grec et persécutaient ceux qui voulaient maintenir notre tradition dans sa pureté. Mais les hassidim n’en avaient pas moins accueilli les nouveaux dirigeants hasmonéens avec une certaine appréhension. Bien sûr ils les remerciaient de les avoir délivrés de l’oppression de l’abominable Antiochus, mais ils espéraient que les nouveaux maîtres leur permettraient d’administrer le Temple de Jérusalem en toute liberté. Or il n’en fut rien : le roi Jean Hyrcan, se proclama grand prêtre, et ils durent accepter sa domination non seulement sur la Judée, mais aussi sur le Temple.
Mon père et ses amis étaient de grands savants, qui connaissaient à la perfection nos textes sacrés, et qui cherchaient à adapter les principes de notre Loi à la vie quotidienne. Pour cela ils se fondaient sur une doctrine qu’ils appelaient la "loi orale" : c’est-à-dire qu’ils débattaient entre eux de chaque cas précis qu’on leur soumettait pour en tirer des instructions qui auraient force de législation dans l’avenir. Ces débats étaient désapprouvés par le roi et ses partisans, qui estimaient qu’il fallait s’en tenir à la lettre du texte de la Torah, refusant toute innovation. A nouveau ils constituaient une minorité que le roi aurait bien voulu éliminer, mais il ne l’osait pas, craignant de provoquer une révolte du peuple. Il se contentait de les humilier à chaque occasion, par exemple en les empêchant de percevoir la dîme qui leur revenait.
Un jour j’osai demander à mon père ce que signifiait ce mot de "hassidim" par lequel il désignait son parti. Voici quelle fut sa réponse : "nous sommes emplis d’amour, de zèle pour notre culte et de respect pour notre Loi. Nous n’oublions jamais nos devoirs envers les pauvres et les opprimés, nous observons fidèlement la prière et le jeûne et c’est en cela que nous différons des prêtres qui font semblant d’être attachés fermement à la Torah, alors qu’en réalité ils ne cherchent que les honneurs et l’argent."
Malgré ces conflits permanents, le Temple était le centre de ma vie ; pour moi il était plus important que la maison paternelle. Aurais-je pu m’imaginer alors que la suite de mon existence se déroulerait dans un autre lieu sacré dont je serais à la fois la maîtresse et la prisonnière ?
***
Tout changea lorsque j’eus douze ans : une épidémie de peste s’abattit sur la ville et trois de mes frères furent frappés par la maladie. On m’envoya avec Johanan et Daniel, qui comme moi avaient échappé au fléau, au village de Motsa, à une journée de voyage de Jérusalem. C’était la première fois que je quittais les murs de la cité, et malgré mes craintes pour ceux qui étaient restés en ville, ce court voyage excita grandement ma curiosité : la route qui descendait vers le village suivait une pente vertigineuse, et j’avais peur que notre charrette, tirée par un âne, ne se renverse. J’admirais les hauts arbres qui bordaient la route et les champs qu’on apercevait çà et là au milieu du désert. Nous fûmes logés chez un paysan riche, que mon père avait beaucoup aidé par son influence, et nous participâmes aux travaux des champs et à la garde des moutons et des chèvres.
Parfois, nous passions la nuit dehors avec les troupeaux, et c’est là que je vis vraiment les étoiles pour la première fois. Un vieux berger me prit en amitié, et m’emmena la nuit au dehors pour m’apprendre à contempler le ciel. Il me parlait des deux grands luminaires, le soleil et la lune et m’expliquait qu’ils se rencontraient tous les mois, et qu’ils se faisaient face deux semaines plus tard dans une autre partie du ciel. Il me parlait des douze constellations dans lesquelles avaient lieu ces rencontres et ces éloignements, et m’expliquait que ces positions avaient une influence sur les êtres humains. Il m’apprit à distinguer les étoiles fixes et celles qui étaient mouvement, qu’on voyait le plus nettement car elles étaient les plus proches de la terre.
Elias le berger ne savait pas écrire, mais il m’aida à reproduire sur une pierre, avec un morceau de bois calciné, le dessin des astres que je contemplais pendant la nuit, afin de pouvoir les comparer et les étudier à loisir.
J’osai faire à ce bienveillant instructeur une confidence que personne n’avait encore entendue : il m’était arrivé plusieurs fois, dans le passé, de voir des événements qui s’étaient réalisés par la suite. Souvent, je pensais très fort à une personne, dont l’image s’imposait à moi, et je la rencontrais quelques heures plus tard. Lorsque je voyais une femme enceinte, je pouvais prédire à coup sûr si celle-ci portait une fille ou un garçon. De façon plus troublante, j’avais croisé parfois un homme ou une femme et j’avais vu se dérouler dans ma tête un accident, une maladie, un veuvage ; peu de temps après, l’événement entrevu se réalisait. Ce qui me chagrinait fort, c’est que je n’étais jamais parvenue de cette façon à prédire un événement heureux ; c’est pour cela que je ne voulais pas parler de cette faculté que je possédais, car je craignais d’être un oiseau de malheur.
Le vieux berger me regarda attentivement :
– Vois-tu aussi, de cette manière, des événements qui surviennent pour toi ou pour ta famille ?
– Oh non ! Grâce à Dieu, ce que je vois ne concerne que les étrangers.
– Ce que tu possèdes, c’est un grand don. Mais pour en faire une vraie bénédiction et pour qu’il te serve vraiment à aider autrui, tu dois cultiver en toi l’amour des humains. Ce n’est que si tu désires sincèrement qu’ils soient heureux que tu pourras deviner les bonnes choses qui leur arrivent. Et ainsi, tu parviendras aussi à voir l’avenir de ceux qui te sont proches.
Je n’oublierai jamais cette réponse d’Elias.
Quelques jours plus tard, pendant mon sommeil, je rêvai que j’étais redevenue une toute petite fille, presqu’un bébé, et ma mère me serrait dans ses bras en me couvrant de baisers. Mais ses caresses ne me procuraient aucun plaisir, je me sentais envahie au contraire d’une profonde tristesse. Je me tournai vers elle pour lui demander de me déposer à terre, mais son visage était voilé, je n’en distinguais pas les traits. Je me réveillai en pleurant, et gardai le cœur lourd toute la journée.
Le lendemain, un messager parvint à Motsa, porteur d’une terrible nouvelle : nos parents avaient succombé à l’épidémie, avec les trois jeunes fils qu’ils avaient gardé chez eux.
Le retour à Jérusalem fut lugubre : où étaient les crisd’étonnement et les joyeuses plaisanteries échangées dans la charrette à l’allée ? Nous ne pouvions retenir nos larmes.Qu’allions-nous devenir ? Johanan, mon grand frère, âgé de dix-sept ans, essayait de nous rassurer : "ne craignez rien, nous resterons toujours ensemble, je prendrai soin de vous." Nous faisions semblant de le croire, mais la stature du jeune homme, encore adolescent, était bien frêle en comparaison de celle de notre père aux larges épaules et au rire sonore. Et comment allions nous vivre ? Johanan logeait dans le Temple depuis plusieurs années pour y apprendre son rôle de prêtre ; il ne gagnait pas d’argent. Allions-nous être réduits à la mendicité ?
Jérusalem était plongée dans la désolation. L’épidémie semblait enrayée, mais les morts étaient nombreux, et les enterrements se succédaient sans interruption.
Les cérémonies funéraires furent brèves mais très solennelles : tous les prêtres du Temple y assistaient. Nous nous pressions l’un contre l’autre, épouvantés de voir les corps de nos parents enroulés dans un drap blanc, qu’on descendait en terre. Mes frères prononcèrent à grand peine la prière des morts. Dès qu’ils eurent terminé, les fossoyeurs et le public partirent aussitôt ensevelir d’autres cadavres. Nous sommes restés tous les trois en silence devant les tombes.
Mes frères et moi dûmes observer une semaine de deuil, assis à même le sol, alors que défilaient les amis et la famille qui rappelaient les mérites de notre père avec des sanglots dans la voix. J’eus alors le sentiment que je ne l’avais pas vraiment connu : je découvrais qu’il était très estimé pour sa science étendue, sonsens de la justice et son empressement à aider son prochain, toujours secondé silencieusement par notre mère. C’était comme si je perdais mes parents pour la seconde fois, en recevant ces témoignages, ce qui accentua ma douleur.
C’est alors qu’arriva l’oncle Mordekhaï, le frère de notre mère, qui venait de Scytopolis. C’était autrefois le mauvais sujet de la famille : séduit par la culture grecque il avait porté la robe courte des hellénisants et s’était adonné aux jeux du stade, oint et nu, avec les jeunes gens de la ville qui prétendaient au modernisme. Il avait mené joyeuse vie, participant à des banquets où l’on s’entretenait de philosophie tout en buvant et en lutinant les ribaudes. Il avait formé avec ses amis une faction qui cherchait à détrôner le grand-prêtre et à établir sur le pays un pouvoir politique qui ne dépendrait plus du Temple. Ils étaient plus actifs en paroles qu’en actes, mais leurs agissements étaient venus aux oreilles du roi, et il avait dû fuir la capitale. Il s’était réfugié à Scytopolis où il avait épousé Milca, la fille d’un riche propriétaire terrien, et avait fait fortune dans le commerce et l’agriculture. Devenu un citoyen honorable, père de six enfants, il avait pris des allures de patriarche, et s’était réconcilié avec sa famille.
Je n’avais jamais vu cet oncle mais j’avais souvent entendu parler de lui ; je savais qu’il était le frère préféré de ma mère, qui lui avait pardonné ses débauches. Malgré mon chagrin, je l’observai avec curiosité : grand, le verbe haut, l’allure assurée, il se tenait très droit malgré ses cheveux blancs, est m’impressionnait beaucoup. Mais il nous parlait avec bonté, et je me sentis un peu rassurée par sa présence.
Il fallait bien songer à l’avenir. L’oncle Mordekhaï avait déjà décidé pour nous : mes deux frères seraient élevés dans le Temple, où ils poursuivraient leur apprentissage de la prêtrise. Ils seraient placés sous la garde de parents de la famille paternelle, et à leur mariage, les biens de notre père leur seraient remis, à l’exception d’une somme réservée à ma dot. Toutefois il ne s’agissait pas d’unefortune importante, et ils devaient s’attendre à vivre avec simplicité.
"Quant à toi Tamar, l’oncle se tourna vers moi, tu vas venir à Scytopolis. Je t’adopte ; tu seras désormais l’une de mes enfants."
Je fondis en larmes et le suppliai de me permettre de rester à Jérusalem. Mais il m’expliqua que si je refusais de le suivre, je serais réduite à la condition d’une servante dans ma famille, que je ne pourrais épouser qu’un humble mari, et serai méprisée de tous. Au contraire, si j’écoutais sa proposition, je deviendrais l’égale de mes cousins, et pourrais jouir de l’opulence dans laquelle ils vivaient en Galilée.
Il nous raconta que sa ville devait son nom aux Scytes, des cavaliers nomades venus de Perse qui l’avaient fondée, mais qu’on y trouvait à présent des gens de nationalités différentes, et qu’il y régnait une animation et une liberté que l’on ne trouvait pas ailleurs dans le pays, ce qui y rendait la vie très agréable.
Je n’avais donc pas le choix. Et lorsque furent dites les prières suivant le premier mois du deuil, je rassemblai mes robes, les quelques bijoux hérités de ma mère, et mes frères me conduisirent au lieu de départ des caravanes, où selon les instructions de mon oncle, je cherchai Yéhiel, le chef du convoi. Les nombreux chameaux qui trépignaient dans l’attente du départ me semblaient immenses et plutôt effrayants. Mais c’est dans une litière menée par une mule que je fus installée. C’était la première fois de ma vie que j’étais seule, je n’avais pas eu la permission d’emmener ma servante avec moi ; mais je n’avais pas peur, je trouvais cette situation grisante.
Le voyage dura une longue semaine dans la chaleur écrasante du début de l’été, avec cette poussière sèche qui envahissait ma bouche sans relâche. Enfermée dans ma litière, car il ne convenait pas qu’une jeune fille fut exposée aux regards des voyageurs,je ne pus voir le chemin et je restai en proie à la solitude et à l’ennui. J’étais rongée par l’appréhension de ma nouvelle vie, et de plus, mon corps me faisait souffrir car j’avais accédé depuis peu de temps à ma nubilité, et chaque chaos de la charrette semblait me briser les os. Je m’étais pourvue de linges qui étaient bientôt maculés de sang et que j’allais enterrer aux étapes.J’avais très peur que ma tunique ne soit souillée et que mon impureté ne devienne visible à mes compagnons de route.
En arrivant devant les remparts de Scytopolis, je vis renaître ma bonne humeur. Du haut de la colline, la cité se déployait devant moi, plus petite que Jérusalem, mais d’une beauté harmonieuse. Les rues étaient très étroites comme dans ma ville natale, pour offrir une ombre salutaire aux maisons, mais de vastes carrefours s’ouvraient, avec des bâtiments majestueux, des temples me sembla-t-il. Une foule animée aux multiples costumes, dans lesquels on reconnaissait ceux des Romains, des Grecs, des Juifs, se côtoyaient dans une ambiance qui paraissait paisible et joyeuse. La curiosité me fit oublier ma fatigue, et m’aida à supporter cette lourde chaleur qui m’était inconnue, à peine rafraîchie par la brise du soir.
L’oncle était venu me chercher à l’arrivée de la caravane, et me conduisit sa demeure au milieu quartier juif de la ville. Je fis connaissance avec ma tante Milca et ses enfants qui m’accueillirent avec des manifestations de tendresse.
Je vécus deux années heureuses dans ma nouvelle famille. Mordekhaï possédait de vastes champs et de nombreux troupeaux, qui lui permettaient de faire vivre richement sa maisonnée. La demeure était vaste et peuplée de visiteurs à toute heure du jour, ce qui me donnait le sentiment de vivre dans une fête permanente.
Mes cousines et moi formions toutes trois une joyeuse bande, et je connaissais enfin le plaisir d’avoir des sœurs. L’une d’elle s’appelait Tamar, comme moi, elle était mon aînée de deux ans. La seconde, Ruth, était ma cadette de quelques mois. Nous recevions des leçons de musique, de danse, et d’hébreu, que mes cousines connaissaient mal car elles s’exprimaient toujours en langue araméenne. On nous initiait aussi à l’art du maquillage et del’habillement, ainsi qu’à la connaissance des bijoux qui nous intéressait plus que tout.
J’osai confier à mon oncle que j’avais été instruite dans la science des étoiles et je lui demandai s’il pourrait m’adresser à un maître qui pourrait me permettre de me perfectionner dans cette discipline. Il me fit rencontrer un vieil homme qu’on appelait le Chaldéen, qui parut bien étonné qu’on lui amène une enfant de mon âge et de mon sexe, mais je réussis à le convaincre que je possédais déjà quelques connaissances, et il accepta de m’instruire ; l’argent que lui versa mon oncle influença certainement sa décision. Il était difficile à comprendre parce qu’il bougonnait plus qu’il ne parlait, et l’araméen n’était certes pas sa langue maternelle. Mais je l’écoutais avec une attention si soutenue qu’il s’adoucit et me parla plus clairement.
Le Chaldéen m’apprit à distinguer les étoiles mouvantes : la plus chaude et la plus rapide, celle qui se tient au plus près du soleil, la plus brillante qui gouverne l’amour, celle qui se teinte de rouge et qui évoque la guerre, la plus large qui incarne la paix et la justice, et la plus lointaine et la plus sévère. "C’est l’étoile de votre Shabath, qui lui a donné son nom", me dit-il.
C’était quand ils étaient proches de la lune que l’on pouvait observer ces astres et calculer leur position par rapport au soleil. Pour cela il s’aidait un cercle de cuivre gradué, qu’il tenait à bout de bras. Il m’enseigna patiemment son usage, et je réussis à faire quelques progrès dans cette science, sans toutefois atteindre sa dextérité. Il m’apprit à observer le passage de ces astres mobiles sur les constellations fixes qui divisaient le ciel en douze périodes, et m’expliqua que chaque position avait une signification sur le destin des hommes.
Cette science me paraissait très difficile, mais je m’appliquai à suivre ses indications, préparant avant nos rencontres les questions que j’allais lui poser. Un jour, il plaça son instrument dans ma main en me disant : "il est à toi maintenant, tu devras apprendre seule à t’en servir. Je repars dans mon pays et je ne sais pas si jereviendrai ici de mon vivant." Ce fut pour moi comme un deuil ; il me restait tant à apprendre ! Et je doutais fort de pouvoir y parvenir en son absence.
Je ne parlais jamais du contenu de ces leçons avec les membres de ma famille : je craignais qu’ils ne m’accusent d’idolâtrie, et je n’étais pas loin de penser qu’ils auraient eu raison.
Nous les jeunes filles possédions notre propre chambre, avec une esclave préposée à notre toilette. Il y avait même un petit établissement de bains, garni d’une salle chaude et d’une salle fraîche. C’est là que nous nous prélassions chaque jour en fin d’après-midi, quand la chaleur au dehors devenait écrasante. Nous passions des heures à nous faire étriller et masser par les esclaves, en comparant nos seins qui poussaient de jour en jour, avec grands rires. C’est là que j’éprouvai mes premiers émois, en partageant la nudité de mes amies et en échangeant avec elles des caresses furtives.
Nous étions libres de sortir où nous le désirions, à condition d’être escortées par nos servantes. On nous permettait même de nous rendre avec une garde réduite aux sources du Sahné, une cascade qui alimentait un étang, dans un paysage verdoyant, à deux heures de route de la ville. Nous nous trempions avec de petits cris dans l’eau glacée qui nous faisait oublier la moiteur de notre cité, puis nous improvisions un repas à l’ombre des arbres touffus, cueillant des fleurs sauvages et tressant des couronnes.
Alors qu’à Jérusalem, les Juifs évitaient farouchement de fréquenter les Grecs et même ceux, parmi leurs frères, qui adoptaient les coutumes hellénistiques, ici, tous se côtoyaient, se recevaient les uns les autres, et assistaient ensemble aux jeux du cirque et aux représentations théâtrales. Chez mes parents, on ne m’aurait jamais autorisée à m’exposer ainsi dans la foule, mais à Scytopolis, il semblait que le plaisir fusse la préoccupation majeure des citoyens, commel’indiquait le Temple de Dionysos qui surplombait la ville. Mon oncle m’expliqua que c’était un dieu grec qui apportait la joie et délivrait des soucis ; c’était aussi le dieu de l’Extase, avec lequel les idolâtres communiquaient surtout par la boisson en s’enivrant !
Sur les places, on s’adonnait aux jeux de l’esprit, avec de longs débats philosophiques auxquels participaient les passants. On me parla aussi de banquets où les danseuses et joueuses de flûte exerçaient leur art jusqu’aux petites heures du matin, mais là, nous n’étions pas admises.
Il y avait aussi un lieu dont on ne parlait jamais et où l’on n’allait pas. Je n’en avais eu connaissance que par les ragots des servantes. Il se trouvait à l’extérieur des murailles, de l’autre côté de la haute colline qui surplombait la ville, et cela s’appelait, semblait-il "la Colline du Chêne" ; parfois, avec un ricanement, on l’appelait aussi "le Temple du Chêne vert". J’avais essayé plusieurs fois d’interroger mes cousines à ce sujet, mais elles avaient détourné la conversation en ricanant. Pourtant j’avais cru comprendre que mon oncle et ses fils se rendaient parfois là-bas, et que cela déplaisait à ma tante. Chaque fois qu’un homme risquait une plaisanterie à propos de ce lieu, on le faisait vivement taire si les enfants se trouvaient dans les parages.
Bien sûr, les fêtes imposées par la Torah réunissaient la population juive dans son temple, de dimensions modestes, et les prescriptions du Shabath étaient observées dans la maison de l’oncle Mordekhaï. Mais, même au cours de ces célébrations, les étrangers étaient les bienvenus s’ils consentaient à se plier aux coutumes de leur hôte.
Je voyais rarement mes cousins, qui menaient leurs vies indépendantes de jeunes hommes. Mais j’avais un faible pour l’aîné, Uriel, un beau garçon rompu aux jeux du stade, qui secondait efficacement son père dans la gestion de ses biens. J’avais remarqué que lorsqu’il passait près de moi ses joues rosissaient, et qu’il essayait de me frôler comme par inadvertance. Mais il ne m’adressait jamais la parole et semblait à la fois me rechercher et me fuir. Je me demandais si l’oncle avait remarqué ce manège, et j’espérais que cela lui donnerait l’idée de concevoir une union entre nous. La nuit, dans l’obscurité, je pensais à lui en caressant ma poitrine.
Toutefois je n’étais pas au centre des projets familiaux. Un jour que je revenais de l’agora, où je m’étais attardée au retour de la maison du Chaldéen pour assister aux joutes philosophiques, qui opposaient rhétoriciens juifs et grecs dans des dialogues complexes, ponctués par les applaudissements des spectateurs, ma tante m’accueillit avec des yeux brillants : "bonne nouvelle ! Ta cousine Tamar va se marier !" Ses parents étaient depuis un an en pourparlers avec une riche famille juive de Gérasa, dont l’un des fils était connu comme un homme sage et avisé. Dans la grande salle, ma cousine était assise parmi des femmes qui la couvraient de fleurs et lui offraient des gâteaux au miel, tout en lui susurrant à l’oreille des propos qui la faisaient rougir. Je me réjouissais du bonheur qui allait échoir à celle qui était devenue ma meilleure amie, mais quelle tristesse de penser que nous allions être séparées !
Les festivités durèrent huit jours, avec d’innombrables invités, une débauche de nourriture, de fleurs, de musique et de danse. Comme le voulait l’usage, on ne laissa pas seuls les jeunes mariés un seul instant après leur nuit de noces. Nous essayâmes, Ruth et moi, d’arracher à notre amie des confidences sur cette première rencontre intime, mais elle nous repoussa d’un sourire : elle était devenue autre, elle était devenue femme.
Au terme de la fête, ma cousine partit pour Tsipori avec sa belle-famille. C’était une grande ville située au nord, à ne journée de voyage de Scytopolis. Quelle impression de vide elle laissa derrière elle ! J’eus le sentiment que ce départ marquait la fin de mon enfance.
Je ne me trompais pas. Quelques jours plus tard, arriva un messager de Jérusalem, qui s’entretint longtemps avec Mordekhaï, avant que celui-ci ne me fasse appeler. L’homme apportait une missive de mon frère Johanan, qui était devenu un prêtre à part entière au Temple : avant leur mort, nos parents s’étaient engagés auprès d’une noble famille sacerdotale à unir leurs enfants. Leur fils Toubia, était adulte, il était devenu prêtre lui aussi, aux côtés de mes frères. Aujourd’hui il réclamait son dû : je devais retourner dans ma ville natale pour l’épouser.
J’étais amèrement déçue : je m’attendais à ce qu’on proclame mes fiançailles avec Uriel ! De plus, j’aimais ma nouvelle vie et me souciais peu de retourner vers la cité austère que j’avais quittée deux ans plus tôt. Mais puisque l’oncle avait donné son accord, il n’y avait plus rien à dire. Qui étais-je pour m’opposer à sa décision ? Ce qui me consola un peu, c’est que je connaissais Toubia qui avait fréquenté la maison familiale : c’était un jeune homme de belle allure, qui semblait doux et timide. J’espérais pouvoir être heureuse avec lui.
Avant mon départ, on organisa pour moi une fête, au cours de laquelle on m’offrit des bijoux, des robes, des manteaux, des ceintures, tout ce qui pouvait constituer une dot honorable. Mes parents adoptifs m’accompagnèrent au départ de la caravane, où je les embrassai longuement, mouillant leur visage de mes pleurs.
III
Mon mariage fut bien différent de celui de l’autre Tamar. Lorsque je vis qu’il allait être célébré le jour d’une éclipse solaire, je m’efforçai de convaincre la famille de mon fiancé de choisir une autre date, mais ce fut peine perdue : personne ne m’écoutait, je n’avais pas droit à la parole, si sur ce sujet, ni sur aucun autre.
Après les bénédictions sous le dais nuptial, on me conduisit dans une chambre obscure où se trouvaient des vêtements, des onguents, des parfums ; nulle servante pour me coiffer ou m’aider à m’habiller. Je m’apprêtai consciencieusement, espérant que lorsque mon mari viendrait me rejoindre, pour prendre notre premier repas en tête à tête, nous pourrions nous parler comme des amis. Mais il n’en fut rien : Toubia entra dans la pièce sans frapper, rouge, suant, il paraissait très nerveux. Sans mot dire, il souffla les chandelles, et m’étreignit jusqu’à m’étouffer. Il me jeta sur le lit et troussa ma robe avec tant de rudesse qu’il la déchira, ce qui le fit pester. Je me tenais allongée, très raide, ne sachant quelle contenance adopter, vaguement effrayée. Il se débarrassa rapidement de son caleçon, et après m’avoir distribué quelques baisers durs sur le cou et les joues, il me demanda d’écarter les jambes et il essaya d’entrer en moi. La douleur fut si vive que, n’osant protester, je me raidis plus encore, ce qui rendit la pénétration impossible. Toubia lui aussi paraissait de plus en plus tendu, et je craignis qu’il ne me frappe. Mais soudain, il eut un sursaut et poussa un cri bref. Je sentis une substance chaude et visqueuse se répandre sur mon ventre. Toubia alla s’asseoir au pied de la couche, muet, le dos courbé, remuant la tête d’un mouvement convulsif. Je ne comprenais rien à ce qui s’était passé. Même de loin, je sentais encore son odeur désagréable de mâle en sueur.
Nous sommes restés longtemps dans l’ombre, moi couchée, lui assis, dans un silence menaçant. Mais il se rapprocha de moi, me prit gentiment la main en murmurant : "nous n’avons pas réussi à nous unir cette, nuit, mais demain, quand tous les regards seront tournés sur nous, nous devrons prétendre que nous sommes heureux. En auras-tu la force ?" Je hochai gravement la tête, ce qui sembla lui plaire. Il me serra dans ses bras et ajouta : "tu es une gentille fille, tu as tout-de-suite plu à ma mère. Je suis certain que tu seras une bonne épouse."
– Et toi ? Seras-tu un bon mari ?
– Quelle question ! Un mari est toujours bon lorsque sa femme l’assiste et le sert fidèlement. N’oublie pas que ma tâche principale est le service du Temple. J’espère que tu sauras être l’épouse d’un cohen.
Nous n’osions pas appeler pour demander qu’on rallume les flambeaux, et nous avons soupé dans le noir, puis nous nous sommes endormis sans nous toucher.
Le lendemain matin, nous avons su faire bonne figure devant les allusions égrillardes des convives. Mais la suite des fêtes nuptiales fut lugubre. Hommes et femmes étaient strictement séparés et festoyaient dans des salles distinctes. Je devais me contenter d’entendre les chants et les rires des hommes de l’autre côté du mur, alors que pour ma part j’étais assise sur un fauteuil au centre d’un cercle de femmes qui caquetaient comme des poules, échangeant des commérages sur des personnes qui m’étaient inconnues, ce qui me semblait stupide et méchant. De plus, ma belle-mère Shoshana me lançait constamment des regards secs et soupçonneux. Toubia était son fils unique ; tous les autres étaient morts en bas âge, et elle se méfiait visiblement de cette étrangère qui allait prendre place dans sa maison.
Au terme de ces huit jours de "fêtes" dont je me serais bien passée, je me rendis pour la seconde fois au bain rituel, et ma vie d’épouse commença. Je passai mes journées avec Shoshana et je ne voyais mon mari que la nuit, lorsque celui-ci revenait du Temple. Nous parlions peu, car nos vies étaient trop différentes pour que nous ayons des sujets de conversation. Au bout de quelques jours il réussit à me pénétrer, en s’aidant de ses doigts, ce qui me fit souffrir plus encore que pendant la nuit de noces. Mais l’honneur était sauf, nous étions désormais un couple normal, même si nos rapprochements se résumaient à de brèves étreintes après lesquelles Toubia se retournait sur sa couche pour s’endormir en ronflant.
Ma belle-mère me manifestait peu de chaleur. Sous prétexte de me faire surveiller les servantes, elle m’imposait de partager leurs tâches : préparer les repas, ranger la maison, lessiver le linge.
Lorsque ces tâches étaient terminées, elle m’obligeait à me mettre au tissage, disant qu’il n’était pas convenable pour une jeune femme de rester oisive. Comme je ne l’avais jamais pratiqué auparavant, elle fit venir une vieille artisane qui m’enseigna comment tordre le fil de laine sur le fuseau, puis l’attacher sur le grand métier qui se tenait tout droit devant moi et qui m’effrayait un peu. Elle m’expliqua comment passer la navette entre les trames, en alternant le brun et le beige. Puis elle m’apprit à tisser le lin, ce qui était plus difficile, parce que le fil était mince, sec et coupant.
C’était ma belle-mère qui décidait quel serait mon ouvrage, et elle inspectait minutieusement l’avancement de mon travail. Je finis par éprouver de fortes douleurs dans les mains et dans les bras, mais elle se contenta de dire : "continue ainsi, tu vas t’habituer…"
En effet, je finis par prendre plaisir au tissage, qui me permettait de rester seule en silence. Je contemplais les fils qui s’entrecroisaient sur le métier et j’imaginais que c’étaient des personnages qui se rencontraient pour nouer des alliances, et former une société idéale.
Lorsque tombait la nuit on condescendait à allumer près de moi une chandelle pour que je puisse continuer mon ouvrage jusqu’au repas du soir.





























