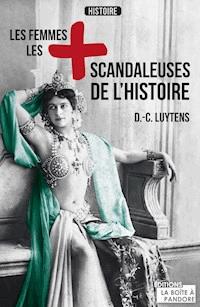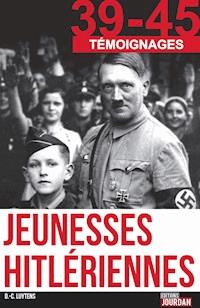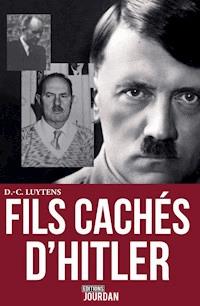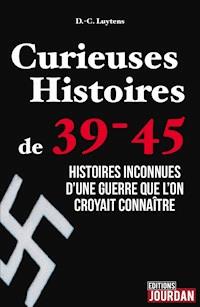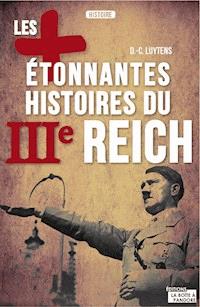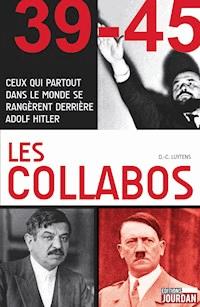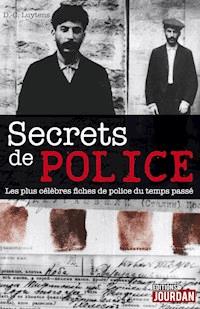
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jourdan
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La face cachée des célébrités !
Découvrez des dossiers, archives de filatures, rapports, enquêtes de la police et des services secrets qui, partout en Europe, surveillaient, filaient et enquêtaient sur des personnages comme Victor Hugo, Zola, Louise Michel, Théodore Herzel, Dumas, Pouchkine, Lénine, Trotski, Gorki, Gabriele d’Annunzio, Marx, Engel...
...mais aussi des personnnages dont la filature étonne : le roi d’Angleterre Édouard VII, Léopold II, Caroline de Brunswick, Louise de Saxe, et même la grande Sarah Bernhardt.
À partir d'archives de rapports d'enquêtes de la police et de services secrets, l'auteur retrace les filatures et surveillances de ces personnalités illustres.
EXTRAIT
Cocteau fut désintoxiqué à la clinique de Saint-Cloud de décembre 1928 à avril 1929.
« Les cliniques reçoivent des opiomanes. Il est rare qu’un opiomane cesse de fumer. Les gardes ne connaissent que les faux fumeurs, les fumeurs élégants, ceux qui combinent l’opium, l’alcool, les drogues, le décor (opium, alcool, ennemis mortels) ou ceux qui passent de la pipe à la seringue et de la morphine à l’héroïne. »
« De toutes les drogues, la morphine est la plus subtile. Les poumons absorbent sa fumée instantanément. L’effet d’une pipe est immédiat. Je parle pour les vrais fumeurs. Les amateurs ne sentent rien, attendent des rêves et risquent le mal de mer ; car l’efficacité de l’opium résulte d’un pacte. S’il nous enchante, nous ne pourrons plus le quitter... »
À PROPOS DE L'AUTEUR
Daniel-Charles Luytens est conférencier et un véritable chercheur de terrain. Les découvertes faites lors de ses investigations servent à alimenter ses nombreuses conférences. Devant le succès de celles-ci, il passe aujourd'hui à l'écriture.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Editions Jourdan
Paris
http://www.editionsjourdan.fr
Les Éditions Jourdan sont sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.
ISBN : 978-2-39009-169-1 – EAN : 9782390091691
Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.D.-C. Luytens
Secrets de
POLICES
Les plus célèbres fiches de police du temps passé
GABRIELE D’ANNUNZIO
En mai 1910, un Italien encore peu connu en France remplit sa fiche dans un hôtel parisien :
–d’Annunzio, Gabriele, né à Francavilla al Mare (Pescara) dans les Abruzzes, le 12 mars 1863, d’une famille d’armateurs.
Il est seul, quoique marié en 1883 à Maria Hardouin de Gallese, dont il est, depuis 1890, légalement séparé de corps et de biens, et qui, seule, s’occupe de leurs trois fils, âgés de 16, 15 et 13 ans.
D’Annunzio a dû quitter Florence presque à la sauvette. Depuis dix ans, après trois ans d’une théâtrale carrière parlementaire qui l’avait vu s’inscrire successivement à l’extrême droite, puis à l’extrême gauche, il résidait à Settignano, non loin de la villa Palmieri à Fiesole où Boccace écrivit le Décaméron.
D’Annunzio aimait la compagnie des lévriers et des étalons, les meubles précieux et les tableaux rares. Il se faisait servir par une domesticité innombrable dirigée par une belle femme, ce fut un temps la marquise la marquise Rudini. Et les droits d’auteur pourtant considérables de Gabriele le Magnifique n’y suffisent point.
Dans les premières années de Settignano, l’écrivain sort de chaque nouvelle liaison un roman brillant de tous les feux de son extravagance. Érotique jusqu’à la vulgarité, égocentrique jusqu’à la muflerie, inspiré jusqu’à la morbidité, ce touche-à-tout italianissime, poète, nouvelliste, romancier, dramaturge se fera bersagliere, aviateur et marin, mais tâtera aussi de la drogue et des plaisirs de l’homosexualité. Il est pourtant d’une étrange laideur, mais il est doué d’une conversation éblouissante.
La politique l’attire : en 1897, il est élu député d’Ortona. Il est déçu. Passant de l’extrême droite à l’extrême gauche, il déchante.
À Settignano, il écrivit beaucoup dans la dernière décennie du dix-neuvième siècle : L’innocent (1892), Le triomphe de la mort (1894), Les vierges (1896), Ville morte (1898), La Joconde (1899), La gloire (1899), le feu (1900).
Il reçoit un énorme courrier qu’il empile sans l’ouvrir, à l’exception des lettres comportant des chèques qu’il détecte au flair. En fait, les maîtresses abandonnées, les créanciers le traquent sans merci et de 1900 à 1910, ils tarissent son inspiration. Il signe quelques Nouvelles de Pescara (1902), des poésies et quelques tragédies bâclées, tandis que les huissiers le persécutent.
Mai 1910. Ces chacals vendent tout. Le mobilier, 500 000 francs or, les chevaux, les lévriers, et les voitures et la maison. Tout et pas assez. Gabriele en a appelé au Premier ministre Giolitti qui fait la sourde oreille. Indigné, le poète fuit son ingrate patrie. Les huissiers rapaces se partagent le moindre franc.
Le voici à Paris où il ne va pas tarder à refaire surface. Les traductions de ses œuvres, accueillies avec enthousiasme par le public français, le remettent en selle. Il s’installe dans un petit appartement de l’avenue Kléber qu’il quittera pour un hôtel particulier de la rue Geoffroy-l’Asnier.
Il a rencontré le producteur Gabriel Astruc, le maître des Saisons de Paris. Face de capucin gourmand, velu et grassouillet, mais couvert de bagues étincelantes, de pierres précieuses aux manchettes, un bracelet d’or, le directeur de la Société musicale et constructeur du Théâtre des Champs-Élysées a tout de suite compris que Gabriele a pressenti la fortune qu’il peut en extraire.
Le poète fantasque se languit aux pieds d’une capricieuse et adorable danseuse et mime russe, Ida Rubinstein. Astruc fait naître de ces amours sublimés Le martyre de saint Sébastien. Sur un argument et un texte de d’Annunzio que Ida enrobe d’un accent étrange, et une musique de Claude Debussy, celle-ci met en valeur sa plastique incomparable. Il en sera donné douze représentations au Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Scandale ! s’exclame la presse nationaliste, « chez le juif Astruc, la juive Rubinstein s’exhibe nue dans la scène du martyre » ! Nue, c’est-à-dire en maillot collant couleur chair. Et les camelots du Roi s’en vont troubler les spectacles qu’ils qualifient d’impies et d’outrageants pour la religion. Mais si le duc d’Orléans approuve cette réaction, Maurras est réservé et finalement cette agitation, au lieu de troubler l’ordre public, amplifie le succès de l’œuvre et permet aux inspecteurs de suivre le spectacle aux premiers rangs.
En fait, Maurras et ses amis ont senti chez l’Italien toute la parenté qui unit leurs idées, faste mis à part. D’Annunzio, grand seigneur, a loué une villa au Moulleau, près d’Arcachon, où, hors de la saison de Paris, il écrit de nouveaux chefs-d’œuvre, car il exalte la beauté, les ancêtres parfaits, la femme-déesse et la nature harmonieuse. On le reverra au Châtelet et à la Porte Saint-Martin en 1913.
Mais les créanciers ne comprennent rien aux exubérances de ce grand seigneur munificent. Ils réclament leur dû et décorent la villa d’Arcachon de leurs ordres de saisies. D’Annunzio, artiste tourmenté par ces diables, continue à créer, faisant de chaque nouvelle maîtresse une source d’inspiration
Il a vécu à Florence, avec la Duse qui le « hait et l’adore », des heures d’extase et il lui avait promis une tragédie conçue pour elle à l’image de leur amour éternel. Il s’agit de Le Triomphe de la Mort (1894) qu’il est allé offrir à la rivale de la Duse, Sarah Bernhardt, tandis qu’il entame à grand bruit une liaison tapageuse et perverse avec la comtesse de Gravina à laquelle il fera deux enfants. L’auteur dira : « Si j’avais pu supprimer les femmes de ma vie, au lieu de quarante livres, j’en aurais écrit cent ».
Apprenant la douleur de la Duse qui s’était réfugiée à Capri dans la solitude, soyons juste, une solitude confortable, il a écrit Le Feu (1900) où il révèle avec un luxe de détails la grande crainte de cette femme brûlée à son contact comme un papillon par la lumière : vieillir, ce qui l’avait entraînée à la frénésie. La Duse s’en remit difficilement tandis que d’Annunzio poursuivait ses excentricités.
En août 1914, il est à Paris et prend feu et flamme pour l’intervention italienne aux côtés des Alliés. Il va rester dans la capitale puisque Arcachon est devenu irrespirable avec cette meute de créanciers pleurnichards et procéduriers. On voit à Chantilly, à Soissons, le poète en uniforme de parade parlant aux étudiants et entre deux visites aux couturiers, il écrit pour la presse Hearst à 5000 francs par article, tous frais payés, plus secrétaire et domestique.
En avril 1915, il se décide à regagner l’Italie. Un adieu déchirant mais bref au secrétaire, à la femme de chambre et à la dernière maîtresse, Nathalie de Goloubeff, un bref passage à Arcachon pour éponger les ardoises, et il part.
Au fait, qui a payé pour Arcachon ? Les bailleurs de fonds interventionnistes, sans aucun doute. C’est la tête haute que d’Annunzio affronte, du balcon de l’Hôtel Régina, son ennemi Giolitti, leader neutraliste, « vieux bourreau lippu, dont les talons de fuyard connaissent le chemin de Berlin ».
Le poète parle du Capitule et traîne dans la boue l’odieux personnage que ne protège même pas une majorité parlementaire née de l’intrigue et de la prévarication. Des Savoie aux socialistes de Mussolini, la petite musique du ténor chaleureux et visionnaire entraîne toute l’Italie vers la guerre, et la victoire de 1918.
Blessé dans une chute d’avion, le lieutenant-colonel d’Annunzio perd l’œil droit. Il reste huit mois dans l’obscurité. À peine guéri, il repart bombarder Pola et les bouches de Cattaro, survole Vienne sur laquelle il jette des proclamations et risque sa vie cent fois.
D’Annunzio va combattre en sous-marin, en avion, voir sa tête mise à prix par les Autrichiens (20 000 couronnes) et blessé, devenu borgne par accident, il va tenter le 11 septembre 1919 de réaliser un rêve césarien d’empire méditerranéen. Conquérant de Fiume, contre et malgré l’affreux Giolitti qu’il pourfend de ses flèches oratoires, il voudrait de là, avec ses 287 volontaires, marcher sur Rome.
Sur Fiume, le poète casqué va régner quinze mois, mais il devra céder à son ami Mussolini les leviers de commande de la révolution nationaliste. Retiré à Gardone sur le lac de Garde, dans une propriété La Vittoriale, offerte par le Duce qui lui servira une généreuse rente viagère, devenu prince de Montenevoso, il finira sa vie en prince amoureux du baroque, partagé entre les joies courtes de la luxure que rappellent des sculptures équivoques, et les paradis artificiels ouverts par la cocaïne qui, comme l’alcool, accroît le désir en réduisant la puissance.
Dans le palais du Vittoriale, un croiseur de bataille est amarré dans les fleurs face au lac, des reliques, un avion et une extravagante collection de chapeaux Renaissance, des chinoiseries, encombrent les pièces garnies de lits et de bureaux majestueux où le poète travaillait.
Avait-il oublié ses rêves césariens ou voulait-il les chasser de son esprit ? En tout état de cause, il aimait toujours la Duse, décédée en 1924, mais ne se souciait ni de son épouse, ni de ses cinq enfants, exception faite de sa fille aînée mariée à un officier de marine.
Madame d’Annunzio sollicitait régulièrement de la police parisienne le renouvellement de sa carte d’identité. Comme d’Annunzio, né Rapagnetta, mais adopté par son oncle d’Annunzio auquel il devait son nom, Marie Hardouin devait son titre de son père normand qui avait épousé en premières noces la duchesse de Gallese, s’était fait naturaliser Italien et avait obtenu du pape Pie X le droit de porter le titre, tombé en déshérence, du duc de Gallese.
Marie de Gallese était domiciliée à Rome, piazza di Spagna, 81, mais elle vivait le plus souvent à Paris, dans un appartement de la rue Andrieux, 7, puis dans un autre de l’avenue de Villers 71, et enfin, à l’Hôtel de Calais, rue des Capucines, 5, dans une modeste chambre louée 18 francs par jour. Son frère était gentilhomme d’honneur de la reine-mère d’Italie et elle était bien notée par la police. Elle mourut oubliée en 1954.
HENRI ROCHEFORT
Fils du marquis Claude de Rochefort-Luçay, mais il ne signa que deux poèmes de son nom complet, Henri Rochefort (1830-1913) avait des idées politiques à revendre, de toutes couleurs, mais toujours extrémistes.
Ce colérique exubérant, dont les propos dépassent la pensée, va signer dix-neuf comédies et vaudevilles, douze romans et pamphlets et surtout 20 000 articles qui, dans la presse, jettent de l’huile sur le feu du jour.
Son affectivité l’a obligé à renoncer aux études de médecine et il passe dix ans, jusqu’en 1861, en qualité d’employé à l’Hôtel de ville de Paris. Pour meubler ses loisirs, il écrit des pièces de théâtre et fait de la critique dramatique dans Le Charivari, ce qui lui vaudra ses premiers duels avec le directeur du Gaulois, avec un officier espagnol, avec le prince Murât, avec Granier de Cassagnac, député du Gers.
Mais son arme de prédilection reste la plume. Avec la commandite de Villemessant, le patron du Figaro, il use des facultés accordées par la nouvelle loi sur la presse de 1868 pour lancer un pamphlet antibonapartiste virulent.
Lorsque sa vocation journalistique s’éveilla, ses violences contre l’Empire mirent en péril les journaux qui lui ouvrent leurs colonnes. Il continue la lutte et édite une feuille à lui : La Lanterne, dont le succès est foudroyant.
Succès triomphal : 50 000 exemplaires vendus. Le second exemplaire tire à 125 000. La police est sur les dents. Dès le n°3, la feuille est saisie. La police mobilise des journalistes à gages qui répondent aux injures de Rochefort par de basses calomnies, mais cela ne réduit pas la vente de La Lanterne.
Les deux premiers numéros furent édités à Bruxelles, à l’imprimerie Vanderauwera, à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité. Ces deux premiers numéros arrivèrent en France cachés à l’intérieur d’un buste en plâtre représentant Napoléon III. Les 11e et 13e numéros seront déférés à la justice pour offenses au chef de l’État.
Rochefort est alors condamné à treize mois de prison par défaut, car il n’a pas attendu la sentence. Il a gagné Bruxelles où il est reçu par un célèbre proscrit, Victor Hugo, qui loua pour lui une chambre à la rue de la Sablonnière 11, à proximité de son domicile. Rochefort y publiera les numéros 14 à 74 de son journal hebdomadaire à couverture rouge qui sera acheminé vers la France par les moyens les plus divers.
Qui paye les factures d’imprimerie ? Le mystère reste entier. Il n’est pas exclu que Bismarck ait été le mécène. Est-ce Victor Hugo qui finança Rochefort ? On sait que Victor Hugo était un homme riche mais avare. Il laissa à ses héritiers une fortune de sept millions. L’hospitalité qu’il aurait offerte à Rochefort, parrain de son petit-fils, lui aurait-elle évité de financer le journal ?
La Lanterne de Bruxelles est datée d’Aix-la-Chapelle, où Rochefort avait loué un meublé pour vingt-cinq francs par mois. Cela ne prouve rien, car il résida presque continuellement à Bruxelles, où furent imprimés tous les numéros de son journal.
Un duel qui fera la une de la presse l’oppose au prince Jérôme Bonaparte, un duelliste redoutable. Rochefort reçut dix centimètres de lame dans le derrière. Le combat a été arrêté.
Aux élections de 1869, Rochefort est élu député républicain de Paris. Le jour du vote, le 5 novembre, sûr de lui, il est dans le train Bruxelles-Paris. À Feignies, vers midi, un commissaire de police le met en état d’arrestation. Le soir, à vingt heures, lorsque le résultat est connu, il est libéré.
Rochefort entre au Corps législatif comme un boulet de canon au travers d’une vitre. Par ailleurs, il lance une Lanterne quotidienne : La Marseillaise,toujours aussi féroce. Tirage moyen de La Marseillaise, 50 000 exemplaires par jour. C’est le troisième tirage de Paris. La Marseillaise,rue de Flandre, 51, dans le 19e arrondissement, possédait une salle de fêtes et de banquets. Le 7 février 1870, Henri Rochefort y fut arrêté donnant une conférence sur Voltaire. Il s’ensuivit une émeute et des barricades à Belleville où 3000 manifestants furent arrêtés.
Provoqué par le prince Pierre Bonaparte, personnage douteux, « un gredin » dira Rochefort, il échappe de peu à l’assassinat dont sera victime son collaborateur, le journaliste Victor Noir. Les obsèques de celui-ci tournent à l’émeute et pour ces incitations au désordre, Rochefort va passer huit mois à la prison de Sainte-Pélagie, tandis que le prince assassin est acquitté.
Dès la chute de l’Empire, Rochefort quitte la prison pour devenir membre du gouvernement, sans portefeuille. Il s’attribue la présidence de la Commission, des barricades, s’efforçant de calmer ceux qu’il a enflammés de ses paroles incendiaires. Le 1er novembre, après s’être querellé avec ses collègues ministres, il refuse toute indemnité ministérielle, il démissionne et après trois mois de repos, lance un nouveau journal, Le Mot d’Ordre, qui paraîtra du 3 février au 20 mai 1871, 86 numéros malgré une suspension du 12 mars au 1er avril. Le 8 février, il est élu député de la Seine, en 6e position, après Blanc, Hugo, Garibaldi, Quinet et Gambetta. Dès le 1er mars, il démissionne pour protester contre l’abandon de l’Alsace-Lorraine.
Sans y prendre part personnellement, il soutient la commune, applaudit les destructions et insulte Thiers et les Versaillais. Mais surpris par les effets de ses articles, il décide, le 20 mai 1871, à la veille de la Semaine sanglante, de cesser la publication du Mot d’Ordre et de se mettre au vert en province.
Reconnu à Meaux, il est arrêté. Refusant l’aide des Allemands qui veulent le libérer, il est amené à Versailles. Le 20 septembre, le conseil de guerre le condamne à la déportation perpétuelle.
Après un temps passé à l’île d’Oléron, il est déporté à la Nouvelle-Calédonie, où, après quatre mois de navigation, il parvient le 10 décembre 1873. Trois mois plus tard, le 20 mars 1874, il s’évade. Par New York et Londres, il va s’installer à Genève d’où il adresse des billets toujours enflammés, contre Thiers et Mac Mahon cette fois, à des journaux de Paris, dont une nouvelle Lanterne. Émile Zola, alors journaliste, le juge ainsi dans le Figaro dans une chronique intitulée « Bêtise » :
« Rochefort est très brave, très loyal et tout le monde en convient. Mais il est aussi très nerveux et ses amis les plus dévoués ne cachent pas que sa tête tourne à tous les vents. C’est un tempérament d’écrivain, rien de plus ... »
Amnistié en 1880, Rochefort rentre à Paris où il fonde L’Intransigeant qu’il va diriger et animer pendant vingt-cinq ans. Il continue à défendre des idées d’extrême gauche, applaudissant les exploits des nihilistes russes, tournant en ridicule les hommes au pouvoir, Gambetta « l’opportuniste », Ferry « le Tonkinois ». Il a toujours avec lui les rieurs qui l’élisent député de Paris en 1885. À la Chambre, il présente une proposition d’amnistie générale et lorsque celle-ci est repoussée, il démissionne du Parlement.
D’abord adversaire du général Boulanger, il se laisse convaincre par ses amis radicaux, Clemenceau, Pelletan, et passe avec plume et journal dans le clan boulangiste. Il va combattre, toujours en extrémiste, pour le brave général qu’il va finalement suivre en exil, tandis que la Haute Cour le condamne à nouveau, par contumace, à la déportation perpétuelle. Rochefort se réfugiera à Bruxelles et louera une chambre au Central Hôtel à la place de la Bourse, puis il occupera l’immeuble de la rue Blanche, 32 à proximité de l’avenue Louise, dans le haut de la ville.
Amnistié une fois encore en 1895, le voici de nouveau à Paris, accueilli et fêté par ses amis radicaux et socialistes. Lorsqu’en 1896, éclate l’affaire Dreyfus, il prend parti pour le capitaine, puis, changeant d’avis, opte pour le parti antidreyfusard. Le voici donc nationaliste, l’internationaliste de 1869, selon une motivation que l’on ne s’explique pas, et il le restera jusqu’à sa mort, percevant même pour L’Intransigeant des subventions russes. À la sortie de L’Intransigeant, Rochefort dira « Un mot de moi et cent mille hommes descendent dans la rue pour aller où je leur dirai d’aller ».
Rochefort était riche, lorsque le 10 octobre 1907, il céda son journal à Léon Bailby ; il avait 77 ans, il continua à fouailler ses adversaires : devenu conservateur cocardier, il poursuivait ses blasphèmes et ses insultes à l’Église. Son cercueil fut suivi par Maurice Barrès et ses nouveaux amis, et les descendants des Communards qui étaient ses amis d’hier, et ils faillirent s’empoigner.
Décidément, Rochefort n’avait été, comme le prévoyait Zola, qu’un homme de lettres dont la plume avait souvent troublé l’ordre public. Un partisan de la « révolution permanente », étonné et parfois navré de la portée de ses bons mots. Au fond, totalement irresponsable.
L’AFFAIRE HUMBERT-CRAWFORD
Avec Thérèse Humbert, née Daurignac, nous entrons dans le monde fascinant des escrocs.
Cette habile menteuse qui vécut vingt-quatre ans d’avances sur un héritage hypothétique de cent millions de francs, n’eut de rapports avec la police qu’à partir du 21 décembre 1902, date à laquelle elle fut, avec son mari et ses frères, arrêtée par la police de Madrid à la demande du gouvernement français, puis transférée à Hendaye et livrée à ses accusateurs.
Au cours de son procès, en août 1903, le mécanisme de l’escroquerie fut découvert.
Suivant l’exemple de son père qui avait bâti un château sur ses espérances, elle se fit épouser en 1878 par un jeune avocat, Frédéric-Gaston Humbert, fils d’un sénateur et professeur de droit à Toulouse, en faisant miroiter les héritages qui allaient lui échoir.
Franche et déterminée, elle avait, dès après le mariage, annoncé à Frédéric qu’il s’agissait d’une mystification qui pouvait se poursuivre s’il devenait son complice et conseiller juridique. Le jeune homme - il avait dix-neuf ans, elle vingt et un - se laissa mener et consentit à jouer le rôle qu’elle lui proposait. Thérèse et Frédéric formaient un couple assez original.
Un certain Crawford d’Amérique a légué à Thérèse Humbert cent millions de francs qu’elle va récupérer à tout moment. Par chance, le beau-père, Gustave Humbert, est promu ministre de la Justice. Dès lors, c’est à qui prêtera au jeune couple Humbert cautionné par le ministre : 245 000 francs pour acheter un château près de Meulan, en 1882, 900 000 francs pour un autre domaine en 1883. Les Humbert changèrent leur niveau de vie.
Puis, alors que Gustave Humbert est devenu Président de la Cour des Comptes, Thérèse crée des titres de rente viagère qui, placés facilement, permettent la construction d’un hôtel particulier, 65 avenue de la Grande Armée à Paris.
Toutes ces opérations se déroulent dans une longue suite de réceptions mondaines qui rassurent les créanciers, et de débats juridiques et querelles de procédure, imaginées par Frédéric, qui montrent la bonne volonté des Humbert.
À l’hôtel des Humbert, les « Témoins de moralité » se succèdent dans les réceptions ininterrompues : Casimir Périer, Louis Barthou, Freycinet, Paul Deschanel qui flirte avec la sœur de l’hôtesse, et Thérèse rend service à tout le monde, même au préfet de police Lépine, Frédéric est même un temps député de Seine-et-Marne.
Quantité de noms illustres, des arts, des lettres, de la finance, du barreau, des membres de l’institut, des médecins célèbres, des sportsmen et des aventuriers étaient reçus à la table des Humbert et participaient aux dîners abondants arrosés de bons vins.
On ne s’ennuyait pas chez les Humbert. Déjà quelques coureurs de dot s’intéressant aux faits et gestes d’Ève Humbert, la fille du couple, qui, âgée de quatorze ans, en paraissait vingt.
Et puis, François-Ignace Mouthon, excellent journaliste et reporter sagace, publie dans Le Matin une série d’articles, lesquels tombèrent comme des coups de massue sur la tête des Humbert, des hommes de loi et des juges. Ce fut un beau tollé autour du journaliste. Mais sans se laisser démonter par les menaces d’un procès en diffamation que les Humbert agitaient au-dessus de sa tête, par les remontrances des amis des Humbert, par les objurgations de ses propres amis, Mouthon, secouant sa grosse tête blonde aux yeux bleus perspicaces et fins, continua sa campagne.
Parfois, les créanciers s’impatientent et s’interrogent, mais une habile manœuvre de procédure les rassure. La faillite de la banque Girard et Cie, à laquelle les Humbert devaient six millions, mit subitement fin à l’opération qui, sans cela, durerait encore. Le liquidateur de la faillite voulut vérifier l’authenticité de la créance, l’adresse des débiteurs, le contenu du coffre. Tout le mythe s’effondra et la veille de l’ouverture du coffre, les Humbert prirent le train de Madrid.
Le préfet de police Louis Lépine en personne dirigeait un service d’ordre rendu plus nécessaire par la présence des curieux. Il se montrait nerveux et de fort méchante humeur, car on avait publié qu’il comptait parmi les familiers de la maison et qu’il avait dîné maintes fois et passé maintes soirées chez les Humbert.
Chacun se sentant quelque peu compromis, y compris le ministre de la Justice de l’époque, ex-avocat de Thérèse Humbert, il faudra une interpellation au Parlement pour déclencher la demande d’extradition, six mois après leur fuite.
Un rire énorme secoua tout Paris à la publication sensationnelle. Dix-sept ans durant, Thérèse Humbert avait berné la justice. C’était de plus une comédienne étonnante, elle avait joué la comédie devant tout Paris. Cette femme avait du génie. Mais la police cherchait toujours les Humbert.
Des mois s’écoulèrent. Et puis, un beau matin, les Parisiens, ouvrant leur journal, lurent en tête cette nouvelle sensationnelle : « La Famille Humbert arrêtée à Madrid ».
Ramenés à Paris, une vraie foule se pressait à la Gare du Nord et les gardes civils, les agents de police français et espagnols avaient la plus grande peine à empêcher les curieux à se masser devant le wagon de première classe que l’on avait attaché au Sud-Express au seul usage des Humbert-Daurignac.
Thérèse jouait la victime que l’on mène au sacrifice. Elle faisait mille efforts pour ne pas trahir son émotion. Eve ne cachait pas ses larmes.
Ce fut du 8 au 22 août 1903 que se plaida le procès aux Assises de la Seine. Maître Labori affrontait l’avocat général Blondel et le juge Bonnet. Thérèse apparut au-dessous de son rôle et ne fut guère brillante.
Thérèse tenta, mais en vain, une dernière manœuvre : elle déclara que les cent millions existaient, n’étaient pas un mythe, mais ils avaient une origine honteuse, le Crawford testateur était en réalité de Régnier qui, en 1870, avait négocié, pour cette somme, entre Bazaine et Bismarck, la capitulation de Metz.
Thérèse et Frédéric Humbert écopèrent de cinq ans de prison. Elle purgea sa peine à la prison de Rennes et lorsqu’elle en sortit, les journalistes firent fête à la plus grande mystificatrice du siècle.
Le scandale avait été si large que M. Delarue, député, fut chargé de faire « rapport sur les complicités politiques dénoncées dans l’affaire Humbert ». (Chambre des Députés : annexe au procès-verbal du 28 juin 1905). Frédéric Humbert, oublié, mourut en 1930. Thérèse habitait alors - elle y demeurait encore en 1939 - un petit et modeste logement proche de l’Étoile. On la voyait parfois, dans un café des boulevards, siroter une grenadine.
LADY SCARLETT-ABINGER,VEUVE MARGUERITE STEINHEIL
Il arrive que le mensonge soit récompensé, ainsi que Lady Scarlett-Abinger, née Marguerite Japy, veuve Steinheil (1858-1954), semble l’avoir démontré.
Cette dame, fille d’un riche industriel lorrain, n’avait guère de chance. Elle avait eu une enfance heureuse auprès d’un père qui l’adorait. À dix-sept ans, elle avait fait son entrée dans le monde.
L’amour se présenta sous les traits d’un jeune lieutenant qu’elle fut obligée d’abandonner, ses parents le trouvant trop pauvre. Mais un homme d’un certain âge se senti attiré par les dix-sept ans de la jeune fille. Il avait la quarantaine, la barbe grisonnante, il était peintre et se nommait Adolphe Steinheil. Le mariage eut lieu et le ménage s’installa à Paris dans un petit hôtel, impasse Ronsin. Une fille, Marthe, naquit de cette union.
Marguerite Steinheil se fit connaître du tout-Paris. Elle reçut à sa table, de Zola à Coppée, de Massenet à Bonnat, et le ministre des Beaux-Arts, Félix Faure, la remarqua.
Le couple fut invité, dès le lendemain, à la table du ministre, et le mari, enfin estimé à sa juste valeur, se vit commander des travaux par l’État. La dame était également appréciée, de 5 à 7, et lorsque le ministre devint président de la République, elle dut, aux mêmes heures, accepter les hommages du Président.
Jusqu’au jour, le 16 février 1899, où, au cours d’un 5 à 7 à l’Élysée, le Président succomba subitement. Elle avait déjà gagné, par l’avenue de Marigny, la sortie de secours et ne fut point inquiétée.
Un soir de février 1899, Mme Steinheil sortit précipitamment de l’Élysée par la petite porte qu’elle empruntait depuis si longtemps, et, tandis qu’effondrée, la jeune femme sanglotait dans le fiacre qui la ramenait vers l’impasse Ronsin, la France apprenait avec surprise qu’elle venait subitement de perdre le sixième président de la troisième République. Il était mort subitement tandis qu’elle lui rendait visite.
C’était alors pour le ménage Steinheil la fin d’une période de prospérité. Afin de maintenir ce « salon », jusqu’à ce jour si brillamment fréquenté, pour continuer à mener cette vie large et facile, il fallait beaucoup d’argent, et, avec la mort du Président, le pactole des commandes officielles s’était brusquement tari. Sans compter que, les impressionnistes triomphant, l’élève de Meissonnier n’avait plus de vogue. Il fallait courir après le client, rechercher les commandes, « se débrouiller ».
L’État cessa ses commandes, à moins que d’autres peintres aient, grâce à leurs épouses, été consacrés par d’autres grands fonctionnaires ou mécènes. Mais l’histoire n’a pas retenu leurs noms.
Depuis les aveux complets des faussaires van Meegeren, Margutti et Keating, il semble que la fabrication des faux soit maintenant la meilleure industrie des artistes méconnus. Nul ne peut dire aujourd’hui par exemple combien Le Louvre compte de faux ! Au Salon International de la Police, on a pu dénombrer soixante et une Joconde, des dizaines de faux Dufy, Corot, Vermeer, etc. La profession de faussaire en tableaux est florissante. Sans parler des vols d’œuvres d’art.
Le lendemain des funérailles du Président, le mari de Marguerite reçut la visite d’un individu parlant avec un fort accent allemand, qui serait venu lui dire que, si on ne lui remettait pas les papiers importants provenant de Félix Faure ainsi que le collier offert à la jeune femme, de très graves ennuis lui surviendraient.
M. Steinheil ignorait tout de l’existence de ce mystérieux collier, mais, aux précisions qu’avait données l’étranger, Marguerite comprit qu’il ne s’agissait certainement pas d’un imposteur.
M. Steinheil, fort impressionné, suppliait sa femme de se dessaisir de tout ce qu’elle détenait, et il était troublé au point de menacer de se brûler la cervelle si elle s’y refusait. Pour éviter un si grand malheur, Marguerite désenfila les perles, en choisit une dizaine parmi les plus belles et remit les autres, environ cinq cents, à son mari, en lui disant d’en faire ce qu’il voudrait.
Le lendemain, l’Allemand était revenu. Après discussion, il avait bien voulu consentir à ce que Mme Steinheil conservât les dix perles, puis on le revit souvent impasse Ronsin, où il eut avec M. Steinheil de mystérieux conciliabules.
L’homme est revenu, il exige toutes les perles et en outre, les papiers de Félix Faure.
Marguerite refusa, tenant à conserver ses perles et préférant brûler ses papiers que de s’en défaire. Mais la situation, déjà fort tendue entre les époux, s’aggrava encore. M. Steinheil paraissait ne vouloir ou ne pouvoir rien refuser à l’Allemand.
Mme Steinheil s’imagina alors que le collier devait être un joyau royal qui, par une série d’événements extraordinaires, après avoir été volé, était tombé entre les mains du président Félix Faure. L’Allemand devait connaître tous ces détails et, véritable maître-chanteur, essayait de s’approprier ce bijou d’un estimable prix.
Se rendant compte de la détention des documents qu’elle gardait, pouvait susciter bien des envies et provoquer de réels dangers, se sentant en plein mystère, et, soupçonnant que les visites que recevait son mari avaient certains rapports avec les précieux Mémoires qu’elle tenait par-dessus tout à mettre à l’abri, Marguerite se décida à y substituer un paquet de vieux journaux, tandis qu’elle dissimulait les vrais papiers en lieu sûr. Le peintre Steinheil eut, pendant dix ans, la grande chance de pouvoir compter sur les talents invisibles de son épouse qui menait toujours grand train et assurait l’ordinaire du ménage grâce aux dons d’une providentielle « tante Lily » que l’artiste ne vit jamais et à laquelle Marguerite consacrait ses 5 à 7. Il s’agissait vraisemblablement d’un riche châtelain des Ardennes, M. Borderel, qui, veuf, était venu s’installer à Paris.
Impasse Ronsin, on avait improvisé un petit dîner servi par Rémy Couillard, le valet de chambre. Les Steinheil avaient invité pour cette occasion Mme Japy, la mère de Marguerite.
Le 31 mai 1908, le nom de Mme Steinheil fit soudain la manchette des journaux. Son mari, qui avait été l’ami (par alliance) du président Félix Faure, et sa mère avaient été assassinés dans la maison des Steinheil, 6 impasse Ronsin. Marguerite avait été ligotée sur son lit, mais légèrement.
Disons tout de suite que le procès, fort mondain, établit qu’elle n’était pas coupable, malgré ses innombrables affabulations, dénonciations et insinuations. Pourquoi l’un des juges, dont elle avait été la maîtresse, l’aurait-il confondue ? Elle avait tellement menti que les jurés ne purent conclure et que le public applaudit à son acquittement. Le crime avait été parfait.
Un spectateur, Robert Brooke Campbell, Lord Scarlett-Abinger, de dix ans plus jeune qu’elle, l’avait admirée, parmi beaucoup d’autres. Ses mensonges étaient tellement séduisants que nul ne résistait à l’attrait de cette femme exceptionnelle. Il l’épousa en 1917, huit ans après le procès. Il mourut en 1920, sans avoir rien regretté, semble-t-il. Elle lui survécut, avec dignité, jusqu’en 1954. Elle mourut à 86 ans, le 20 juillet 1954, sans livrer son secret.
LEIBA BRONSTEIN dit TROTZKi
La vie de Leiba Bronstein (1879-1940) fut tout entière marquée par la police.
Fils d’un paysan juif d’Ukraine, Bronstein était venu très tôt à la politique, à dix-huit ans. Étudiant en droit à Odessa, d’abord populiste, il s’initia au marxisme, puis adhéra à la social-démocratie. À dix-neuf ans, première arrestation, suivie de déportation en Sibérie d’où il s’évade en 1902, il gagne l’Autriche, puis l’Angleterre, avec un faux passeport au nom de Léon Trotzki qu’il gardera désormais.
Il se lie avec Lénine, collabore à l’Iskara, puis en 1903, au Congrès de Bruxelles. C’est à cette date que Trotzki est signalé au 11 rue de la Tulipe à Ixelles où il partageait l’appartement d’un écrivain soviétique, Ivan Popov. Cette commune était, avant 1914, le refuge des exilés communistes. C’est à l’hôtel-restaurant Le Coq d’Or, qui se situait au coin de l’impasse de la Grâce de Dieu, à la rue de Namur à Bruxelles, que les exilés soviétiques prenaient leurs repas et organisaient leurs meetings. Cette salle était toujours comble.
Trotzki entre dans l’opposition et pend parti pour les mencheviks. Rentré en Russie en 1905, il est président du Soviet de Saint-Pétersbourg. Après l’échec de l’action révolutionnaire, il est arrêté à nouveau et une fois encore déporté en Sibérie. De Tobolsk en 1907, il s’évade et gagne Vienne où il fonde la première Pravda et monte en 1912 une conférence d’unification soviétique, sans les bolcheviks. Ses activités turbulentes l’obligent à errer d’un pays à l’autre, de Constantinople à Zurich. En août 1914, la police le pointe à Genève et le 20 novembre, il part pour Paris où il va résider rue d’Odessa 28, puis, à dater de juin 1915, rue de l’Amiral Mouchez 23.
Le 17 septembre 1916, un arrêté signé Malvy ordonne son expulsion. Il demande de passer en Suisse, mais Berne refuse le visa. La police le conduit donc à la frontière espagnole. Le 31 octobre, à 21h50, entre deux inspecteurs, il prend le Paris-Irun et se rend à Cadix. Sa correspondance, des lettres à N. Sedov, 27 rue Oudry à Paris, est ouverte par les Espagnols et les Français, et le 11 novembre, il est incarcéré par la police espagnole. Il sera détenu jusqu’à son départ pour les États-Unis où il va passer les dernières semaines de 1916 et les premiers mois de 1917.
Lorsque la révolution se déclenche en Russie, au printemps de 1917, il s’embarque à bord d’un cargo norvégien, mais il est arrêté par la police britannique à l’escale de Halifax (Canada). Kerenski, nouveau chef du gouvernement russe, le fait relâcher pour lui permettre de venir à Pétersbourg faire contrepoids à Lénine. C’est une erreur d’appréciation.
Arrivé le 4 mai dans la capitale, Trotzki quitte les mencheviks et, en juillet, se rallie aux bolcheviks de Lénine. Il joue alors un rôle important que l’on sait dans les événements d’octobre, à la tête du Soviet de Pétrograd, puis comme commissaire du peuple à la guerre.
C’est grâce à lui, l’organisateur de l’armée rouge, que Lénine peut maîtriser la révolution, mais Trotzki ne veut point en rester là : il vise la révolution permanente et universelle et dès lors se sépare de son chef. Lors de la mort de Lénine, il est absent, absent de Moscou, et ne jouera aucun rôle dans la nomination de Staline au secrétariat du parti. Le nouveau leader tente d’abord de le reléguer à des postes secondaires, mais Trotzki ne se laisse pas isoler : il prend la tête de l’opposition de gauche et traite Staline de fossoyeur de la Révolution.
La tension croît entre les deux hommes et le 15 novembre 1927, Staline fait exclure Trotzki du parti. Le 16 janvier 1928, il est déporté par la Guépéou à Alma-Ata, au Kazakhstan. La lutte entre Staline et Trotzki avait commencé immédiatement après la mort le Lénine. En 1924, Trotzki, qui fut l’intime de Lénine et le plus brillant des membres de la Vieille Garde,s’attendait à être élu à la succession du grand leader.
Quand la maladie de Lénine empira à une vitesse surprenante, Staline en profita pour se servir au maximum de sa situation de secrétaire général afin de s’acquérir de plus en plus de puissance et s’en servir le plus efficacement possible. À la mort de Lénine, dès lors, le choix du successeur était inévitable.
Trotzki gardait de nombreux partisans et il reconnaît avoir, d’Alma-Ata, expédié 800 lettres politiques et 550 télégrammes entre avril et octobre 1928. Staline n’était nullement rassuré. N’osant pas faire exécuter son rival, il le fit, le 22 janvier, expulser de l’Union Soviétique, « pour organisation d’un parti antisoviétique illégal dont l’activité, ces derniers temps, vise à provoquer des manifestations antisoviétiques et à préparer une lutte armée contre le pouvoir soviétique »,et conduire à Constantinople où il parvint le 12 février.
Le Leader de la « Révolution permanente » s’installe peu après à Bùyùk Kada (ex-Prinkipo) dans l’archipel des îles des Princes, en mer de Marmara. Nous avons retrouvé la villa de son exil, c’est un magnifique lieu de villégiature, mais Trotzki le considère comme Napoléon l’île d’Elbe : le point de départ d’une reconquête.
Bûyiik Kada connaît le calme et la sérénité presque en permanence, mais lorsque les ouragans se déchaînent sur la Marmara, celle-ci devient, avec les Grands Lacs, la mer la plus dangereuse du monde et dans l’île, nous l’avons éprouvé, une charge d’électricité incite chaque habitant à refaire le monde. Trotzki, visionnaire exubérant, juif messianique, écrit beaucoup à Bùyùk Kada, où il va résider quatre ans. Dès juillet 1929, il sort le premier numéro d’un Bulletin de l’Opposition qui paraîtra jusqu’en juillet 1939. Il rédige des livres : La Révolution défigurée et L’Internationale communiste après Lénine, recueil de pièces qui condamne Staline, puis Ma Vie, en 1929 ; une Histoire de la Révolution russe, en plusieurs volumes, de 1930 à 1932 ; La Falsification stalinienne de l’histoire en 1932.
Par ailleurs, il établit des liaisons avec les groupes d’opposition communiste de tous les pays et notamment de France, d’Espagne et d’Union Soviétique.
Dans son travail, il est aidé par son fils Léon Sedov, né le 24 février 1906 à Saint-Pétersbourg, véritable chef d’état-major qui rassemble la documentation historique et se charge des travaux de copie des livres et de la correspondance.
Trotzki vit à Bùyùk Kada avec une compagne, Nathalie Ivanow, épouse Sedov, née à Rommy (Russie) le 26 août 1882. Elle avait connu Trotzki à Paris, en 1902, lorsqu’elle étudiait l’histoire de l’Art, en Sorbonne. En 1905, elle avait pris part, avec lui, aux événements de Saint-Pétersbourg, puis elle s’était mariée, cette même année, à Moscou avec un sieur Sedov, né en 1879 à Charnov (mariage blanc ?). Précisons que Trotzki s’était déjà marié en 1898 au cours de sa première déportation avec une militante, Alexandra Lvovna, et que, de sa première épouse, il avait eu deux filles, Zinaïda et Nina.
Tandis que Trotzki était incarcéré à la forteresse Pierre et Paul avant d’être déporté en Sibérie, Nathalie accoucha, en 1906, de Léon Sedov, puis partit, en 1907, pour Vienne où elle attendit l’arrivée de son amant. Un ami de Trotzki, le Roumain Rakovski, assure sa subsistance jusqu’en 1908. Nathalie accouche à Vienne, en 1908, d’un deuxième fils de Trotzki, Serge Sedov.
Nathalie Sedov et ses deux fils suivirent Trotzki sur les routes de l’exil jusqu’en 1917 et elle ne fit l’objet d’aucune observation particulière de la police. Lorsque Trotzki fut expulsé de France en 1916, à la demande des Russes, sa correspondance avec elle fut surveillée, puis sa compagne le rejoignit à Cadix pour gagner avec lui les États-Unis.