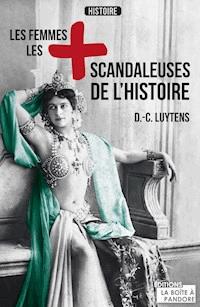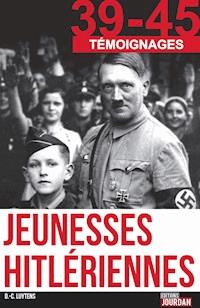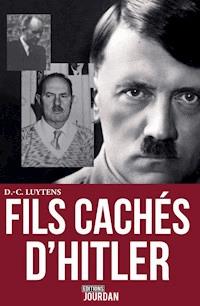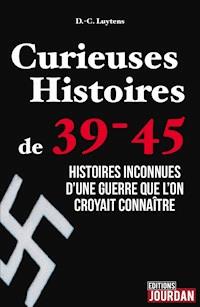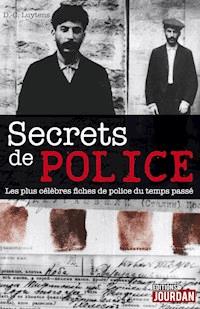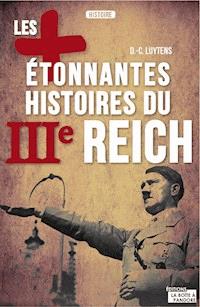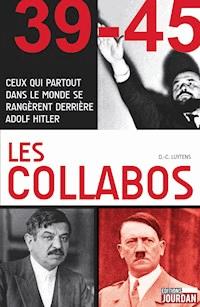Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jourdan
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Découvrez le quotidien de Wallons engagés dans les forces SS au travers de lettres, carnets de guerres et témoignages.
Il y a déjà eu des études, jamais de livre de témoignage. La division SS Wallonie était composée de volontaires wallons. Elle est issue de la Légion Wallonie, formée en août 1941 sous les auspices conjugués de Fernand Rouleau, bras droit de Léon Degrelle, de l’occupant et du mouvement rexiste de Léon Degrelle. Nous n’avons pas voulu ici faire une histoire de la Légion Wallonie mais nous intéresser à des témoignages bruts, à des lettres, à des carnets de guerre qui nous permettent, au-delà de l’histoire officielle, de comprendre ce qui a fait que ces jeunes soient partis mourir dans les steppes sibériennes pour un motif dévoyé. Ces écrits personnels sont éclairant. 60 ans plus tard rien ne permet encore d’excuser cette hécatombe.
Un ouvrage richement documenté pour comprendre l'engagement de ces Wallons.
EXTRAIT :
Livres, articles de presse, vidéos, émissions télévisées ; tout semblait avoir été archivé concernant la « Légion Wallonie », cette troupe de volontaires belges franco¬phones s’enrôlant aux côtés des armées du IIIe Reich national-socialiste durant la Seconde Guerre mondiale. Nombreux sont les historiens et journalistes qui consa¬crèrent leur talent à établir des ouvrages devenus réfé¬rences en la matière. Si la personnalité de son chef politique, Léon Degrelle, joua pour beaucoup à en réaliser la publicité, jamais, pourtant, un historien n’offrit la parole à ceux qui rejoignirent le chef de Rex et formèrent cette légion, c’est-à-dire aux volontaires eux-mêmes, à ces « mon¬sieur tout le monde » qui, un jour d’été 1941, déci-dèrent d’abandonner foyer et famille pour combattre dans les steppes de la Russie communiste bolchevik comme l’on disait à cette époque. Quoi de mieux, dès lors, que de laisser s’exprimer, les acteurs principaux, eux-mêmes témoins de ces heures tragiques de notre Histoire. Tâche difficile, car si en tant qu’historien, il nous faut impérativement rester objectif et impartial, le sujet lui reste sensible, délicat ou carrément tabou, et les propos, eux, peuvent encore choquer, même après le grand nombre d’années qui nous séparent de cette guerre…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SS wallons
Daniel-Charles Luytens
Avant-propos
Livres, articles de presse, vidéos, émissions télévisées ; tout semblait avoir été archivé concernant la « Légion Wallonie », cette troupe de volontaires belges francophones s’enrôlant aux côtés des armées du IIIe Reich national-socialiste durant la Seconde Guerre mondiale.
Nombreux sont les historiens et journalistes qui consacrèrent leur talent à établir des ouvrages devenus références en la matière.
Si la personnalité de son chef politique, Léon Degrelle, joua pour beaucoup à en réaliser la publicité, jamais, pourtant, un historien n’offrit la parole à ceux qui rejoignirent le chef de Rex et formèrent cette légion, c’est-à-dire aux volontaires eux-mêmes, à ces « monsieur tout le monde » qui, un jour d’été 1941, décidèrent d’abandonner foyer et famille pour combattre dans les steppes de la Russie communiste bolchevik comme l’on disait à cette époque.
Quoi de mieux, dès lors, que de laisser s’exprimer, les acteurs principaux, eux-mêmes témoins de ces heures tragiques de notre Histoire.
Tâche difficile, car si en tant qu’historien, il nous faut impérativement rester objectif et impartial, le sujet lui reste sensible, délicat ou carrément tabou, et les propos, eux, peuvent encore choquer, même après le grand nombre d’années qui nous séparent de cette guerre…
Le but était d’avoir les témoignages les plus vrais possible, sur ce que furent les actes, mais surtout sur ce qu’avaient été les mentalités, l’esprit de ceux à qui jamais on n’avait laissé la possibilité de s’expliquer. Un de nos témoins résume d’ailleurs très bien ce que nous avons voulu : « Je ne fais ici qu’exprimer ce que je ressentais à l’époque, ce que j’entendais autour de moi, en usant des mêmes mots et rien de plus ».
Historien averti, j’ai laissé de côté le débat idéologique pour ne m’attacher qu’au travail de collationnement des témoignages. Le but étant, les années ayant fait leur travail de pacification, de sauver ces récits de l’oubli et d’en permettre une première lecture au grand public.
Il me fallait rester neutre et ne tomber, ni dans le jugement hâtif les condamnant, ni dans la tentation de l’admiration spontanée du guerrier. Je ne suis ni juge, ni propagandiste ; je suis un historien qui ne fait que rapporter les documents propres à notre Histoire afin que les générations futures puissent comprendre et travailler sur un matériau de première source.
Sur base de cette neutralité affirmée, j’ai pu rencontrer encore quelques témoins, malgré la vieillesse qui les emporte au fur et à mesure que le temps s’écoule.
En tant qu’historien, quelle chance de pouvoir bénéficier, aujourd’hui en ce XXIe siècle débutant, de leurs relations, ce qui est rarement le cas en Histoire.
Tous ils m’ont remis leur témoignage ou ceux de leurs amis disparus, des documents relatant, non pas leur aventure, mais leur épopée comme ils tiennent tant à le préciser.
Ce qui m’a le plus marqué dans ce travail, c’est la mémoire de ces anciens soldats belges du camp des vaincus. Ces volontaires bien souvent à tort ou à raison restés fidèles à leur idéal, n’ont rien oublié, ne regrettent rien – si ce n’est d’avoir perdu la guerre – et relatent avec une surprenante précision leurs expériences.
Une dernière chose, il est surprenant de constater que certains de ces soldats ne sont ni nationaux-socialistes, ni même hitlériens, voire degrelliens. Certains en effet n’apprécient ni Adolf Hitler, ni Léon Degrelle, alors qu’ils ont pourtant prêté serment au premier et qu’ils ont suivi le second jusqu’au sacrifice de leur vie. Par contre, je ne prendrai aucun risque en affirmant que tous ces volontaires étaient – et le sont encore – farouchement anti-communistes et fascistes. Comme le cas qui m’a été rapporté par l’un de ces témoins qui avait connu un camarade qui s’engagea pour combattre aux côtés des troupes franquistes contre les « rouges », qui se réengagea en 1941 dans la « Légion Wallonie » pour les combattre en Russie et qui se réengagea une dernière fois à la Légion étrangère de l’armée française pour combattre une ultime fois les communistes en perdant la vie à Diên Biên Phu.
Daniel-Charles Luytens
Un légionnaire wallon posant auprès d’une famille russe devant son isba.
Premier contingent
« Notre seul crime avait été de combattre le bolchevisme »
L’un des chefs de groupe des pionniers, le sergent Raymond Lemaire est un des rares soldats de la Légion Wallonie qui fit partie du premier contingent du 8 août 1941 et qui en revint. Parti à la Légion Wallonie avec son père Marcel Lemaire, ancien combattant de 14-18, il sera promu candidat officier après la bataille de Tcherkassy1.
Mon nom est Raymond Lemaire et j’ai fait partie de la Légion Wallonie du 8 août 1941 au 5 mai 1945. Ce qui va suivre, c’est tout simplement le récit de ce que j’ai vécu pendant cette période de près de quatre ans. Il s’agit d’une période durant laquelle j’avais entre 18 et 23 ans.
A-t-on commis une erreur ? A-t-on fait une bêtise en ayant été idéaliste à 20 ans ? Faut-il en être honteux ? Le regretter ? Se le reprocher ? Certainement pas ! Car l’idéalisme de cet âge est une vertu. C’est courageux, c’est sincère, c’est propre. Et ceux qui se vantent en affirmant qu’on ne les a pas pris à ces attrape-nigauds ne réussissent aucunement à faire croire qu’à 20 ans ils avaient déjà de la tête, mais tout simplement qu’ils manquaient de cœur et, souvent, de courage.
Que les hommes posés ne soient plus prêts à recommencer ce qu’ils ont fait par idéal vingt-cinq ans plus tôt est tout à fait normal. Ce qui serait inadmissible, sous peine de se condamner soi-même, ce serait de regretter d’avoir agi de telle façon. On peut regretter d’avoir commis une faute, un crime ; on ne peut regretter d’avoir tenté une expérience au prix d’un sacrifice. Il est absolument impensable qu’un homme, de n’importe quel âge, puisse renier un idéal pour lequel il a été jusqu’à risquer sa vie pendant plusieurs années, comme l’ont fait quelques milliers de légionnaires wallons au Front de l’Est d’août 1941 à mai 1945, et dont 2 500 reposent entre le Caucase et la Mer Baltique. Renier, ce serait non seulement remettre en cause sa propre honnêteté et son propre courage ; ce serait, surtout, piétiner l’honneur de ceux qui ont payé de leur vie, ce serait un sacrilège.
Le vendredi 8 août 1941, défilaient à Bruxelles, mille hommes (la plupart en uniforme noir des « formations de combat » de Léon Degrelle) musique de la Wehrmacht en tête acclamés par quelques centaines de rexistes, de germanophiles et sympathisants et visiblement désapprouvés par les quelques centaines de Bruxellois se trouvant, par hasard, sur le parcours. C’était mille volontaires qui s’étaient engagés pour combattre le communisme sur le Front de l’Est ouvert le 22 juin précédent par l’attaque des troupes du IIIe Reich contre la Russie soviétique. C’était la légion belge « Wallonie », c’était les Bourguignons. Ces mille volontaires furent appelés, plus tard, « les volontaires du 8 août ».
« Bourguignons ». Quelles circonstances nous avaient fait adopter ce nom qui fut durant quatre ans le nom par lequel, entre nous, nous désignions un légionnaire wallon ?
Plusieurs fois, j’avais assisté à des conférences au cours desquelles Léon Degrelle parlait de l’Histoire de la Belgique. La période de cette Histoire qui l’emballait particulièrement était celle des Ducs de Bourgogne, Philippe Le Bon et Charles le Téméraire, qui, au XVe siècle, avaient régné sur nos provinces. Lorsque le 22 juin 1941 Léon Degrelle entrevit la possibilité pour la Belgique de faire valoir ses droits au sein d’une Europe nouvelle, il n’était pas éloigné de penser qu’il pouvait un jour être le maître d’un État dont les limites rappelleraient celles de nos provinces de l’époque glorieuse et fastueuse des Ducs de Bourgogne.
L’emblème de la Légion Wallonie fut la croix de Bourgogne rouge sur fond noir frangé d’or. Les drapeaux des compagnies portaient, sur fond blanc, la croix de Bourgogne rouge barrée d’un bras armé d’un glaive. C’est ainsi que si pour tous, à l’extérieur et officiellement, nous portions le nom de légionnaire wallon, à l’intérieur de la Légion nous nous étions donné le nom de « Bourguignon ».
Pour Léon Degrelle, être Belge, c’était être et voir grand. Pour lui, la Belgique, c’était la richesse, la grandeur des Ducs de Bourgogne, mais aussi, leur autorité et leur discipline.
Mon père et moi faisions partie de la Légion Wallonie. Qu’allions-nous donc faire dans cette galère ? Qui étions-nous pour prendre pareille option ?
Mon père, volontaire de guerre de 14-18, était ardent patriote. Petit employé chrétien, simple, d’une honnêteté déconcertante, dégoûté de la « politicaille » belge, il avait été séduit d’y donner un grand coup de balai. Rexiste, il suivait Léon Degrelle depuis 1936.
J’avais 18 ans. La politique ne m’intéressait pas particulièrement, mais élevé dans l’esprit de mon père, témoin de sa sincérité, je dois bien reconnaître que j’avais été enthousiasmé par quelques meetings tenus par Léon Degrelle au Palais des Sports et auxquels mon père m’avait fait assister.
J’avais, à ces occasions aussi, été fort impressionné par la haine de milliers de rouges qui attendaient à la sortie de ces réunions pour cracher leurs injures et leur imbécillité à des gens qui ne demandaient qu’à rentrer bien tranquillement chez eux.
Mon père et moi-même étions contre le régime politique en vigueur en Belgique. Mais ni mon père, ni moi n’étions nazis. Seulement, nous croyions à la victoire de l’Allemagne et il était dès lors tout à fait normal que notre conduite fût celle qu’elle a été puisqu’elle était le corollaire logique de notre conviction.
Après la bataille de Gromovaja-Balka, de ces mille premiers volontaires, ceux du 8 août, il n’en resterait plus que 301. Battus, humiliés, torturés, jamais les légionnaires n’ont été soumis. Leur mépris et leur dignité ont vaincu tous leurs ennemis. Aujourd’hui, ils n’ont toujours pas oublié la devise qui les a portés : « mon honneur est fidélité ».
Je vivrai cette aventure jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au 5 mai 1945, jour où le dernier groupe de combat de la Légion Wallonie engagé à l’Est se rendit aux troupes américaines quelques minutes avant leur jonction avec les Russes.
Pour la grosse majorité de nos compatriotes, nous étions des traîtres qui n’avaient d’autre but que de livrer la Belgique poings et mains liés à l’Allemagne nazie. Mais alors, pourquoi avoir attendu un an, pourquoi avoir attendu un événement auquel nous pouvions donner un autre sens que le but de la guerre menée par l’Allemagne ? Pourquoi aller risquer notre vie à des milliers de kilomètres de chez nous, alors qu’il aurait été bien plus simple et beaucoup moins dangereux pour chacun d’entre nous d’exercer au pays notre métier de valet et de traître ?
Il est bien facile d’entretenir dans l’esprit des anciens, et de faire naître dans celui des jeunes, l’idée que les légionnaires qui ont combattu volontairement en Russie l’ont fait en valets de l’Allemagne avec l’intention méchante de trahir la Belgique. Qu’on ne vienne pas dire qu’en combattant dans les rangs de l’armée allemande, on aidait les nazis à conquérir l’Europe pour imposer leur doctrine. Ce n’est pas sérieux. L’Allemagne a perdu la guerre avec nous, elle aurait pu très bien la gagner sans nous. De même, les Alliés auraient tout aussi bien pu remporter la victoire sans l’aide de la brigade Piron ou de la division Leclerc. Pas plus que le nôtre, le but de cette formation n’était d’aider l’une ou l’autre puissance à atteindre son objectif. Dans les deux cas, les mêmes moyens étaient utilisés dans un but identique, différait seul le point de vue initial.
Me voici donc à la Légion Wallonie. Le 8 août 1941, une cérémonie fut organisée au palais des Beaux Arts de Bruxelles. Notre train quitta la gare du Nord en fin d’après-midi et un ravitaillement nous fut offert en gare de Schaerbeek. Le voyage dura deux jours jusqu’au dimanche après-midi où nous sommes arrivés à Meseritz.
Les deux ou trois premiers jours furent réservés à l’installation et à la répartition dans sa forme définitive du bataillon d’infanterie que nous formions. Puis, ce furent les premières théories et prises de contact avec les instructeurs : les grades, les saluts, les présentations, le règlement d’ordre intérieur, etc.
Chacun, dès le début, avait reçu à la Légion Wallonie le grade qu’il avait eu à l’armée belge. Mon père était sous-officier. Comme je n’avais jamais été militaire, j’étais bien entendu simple soldat. Léon Degrelle, lui non plus, n’avait jamais été militaire. Mais il est bien certain qu’en tant que chef politique de la Légion, on lui avait proposé un grade et une fonction en dehors de la troupe. Il les refusa. La seule distinction qu’il accepta fut d’être promu soldat de 1re classe, ce qui ne changeait absolument rien à son état de recrue. Il était le premier mitrailleur du 1er groupe du 1er peloton de la 1re compagnie. À ce titre, Léon Degrelle fit avec tous les autres la période d’instruction dans les mêmes conditions.
J’étais mitrailleur au 1er peloton et dix fois j’ai partagé avec Léon Degrelle le même pain, la même botte de paille, les mêmes poux. Après, Léon Degrelle fut nommé adjudant, et rapidement devenu officier avec le titre de commandant de compagnie et, ensuite, de commandeur de la Légion Wallonie après la mort du commandeur Lippert à Tcherkassy. Même à ce moment-là, Léon Degrelle n’a prétendu être éloigné d’une quelconque action, d’aucune bataille, d’aucun danger auxquels participait la Légion Wallonie.
Lorsqu’en juin 1944, se trouvant à Paris, Léon Degrelle apprit qu’un groupe de légionnaires avait, à son insu, été engagé en Estonie, il devint fou furieux et transgressa purement et simplement l’interdiction de Hitler d’encore s’exposer au feu. Cet ordre, Léon Degrelle l’avait reçu lorsque, après Tcherkassy, il avait été fait par le Führer « Chevalier de l’ordre de la Croix de Fer ». Il partit de Paris au volant de sa voiture et rejoignit ses légionnaires. Lorsqu’il revint, Hitler ajouta les feuilles de chêne à sa croix de chevalier ; non pas parce qu’il s’appelait Léon Degrelle, mais bien parce qu’il les avait méritées. Lorsque Léon Degrelle s’enfuit en Espagne, dans les premiers jours de mai 1945, plus un seul légionnaire wallon ne se trouvait en ligne. Avec eux, il avait participé aux derniers combats livrés sur l’Oder.
Léon Degrelle, traître et criminel de guerre ? Parmi tous les chefs politiques de l’époque, de quelque nationalité qu’ils soient, qu’ils possèdent un certificat de civisme doublé d’un brevet d’enfant de la patrie, je voudrais bien qu’on m’en cite un seul qui eut une telle conduite, qui risqua sa vie autant de fois que Léon Degrelle alors que rien ne l’y obligeait. Au contraire, cela lui fut défendu à un moment donné et il ne tint aucun compte de cette interdiction. Que son ambition le poussât à prendre pareil risque pour « devenir quelqu’un » s’il en échappait… Allons donc ! En 1945, sur l’Oder, n’importe quel volontaire belge ou étranger, fut-il Léon Degrelle, savait très bien qu’aucune récompense, qu’aucun honneur n’attendait celui qui s’en tirerait ; que la seule chose à sauver, c’était sa vie. Alors pourquoi sommes-nous restés ? Pourquoi Léon Degrelle est-il resté ? Pour trahir la Belgique ? Il faut être stupide, borné, incurable pour croire pareille énormité. Quel intérêt pouvait nous valoir une telle conduite ? Car encore une fois, peut-on imaginer que des milliers d’hommes aillent volontairement risquer leur vie pendant des années pour le plaisir de trahir. Un traître ne risque rien, en tout cas pas sa vie.
Nous n’avons rien trahi. Jamais. Capables de trahir notre pays, nous nous serions bien empressés de trahir nos nouveaux maîtres dès que nous nous serions aperçus que la victoire changeait de camp. Mais l’idée ne nous a jamais effleurés. N’est-il pas étonnant de constater que, contre toute logique apparente, les effectifs de la Légion Wallonie augmentent au fur et à mesure que pâlit l’étoile de l’Allemagne ? Cette progression des effectifs de la Légion Wallonie, inversement proportionnelle aux succès de l’Allemagne sur tous les fronts, n’est-elle pas de nature à faire réfléchir un esprit de nature objectif ? N’est-ce pas une preuve que les légionnaires s’engageaient la conscience tranquille vis-à-vis de leur devoir patriotique ? Qu’ils l’auraient fait même si l’avenir de la Belgique n’avait pas été en jeu parce qu’ils estimaient, à juste titre, que dans ces circonstances le fait à considérer n’était pas l’aide infime apportée à l’Allemagne nazie, mais la contribution à une œuvre qui allait sauver l’Europe du plus grand malheur qui ne pouvait jamais lui arriver.
Soldat comme tous ses légionnaires, Léon Degrelle s’est conduit en soldat du premier au dernier jour. À ce titre, je l’admire et je le respecte. Et pourtant, il n’avait rien de militaire, car il était, selon le jargon du milieu, parfaitement incapable de conduire deux hommes au milieu d’une cour de ferme. La discipline prussienne lui donnait la colique et de plus, n’en déplaise à certains, il ne portait pas les Allemands dans son cœur. Qu’il se sentît le frère d’armes des soldats allemands, c’est certain ; qu’il admirât certains militaires ou hommes politiques allemands, cela ne faisait aucun doute, mais cela s’arrêtait là. Léon Degrelle n’avait rien d’un germanophile.
Que Léon Degrelle ait eu la prétention de devenir le chef n’était un secret pour personne, mais chef à part entière, pas sous-fifre. Et tant qu’on n’a rien eu d’autre à lui offrir – si on le lui a offert –, il n’a pas lâché, il a attendu le moment où il aurait eu l’occasion de conquérir le droit de discuter d’égal à égal avec le chef de l’État allemand si celui-ci, en gagnant la guerre, était appelé à organiser l’Europe. Cette occasion fut donnée à Léon Degrelle par la guerre germano-soviétique qu’il sentait probablement venir, car il fallait bien un jour en arriver là. Léon Degrelle sut en profiter, pas seulement en y envoyant les autres, mais en y allant lui-même.
Cette guerre contre la Russie bolchevique n’était-elle pas la meilleure des occasions qui ne se présenteraient jamais de conquérir un droit que personne n’avait jamais eu l’intention de nous reconnaître ? Pour nous, elle remplissait les conditions rêvées. N’y aurait-il jamais occasion plus belle, par sa logique et son opportunité, que la guerre contre l’URSS ? Logique, car nous étions farouchement anticommunistes. Opportune, car c’était le moyen de conquérir l’autorité nécessaire pour revendiquer une chose qu’il serait moralement impossible d’encore nous refuser, l’Allemagne contractait envers nous une dette de reconnaissance qu’elle serait obligée d’acquitter. Et ce moyen, nous l’utilisions allègrement, la conscience parfaitement tranquille. Une preuve de plus que nous ne nous sommes pas engagés comme valets de l’ennemi pour l’aider dans SA guerre, car nous aurions pu le faire un an plus tôt, sans donner aucune autre raison. Or, aucun légionnaire, dont la plupart avaient fait la campagne des dix-huit jours en 1940 et des dizaines la guerre de 1914-1918, n’aurait songé à s’engager dans l’armée allemande pour combattre la France ou l’Angleterre.
Pour nous, il s’agissait bien d’un moyen amplement justifié par la fin que nous nous proposions : la Belgique. Je défie quiconque de démontrer qu’il n’a été question d’autre chose, à aucun moment, en aucune circonstance. Voilà pourquoi des milliers de légionnaires ont combattu en Russie et voilà pourquoi 2 500 d’entre eux sont morts.
Si notre instruction s’est relativement passée gentiment pour nous, c’est parce que nos compagnies étaient composées d’hommes de tous âges et de toutes conditions. Il y avait, mélangés dans toutes les unités, des jeunes de 18 ans comme moi et des anciens de 14-18 de plus de 45 ans comme mon père. S’il eut été très facile de me mécaniser moralement et physiquement, il n’en eut pas été de même pour ceux de l’autre guerre qui, en plus de leur âge, portaient sur la tunique allemande une douzaine de décorations belges. Cela n’avait pas échappé aux responsables de notre instruction militaire.
J’ai fréquenté, par la suite, deux écoles : celle des pionniers d’assaut SS à Dresde et l’école d’officiers SS près de Prague où il n’y avait que des jeunes aptes à tout subir et où étaient appliquées, dans toutes leurs rigueurs, les méthodes d’instruction et de discipline prussiennes par des officiers et sous-officiers qui n’avaient à ménager ni âge, ni susceptibilité d’aucune sorte.
À Meseritz, du mois d’août à octobre 1941, je ne devais revoir une ville occidentale que dix mois plus tard. Dans un bataillon d’infanterie hippomobile comme le nôtre, les commandants de compagnies étaient montés ; c’est donc à cheval qu’ils marchaient en tête de leur compagnie.
Le 13 octobre 1941, j’ai fêté mon 19e anniversaire et le 17, c’était l’embarquement à Meseritz : 850 hommes et quatorze officiers constituaient la « Wallonische Infanterie-Bataillon 373 » qui, le 3 novembre 1941, débarquait à Dniépropétrovsk au terme d’un voyage de dix-sept jours au confort très relatif. Alors commença la marche vers l’Est.
La Légion Wallonie débarqua le 6 novembre 1941 à Petrosk, sur le Dniepr qui constituait la frontière entre deux mondes : sur la rive droite, le monde civilisé ; sur l’autre rive, le fléau bolchevique. Dans une brève allocution, Léon Degrelle tint à nous imprégner de la signification du geste que nous allions accomplir en franchissant ce pas par lequel nous allions entrer dans l’inconnu et être jetés dans une suite d’aventures inoubliables. En franchissant le pont au-dessus du Dniepr, nous sentions qu’un lien venait d’être tranché, un lien que tant de choses nous rattachaient à chez nous et auxquelles nous n’avions pas pensé jusqu’ici. Nous étions abandonnés par la grande majorité de nos compatriotes dont l’incompréhension générale nous avait mis au ban d’une société aux yeux de laquelle notre sacrifice était une trahison.
Rapidement, la nature russe — qui infligea plus d’une défaite aux agresseurs de la Russie — nous rappela à l’ordre. Très vite aussi, les routes plus ou moins pavées de la ville firent place aux pistes de la steppe que la pluie commençait à rendre spongieuse. En Russie, j’ai fait plus de deux mille kilomètres à pied, à toutes époques, à toutes saisons ; jamais, je n’ai fait une étape dans des conditions normales. Cela n’existe pas en Russie. Les difficultés se présentaient au fur et à mesure que la pluie détrempait la piste et la transformait en un bourbier indescriptible où soulever les pieds demandait un effort de plus en plus épuisant. Nous rencontrions également des difficultés avec notre charroi qui n’était pas bien équipé pour être déplacé dans cette boue. Cette image de la marche en avant d’une armée victorieuse était déjà celle de soldats en déroute. Que devait être une vraie retraite dans les mêmes conditions ?
La région était faiblement occupée, et déjà les partisans avaient fait leur apparition un peu partout sur les arrières du front. Dans la nuit, retentissait de temps à autre le bruit sourd d’une explosion. Un véhicule en panne ou embourbé, saboté par une ombre, une de ces ombres dont les nuits russes étaient toujours peuplées ; ombres actives, inlassables. La nuit, il fallait être fort prudent à l’arrière. Nous avons donc assuré des gardes, effectué des patrouilles. Le reste du temps, nous astiquions nos armes et nos uniformes qui en avaient bien besoin.
Ma compagnie, la 1re, fut détachée pour aller occuper un gros village à la lisière d’un bois. À nouveau, une étape de vingt-cinq kilomètres dans la boue. Nous allions, pour la première fois, loger chez l’habitant. L’isba russe est une construction dont le matériau principal est un aggloméré de bouse de vache et de boue séchée autour de torchis de tiges de maïs ou de tournesol.
Nous allions passer trois semaines dans ce village occupé déjà par une compagnie italienne. La forêt voisine est occupée par des partisans et notre tâche consistait à patrouiller nuit et jour. Vers le 15 novembre, la pluie cessa de tomber et fit place aux premières gelées. Les boues de l’automne ont stoppé net l’avance des troupes allemandes qui fonçaient vers l’Est. Où elles se trouvent, elles devront rester. Les problèmes de ravitaillement en vivres et en munitions sont énormes.
Malgré les campagnes foudroyantes de ces cinq premiers mois, les armées victorieuses ont subi de sérieuses pertes en hommes et en matériel. Les unités, qui combattent depuis le 22 juin, sont exténuées. Il faut réorganiser, boucher les trous, relever les troupes. Pour l’hiver qui s’annonce, il va falloir faire avec un minimum d’effectifs. Il ne s’agit pas d’un front continu, mais plutôt un front constitué de points d’appui isolés s’étalant du Donetz jusqu’à la mer d’Azov. Les points d’appui jalonnant cette ligne de front sont reliés entre eux par des patrouilles. Mais entre deux patrouilles, dix kilomètres séparent parfois deux de ces points.
Le 27 novembre 1941, la Légion Wallonie se remet en marche pour une série d’étapes de vingt-cinq à trente kilomètres. 1er décembre : la neige est tombée toute la nuit. Aucun des lieux communs, aucun cliché habituel pour décrire la nature sous la neige dans nos pays occidentaux n’est à l’échelle de la steppe russe. Hommes et bêtes fournissent des efforts considérables, une partie du charroi est abandonnée ; charroi qu’il faudra aller rechercher plus tard. La nuit tombe. Les 1re et 2e compagnies égarées s’arrêtent dans un petit village. Les hommes épuisés, vidés, sont incapables d’aller plus loin. Depuis le matin, pour toute nourriture, nous avons grignoté un morceau de pain gelé. Nous allons ainsi, dans des conditions épouvantables, couvrir une centaine de kilomètres pour aboutir, le 10 décembre, à Cherbinowka où nous établissons nos quartiers d’hiver. Au début janvier 1942, il fera - 48 °C.
Durant l’hiver 1941-1942, la Légion Wallonie avait déjà connu la possibilité de finir prématurément. Les difficultés éprouvées lors des étapes dans la neige avaient été terribles. Le charroi abandonné ne nous avait rejoints que peu de temps avant Noël. De nombreux malades avaient été évacués, réduisant notre effectif à environ 650 hommes. Nous traversions un hiver effroyable, sans le moindre équipement spécial. Physiquement, nous étions à bout ; moralement, presque. Il fallait surmonter une pareille crise en nous reprenant en main. Or, à ce moment-là, la Légion Wallonie souffrait de l’absence de commandeur digne de ce nom. Est arrivé alors de Bruxelles le capitaine breveté d’État-major Pierre Pauly, un Liégeois. Il nous tomba dessus, et l’expression est faible, le 30 décembre 1941. Avec le capitaine Pauly, étaient arrivés quelques dizaines de volontaires. Tout était rentré dans l’ordre. La situation générale était la suivante : 600 000 hommes tenaient le Front de l’Est sur 1 600 kilomètres à vol d’oiseau. Cherbinowka, occupée par la Légion Wallonie, constituait un point d’appui en retrait du front. La liaison est établie à 8 kilomètres au Nord-Est par une unité allemande et, à 15 kilomètres au Sud, par un corps italien.
Un corps italien occupait les points d’appui au sud de notre dispositif. Nous connaissions les Italiens pour les avoir rencontrés à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 1941. Tout de suite, la sympathie avait joué entre Latins. Cette fois-ci, c’était au Donetz en janvier 1942. Une nuit, dans un village occupé par les Italiens, une troupe de cosaques fit irruption dans le village non alerté et captura les Italiens jusqu’au dernier. Ils furent victimes d’une cruauté inouïe : par 40 °C sous zéro, ils furent dépouillés de leurs vêtements, conduits à la lisière du village et là, aspergés à grands coups de seaux d’eau glacée. Tous moururent ainsi.
Au plus fort de cet hiver 1941-1942 particulièrement rigoureux, les Russes sont passés à l’attaque par une puissante offensive et ont enfoncé le front défensif allemand dans la région d’Izium sur le Donetz. La légion Wallonie se remit en marche. Il est tombé pendant soixante heures une quantité de neige incroyable. En route, nous rencontrons d’autres groupes et, pour finir, la compagnie se reforme. Notre hantise était de nous faire surprendre par les troupes de cosaques très nombreuses.
En février 1942, la Légion Wallonie constitue avec la Légion Croate du colonel Markov une colonne toutes armes chargée du nettoyage de la région du Samara. Les bombardiers légers, de fabrication anglaise, ne nous épargneront pas. C’est au cours de l’une de leurs attaques qu’un traîneau, enlevé par ses chevaux effrayés, écrasa le pied de Léon Degrelle qui subit plusieurs fractures. Personne n’ayant été capable de le convaincre que sa place était à l’hôpital, Léon Degrelle déambulait tant bien que mal en traînant une énorme botte de plâtre. Pour rien au monde, il n’aurait abandonné sa place parmi nous. Jamais, depuis des mois, il n’avait accepté aucune faveur qui aurait pu le sortir du service auquel nous étions astreints.
Dans les plaines d’Ukraine, au plus fort de l’hiver, à la fin janvier début février, se produit un dégel subit. Pendant une semaine environ, la température remonte à 4 ou 5 °C. Comme le sol est recouvert d’une couche de neige d’un mètre, je vous laisse imaginer la patinoire que ce dégel occasionne, le sol restant gelé. Puis, en une nuit, tout est à nouveau gelé.
Le 17 février 1942, la Légion Wallonie prend position à Gromovaja-Balka, un petit village d’Ukraine. C’est la fin d’un calvaire, mais c’est le début d’un martyre. Cette fois, ça y était, la Légion Wallonie rentrait dans la danse. Depuis quelques semaines, les Russes profitaient de leur hiver pour contre-attaquer avec une vigueur dont on ne les aurait pas crus capables après les coups terribles que leur avaient portés les armées allemandes.
Nous entrâmes dans Gromovaja-Balka — qui porte bien son nom de « vallée du tonnerre » — sous une avalanche d’obus, à la suite des volontaires croates qui desservaient une batterie de canons antichars et qui allaient vivre, avec nous, l’enfer.
Je suivais le mouvement, un peu comme un somnambule. Je n’avais pas peur, du moins pas encore, parce que je n’avais pas encore réalisé complètement ce qui m’arrivait. Ce n’est qu’un peu plus tard, quand cela s’est calmé, que la colique m’a pris. Le but à atteindre était le haut du village. Il fallait avancer, et les sifflements des obus disparaissaient dans le fracas des explosions. Autour de cela, ce n’était que petits cratères gris dans la neige durcie par le gel. Des éclats volaient. J’étais arrêté, le dos courbé, un soldat croate s’était accroupi, la tête contre ma cuisse. L’obus est tombé à quelques mètres, j’ai vu l’éclat arriver et j’ai senti le choc. Le soldat croate était déjà mort, la tempe défoncée ; déjà, son sang gelait sur ma capote. Du sang, j’allais en voir couler par la suite, celui de dizaines de camarades. Celui de mon père, le mien aussi.
Nous nous sommes installés dans des isbas qui allaient devenir le tombeau de dizaines des nôtres. Pendant dix jours et dix nuits : attaques aériennes, obus, grenades, tirs des chars. Nous n’avions aucun répit. Il gelait à plus de 30 °C sous zéro. Tout le monde était malade : la dysenterie, les nerfs, la fièvre, le manque de sommeil. Les quelques instants de repos que nous laissait cette guerre inhumaine, nous les passions à chasser les centaines de poux qui nous dévoraient aux endroits les plus intimes du corps.
Mais aucune panique ne s’empare des Wallons. Beaucoup cependant font leurs premières armes, comme moi. Rien n’est classique dans cette guerre. Depuis quatre mois que je suis en campagne, aucune des situations dans lesquelles je me suis trouvé n’a ressemblé jusqu’ici aux exercices d’infanterie que j’avais suivis à l’instruction. Il n’y avait pas que les jeunes qui étaient désorientés. Mon père a fait 14 - 18, mis à part sa façon beaucoup plus raisonnable et très flegmatique de se comporter face au danger, il est tout aussi désorienté que moi par la forme que prennent les événements. Sur lui, et les autres anciens, les souffrances et la mort ont moins de prise. Ils les supportent avec plus de force morale, ils les côtoient avec plus de calme que nous, les jeunes.
Léon Degrelle, simple mitrailleur comme moi et toujours avec son pied cassé, nous remontait le moral. Il y avait des rexistes comme mon père et d’autres qui n’avaient jamais fait de politique. Quant à moi, depuis mes 18 ans en 1940, je faisais partie des formations de combat qui constituaient une sorte de milice qui assurait la garde de Léon Degrelle lors des réunions. J’avais donc été, à plusieurs reprises, au contact de Léon Degrelle et ce qui m’avait le plus frappé chez lui c’était une certaine audace et beaucoup de désinvolture. Lors de ces premiers tragiques combats, cette audace et cette désinvolture se transformèrent en beaucoup de courage et un calme certain qui ne manquaient pas d’impressionner chacun. C’est là que j’ai commencé à admirer cet homme que, plus tard, j’allais respecter pour ses actions personnelles au sein de notre Légion. Que Léon Degrelle soit considéré en Belgique comme un criminel de guerre me laisse parfaitement indifférent, tout d’abord parce que cela reste à prouver, et ensuite parce que je ne peux m’empêcher de respecter quelqu’un qui risquait plus de cent fois sa vie avec le seul souci de donner l’exemple alors que sa position lui permettait d’observer tout ça de très loin et de laisser aux autres le soin de tirer les marrons du feu à son avantage. Certains ont reproché à Léon Degrelle d’être responsable de la mort de plus de 2 000 de ceux qu’il avait envoyés au Front de l’Est. Non seulement Léon Degrelle n’a jamais forcé personne à y aller, mais n’a accepté que des volontaires. Il était très rare que Léon Degrelle soit absent lors de la mort de ses soldats. S’il a survécu à la guerre, Léon Degrelle ne le doit uniquement qu’à sa chance, une chance effrontée qui a fait de ses six blessures, six égratignures insignifiantes.
Si nous avions été du côté du vainqueur, rentrés en Belgique plus tard, je ne pense pas que j’aurais été rexiste. Pour moi, un parti politique, c’est un parti de trop. J’ignore si Léon Degrelle politicien aurait été meilleur ou plus capable qu’un autre. Ce qui est certain, c’est que je continue à respecter Léon Degrelle au même titre que tous mes autres compagnons d’armes. Celui qui ne peut pas comprendre cela n’a jamais vu mourir autour de lui des hommes qui se battaient pour la même idée, quelle qu’elle fût.
Depuis notre arrivée à Gromovaja-Balka, notre effectif a été réduit à environ 500 hommes. Nous faisions partie d’un groupe de combat placé sous le commandement du lieutenant-colonel Tröger et comprenant : la Légion Wallonie, un bataillon d’infanterie croate, un bataillon de la SS-Germania, une compagnie d’éclaireurs sur traîneau, un groupe d’artillerie allemand, douze chars et une escadrille de Stukas.
Notre mission à Gromovaja-Balka était de tenir vingt minutes, vingt minutes qui devaient permettre l’intervention des chars et des Stukas. C’était le 28 février 1942, il faisait 30 °C sous zéro. Arrivèrent au pas de charge, deux régiments d’infanterie russes représentant environ 2 000 hommes soutenus par quatorze chars T34. Nous étions 500, traîtres, qui portaient sur le bras l’écusson belge, des traîtres qui allaient monter à l’assaut en chantant « Vers l’avenir » et « la Brabançonne », des traîtres qui allaient mourir en criant « Vive la Belgique ». L’artillerie russe nous pilonnait. Mais nous allons faire subir aux rouges un vrai massacre. Nos blessés, que nous n’avons pas eu le temps d’évacuer, sont abattus d’une balle dans la tête par les rouges.
Nous quittons le secteur, pour le reconquérir par la suite après un enfer indescriptible rempli d’images inoubliables comme celle de mon père gisant dans une isba. Il avait la jambe gauche traversée par une balle, le bras gauche traversé par une balle, le poignet droit fracassé par un éclat d’obus de char. Il y avait déjà plus de deux heures qu’il était là, pansé provisoirement. Je l’ai laissé pour reprendre le combat. Nous nous battions depuis 6 heures du matin et un contre quatre. Alors que nous devions tenir vingt minutes, nous avons combattu jusqu’à 16 heures pour obtenir la victoire grâce à l’appui des Stukas et des chars venus nous sauver à partir de 15 heures, in extremis. Nous comptions 180 morts et 110 blessés. L’attaque des rouges, dont les moyens mis en œuvre témoignaient de l’importance, devait ouvrir la route du Dniepr au Petrosk — parachevant ainsi l’offensive russe d’hiver — avait échoué. Sur le plan tactique, les rouges s’étaient heurtés à une poignée de fous intraitables qui avaient réussi l’impossible à force de volonté, de courage et d’héroïsme. 500 légionnaires wallons avaient empêché 2 000 rouges, appuyés de quatorze chars, de faire sauter le dernier obstacle qui leur barrait la route. Les Russes comptaient 750 morts. Quant à mon père, je l’ai transporté moi-même, dans des circonstances plus que cocasses, vers l’arrière ; blessé sévèrement, mais sauvé.
La crise qui avait menacé l’existence même de la Légion Wallonie était conjurée. Deux facteurs ont eu sur cette guérison une influence primordiale : la prise de commandement du capitaine Pauly et la bataille de Gromovaja-Balka. Nous étions 350 légionnaires. Le 10 mars 1942, un contingent de 450 volontaires avait quitté Bruxelles et allait nous rejoindre quelques semaines plus tard. En attendant, nous nous réorganisons. Le capitaine Pauly a dû nous quitter pour raison de santé.
L’arrivée du contingent du 10 mars était pour tout le monde un événement. Les nouveaux nous apportaient des nouvelles du pays, de nos parents, de nos amis. Nous avions, nous les anciens, à mettre les bleus au fait des astuces du métier de guerrier qu’ils ne connaissaient encore qu’en théorie. Nous, les anciens, car cela faisait plus de huit mois que nous étions en Russie et, déjà, nous avions derrière nous deux campagnes. Leur apprentissage à eux, contrairement à nous, se fera sur des centaines de kilomètres de pistes poussiéreuses, sous un soleil de plomb, et ils se retrouveront entre 500 et 1 000 mètres d’altitude pour se battre sous 50 °C de chaleur.
Grâce à ces nouveaux effectifs, la Légion Wallonie reprend figure d’unité complète avec 850 hommes. Le bataillon reconstitué et réorganisé reçoit un nouveau commandeur : le premier lieutenant d’artillerie Lucien Lippert. Il a 30 ans. Très rapidement, il va devenir l’exemple et l’idole des légionnaires, aimé de tous, connaissant chacun, il s’imposera par ses capacités, son courage, sa maturité, son intégrité et sa simplicité. Rarement, un homme aussi jeune a réuni autant de qualités qui sont indispensables à un bon chef.
Le 15 juillet 1942, j’ai reçu un congé de convalescence de 15 jours et je retrouvais ma mère inquiète pour deux, mon père étant toujours hospitalisé avant d’obtenir une place au sein d’un service administratif de la Légion Wallonie à Bruxelles suite à ses blessures et à ses états de service. Je retournerai au front alors que mes camarades marchaient depuis quarante jours. La Légion Wallonie commence une marche en montagne dès l’aube du 19 août. Nous traversâmes la forêt caucasienne sur 15 kilomètres.
Je vous ai parlé de l’arrivée, au mois de juin, d’un contingent de volontaires qui comprenait 150 membres des jeunesses rexistes, avec à leur tête leur prévôt : John Hagemans. J’ai eu alors une admiration pour cet homme qui, comme Léon Degrelle, n’avait aucune obligation, même morale, de montrer l’exemple. Non seulement ces deux hommes ont voulu prendre tous les risques, mais encore sans bénéficier du moindre avantage, sans accepter le moindre régime de faveur qui leur était proposé. John Hagemans avait été sergent dans l’armée belge. Il l’était à la Légion Wallonie et, à ce titre, commandait le groupe de commandement de la 3e compagnie.
Le 26 août, alors que le groupe était réuni à couvert pour recevoir les instructions de son chef, une grenade russe explose au milieu d’eux. Il y eut plusieurs tués parmi lesquels le sergent John Hagemans. Le prévôt des jeunesses rexistes était mort parce qu’il avait estimé que, pour être honnête avec lui-même, sa place était au milieu de ses 150 jeunes garçons.
Nous passerons dix jours à Tchériakov, repoussant à plusieurs reprises les Russes. 90 % de nos pertes étaient principalement dues aux lance-grenades russes. Nous avons eu 15 tués et une soixantaine de blessés. Le 28 août 1942, nous sommes relevés par deux compagnies motorisées de la division SS-Wiking. J’ai bien failli avaler ma casquette de travers en reconnaissant Roger Van Hout, un camarade du collège Saint-Pierre à Uccle, dont le frère Jean-Pierre était dans la même classe que moi et également engagé volontaire dans la SS-Wiking. Nous nous étions vus pour la dernière fois le 9 mai 1940 (veille du déclenchement de la guerre en Belgique) sans nous douter le moins du monde que nous nous retrouverions deux ans et demi plus tard à 3 000 kilomètres de chez nous et dans ces circonstances. La guerre nous avait séparés et voici qu’elle nous réunissait de la manière la plus inattendue. Mais nos destinées et nos unités ne suivirent pas le même chemin.
Les Russes étaient beaucoup plus proches de la nature que nous. Leurs besoins en confort et en nourriture étaient bien moins exigeants que les nôtres. Aussi, il leur était possible de mieux s’identifier que nous dans la forêt caucasienne, de mieux s’y dissimuler, d’y trouver des moyens de subsistance que nous abandonnions, nous, dédaigneusement aux cochons sauvages. Nous, qui ne pouvions nous déplacer sans brosse à dents ou sans rasoir et qui grognions lorsque le ravitaillement ou la cuisine n’étaient pas ce qu’ils auraient dû être, avions à faire à des brutes qui, pour la plupart, n’avaient jamais vu de brosse à dents, qui se rasaient avec un tesson de bouteille et qui, avec une carotte de maïs dans la besace, bougeaient 72 heures dans la forêt sans ressentir le moins du monde l’inconfort de la situation.
Avec une centaine de camarades, je recevrai la médaille de l’Est. Cette décoration était décernée à ceux qui avaient fait toute la campagne d’hiver 1941-1942 dans une unité combattante. Ce ruban nous rappellera les souffrances, sans nom, endurées pendant des mois dans des températures qui n’avaient plus été connues depuis soixante ans dans les plaines d’Ukraine et du Donetz et qui atteignaient leur point final par la bataille de Gromovaja-Balka. Sept mois s’étaient écoulés depuis et, quelques semaines avant de recevoir cette décoration, nous avions connu une température de 59 °C, ce qui faisait sur un écart de six mois une différence de 107 °C entre les deux températures extrêmes. En y pensant, nous ne pouvions que nous étonner des capacités physiques de l’être humain.
Les mois qui vont suivre verront la métamorphose complète de notre Légion qui deviendra la plus belle unité qu’elle n’ait jamais été : la 5e Brigade d’assaut motorisée SS Wallonie qui prendra part à la terrible campagne de Tcherkassy.
Je serai nommé caporal-chef et recevrai mes épaulettes de sous-officier. Entre-temps, nous avons reçu la visite imprévue du Reichsführer-SS Heinrich Himmler et le 3 juin 1943, toutes les Légions étrangères considérées comme formations politiques passent en bloc sous la direction administrative des Waffen-SS. Le commandeur Lippert est promu major. Nous voilà donc SS. Cette circonstance n’a pas manqué d’aggraver notre cas dans l’esprit de la grande majorité de la masse qui nous considérait comme traîtres depuis le 8 août 1941. La réputation de cette phalange n’est moins rien que sinistre pour les ignorants et surtout pour ceux qui, après des dizaines d’années, croient encore devoir remplir une mission sacro-sainte en entretenant cette ignorance et en continuant de répandre la haine. Pour nous, légionnaires, quelle que fût la raison pour laquelle nous nous étions engagés collectivement ou isolément, le fait de passer (à notre corps défendant) de la Wehrmacht à la Waffen-SS ne changeait, ni aggravait, absolument rien. Pour nous, le seul changement résidait dans le mode de salut et dans certains insignes de l’uniforme entre autres, bien sûr, les runes « SS » sur le col de la tunique, la tête de mort sur le képi et la boucle du ceinturon sur laquelle le « Gott mit uns » était remplacé par une devise, par ailleurs magnifique, que nous honorions bien avant de l’arborer : « Meine ehre einßt treue », « Mon honneur s’appelle fidélité ». L’unité qui va sortir de cette mutation ne sera plus un régiment d’infanterie, mais une brigade d’assaut motorisée. Une brigade d’assaut de ce modèle alliait la puissance de feu et la variété de l’armement à une extrême mobilité.
J’étais devenu sous-officier et chef de groupe dans le peloton des pionniers d’assaut de la Brigade Wallonie. Nous sommes envoyés au centre d’instruction de Dresde où, durant douze semaines, nous sommes à un entraînement intensif de jour et de nuit, subissant une discipline des plus rigoureuses. Plusieurs fois, lors des exercices, la Brigade Wallonie au grand complet sillonnait la région. Partout où nous passions, on connaissait maintenant les Wallons. Leurs exploits guerriers avaient rempli les colonnes des journaux allemands.
Il n’y a que les imbéciles pour prétendre que nous sommes partis nous battre en Russie pour les beaux yeux des Allemands. Seules des raisons nous ont poussés à adopter cette conduite et aucun sentiment. Si au cours de nos campagnes était née, entre soldats allemands et wallons, une fraternité d’arme qui n’a jamais été démentie ni d’une part, ni de l’autre — et cela était tout à fait normal et humain — les Allemands ne nous étaient ni plus ni moins sympathiques que d’autres. De plus, notre esprit et notre tempérament étaient diamétralement opposés dans toutes les relations que nous avions avec eux à quelque niveau que ce fût. Il fallait, pour éviter les frictions, mettre de chaque côté pas mal d’eau dans son vin. Ce n’était pas toujours facile.
Un beau jour, nous avons été tatoués. Encore une histoire qui a fait couler beaucoup d’encre et a fait travailler l’imagination des amateurs de sensations. Du fait que seuls les SS — j’ignore pourquoi — ont été soumis à cette mesure qui, vu son utilité, aurait dû être étendue à toutes les armées, cela a permis après la guerre de n’en laisser échapper que très peu. Dans tous les pays où l’on faisait la chasse aux inciviques, il suffisait de faire lever à tous le bras gauche pour repérer un légionnaire du Front de l’Est. Longtemps, tout le monde a cru qu’il s’agissait d’une marque de reconnaissance ou de qualité nazie. Il y a des imbéciles qui y croient encore aujourd’hui. Il s’agissait en fait de toute autre chose. Dans toutes les armées du monde, chaque soldat porte une plaque d’identité reproduisant son numéro de matricule et son groupe sanguin. Dans l’armée allemande, cette plaque se portait autour du cou grâce à un cordon. Or, pas mal de soldats trouvaient cela gênant, la plaçaient en poche et finissaient par la perdre. Dans pas mal de cas, le blessé se retrouvait sans plaque et l’on ignorait son groupe sanguin en vue de le soigner. Il fallait procéder à une analyse avant la transfusion ce qui est difficile sur le front. Il fallait donc trouver le moyen d’indiquer ce groupe sanguin sans que le soldat puisse le perdre ou le dégrader.
Le vendredi 20 juillet 1944, dans l’après-midi, nous fûmes consignés à la caserne comme tous les autres militaires d’ailleurs. Durant la journée, des patrouilles avaient fait le tour des terrains d’exercice et rameuté toutes les unités qui étaient à l’instruction. En rentrant à la caserne, nous avions reçu des armes et des munitions. Il nous était interdit de sortir le soir. Il nous fut permis de nous coucher, au-dessus des couvertures, bottés, le ceinturon simplement dégrafé sur le lit, le casque à portée de main. Le samedi midi, la consigne était levée et nous apprenions l’attentat contre Hitler. À partir de ce jour, les autorités du parti décidèrent que tous les militaires effectueraient le même salut que celui déjà en vigueur chez les SS, ce salut qu’on appelle fasciste, nazi, hitlérien, et qui était déjà celui des empereurs romains (« Ave Caesar ») et qui est toujours celui des athlètes. Entre-temps, le débarquement allié et le déroulement des opérations militaires nous inquiétaient fortement. Contrairement à ce que croyaient — et croient encore aujourd’hui — une multitude d’ignorants, à cette époque l’Allemagne était encore très loin d’avoir perdu la guerre. Personnellement, je ne me faisais pas trop de soucis de ce côté-là. De plus, j’étais soldat volontaire et mon sort était scellé.
Depuis le 6 juin 1944, tous les congés étaient supprimés. À la fin août, les Alliés occupaient Paris et se précipitaient vers la Belgique. Par la suite, je fus élève officier-SS. La première sélection s’opère pendant les deux premiers mois et s’appelle « la préparation ». Cela se déroulait à l’école de Neweklau. En ce qui concerne les Wallons, tous les candidats étaient sous-officiers, vétérans, décorés de la Croix de Fer. La plupart avaient au moins un an de service, ou deux ou trois comme moi. À Tcherkassy, j’avais commandé un groupe, puis un peloton de pionniers d’assaut au feu. Pendant la période de préparation, sans insigne de grade, sans décoration, nous étions traités avec beaucoup moins d’égard et de considération que les recrues. Le futur officier SS doit être capable de supporter, physiquement et mentalement, tout ce qui est possible et impossible ; surtout, l’impossible. Le but de l’opération est d’éliminer, en deux mois, tous ceux qui ne résistent pas dans ces domaines. Ainsi, sur plus de deux cents élèves français et wallons, une bonne centaine quittait l’école, inapte à porter les insignes de candidats officiers.