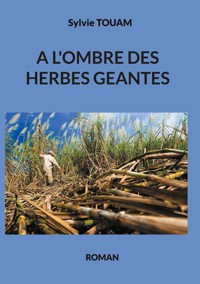Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"J'avais compris que je devais faire le deuil de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un, qui n'avait jamais existé. Aussi, n'y avait-il pas de mémoire, de souvenir à partager. Mais il était pour moi une absence, comme si quelque part, il y avait un être dont le destin me privait." Un va et vient entre chimères et convictions qui conduira une jeune fille jusque dans le quartier des tanneurs d'Essaouira, au Maroc.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De la même auteure :
Recueils de poésie
Aux éditions Lulu :
Des pas…sculpteurs de vie
Le parfum des mouvances
Eclaboussures
Les étoiles la nuit
Fondus enchaînés
Entre deux vents la vie
Errance poétique d’un vers inachevé
L’aube d’un émoi
Deviens qui tu es (Nietzsche)
A l’encre de brume
Aux éditions BoD :
Quelques alexandrins pour rythmer la saison
Points de rencontre
A mon père…
Patchwork poétique
Poèmes aux quatre vents
Roman
Ma vie sur ton chemin
“Je suis né quelque part,
Laissez-moi ce repère,
Ou je perds la mémoire. »
Maxime Le Forestier
Sommaire
Partie 1: Aïcha
Saint Laurent sur Sèvre, le dimanche 17 octobre 1982
Sablé sur Sarthe, le lundi 18 octobre 1982
Angers, le jeudi 1er septembre 1966
Sablé sur Sarthe, le mardi 19 octobre 1982
Angers, Saint Laurent sur Sèvre, le vendredi 25 juin 1971
Sablé sur Sarthe, le mercredi 27 octobre 1982
Angers, le samedi 26 juin 1971
Angers, le mardi 29 juin 1971
Sablé sur Sarthe, le jeudi 28 octobre 1982
Partie 2: Alain
Cholet, de 1936 à 1955.
Cholet, le samedi 25 juin 1955.
Angers, de 1955 à 1957
De Cholet au Maroc, le 16 avril 1957
Maroc, à partir du 16 avril 1957
Essaouira, le 2 septembre 1958
Essaouira, le 14 septembre 1958
Arrivée à Angers, le 16 septembre 1958
Angers, après le 16 septembre 1958
Partie 3: Aïcha
Sablé sur Sarthe, le vendredi 29 octobre 1982
Essaouira, août 1981
Essaouira, le 1er septembre 1958
Essaouira, le 16 août 1981
Angers fin août 1981
Sablé sur Sarthe, septembre 1981
Angers, lundi 14 décembre 1981
Angers, jeudi 17 décembre 1981
Sablé sur Sarthe, 1er semestre de l’année 1982
Saumur, le mercredi 22 septembre 1982
Partie 4: Jacote
Perrigny lundi 28 décembre 1964
Londres, le lundi 1er septembre 1969
Saint Laurent sur Sèvre, année scolaire 69/70
Saint Laurent sur Sèvre, début de l’année scolaire 70/71
Saint Laurent sur Sèvre, Jacques, Janvier 1971
Saint Laurent Sur Sèvre, le vendredi 25 juin 1971
Retour en arrière, Essaouira, Jacques, semaine du 17 au 20 mai 1971
Départ de Saint Laurent Sur Sèvre, été 1971
Partie 5: Aïcha et Jacote
Saumur, Madame Vilette, fin 1982
Paris, Jacote, mars 1980
Aïcha, le lundi 10 janvier 1983
Jacote, été 1980.
Jacote, samedi 1er janvier 1983
Madame Vilette, le mardi 11 janvier 1983
Aïcha, le vendredi 14 janvier 1983
Saint Laurent sur Sèvre, Aïcha et Jacote, le dimanche 30 janvier 1983
J’avais six ans, peut-être sept. Je venais de comprendre que les lettres J A C O T E mises bout à bout formaient le prénom JACOTE. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que la maîtresse épelait ce mot et faisait chanter ensemble ses six lettres. Le déclic pourtant n’eut lieu en moi que ce jour-là, mais il fut foudroyant.
- « Jacote dort dans le petit lit blanc. La grosse pendule sonne. Maman chuchote : Jacote… »
lisais-je d’un seul trait.
Je me souvenais de mon institutrice. Elle me paraissait très âgée, mais qui ne l’était pas du haut de mes jeunes années ? Elle d’autant plus, car elle représentait le savoir et l’autorité. Mes parents n’avaient de cesse de m’enseigner ce respect. Aussi, eut-elle été encore en pleine fleur de l’âge, que je l’aurais de toute manière vue à travers mes yeux d’enfant : une femme accomplie, dont la longueur de l’existence n’avait d’égal que l’étendue de son instruction. Ce ne fut que des années plus tard, lorsque je devins à mon tour adulte, que je compris qu’il n’était évidemment rien de tout cela.
Mais à cet instant, où je voyais soudainement toutes ces lettres prendre sens devant mes yeux, la vie venait de m’offrir l’extase la plus belle qu’il soit, et rien n’aurait dû venir perturber cette innocence…
PARTIE 1
Aïcha
1
Saint Laurent sur Sèvre, le dimanche 17 octobre 1982
La météo était plutôt maussade ce dimanche-là à Saint Laurent Sur Sèvre, mais les parents d’élèves étaient pourtant au rendez-vous. C’était aujourd’hui le vide-greniers organisé par leur association. L’école comptait aujourd’hui plus de deux-cents élèves et ils avaient à coeur de la faire vivre en mettant ainsi sur pied quelques manifestations. Celles-ci permettaient, non seulement de garantir un apport financier, ce qui en soi était déjà non négligeable, mais également de donner lieu aux familles de se rencontrer.
C’était la toute première initiative de ce type. L’idée avait été soufflée par une maman, venue d’Amiens, qui se prit à rêver d’importer jusqu’ici ce concept de grande braderie, largement populaire dans sa ville d’origine. Disons plutôt, pour ne pas la froisser, de grande réderie puisque c’était ainsi qu’elle était appelée par les Amiénois. A Saint Laurent, le projet était novateur. Aussi, comme bien souvent lorsqu’il s’agissait d’accueillir une personne nouvelle, l’enthousiasme avait été de mise. Chacun s’activait à mettre en place cet évènement. Monsieur Raymond, le Maire, avait aussitôt donné son autorisation pour qu’elle puisse avoir lieu sur la place Georges Clémenceau. Il terminait son troisième mandat et était toujours partant pour des actions inédites.
Ainsi, pour cette première édition, il s’agissait de mettre en vente des articles scolaires. Le débat avait été d’ailleurs assez agité pour définir si ce vide-greniers allait être alimenté seulement par les parents de l’école ou par tous les vendeurs extérieurs qui le souhaiteraient. De même s’il allait être ouvert ou non à toutes sortes d’articles. Il fut statué que n’importe quel particulier pouvait venir louer un stand de vente, mais pour cette première version, seul le rayon école serait autorisé. L’étalage était pour autant varié : des plumiers aux planches de géographie en passant par les bureaux, les bouliers, les buvards, les cahiers Lutèce et bien d’autres choses. Les manuels scolaires étaient en nombre, et une jeune femme posait devant une méthode de lecture à laquelle, vu la nostalgie de son regard, elle avait l’air très attachée. C’était un livret vert des éditions L’école : « Allons au bois-joli ». Et curieusement, cette femme passait la main sur une double page ouverte comme si elle voulait caresser tous les souvenirs qu’elle contenait. « J A C O T E » pouvait-on même l’entendre épeler, « Jacote dort dans le petit lit blanc ». Elle se balançait au rythme des syllabes, le regard perdu. « Maman chuchote : Jacote… ». Et ce fut à cet instant qu’elle perdit connaissance.
Aussitôt, un véritable attroupement s’était formé. Il y avait là, parmi les bénévoles de l’association, un jeune pompier volontaire qui prit aussitôt l’affaire en mains, demandant avant tout aux curieux de bien vouloir s’écarter. Il ne fallut que quelques minutes pour qu’on entende résonner l’appel de la sirène. Ce n’était pas que l’état de cette femme lui paraissait véritablement alarmant, mais le sapeur n’avait avec lui aucun matériel de secourisme. Après l’avoir placée en position latérale de sécurité, il contrôlait sa respiration, et tentait de la rassurer par des gestes et des mots qu’elle ne semblait pas pour autant percevoir. Lorsque le camion de pompiers arriva sur la place, il fut accueilli avec soulagement. La subjectivité du temps eut-elle été encore à démontrer que l’impatience qui se lisait sur tous les visages la mettait ici clairement en évidence. Une fois la victime transportée à l’intérieur du véhicule, les langues se déliaient. Avec surtout une grande question : Qui était cette femme que personne ne semblait connaître ?
On ne l’a jamais vue à la sortie des classes, murmurait-on un peu partout.
Ce n’est pas une maman d’élèves, confirma une des maîtresses qui se trouvait-là.
Quelqu’un l’aurait-il aperçu à Saint Laurent ? demanda l’adjoint municipal.
Je la voyais. Depuis ce matin, elle lisait sans cesse les pages de son livre, rajouta le voisin de sa table.
Oui, elle avait l’air très triste, comme un peu perdue en fait, renchérit son épouse. On a voulu lui parler mais elle ne paraissait pas vouloir nous entendre.
Les commentaires y allaient bon train. Le responsable de l’association se tenait en retrait. Il ne voulait pas faire part lui aussi de son étonnement, mais il se souvenait avoir été particulièrement intrigué par la démarche de cette femme lorsqu’elle l’avait contacté pour réserver son stand. Elle ne semblait connaître ni la commune, ni l’école, mais l’avait beaucoup questionné au sujet des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par ce vide-greniers. Lorsqu’il lui avait demandé de quel espace elle souhaitait disposer en fonction de l’importance en nombre et en volume des articles qu’elle pouvait mettre en vente, elle lui avait dit n’avoir en fait que quelques livres de lecture et cahiers d’écriture. « Exactement six » avait-elle précisé, ce qui, s’était-il dit, ne justifiait pas vraiment l’installation d’une table. Il n’avait pour autant pas voulu lui en refuser l’accès, aussi avait-il pris soigneusement en note ses nom et prénom ainsi que son adresse.
Aïcha Le Goff, et je suis domiciliée à Sablé sur Sarthe.
Il avait aussitôt été interpellé par la distance qu’elle était prête à parcourir, seulement pour mettre six livres et cahiers en vente, dans un si petit marché. Il lui semblait bien qu’elle avait là près de cent-cinquante kilomètres à effectuer. Et comment d’ailleurs avait-elle eu vent de l’organisation de cette brocante ?
Il fut coupé là dans sa réflexion par un pompier venant l’informer qu’ils préféraient conduire la jeune femme sur le centre hospitalier de Cholet, même si son pronostic vital n’était en rien préoccupant.
Savez-vous quel proche nous pourrions prévenir de cet incident ? Il n’y a dans ses vêtements aucun papier ne nous permettant de l’identifier. Et elle n’a pas suffisamment retrouvé ses esprits pour pouvoir nous informer.
Je ne peux que vous restituer les articles avec lesquels elle est venue. Elle n’a pas laissé de sac à côté d’elle. Lors de son inscription elle a réservé son espace sous le nom de Madame Aïcha Le Goff, résidant à Sablé sur Sarthe. C’est tout ce que je peux vous dire. Aucune personne ici ne parait la connaître.
Merci, nous allons attendre qu’elle puisse elle-même nous renseigner, et si toutefois quelqu’un venait la chercher vous pourrez lui dire où nous l’avons transportée. Mais ne vous en faites pas, les nouvelles seront très certainement rassurantes dans les heures qui viennent.
Et le sapeur-pompier courut rejoindre le véhicule où ses collègues n’attendaient que lui pour prendre la route vers Cholet. Une vingtaine de minutes seulement séparait le marché de l’hôpital, et malheureusement, ils ne connaissaient que trop bien cette route qu’ils avaient si souvent l’habitude de parcourir.
2
Sablé sur Sarthe, le lundi 18 octobre 1982
J’arrivai enfin dans mon appartement. J’avais dû faire deux arrêts le long de ces cent-cinquante kilomètres qui m’avaient éloignée de Sablé, tant la fatigue avait eu raison de mon déni. Cette expédition à Saint Laurent sur Sèvre avait été aussi stupide que le rêve complètement insensé qui s’était emparé de moi quelques semaines plus tôt. Comment avais-je pu croire…
Divers scénarios avaient pris forme dans mon imaginaire, du plus merveilleux au plus dérisoire. A l’image fidèle de ce que fut ma vie jusqu’à présent : un va et vient permanent entre chimères et convictions. C’était sans compter, une fois de plus, sur tous ces inattendus qui n’avaient jamais cessé de me faire vivre et de m’abîmer à la fois. Mon passage dans le camion des pompiers faisait partie de tous ces menus évènements qui m’isolaient davantage encore dans ma singularité. Evidemment, ni les organisateurs, ni les soignants n’avaient compris le moindre sens à mon histoire. Mais qu’importait. Ils m’avaient laissée repartir. Mon état physique ne leur inspirait plus d’inquiétude. Je n’avais laissé là-bas que mon identité administrative, dont personne n’avait que faire finalement. C’était bien là mon drame.
L’urgence pour moi était maintenant de sombrer dans le sommeil. Je descendis le volet roulant de ce petit studio que j’occupais seule depuis maintenant trois années, et fermai les oreilles à tout bruit pouvant provenir de l’extérieur.
Il était déjà près de minuit quand je rouvris les yeux. Ignorant même à quelle heure exacte j’étais rentrée, j’en déduisis malgré tout que j’avais bien dû faire le tour de la pendule. Il n’y avait pas un bruit dans l’immeuble, et seules quelques voitures circulaient encore sur le boulevard.
J’étais très attachée à cet appartement, même si ses vingt-cinq mètres carrés ne m’offraient pas un espace de vie très vaste. Je l’avais loué non-meublé, et j’avais pris plaisir à le personnaliser à ma manière. J’y avais déposé dans l’angle le fauteuil Voltaire hérité de ma grand-mère, fauteuil que j’avais rhabillé d’un tissu de style jacquard rouge foncé. Mon secrétaire était jusqu’à côté. Il me servait à la fois de rangement, de bibliothèque et de table de travail. L’espace cuisine était très sobre, mais je n’avais pas besoin de plus, compte tenu de mon peu d’attirance pour la gastronomie. Je regardais tout cela, encore dans mon lit, ce cocon aussi bien intégré dans cette même et unique pièce.
Sablé n’était qu’à une soixantaine de kilomètres d’Angers, ma ville d’origine où mes parents habitaient encore. J’y avais élu domicile en 1979 lorsque j’avais trouvé cet emploi à la boulangerie. J’avais alors vingt-et-un an et j’avais apprécié cette première indépendance, espérant ainsi me libérer d’une jeunesse compliquée, ou du moins pleine d’interrogations. Avais-je pour autant réussi ? Probablement que non… mon aventure d’hier à Saint Laurent en était une preuve de plus…
Les quatre chiffres rouges de mon radio-réveil se modifièrent d’un coup pour m’avertir du changement de jour. J’étais maintenant complètement éveillée et je pris conscience de mon dérèglement horaire. Il m’avait suffi d’un dimanche pour replonger dans le désordre de ma conscience, et je savais, à cet instant, que cette nuit encore allait convoquer tous les fantômes de mon passé.
3
Angers, le jeudi 1er septembre 1966
Comment oublier le jour de mon 8ème anniversaire… C’était toujours une fête pour moi. Maman confectionnait une tarte aux pommes, et je recevais de sa part et de celle de Papa un cadeau qui avait d’autant plus de valeur que je savais combien il avait été choisi avec amour. J’étais leur seule enfant, et même s’il m’arrivait parfois d’espérer encore l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite soeur, je sentais bien malgré moi que ce rêve ne se réaliserait pas. Bien qu’ils ne m’aient jamais répondu lorsque je le leur avais demandé à plusieurs reprises, j’avais, comme tous les enfants, cet étrange pouvoir de deviner les mots à travers les silences. J’avais compris que je devais faire le deuil de quelque chose, ou plutôt de quelqu’un, qui n’avait jamais existé. Aussi n’y avait-il pas de mémoire, de souvenir à partager. Cela n’aurait dû être qu’un néant, mais il était pour moi une absence, comme si quelque part il y avait un être, dont le destin me privait. Mes parents n’étaient pas très démonstratifs, ni en gestes ni en mots, aussi ce sujet-là était clos avant même d’avoir été entrouvert. C’était ainsi que j’avais appris à faire de ma solitude une alliée.
Et j’avais mes poupées… mes plus précieuses confidentes. Chacune d’entre elles portait un prénom que j’avais choisi avec soin. Je me souvenais de Catherine, elle avait les cheveux dorés comme les blés, et me rappelait une fille de CM2 que j’admirais pour sa longue chevelure blonde. Il y avait aussi Nadine, comme l’une des amies de ma grande cousine auprès de qui j’aimais vaguer, dans l’espoir peut-être inconscient d’attirer l’attention. Et puis Nathalie, Anita, Babichou en souvenir d’une histoire que j’aimais beaucoup lire, et sans oublier Christophe, un joli baigneur en celluloïd que j’affectionnais particulièrement. C’était ma famille. Je jouais à la fois le rôle de maman, de grande soeur, de copine. Parfois même de maîtresse d’école. Je grandissais avec mes poupées.
Ce jour-là, j’avais 8 ans. Je les avais toutes réunies autour d’une vieille caisse en bois dans le sous-sol, les unes posées sur des seaux de plage mis à l’envers, d’autres sur un parpaing que j’avais eu mille peines à rapprocher. J’avais planté les bougies dans un pot de fleurs rempli de mousse. Il n’était évidemment pas question que je les allume, mais « on va faire mine » : c’était là ma formule consacrée. Et nous nous apprêtions toutes ensemble à célébrer mon anniversaire, lorsque j’entendis Alain m’appeler :
Coucou Aïcha !
Alain, c’était mon parrain. Je n’étais pas alors vraiment capable d’expliquer s’il y avait un lien de famille entre lui et moi, tant les explications de Papa et Maman sur la complexité de la généalogie m’étaient passées au-dessus de la tête. Alain était, de toute manière, très présent dans notre famille, et je l’aimais beaucoup. Il avait alors une trentaine d’années, et habitait lui aussi à Angers, à quelques rues de chez nous, dans le même quartier St Léonard. Il y vivait seul, et avait peut-être pour cela reporté sur moi tout ce trop-plein d’affection qu’il ne pouvait partager par ailleurs.
Je laissai aussitôt ma gentille compagnie pour me jeter dans ses bras.
Bon anniversaire ! me dit-il en me rattrapant tendrement de son bras gauche. Car dans sa main droite, il tenait un beau paquet enrobé de papier kraft. Et c’est pour qui ça ? dit-il en me le présentant. Mon petit doigt me dit que ma filleule préférée, qui aujourd’hui devient grande, aimerait beaucoup l’ouvrir…
C’est quoi Parrain ? m’écriai-je en trépignant d’impatience.
Eh bien ouvre, mais attention, il y a peut-être de très très méchantes créatures qui vont sortir de là pour te dévorer toute crue le jour de tes 8 ans, s’écria-t-il en roulant des yeux qui devenaient soudain aussi globuleux que ceux du poisson rouge de tante Monique.
Chiche que non ! et même pas peur !
Et mon empressement à déchirer le papier kraft n’avait d’égal que mon impatience à découvrir ce qu’il camouflait. Aujourd’hui encore, j’entendais carillonner les rires de Parrain à cet instant…
Ohhhhhh !
J’étais époustouflée…. Qu’elle était belle !! Une poupée au teint mat, avec des yeux d’un marron éblouissant et des grands cils. Ses longs cheveux noirs étaient ondulés et retombaient sur ses épaules. Elle était vêtue d’une robe rouge foncé avec des volants aux emmanchures, et portait un tablier blanc autour de la taille. Elle avait des petites sandales avec des socquettes blanches. Elle était tout simplement sublime ! j’en avais les larmes aux yeux.
Elle te plaît Princesse ?
Oh Oui Parrain, elle est magnifique !
Et je me serrai bien fort dans ses bras pour le remercier de ce cadeau fabuleux. Offerte par Alain, je savais déjà que cette poupée allait avoir une histoire prodigieuse.
Je l’ai choisie parce que je trouvais qu’elle te ressemblait avec tes cheveux noirs et tes beaux yeux marron. C’est une petite Aïcha en miniature !
Oh, tu exagères ! Elle est tellement plus belle que moi !
Mouais….dit-il en faisant la moue. Et alors, comment va s’appeler cette Beauté ?
JACOTE ! criai-je sans même réfléchir.
Et à ma grande stupéfaction, j’eus à peine le temps de voir se métamorphoser le visage d’Alain, que je tombai lourdement sur le sol, emportée par la gifle la plus magistrale que je n’avais jamais imaginée…
Alain… il n’arrivait même pas à tendre la main vers moi pour m’aider à me relever. Il était comme statufié, un masque de souffrance le défigurait. Et pour ma part, aucun geste, aucun mot, rien n’aurait pu enrober l’abysse dans lequel j’avais été si brutalement projetée. Je savais que je venais d’être, dans la violence, et sans explication, expulsée de l’enfance.
Je n’avais que huit ans. Même si cette scène et les minutes qui suivirent ont marqué ma vie, il resta autour de ce terrible souvenir comme un boycottage émotionnel, m’empêchant d’ouvrir la porte sur le reste de la journée, et sur la manière dont j’ai pu sceller l’évènement d’un silence absolu. Ce fut comme un pacte tacite passé avec Alain, un malheur fantôme.
Je me souvenais, en revanche, avec précision de cette poupée. Je l’aurais reconnue entre des milliers. Je n’ai pourtant jamais joué avec elle. Je l’ai détestée avec tellement de force, que jamais je n’aurais pu créer le moindre lien affectif. Je me rappelais l’avoir cachée au fond d’un tiroir, et avoir profité d’une promenade à vélo quelques années plus tard pour la jeter dans un terrain vague où les gens avaient la mauvaise habitude d’y abandonner des objets encombrants. C’était la poupée sans nom, la poupée du malheur. Je savais trop qu’il y avait en elle une boîte de Pandore qu’il m’était interdit d’ouvrir, un prénom que je n’aurais jamais dû prononcer. Celui qui m’avait pourtant permis d’accéder à la lecture et à la magie des mots quelques mois auparavant. Jacote. « Jacote dort dans le petit lit blanc… ».
J’ai grandi dans ce non-dit, et je dois bien reconnaitre que mon « après huit ans » fut plutôt heureux. Du moins pour un temps, jusqu’en juin 1971, quelques semaines avant mes treize ans. Durant ce laps de temps mes parents s’étonnaient-ils de la distance affective que je cultivais envers mon parrain ? Je me disais parfois qu’ils n’avaient pourtant pas dû oublier à quel point je l’adulais durant mes huit premières années. Mais rien ne me le laissait penser. Alain venait épisodiquement à la maison, et je feignais de l’ignorer, une prétendue indifférence qui semblait finalement satisfaire tout le monde.
4
Sablé sur Sarthe, le mardi 19 octobre 1982
Je me regardai dans le miroir. La nuit passée à replonger dans le souvenir de cet anniversaire avait laissé des cernes et des poches sous mes yeux. J’allais devoir une fois de plus compter sur une bonne couche de crème hydratante pour m’aider à faire illusion. Illusion seulement. Wilfried me le dirait encore ce soir. Il était tellement habitué à mes lendemains de nuits blanches tant celles-ci étaient fréquentes. Et ce soir en plus, il allait falloir que je lui raconte en détail comment s’était passé mon dimanche à Saint Laurent. Je lui avais dit déjà au téléphone que je n’avais pas réussi à retrouver la trace de Jacote. Bien sûr d’ailleurs que si cela avait été le cas, je serais allée sonner chez lui, même en plein milieu de la nuit ! Mais il me fallait en plus lui raconter mon malaise et mon passage à l’hôpital. Et je savais déjà que Wilfried allait être très contrarié.
Wilfried et moi nous nous connaissions depuis deux ans. Nous nous étions rencontrés à Sablé, dans le club de basket duquel nous étions tous deux licenciés. Pour ma part, je pratiquais le basket à Angers depuis les premières années de Poussine. J’y recherchais autant la convivialité que la performance sportive en elle-même, dans laquelle je n’excellais pas plus que cela. Mais ce sport collectif me permettait de vivre une véritable histoire d’équipe. Pour moi qui étais fille unique, c’était en dehors de l’école, le seul lieu d’échanges et de jeux avec les enfants de mon âge. Aussi, c’est tout naturellement qu’en arrivant sur Sablé, je m’étais dirigée vers le club de basket pour espérer ainsi tisser des liens. C’était un tout jeune club, « Sablé basket », créé en 1978. Ses dirigeants cherchaient des bénévoles, et Wilfried était de ceux-là. Notre première rencontre ne fut pas un coup de foudre à proprement parler, mais nous nous étions sentis aussitôt à l’aise l’un avec l’autre. Les semaines suivantes avaient largement confirmé cette entente mutuelle, et cet attachement s’était tout naturellement concrétisé vers une relation amoureuse. Lorsque peu à peu, j’étais allée au bout du récit de mon histoire, Wilfried m’avait largement poussée à entreprendre mes recherches pour retrouver Jacote.
Aussi, ce soir, j’allais bien évidemment lui faire part de ce nouvel échec, et de la tournure qu’avaient pris les évènements.
Pour l’heure il me fallait partir à la boulangerie. Elle n’était qu’à quelques encablures de l’appartement, cela me permettait d’y aller à pied. J’avais l’habitude de débuter à neuf heures, ce qui était plutôt confortable sur ce type d’emploi. Bien évidemment, Monsieur Crouzet, le boulanger, lançait le pétrin et la première cuisson de nuit. La boulangerie ouvrait à sept heures et son épouse assurait seule ces deux premières heures de la journée. Je ne venais donc qu’ensuite pour lui prêter main forte, au moment du premier temps d’affluence de la journée.
J’aimais mon travail. Je ne m’y étais pourtant pas spécifiquement destinée puisque c’était un CAP vente que j’avais préparé et obtenu, après le collège. Mes amis de formation avaient, pour la plupart, été embauchés en boutiques ou grandes surfaces dans des rayons non-alimentaires. Il avait suffi d’un hasard, une petite annonce lue dans Ouest France au bon moment, et je m’étais retrouvée dans cette boulangerie à Sablé. Trois ans plus tard j’aimais particulièrement les relations de confiance que j’avais pu établir avec les clients réguliers. Et ce matin c’était la fidèle Madame Dubois qui allait être servie en premier.
Bonjour Aïcha ! me dit-elle. Tout va comme vous le voulez ?
Je n’avais même pas le temps de lui répondre que déjà elle enchaînait par son traditionnel :
Ce matin ce sera une baguette pour moi.
Ça vous fera un franc soixante-dix, Madame Dubois.
Tout se passait comme d’habitude. Le scénario était écrit à l’avance. Mais ce matin, Madame Dubois m’informa que le jour suivant il lui faudrait deux baguettes, car ses cousins, venus du Mans, viendraient déjeuner avec elle. Elle hésitait encore entre une blanquette de veau et une poule au pot. Et c’était ainsi que se déroulaient mes journées, au plus près du quotidien de tant de personnes esseulées, qui venaient chercher à la boulangerie avant tout un peu de considération. Et il me fallait aussi les accompagner dans leur choix, connaissant leurs besoins, leurs préférences, leurs allergies parfois.
La journée passa ainsi, et malgré ma fatigue, j’étais heureuse d’aller retrouver Wilfried. Nous n’avions pas encore franchi le cap de la vie commune. Il habitait une petite maison plaisante avec jardinet au bord de l’Erve.
Entre, me dit-il du fond de la cuisine, je suis en train de préparer une béchamel et je ne veux pas lâcher ma casserole.
Wilfried avait toujours cet air insouciant qui m’apaisait tellement. Avec lui rien ne semblait ni grave ni urgent, et cette sérénité m’était d’autant plus précieuse que je savais qu’elle me manquait justement cruellement.
Qu’est-ce que tu nous prépares ?
Tu sais la recette de Mamie, avec des biscottes, du jambon et du fromage. Ça passe au four avec la béchamel dessus.
Ah, c’est une bonne idée !
Ça y est, la béchamel est assez épaisse, j’éteins et tu vas me raconter tout ça. On mettra le plat au four plus tard.
Et c’était ainsi, qu’assise bien tranquillement sur le canapé, je racontai à Wilfried comment ce dimanche à Saint Laurent sur Sèvre ne s’était absolument pas passé comme je l’avais imaginé.
Mais maintenant, ça va, tu te sens bien ? s’inquiéta-t-il aussitôt
Mais oui bien sûr. C’était nerveux, c’était évident. Tu ne peux pas t’imaginer à quel point j’étais angoissée en arrivant. Imagine que c’était la première fois que j’allais à Saint Laurent depuis 1971. Le choc que j’avais eu ce jour-là, sans parler du lendemain… J’ai tout revécu avec une intensité qui m’était insupportable. Et cette méthode de lecture, c’était ma dernière bouteille jetée à la mer. Jacote… Rappelle-toi
« Jacote dort dans son petit lit blanc ».
Wilfried connaissait mon histoire et savait combien j’en souffrais. Aussi réussit-il à taire son inquiétude pour accepter l’idée que ce malaise n’était absolument pas grave, du moins du point de vue de ma santé physique. Il regrettait surtout de ne pas m’avoir accompagnée, tant il prenait vraiment la mesure de ce qu’avait pu représenter pour moi ce retour à Saint Laurent onze années après l’évènement qui avait engendré la découverte la plus bouleversante de mon histoire.
Sans l’avoir formulé, nous avions fait le choix ce soir-là de « passer à autre chose », et la soirée s’était passée sur un mode plus décontracté. Il était important aussi que nous trouvions cet équilibre entre nous. Depuis le tout début de notre rencontre, Wilfried s’était beaucoup investi dans mes recherches. Il avait tout d’abord accepté le rôle, pas forcément facile, de confident.
Ce n’était que peu à peu que j’avais accepté de lui dévoiler le secret de mon enfance et cette quête éperdue qui était désormais la mienne. Je ne pouvais pas m’imaginer partager son amour tout en lui cachant ce qui m’était à la fois si fondateur et si destructeur. Mais il m’était aussi tellement difficile de briser le silence sur ce sujet, qui justement n’était fait que de celui que l’on m’avait imposé. En avais-je d’ailleurs vraiment envie ? C’était bien là tout le paradoxe de ma situation, et ce fut tout un travail d’introspection qu’il me fallut faire. Je me demandais si raconter mon histoire à Wilfried était vraiment un besoin, une nécessité, ou juste un devoir de transparence que je m’imposais. Et ce que je n’osais m’avouer, c’était aussi cette peur qu’il me rejette, ou tout simplement qu’il ne comprenne pas mes ressentis. Je savais bien que j’aurais perdu alors, non seulement l’avenir de cet amour naissant, mais aussi ce sentiment de sécurité que je savais en moi déjà si précaire.