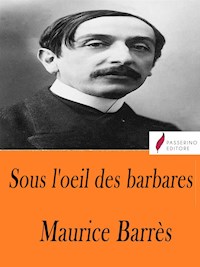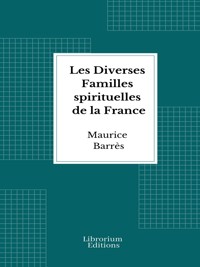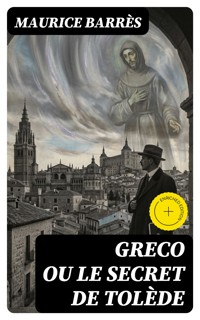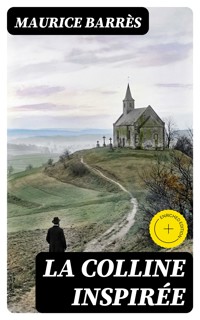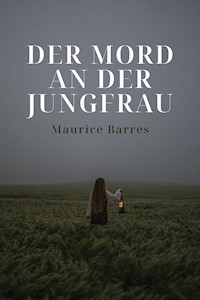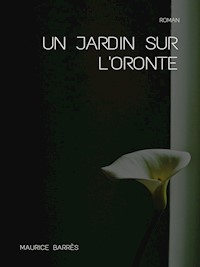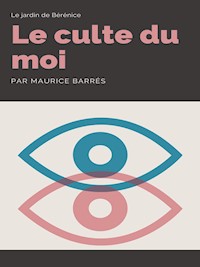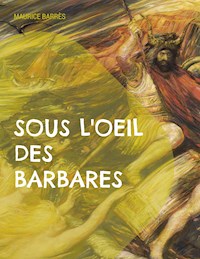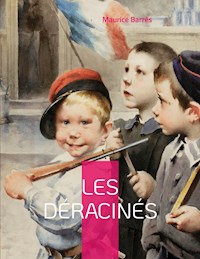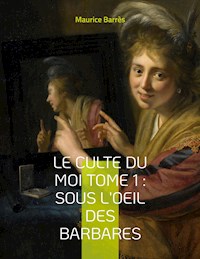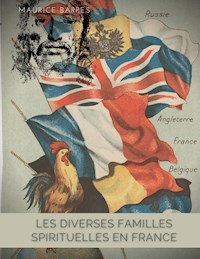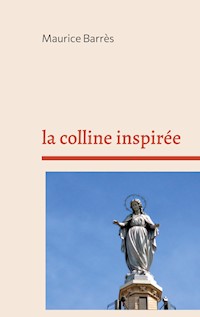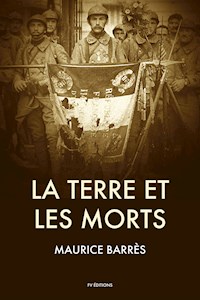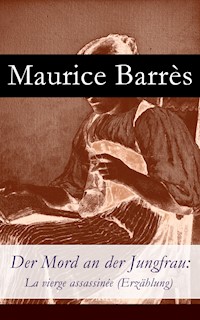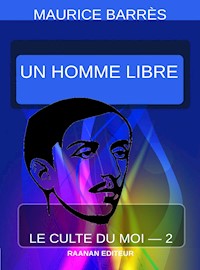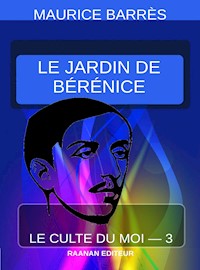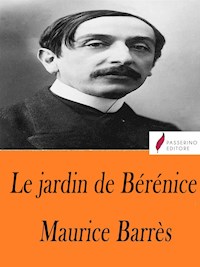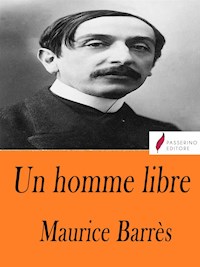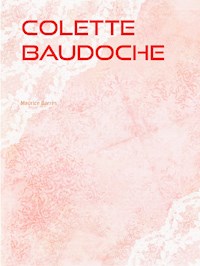A M. PAUL BOURGET
MON CHER AMI,
Ce volume, Sous l'oeil des Barbares, mis en vente depuis six
semaines, était ignoré du public, et la plupart des professionnels
le jugeaient incompréhensible et choquant, quand vous lui
apportâtes votre autorité et voire amitié fraternelle. Vous m'en
avez continué le bénéfice jusqu'à ce jour. Vous m'avez abrégé de
quelques années le temps fort pénible où un écrivain se cherche un
public. Peut-être aussi mon travail m'est-il devenu plus agréable à
moi-même, grâce à cette courtoise et affectueuse compréhension par
où vous négligez les imperfections de ces pages pour y souligner ce
qu'elles comportent de tentatives intéressantes.
Ah! les chères journées entre autres que nous avons passées à
Hyères! Comme vous écriviez Un coeur de femme, nous n'avions souci
que du viveur Casal, de Poyanne, de la pliante madame de Tillière,
puis aussi de la jeune Bérénice et de cet idiot de Charles Martin
qui faisaient alors ma complaisance. Ils nous amusaient
parfaitement. J'ajoute que vous avez un art incomparable pour
organiser la vie dans ses moindres détails, c'est-à-dire donner de
l'intelligence aux hôteliers et de la timidité aux importuns; à ce
point que pas une fois, en me mettant à table, dans ce temps-là, il
ne me vint à l'esprit une réflexion qui m'attriste en voyage, à
savoir qu'étant donné le grand nombre de bêtes qu'on rencontre à
travers le monde, il est bien pénible que seuls, ou à peu près, le
veau, le boeuf et le mouton soient comestibles.
Et c'est ainsi, mon cher Bourget, que vous m'avez procuré le
plaisir le plus doux pour un jeune esprit, qui est d'aimer celui
qu'il admire.
Si j'ajoute que vous êtes le penseur de ce temps ayant la vue
la plus nette des méthodes convenables à chaque espèce d'esprit et
le goût le plus vif pour en discuter, on s'expliquera
surabondamment que je prenne la liberté de vous adresser ce petit
travail, ou je me suis proposé d'examiner quelques questions que
soulève cette théorie de la culture du Moi développée dans Sous
l'oeil des Barbares, Un homme libre et le Jardin de Bérénice.
EXAMEN
Oui, il m'a semblé, en lisant mes critiques les plus
bienveillants, que ces trois volumes, publiés à de larges
intervalles (de 1888 à 91) n'avaient pas su dire tout leur sens. On
s'est attaché à louer ou à contester des détails; c'est la suite,
l'ensemble logique, le système qui seuls importent. Voici donc un
examen de l'ouvrage en réponse aux critiques les plus fréquentes
qu'on en fait. Toutefois, de crainte d'offenser aucun de ceux qui
me font la gracieuseté de me suivre, je procéderai par exposition,
non par discussion.
Que peut-on demander à ces trois livres?
N'y cherchez pas de psychologie, du moins ce ne sera pas celle
de MM. Taine ou Bourget. Ceux-ci procèdent selon la méthode des
botanistes qui nous font voir comment la feuille est nourrie par la
plante, par ses racines, par le sol où elle se développe, par l'air
qui l'entoure. Ces véritables psychologues prétendent remonter la
série des causes de tout frisson humain; en outre, des cas
particuliers et des anecdotes qu'ils nous narrent, ils tirent des
lois générales. Tout à l'encontre, ces ouvrages-ci ont été écrits
par quelqu'un qui trouve l'Imitation de Jésus-Christ ou la Vita
nuova du Dante infiniment satisfaisantes, et dont la préoccupation
d'analyse s'arrête à donner une description minutieuse, émouvante
et contagieuse des états d'âme qu'il s'est proposés.
Le principal défaut de cette manière, c'est qu'elle laisse
inintelligibles, pour qui ne les partage pas, les sentiments
qu'elle décrit. Expliquer que tel caractère exceptionnel d'un
personnage fut préparé par les habitudes de ses ancêtres et par les
excitations du milieu où il réagit, c'est le pont aux ânes de la
psychologie, et c'est par là que les lecteurs les moins préparés
parviennent à pénétrer dans les domaines très particuliers où les
invite leur auteur. Si un bon psychologue en effet ne nous faisait
le pont par quelque commentaire, que comprendrions-nous à tel
livre, l'Imitation, par exemple, dont nous ne partageons ni les
ardeurs ni les lassitudes? Encore la cellule d'un pieux moine
n'est-elle pas, pour les lecteurs nés catholiques, le lieu le plus
secret du monde: le moins mystique de nous croit avoir des lueurs
sur les sentiments qu'elle comporte; mais la vie et les sentiments
d'un pur lettré, orgueilleux, raffiné et désarmé, jeté à vingt ans
dans la rude concurrence parisienne, comment un honnête homme en
aurait-il quelque lueur? Et comment, pour tout dire, un Anglais, un
Norvégien, un Russe se pourront-ils reconnaître dans le livre que
voici, où j'ai tenté la monographie des cinq ou six années
d'apprentissage d'un jeune Français intellectuel?
On le voit, je ne me dissimule pas les difficultés de la
méthode que j'ai adoptée. Cette obscurité qu'on me reprocha durant
quelques années n'est nullement embarras de style, insuffisance de
l'idée, c'est manque d'explications psychologiques. Mais quand
j'écrivais, tout mené par mon émotion, je ne savais que déterminer
et décrire les conditions des phénomènes qui se passaient en moi.
Comment les eussé-je expliqués?
Et d'ailleurs, s'il y faut des commentaires, ne peuvent-ils
être fournis par les articles de journaux, par la conversation? Il
m'est bien permis de noter qu'on n'est plus arrêté aujourd'hui par
ce qu'on déclarait incompréhensible à l'apparition de ces volumes.
Enfin ce livre,—et voici le fond de ma pensée,—je n'y mêlai aucune
part didactique, parce que, dans mon esprit, je le recommande
uniquement à ceux qui goûtent la sincérité sans plus et qui se
passionnent pour les crises de l'âme, fussent-elles d'ailleurs
singulières.
Ces idéologies, au reste, sont exprimées avec une émotion
communicative; ceux qui partagent le vieux goût français pour les
dissertations psychiques trouveront là un intérêt dramatique. J'ai
fait de l'idéologie passionnée. On a vu le roman historique, le
roman des moeurs parisiennes; pourquoi une génération dégoûtée de
beaucoup de choses, de tout peut-être, hors de jouer avec des
idées, n'essayerait-elle pas le roman de la métaphysique?
Voici des mémoires spirituels, des éjaculations aussi, comme
ces livres de discussions scolastiques que coupent d'ardentes
prières.
Ces monographies présentent un triple intérêt:
1° Elles proposent à plusieurs les formules précises de
sentiments qu'ils éprouvent eux aussi, mais dont ils ne prennent à
eux seuls qu'une conscience imparfaite;
2° Elles sont un renseignement sur un type de jeune homme déjà
fréquent et qui, je le pressens, va devenir plus nombreux encore
parmi ceux qui sont aujourd'hui au lycée. Ces livres, s'ils ne sont
pas trop délayés et trop forcés par les imitateurs, seront
consultés dans la suite comme documents;
3° Mais voici un troisième point qui fait l'objet de ma
sollicitude toute spéciale: ces monographies sont un enseignement.
Quel que soit le danger d'avouer des buts trop hauts, je laisserais
le lecteur s'égarer infiniment si je ne l'avouais. Jamais je ne me
suis soustrait à l'ambition qu'a exprimée un poète étranger: «Toute
grande poésie est un enseignement, je veux que l'on me considère
comme un maître ou rien.»
Et, par là, j'appelle la discussion sur la théorie qui remplit
ces volumes, sur le culte du Moi. J'aurai ensuite à m'expliquer de
mon Scepticisme, comme ils disent.