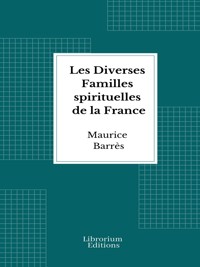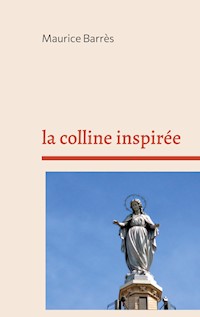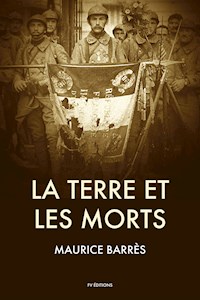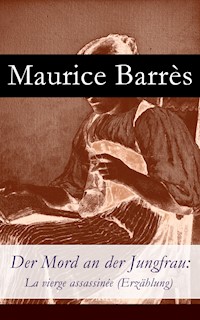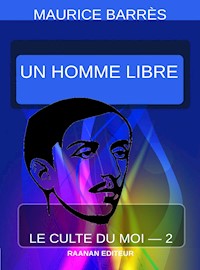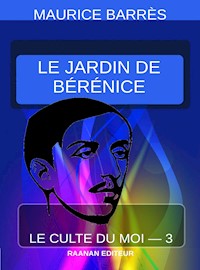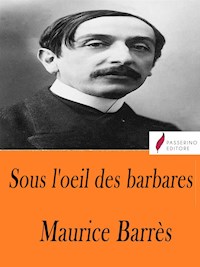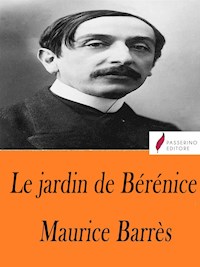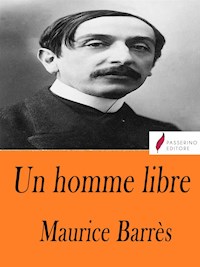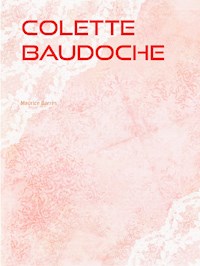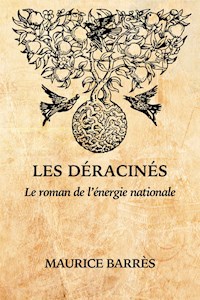Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un chevalier chrétien du XIIIe siècle s'éprend de l'épouse d'un émir ; différentes péripéties vont les réunir ou les éloigner. L'histoire d'amour est ici dissymétrique : le chevalier est preux, naïf et pieux quand la dame est manipulatrice, intéressée, versatile et tentatrice.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un jardin sur l'Oronte
Un jardin sur l'OrontePrologueIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIPage de copyrightUn jardin sur l'Oronte
Maurice Barrès
Prologue
À la fin d’une brûlante journée de juin 1914, j’étais assis au bord de l’Oronte dans un petit café de l’antique Hamah, en Syrie. Les roues ruisselantes qui tournent, jour et nuit, au fil du fleuve pour en élever l’eau bienfaisante, remplissaient le ciel de leur gémissement, et un jeune savant me lisait dans un manuscrit arabe une histoire d’amour et de religion… Ce sont de ces heures divines qui demeurent au fond de notre mémoire comme un trésor pour nous enchanter.
Pourquoi me trouvais-je ce jour-là dans cette ville mystérieuse et si sèche d’Hamah, où le vent du désert soulève en tourbillons la poussière des Croisés, des Séleucides, des Assyriens, des Juifs et des lointains Phéniciens ? J’y attendais que fût organisée une petite caravane avec laquelle j’allais parcourir les monts Ansariehs, pour rechercher dans leurs vieux donjons les descendants des fameux Haschischins. Et ce jeune savant, un Irlandais, chargé par le British Museum des fouilles de Djerablous sur l’Euphrate, une heureuse fortune venait de me le faire rencontrer qui flânait comme moi dans les ruelles du bazar.
Deux Européens perdus au milieu de ces maisons aveugles et muettes, sous un soleil torride, ont tôt fait de s’associer. C’était d’ailleurs, cet Irlandais, un de ces hommes d’imagination improvisatrice qui savent animer chaque minute de la vie et chez qui l’effroyable chaleur de l’été syrien développe cette sorte de poésie qui vient du frémissement des nerfs à nu, une poésie d’écorché vif. Après avoir parcouru la ville et poussé jusqu’aux jardins, qui la prolongent durant quelque cent mètres sur le fleuve, nous avions vu tout et rien.
Quel esprit se cache dans Hamah ? À quoi songent ces Syriens ? On voudrait comprendre, on voudrait apercevoir dans ce décor monotone, au cœur de ces petites maisons, toutes pareilles et toutes fermées, plus que des intérieurs de patios, des intérieurs d’âmes.
— Ne pensez-vous pas, me dit l’Irlandais, que le mieux serait maintenant que nous cherchions des antiquités ?
Un indigène nous conduisit devant une porte qu’il heurta d’une suite de coups convenus, et après quelques pourparlers et les cinq minutes qu’il fallut pour que les femmes se retirassent, nous fûmes introduits dans un divan, où, le café servi, un juif nous montra ses trésors : deux ou trois bustes funéraires de Palmyre, qu’il débarrassa des linges qui les enveloppaient comme les bandelettes d’une momie, des monnaies d’or et d’argent à l’effigie des empereurs syriens, et un manuscrit arabe.
— Le manuscrit, me dit l’Irlandais, après un examen rapide, est d’une écriture médiocre, mais à première vue il me semble très curieux. Il pourrait être d’un de ces métis d’Occidentaux et d’indigènes que les Croisés appelaient, ici, des Poulains et, en Grèce, des Gasmules. Les Poulains (d’où vient ce nom, je l’ignore) étaient les produits de père franc et de mère syrienne, ou de père syrien et de mère franque. Leurs écrits sont rares, et, comme vous pensez, d’un esprit plutôt singulier.
Il est vraisemblable que l’auteur de la Chronique grecque de Morée était un Gasmule, et le récit que voici peut provenir de quelque Poulain appartenant à la maison d’un baron à qui le rattachait sa naissance et qu’il servait comme interprète pour les langues orientales.
C’était une heureuse trouvaille. Mon compagnon acheta les précieux feuillets, je choisis une pièce d’or d’Héliogabale où figure la pierre noire qu’adorait ce jeune dément, et nous allâmes nous asseoir au petit café sous les peupliers de l’Oronte.
Quelques Arabes commençaient d’y arriver, car le soleil descendait sur l’horizon, et déjà les colombes et les hirondelles ouvraient leurs grands vols du soir. Mon savant se plongea dans l’examen de son grimoire, et moi, sous les beaux arbres, – pareils aux arbres de chez nous, mais qu’ici l’on bénit de daigner exister et fraîchir à la brise, – en face de cette eau de salut et devant ces humbles roues de moulin élevées à la dignité de poèmes vivants, je goûtai la volupté de ces vieilles oasis d’Asie, accordées invinciblement avec les pulsations secrètes de notre âme. Inexplicable nostalgie ! À quel génie s’adressent les inquiétudes que fait lever dans notre conscience un décor si pauvre et si fort ? Qu’est-ce que j’aime en Syrie et qu’y veux-je rejoindre ? Je crois que j’y respire, par-dessus les quatre fleuves, un souvenir des délices du jardin que nous ferma jadis l’épée flamboyante des Keroubs.
— Oui, vraiment, une histoire curieuse, dit l’Irlandais, au bout d’une heure qu’il avait passée sans lever le nez de dessus son texte, et d’autant plus intéressante pour nous qu’elle se déroule dans la région. Avez-vous vu sur l’Oronte, en venant d’Homs et non loin du village de Restan, les ruines d’un château et d’un monastère ? Certaines cartes les indiquent sous le nom de Qalaat-el-Abidin, la forteresse des adorateurs. C’est là que vivait au treizième siècle (j’avoue que je viens de l’apprendre) un de ces roitelets voluptueux et lettrés, innombrables dans les annales du monde musulman, qui passaient leur vie au milieu de leurs femmes à écouter des vers et de la musique et à discuter sur des nuances grammaticales ou sentimentales, en attendant que pour finir, soudain, ils disparussent dans un coup de vent comme meurent les roses.
— Bravo ! lui dis-je, voici du renfort. Hamah, cette après-midi, sous le soleil, était vide et sans âme. La nuit descend, faites-moi donc l’immense plaisir de la peupler et d’y appeler ce fou et ces folles pour qu’ils nous distraient.
— À vos ordres, me répondit-il en riant, et vous allez voir une rare collection de jeunes beautés arabes et persanes, toute une série de tulipes éclatantes au cœur noir. Mais faites attention que les Orientaux écrivent des annales plutôt que de l’histoire. Ils juxtaposent les faits sans les lier ni les organiser, et je ne vous avancerais guère en vous traduisant tel quel ce sommaire. Laissez-moi vous dire à mon aise, sans m’astreindre au mot à mot, comment je crois le comprendre, et rappelez-vous les vers de Saadi (peut-être les écrivait-il sur cette berge de l’Oronte) : « Le gémissement de la roue qui élève les eaux suffit pour donner l’ivresse à ceux qui savent goûter le breuvage mystique. Au bourdonnement d’une mouche qui vole, le souffi éperdu prend sa tête entre ses mains. L’ineffable concert ne se tait jamais dans le monde ; seulement l’oreille n’est pas toujours prête à l’entendre. »
— Allez, allez, mes oreilles et mon cœur sont prêts. On s’ennuie trop dans cette Hamah sans âme. Est-ce la peine d’y venir de si loin pour y manquer à ce point de musique ! Lisez-moi votre histoire d’or, d’argent et d’azur. Jamais vous n’aurez d’auditeur mieux disposé que je ne suis, ce soir, à goûter le concert de l’Asie.
Et voici ce que me conta, tard dans la nuit, ce jeune Irlandais, commentant très librement son texte… Croyez-vous qu’il m’ait mystifié et sous couleur d’adaptation conté une histoire de son cru ? Quelqu’un m’a dit qu’il y retrouvait des vers de poètes orientaux, qui n’étaient pas nés à l’époque où se passe ce drame, et, chose plus étrange, quelques lambeaux d’Euripide. Je ne sais que répondre. Ces Irlandais sont de prodigieux fabulistes, et je me rappelle comment Oscar Wilde, s’il avait un cercle à son goût, racontait avec des airs de magicien des histoires qu’il jurait exactes et qui étaient de purs mensonges. Eh bien ! le beau grief ! Qu’importe que mon compagnon ait relevé de sa fantaisie la sécheresse d’un vieux manuscrit ! Toute une nuit, j’ai vu grâce à lui voltiger sur l’Oronte un beau martin-pêcheur… Un oiseau bleu sous les étoiles, c’est impossible ? Pourtant mes yeux l’ont vu. Puissé-je l’amener tout vivant sous les vôtres !
I
Un jour l’Émir de Qalaat reçut une ambassade des chrétiens de Tripoli, désireux d’établir avec lui des rapports de bon voisinage. Il accueillit avec empressement ces porteurs du rameau vert, car il ne rêvait que de jouir en paix de ses richesses, de ses beaux jardins et de son harem, qui passait pour le mieux composé de l’Asie. À leur tête se trouvait un chevalier de vingt-quatre ans, sire Guillaume, plein de cœur, de franchise et d’élan, et qui, malgré sa jeunesse, avait été choisi pour cette mission, parce qu’il excellait dans l’art de bien dire, comme les fameux chevaliers-poètes, et qu’arrivé de France à seize ans, il s’était mis merveilleusement à parler l’arabe. Tout de suite il plut à l’Émir qui avait le goût de renouveler ses plaisirs en les étalant devant un étranger. Et bientôt ils ne se quittèrent plus.
L’Émir l’emmenait à la chasse au faucon, et le reste du temps le promenait dans ses jardins et ses palais, où le jeune chrétien admirait toutes choses avec un entrain inépuisable.
Les jardins de Qalaat étaient réputés parmi les plus beaux de la Syrie, dans un temps où les Arabes excellaient dans l’art d’exprimer avec de l’eau et des fleurs leurs rêveries indéfinies d’amour et de religion. On y voyait les fameuses roses de Tripoli, qui ont le cœur jaune, et celles d’Alexandrie, qui ont le cœur bleu. Au milieu de pelouses parfumées de lis, de cassis, de narcisses et de violettes, rafraîchies par des ruisseaux dérivés de l’Oronte, et ombragées de cédrats, d’amandiers, d’orangers et de pêchers en plein vent, étaient dispersés de légers kiosques, tous ornés de soies d’Antioche et de Perse, de verreries arabes et de porcelaines chinoises.
Mais rien n’approchait des magnificences accumulées dans la forteresse.
Au milieu de ces merveilles, le jeune chevalier-poète riait et chantait toute la journée, et l’Émir aimait à le faire passer sous les fenêtres des kiosques où se tenaient ses femmes, afin qu’elles eussent l’amusement de voir un si curieux personnage. Elles l’admiraient et se gardaient bien de le dire. Mais lui, au bout de quelques semaines, il éprouva un certain vide. Quelque chose manquait à ces délices. Ces divans de soie semblaient dans l’attente d’une présence qui les animât. Quand il traversait les jardins, il voyait sur le sable des empreintes très fines comme en laissent les gazelles, et des coussins parfumés épars sur les pelouses gardaient l’empreinte des corps charmants qui s’y étaient appuyés.
— Seigneur, c’est splendide, dit-il un matin à l’Émir, mais pour compléter ces magnificences ne faudrait-il pas un peu de fraîcheur, le chant d’une flûte, un rire joyeux, des cris, des larmes, la vie ?
— Quelle musique veux-tu que mes musiciens te jouent et quel vin désires-tu que je te fasse verser ?
— Je pense à une ivresse qui s’acquiert sans vin ni musiciens. Nous n’avons pas vos richesses, mais, dames et chevaliers, nous nous réunissons parfois pour entendre des histoires de guerre et d’amour. Dernièrement on nous a récité le merveilleux enchantement de Tristan et d’Iseult, et nous nous réjouissions à regarder de jeunes visages émus par les mêmes sentiments qui nous troublaient.
— Crois-tu, dit l’Émir, que je sois comme le paon qui étale au-dehors toutes ses richesses ? Mes tapis, mes pierreries, mon pouvoir même, qu’est-ce que tout cela, si je n’avais pas en secret quelque chose de plus beau ?
Ce soir-là, il pria Guillaume à souper dans la salle d’honneur de la forteresse. Tous deux seuls, ils étaient assis sur des tapis devant des plateaux qui portaient leur repas. L’air de la nuit circulait librement par les hautes et larges fenêtres et répandait une délicieuse fraîcheur en agitant une gerbe d’eau, jaillie d’un bassin de marbre au centre de la pièce. Les flammes dansantes des torches laissaient mal distinguer les figures de perroquets, de gazelles et de lièvres qui décoraient les frises, les poutres et les panneaux. Une profonde tribune sous laquelle ils étaient installés demeurait dans une complète obscurité.
Tandis que dans une pièce voisine les musiciens jouaient, l’Émir fit boire force vins à son compagnon, puis au moment qu’il crut favorable, leur ayant crié de se taire, il l’invita à lui raconter Tristan et Iseult.
Le jeune homme ne se fit pas prier. Il dit comment ces deux-là burent le philtre d’amour et s’aimèrent invinciblement à travers toutes les misères, et comment nous devons leur pardonner leurs fautes, parce qu’aucun de nous, jeune ou vieux, n’est sûr qu’il ne va pas rencontrer l’être dont il subira jusqu’à la mort la fascination. Il allait poursuivre de tout son élan, mais voici qu’ayant cru soudain entendre de légers bruits de soie froissée, il s’arrêta net et leva la tête vers la tribune obscure.
— Ce n’est rien, sire Guillaume, dit l’Émir ; ce sont les souris qui attendent la fin de notre repas pour en prendre les miettes. Continuez votre beau récit.
Guillaume continua, et puis de nouveau ayant entendu comme des chuchotements :
— Seigneur, dit-il, je crois que les souris de Qalaat aiment autant les histoires qu’aucun bon dîner.
Cette réflexion égaya beaucoup l’Émir. Il se livra à un accès d’un rire désordonné, en donnant de petits coups d’amitié avec le plat de la main sur l’épaule de Guillaume et lui demanda :
— Pourquoi, sire Guillaume, me quitter si rapidement ? Vos compagnons et mes conseillers viennent de s’entendre sur les termes du traité. Nous concluons une trêve de dix ans, dix mois, dix jours et dix heures. Plaise au ciel que j’en fasse autant avec le prince d’Antioche ! Restez donc avec nous quelque temps, puisque nous allons jouir de la paix.
— Seigneur, ce n’est pas seulement pour la guerre que je suis venu en Asie.
— Et pourquoi encore, sire Guillaume ?
— Pour quelque chose que m’a dit ma mère.
— Qu’est-ce donc ?
— Ma mère m’a raconté des histoires de ceux qui se sont aimés jusqu’à la mort, d’un amour si irrésistible qu’ils l’avaient éprouvé avant même de s’être rencontrés, et elle me disait : « Si j’étais un garçon, je m’en irais chercher à travers le monde le bonheur qui m’est destiné. » C’est ainsi que je suis venu près du tombeau du Christ. Je me suis croisé pour faire de grandes choses, pour gagner mon paradis dans le ciel et sur la terre.
J’espérais voir des anges avant même que de mourir. Mais après huit années je pense qu’il y avait dans mon rêve de la démesure, et maintenant je veux rentrer dans mon pays, où ma mère n’est plus, avec l’idée de trouver au chevet de notre église, près de la rivière, l’ange ou la fée que m’a refusé l’Asie.
Cette chaleur d’extravagance plut à l’Émir, et il désira encore plus garder auprès de lui ce jeune homme qui lui excitait l’esprit.
Après un silence, il dit à Guillaume :
— Dans votre pays et d’après vos coutumes, si l’un de vous possède une jeune merveille, il la montre à ses amis ?
— Certainement ! Nous portons ses couleurs, et si nous voulons conquérir l’estime de tous, c’est pour lui faire honneur publiquement.
— Vous avez raison ! Si l’on entend un rossignol, on dit à son ami : « Écoute ! » Si l’on a dessiné et planté un beau jardin, on est content que d’autres l’admirent par-dessus le mur. Eh bien ! le chant de flûte que tu réclames, l’ivresse sans vin ni musiciens, tout cela je l’ai dans un de mes kiosques. Tu sais qu’une touffe de poil blanc au front d’un cheval dénote la pureté du sang et la finesse de la race : je possède cette jeune jument au front étoilé de blanc… Il ne faut pas que tu désespères de trouver ce que ta mère t’annonçait. Le paradis existe sur terre, et tu ne quitteras pas Qalaat sans avoir soupçonné ce que peuvent être les anges des nuits d’Asie.
Il disait ces folies à cause de cette mauvaise vanité qu’il avait de ne jouir des choses que si on l’enviait, et puis sous l’influence de la plus romanesque de ses femmes.