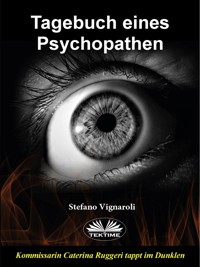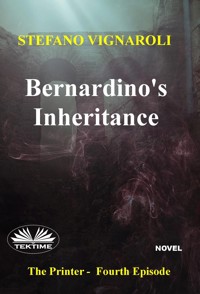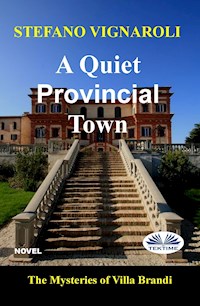5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tektime
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Année 2019 : une fois encore, l'historienne Lucia Balleani et l'archéologue Andrea Franciolini nous prendront par la main et nous guideront à travers les mystères ésotériques de la Jesi de la Renaissance, entre ruelles, passages et palais d’un centre historique qui, à l’aube des années 2020 du XXIᵉ siècle, commence à exhumer d’anciens et précieux vestiges du passé enfouis sous son sol. Les fouilles archéologiques de la Piazza Colocci révéleront en effet des découvertes inattendues, captivant l’attention de toute la population de Jesi. Nous reprenons ainsi le fil des événements du XVIᵉ siècle à travers la mise au jour de documents anciens et d'artefacts historiques par ce jeune couple de chercheurs de notre époque. De nouveaux vents de guerre ramèneront bientôt le Capitaine d’armes de la Cité Royale de Jesi sur les champs de bataille.
Après les deux premiers épisodes de la série « L’Imprimeur », voici enfin l’épilogue, le dernier volet de la saga consacrée à la Jesi de la Renaissance. Nous avions laisse Andrea au seuil de la mort, secouru par sa bien-aimée, dissimulée sous une fausse identité. L’intrigue s’est déplacée à Urbino, mais nos deux héros, Andrea Franciolini et Lucia Baldeschi, devront inévitablement retourner à Jesi pour réaliser leur rêve d’amour. Le mariage doit être un événement grandiose et fastueux, célébré par l’évêque de la ville de Jesi, Monseigneur Piersimone Ghislieri. Mais sommes-nous certains que les sombres machinations, qu’elles soient le fruit du destin ou des hommes, ne viendront pas entraver une fois de plus l’union d’Andrea et Lucia ? Les deux amants se sont enfin retrouvés, et rien au monde ne saurait les séparer de nouveau. Andrea souhaite enfin être un père pour sa fille, Laura, et, pourquoi pas, également pour Anna, la fille adoptive de Lucia. Les deux enfants grandissent en parfaite santé dans la résidence de campagne des Comtes Baldeschi, et Andrea profite de chaque instant à leurs côtés. Mais les vents de guerre souffleront de nouveau, ramenant le Capitaine d’armes de la Cité Royale de Jesi sur les champs de bataille en l’arrachant ainsi à la quiétude et à la paix tout juste retrouvées. Les lansquenets menacent les portes de l’Italie du Nord, et le duc Della Rovere, dans une alliance inattendue avec Giovanni de’ Medici, plus connu sous le nom de Giovanni dalle Bande Nere, fera tout pour empêcher ces mercenaires allemands de parvenir jusqu’à Florence, voire Rome. Éviter le sac de la Ville éternelle en 1527 ne sera pas une tâche facile, ni pour le duc Della Rovere, ni pour Giovanni dalle Bande Nere, et encore moins pour le Capitaine Franciolino de’ Franciolini. Nous suivons une fois encore les événements du XVIᵉ siècle à travers les découvertes de documents anciens et de vestiges archéologiques découverts par la jeune équipe de chercheurs de notre époque. À nouveau, l’historienne Lucia Balleani et l’archéologue Andrea Franciolini nous prendront par la main et nous guideront au cœur des mystères ésotériques de la Jesi de la Renaissance, entre ses rues, ruelles et palais d’un centre historique qui, au seuil des années 2020 du XXIᵉ siècle, commence à exhumer d’anciens et précieux vestiges du passé enfouis sous son sol.
PUBLISHER: TEKTIME
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
À Giuseppe Luconi et Mario Pasquinelli,
illustres concitoyens qui font partie de l'Histoire de Jesi
Stefano Vignaroli
SOUS LE SIGNE DU LION
L’imprimeur – Troisième Épisode
Traduit par Elisabeth Grelaud
©2025 Tektime
Tous droits de reproduction, de distribution et de traduction réservés.
Les passages sur l'histoire de Jesi ont été extraits et librement adaptés des textes de Giuseppe Luconi.
Illustrations du Professeur Mario Pasquinelli, gracieusement accordées par les héritiers légitimes.
Site web http://www.stedevigna.com
E-mail pour les contacts [email protected]
Stefano Vignaroli
SOUS LE SIGNE DU LION
L’imprimeur – Troisième Épisode
ROMAN
INDEX
PRÉFACE
PRÉAMBULE
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CHAPITRE 4
CHAPITRE 5
CHAPITRE 6
CHAPITRE 7
CHAPITRE 8
CHAPITRE 9
CHAPITRE 10
CHAPITRE 11
CHAPITRE 12
CHAPITRE 13
CHAPITRE 14
CHAPITRE 15
CHAPITRE 16
CHAPITRE 17
CHAPITRE 18
CHAPITRE 19
CHAPITRE 20
CHAPITRE 21
CHAPITRE 22
CHAPITRE 23
CHAPITRE 24
CHAPITRE 25
CHAPITRE 26
CHAPITRE 27
CHAPITRE 28
ÉPILOGUE
APPENDICE
NOTES DE L’AUTEUR
REMERCIEMENTS
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
PRÉFACE
Sous le signe du lion clôt magistralement la trilogie d’ambiance Renaissance intitulée L’imprimeur, inaugurée par « L’ombre du clocher » et suivie de « La couronne de bronze ». Les protagonistes, encore une fois, sont l’intrépide condottiere, le marquis Andrea Franciolini, et la jeune comtesse Lucia Baldeschi, condamnés par le destin à reporter constamment leurs noces, sceau d’un grand amour. Avec eux, leurs descendants, Andrea et Lucia les homonymes d’aujourd’hui.
L’appel inattendu aux armes, lancé par le duc d’Urbino le jour du mariage, oblige Andrea à entreprendre un voyage périlleux, d’abord dans le nord de l’Italie, puis aux Pays-Bas, tandis que Lucia doit à nouveau assumer la régence de la ville de Jesi et de ses alentours. Ainsi, le récit se divise : d’un côté, le chevalier errant et ses aventures, jalonnées et enrichies par des rencontres avec des personnages plus ou moins historiques, comme l’astucieux et impitoyable Giovanni dalle Bande Nere, ou encore le duc Franz Vollenweider, un mercenaire, moitié aventurier, moitié lansquenet, d’abord rival puis ami. De l’autre côté, Lucia, mère attentionnée, amante passionnée et gouvernante déterminée dans une époque dominée par les hommes, ne trouve un soutien, un confident et un allié qu’en Bernardino, l’imprimeur.
En toile de fond, le conflit entre l’empereur Charles Quint et le pape, soutenu par ses alliés, du roi de France aux différents seigneurs des cités italiennes, qui nouent et rompent des alliances selon des intrigues machiavéliques. Batailles, intrigues, amours, sabbats au clair de lune et, surtout, deux grands mystères, surgis des entrailles de la terre lors de fouilles sur la place devant le Palais du Gouvernement de Jesi, lient et rythment les destins des Lucia et des Andrea d’hier et d’aujourd’hui.
Un ancien code, convoité même par Hitler, et une icône représentant le lion passant, symbole de la ville, troublent les rêves, suscitent l’angoisse et la soif de connaissance, et incitent à l’action. Une prose fluide restitue non seulement les couleurs, mais aussi les sons et les atmosphères des lieux et des situations, captivant le lecteur de la première à la dernière page dans une montée en intensité concernant le sort des protagonistes.
Vignaroli signe une grande fresque historique, mêlant imagination et érudition, qui scelle dignement le dernier acte d’une remarquable trilogie.
Marco Torcoletti
PRÉAMBULE
Après les deux premiers épisodes de la série « L’Imprimeur », voici enfin le dénouement : le dernier épisode de la saga consacrée à la Jesi de la Renaissance. Nous avions laissé Andrea presque à l’agonie, secouru par son aimée, cachée sous une fausse identité. L’intrigue s’est déplacée à Urbino, mais il est certain que nos deux héros, Andrea Franciolini et Lucia Baldeschi, devront retourner à Jesi pour réaliser leur rêve d’amour. Le mariage devra être un événement festif et somptueux, célébré par l’évêque de la ville de Jesi, Monseigneur Piersimone Ghislieri. Mais sommes-nous sûrs que de sombres machinations, du destin comme des hommes, ne viendront pas une fois de plus entraver l’union d’Andrea et Lucia ? Les deux amants se sont retrouvés, et pour rien au monde ils ne voudraient se séparer à nouveau. Andrea souhaite enfin être un père pour sa fille, Laura, et, pourquoi pas, également pour la fille adoptive de Lucia, Anna.
Les fillettes sont merveilleuses, grandissant en bonne santé et pleines de vie dans la résidence campagnarde des comtes Baldeschi, et Andrea profite de leur proximité. Mais des vents de guerre ramèneront bientôt le condottiere de la Royale Cité de Jesi sur les champs de bataille, le forçant à abandonner la tranquillité et la paix récemment retrouvées. Les lansquenets se pressent aux portes de l’Italie du Nord, et le duc della Rovere, dans une étrange alliance avec Giovanni de’ Medici, plus connu sous le nom de Giovanni dalle Bande Nere, s’efforcera d’empêcher que ces mercenaires allemands n’atteignent Florence, voire Rome. Éviter le sac de la ville éternelle en 1527 ne sera pas une tâche aisée, ni pour le duc della Rovere, ni pour Giovanni dalle Bande Nere, et encore moins pour le capitaine Franciolino de’ Franciolini.
Nous suivons une fois de plus les aventures des personnages du XVIe siècle à travers les découvertes de documents anciens et de vestiges archéologiques effectuées par le jeune couple de chercheurs de notre époque. Une nouvelle fois, l’historienne Lucia Balleani et l’archéologue Andrea Franciolini nous prennent par la main pour nous guider au cœur des mystères de la Jesi de la Renaissance, entre rues, ruelles et palais d’un centre historique qui, au seuil des années 2020 du XXIe siècle, commence à faire resurgir de son sous-sol d’anciens objets importants liés à des époques révolues.
Stefano Vignaroli
CHAPITRE 1
Bernardino, debout sur le seuil de son imprimerie qui donnait sur la Via delle Botteghe, face à l’arc de l’ancienne Domus Verronum, observait avec grande satisfaction le cortège nuptial défiler devant lui. Enfin, après tant d’obstacles et de péripéties, la comtesse Lucia Baldeschi, par un radieux jour de fin d’été 1523, allait s’unir en mariage avec Andrea De’ Franciolini. Plus précisément, avec le marquis Franciolino De’ Franciolini, seigneur de l’Alto Montefeltro et condottiere de la Royale Cité de Jesi.
Le cortège, à proprement parler, avait été précédé par des roulements de tambours et des sonneries de trompettes, des exhibitions de porte-drapeaux, des acrobaties de rapaces élégants lancés en vol par d’habiles fauconniers, et encore par le défilé des familles nobles des différents quartiers de la ville, chacune identifiée par son gonfalon et son étendard. La ville était un véritable festival de couleurs. Chaque rue, chaque ruelle et chaque palais étaient décorés pour la fête. L’air frais de septembre, vers le milieu de la journée, avait cédé sous les rayons du soleil, qui réchauffaient l’atmosphère de manière presque insolite pour la saison, si bien que de nombreux nobles transpiraient sous leurs vêtements de brocart ou de velours. Les plus chanceuses étaient les dames nobles qui avaient opté pour des robes fraîches en soie colorée.
Bernardino avait reconnu les membres des plus importantes familles de Jesi, non seulement grâce aux étendards, mais aussi parce qu’il connaissait bien leurs physionomies : les comtes Marcelli, les marquis Honorati, les Amatori, les Amici et les Colocci. Tous se dirigeaient vers la Piazza San Floriano pour assister à la cérémonie religieuse présidée par le cardinal Piersimone Ghislieri, un évêque très aimé de tous les habitants. C’est après un passage de jongleurs et cracheurs de feu, et une autre exhibition des porte-drapeaux qu’apparut enfin la mariée, magnifique, montée sur un cheval d’un blanc immaculé, dont la crinière, coiffée en fines tresses, tombait de chaque côté du cou élégant de l’animal. Lucia portait une magnifique robe de soie damassée rouge, ornée de motifs floraux brodés en léger relief. L’encolure carrée et les bords des manches étaient agrémentés de dentelle blanche. La robe, longue jusqu’aux pieds, embellie de boutons incrustés de pierres précieuses, était serrée à la taille par une ceinture finement tressée.
La tenue de la mariée ne lui permettait pas de monter à cheval comme une amazone, comme elle était pourtant habituée à le faire. Les deux jambes devaient reposer du même côté de la selle, rendant encore plus difficile et fatigant de maintenir son équilibre. Mais Lucia conservait un regard altier, se tenant légèrement aux rênes, sans jamais croiser directement le regard d’un citoyen. Elle se laissait admirer, sans rendre un seul regard. Ce n’est que lorsqu’elle passa devant Bernardino que son visage s’éclaira, et elle esquissa un sourire en guise de salut à son cher ami et mentor. L’imprimeur le remarqua et s’en réjouit intérieurement. En regardant avec une admiration respectueuse la jeune comtesse Baldeschi, il se rappela que le rouge était la couleur préférée des mariées de l’époque. Le rouge symbolisait la puissance créatrice et donc la fertilité, mais surtout, les tissus de cette couleur étaient les plus coûteux et prisés.
Le cortège nuptial faisait partie intégrante de la cérémonie. Il représentait généralement une ostentation publique des richesses de la famille de la mariée, qui défilait dans les rues de la ville dans sa précieuse tenue de noces, accompagnée par les chevaliers nobles de sa famille. Rien de tout cela pour Lucia Baldeschi, qui n’avait voulu aucun prétendu membre de sa famille à ses côtés. Son élégance sobre et son port étaient presque ceux d’une reine se rendant à l’autel pour épouser son prince. Une reine qui, néanmoins, avait toujours su se faire aimer de son peuple pour ce qu’elle était et non pour ce qu’elle voulait paraître. Et elle n’aurait jamais rêvé de paraître différente, même en ce jour spécial. Tous les citoyens de Jesi avaient appris à l’aimer comme une femme au caractère fort et déterminé, mais aussi à l’âme douce et généreuse.
Bernardino se joignit au cortège qui, peu après, arriverait sur le parvis de l’église San Floriano, où l’époux, accompagné du cardinal Ghislieri, devait attendre. Là, sur le parvis, se tiendrait la cérémonie nuptiale avec l’échange des anneaux. Ensuite, les époux, les célébrants et les invités entreraient dans l’église pour assister à la messe proprement dite.
Bien qu'elle n'en laissât rien paraître, Lucia bouillait d'impatience et d'anxiété. Elle avait hâte de descendre de son destrier et de s'approcher de son époux, de tendre sa main gauche pour qu'il la baisât et la gardât étroitement dans la sienne. Mais dès que le cheval blanc posa le pied sur la place, celle qui avait vu naître l'empereur souabe, il devint tout de suite évident, pour la mariée comme pour tout son cortège, que le capitaine Franciolini n'était pas à sa place sous le dais spécialement préparé devant l'église. L'évêque, le cardinal Ghislieri, accueillit la jeune mariée en ouvrant les bras, visiblement embarrassé. Il était clair qu'il ne savait pas par où commencer pour lui fournir les explications nécessaires.
« Les hommes du duc Della Rovere… Oui, ce sont bien des hommes du duc Della Rovere qui sont arrivés il y a peu. Ils ont échangé quelques mots avec le marquis et lui ont remis une enveloppe scellée. Il l'a lue en un clin d'œil, puis, sans prononcer un mot, il a sauté sur son cheval et est parti au galop derrière ces hommes. Avant de disparaître, il s'est retourné et m'a crié : « Veuillez présenter mes excuses à la comtesse, mais ma présence est requise d'urgence à Mantoue ! »
CHAPITRE 2
La forteresse des princes de Carpegna était un refuge sûr, grâce à l’inaccessibilité du lieu, perché sur un éperon rocheux dominant un hameau de quelques maisons sur le Mont de la Carpegnia. Deux mois s’étaient écoulés depuis le mémorable 27 mars 1523, jour où Andrea avait été grièvement blessé lors d’un tournoi chevaleresque par la main du lâche Masio de Cingoli. Il était évident que ce dernier, jaloux de sa position, espérait sa mort ou, au moins, une invalidité grave pour se placer dans les bonnes grâces du duc Della Rovere à sa place. Il avait tout tenté, mais son plan avait échoué.
Andrea avait appris plus tard que, ce même jour, le 27 mars, le pape Adrien VI avait signé une bulle légalisant la position de Francesco Maria Della Rovere, confirmant en sa faveur toutes les concessions accordées par les papes précédents et annulant la sentence de Léon X, qui attribuait les territoires d’Urbino et du Montefeltro aux Médicis. Le duc avait été réintégré dans sa fonction et ses territoires lui avaient été restitués, moyennant un cens annuel de 1 340 florins pour le duché d’Urbino, 750 pour la ville de Pesaro et 100 pour Senigallia. Seuls San Leo et Maiolo, où s’étaient installées les troupes de Giovanni de’ Medici, mieux connu sous le nom de Giovanni dalle Bande Nere, entre janvier et février 1523, restaient sous le contrôle des Médicis, servant de zone tampon entre les terres de Montefeltro et celles des Médicis.
Andrea s’était remis très lentement, en raison de la grave perte de sang qu’il avait subie et de la blessure à un bras déjà endommagé lors du sac de Jesi. En rouvrant les yeux après plusieurs jours d’agonie, il avait espéré retrouver à son chevet son aimée Lucia, comme cela s’était produit lorsqu’il avait été blessé des années auparavant. Au lieu de cela, la seule présence qu’il percevait était celle d’un frère franciscain, occupé à préparer des décoctions et des cataplasmes dont Andrea doutait des vertus curatives. Peut-être ce moine avait-il été instruit par la comtesse elle-même, qui, ne pouvant rester à son côté, lui avait confié ses remèdes. Andrea gardait néanmoins gravée dans son esprit l’image des yeux inoubliables de Lucia, aperçus à travers la visière d’un casque avant qu’il ne perde connaissance. Mais en était-il sûr ? Ou était-ce son imagination, nourrie par la peur de la mort, qui déformait la réalité en faveur de pensées bienveillantes ?
Quelles que soient les circonstances, il allait mieux. Son épaule lui faisait toujours souffrir des douleurs lancinantes, mais il était temps de se remettre complètement et de penser à sa vengeance contre Masio. « La vengeance est un plat qui se mange froid. » Andrea avait eu tout le temps de réfléchir à ses projets.
Il reprenait des forces peu à peu, et les plateaux du Mont Carpegna étaient l’idéal pour des chevauchées tranquilles et revigorantes. On ne risquait pas d’embuscades, car l’horizon entièrement dégagé ne permettait à personne d’arriver en cachette. Ainsi, pour fortifier son esprit et ses muscles, Andrea avait pris l’habitude de seller un cheval docile tôt le matin et de sortir respirer l’air pur et frais que seule la montagne pouvait offrir. Chaque jour, il se sentait plus fort et plus sûr de lui, même si son épaule le faisait encore souffrir. Mais il serrait les dents, résistait comme si de rien n’était, et les douleurs s’évanouissaient rapidement, comme neige au soleil.
Il aspirait à retrouver la santé pour rejoindre au plus vite son aimée et sa ville, pour honorer la promesse de mariage, mais aussi pour reprendre en main le gouvernement de la ville. Grâce à ce qui lui avait été accordé par le duc Della Rovere, il pouvait revendiquer tout cela en toute légitimité. Il n’était plus seulement le fils d’un marchand, bien qu’il eût été nommé capitaine par le peuple de Jesi. Il était désormais noble, un marquis, avec des terres, même si elles étaient austères et montagneuses, et il jouissait de la faveur du duc d’Urbino. Certes, il devait obéissance à ce dernier, mais il se sentait capable de revenir à Jesi en toute autonomie.
Plongé dans ses pensées, Andrea aperçut soudain, au loin, un nuage de poussière soulevé par un groupe d’hommes à cheval qui remontaient la route de terre menant à la forteresse. De loin, il entendit les appels des sentinelles depuis les remparts.
Même si les voix ne semblaient pas alarmées, le coup de canon retentit pour avertir de l’arrivée d’un ennemi potentiel. Puis, les sonneries des cloches firent comprendre à Andrea qu’il n’y avait pas de danger, que ceux qui approchaient n’étaient pas sur le pied de combat. Lorsque le groupe commença à se distinguer plus nettement, il remarqua un cavalier à l’allure plus fière, monté sur un destrier dépassant en hauteur tous les autres palefrois montés par des hommes d’armes aux armures légères. Les couleurs étaient celles des Médicis.
« Giovanni De’ Medici », se dit Andrea en lui-même, « le fameux et redouté Giovanni delle Bande Nere, ou plutôt Ludovico di Giovanni De’ Medici, officiellement renié par sa famille en tant que fils illégitime de Giovanni il Popolano, mais tout de même encore étroitement lié à elle. Pourquoi donc serait-il venu jusqu’ici ? Aurait-il appris ma présence ? Serait-il venu me défier ? Voudrait-il reprendre les territoires du haut Montefeltro au nom de sa famille ? »
L’arrivée inattendue inquiétait un peu Andrea, d’autant plus qu’en cas d’affrontement avec les sbires des Médicis, il n’aurait à ses côtés que quelques hommes au service des comtes de Carpegna. Et cela faisait bien pâle figure face à la renommée qui précédait les soldats de fortune du capitaine Giovanni des Bandes Noires. Il se retourna vers la forteresse, pensant qu’il serait plus sage de s’entretenir avec le Médicis avec plus de sécurité derrière des murs et entouré d’hommes de confiance. Mais il aperçut déjà les comtes de Carpegna, les frères Piero et Bono, qui accouraient à bride abattue pour lui prêter main-forte. Rassuré de savoir ses arrières protégés, il se tourna de nouveau vers les ennemis potentiels, qui étaient maintenant à quelques pas de lui. Andrea posa la main sur la garde de son épée, fixée à la selle de sa monture, la serrant, prêt à la dégainer au moindre signe d’hostilité de la part des nouveaux arrivants.
Le Dalle Bande Nere leva un bras, ordonnant à son escorte de s’arrêter. Puis, d’un bond, il descendit de cheval et s’avança à pied, les bras grands ouverts et levés. Le geste était clair, et Andrea se détendit, retirant la main de son arme et descendant lui aussi de cheval. Quand l’homme fut à quelques pas de lui, il s’inclina profondément. Andrea l’observa, le jaugea de la tête aux pieds, cherchant à comprendre pourquoi un homme d’apparence si douce était associé à une réputation de guerrier impitoyable.
C’était un jeune homme, âgé d’à peine vingt-cinq ans, le visage orné d’une barbe soignée, pas trop longue. Ses cheveux, foncés et coupés courts, étaient bien visibles puisqu’il ne portait pas de heaume, et encadraient un visage rond à l’air serein. L’homme n’était même pas très grand, vu ainsi à pied. Il devait probablement préférer monter des chevaux hauts et imposants pour dominer ceux qui l’entouraient. Il portait un pourpoint couleur terre brûlée, orné à l’avant des cinq boules rouges et du lys à trois pétales, symbolisant sa fidélité à sa famille d’origine.
« C’est un honneur pour moi de vous voir ici, messire », dit Andrea en esquissant à son tour une révérence en guise de salut, impatient de connaître la raison de cette visite inattendue. « Alors, puis-je savoir ce qui vous a poussé à quitter la forteresse de San Leo, votre bastion incontesté, pour venir jusqu’au mont de Carpegna, un terrain qui vous est hostile et plein de périls »
Giovanni esquiva la question avec un sourire, puis Andrea le vit s’approcher davantage, jusqu’à poser une main sur son épaule, presque en geste d’amitié. De lui ? De celui qu’il considérait comme un ennemi ? Devait-il s’attendre à tomber dans un piège ? La méfiance était de mise. Andrea se raidit, et l’autre abaissa son bras avant de commencer à parler.
« J’apporte de bonnes nouvelles pour vous, peut-être un peu moins pour moi », entama le Médicis. « Le duc d’Urbino s’est entendu avec le nouveau pape, et… »
« Vous me racontez des choses dont je suis déjà informé. L’accord avec Adrien VI a eu lieu il y a deux mois ! »
Un nouveau sourire se dessina sur les lèvres de son interlocuteur.
« Ne m’interrompez pas, laissez-moi terminer. Je ne parle pas du pape qui, je pense, ne siègera plus très longtemps sur le trône pontifical. Je parle de l’évêque de Florence, Giulio de Médicis, qui prendra bientôt la place qui lui revient. Les rumeurs disent qu’Adrien Florensz est en très mauvaise santé et qu’il n’a plus longtemps à vivre. Si le bon Dieu ne le rappelle pas à lui, il devra de toute façon renoncer bientôt à sa charge. Et la papauté reviendra à nouveau à la maison des Médicis. »
« Et vous êtes ici pour me faire croire que mon seigneur, le duc Della Rovere, ennemi juré de votre maison, s’est déjà secrètement entendu avec l’évêque de Florence, avant même d’avoir la certitude qu’il sera élu au trône pontifical ? Mais voyons, épargnez-moi vos balivernes ! »
« Croyez-moi ! Pour vous prouver ma bonne foi, je vous ai apporté un présent que je suis certain que vous apprécierez. »
D’un claquement de doigts, Giovanni fit signe à l’un de ses sbires restés à distance de s’approcher. Ce dernier sauta à terre et s’avança, déposant près de son maître un grand panier d’osier.
Puis il s’inclina profondément et fit demi-tour. La tension était palpable, presque oppressante, et un silence pesant régnait. Même les comtes de Carpegna s’étaient arrêtés à une distance respectueuse, attendant de voir comment les événements allaient se dérouler. Le seul bruit perceptible était celui des étendards battant au vent. Giovanni souleva le couvercle du panier et en sortit son macabre contenu, le brandissant devant Andrea. Une tête tranchée net au niveau du cou, encore dégoulinante de sang, les cheveux emmêlés dans les doigts de celui qui, bras tendu, agitait fièrement ce sinistre trophée sous son nez. Andrea réprima de justesse un haut-le-cœur, mais il reconnut immédiatement à qui avait appartenu cette tête de son vivant.
« Votre pire ennemi, messer Franciolini ! Masio de Cingoli. Comme vous le voyez, je me suis chargé de faire en sorte qu’il ne vous cause plus de soucis. Vous devriez m’en être reconnaissant ! »
« En vérité, j’avais d’autres intentions pour lui. J’avais prévu d’exposer les faits au duc Della Rovere dans une missive dont j’avais déjà en tête le contenu, afin de réclamer un procès équitable pour cet individu. Loin de moi l’idée de le tuer sans intervention de la justice. Si je l’avais fait, je ne vaudrais pas mieux que lui. Jamais on ne pourra dire que le marquis Franciolini est un lâche ! »
« Vous auriez toujours pu le défier en duel, mais puisque quelqu’un d’autre s’en est occupé, votre honneur est sauf, et vous pouvez vous estimer satisfait. » Sur ces mots, Giovanni des Bandes Noires jeta avec mépris la tête de Masio à terre, près des pieds d’Andrea, reprenant aussitôt la parole avant que celui-ci n’ait le temps de répondre. « Mais il y a plus, et c’est une bonne nouvelle pour vous. Mes hommes et moi quittons San Leo. Étant donné les termes de l’alliance entre les Médicis et le duc Della Rovere, il n’y a plus rien à craindre dans cette région. Dans les jours à venir, les communautés de San Leo et de Maiolo reviendront sous votre juridiction. Notre présence est désormais requise à Brescia.
Il semblerait que les lansquenets aient quitté Bolzano et assiègent déjà les portes de cette ville. Les Gonzague d’un côté et les Visconti-Sforza de l’autre se sentent menacés, car la majeure partie des forces vénitiennes est actuellement engagée en Dalmatie pour repousser les attaques ottomanes. Le Della Rovere, seul, ne peut faire face à ces bandes de mercenaires, et personne ne souhaite qu’à leur suite l’armée de Charles Quint de Habsbourg menace des villes comme Milan, Florence, ou pire encore, Rome. On a besoin de mes soldats de fortune, et notre ami commun, Francesco Maria, l’a bien compris ! »
« Si je n’étais pas dans cet état, le Duc aurait certainement convoqué moi et mes hommes pour combattre à ses côtés, plutôt que ce sanguinaire au visage d’ange », se dit Andrea en lui-même, prenant bien soin de ne pas exprimer cette pensée à voix haute. « Mais, au fond, peut-être que c’est mieux comme ça. Une fois le Médicis parti, ces territoires seront calmes pour le moment, et je pourrai, dès que possible, retourner à Jesi et épouser la comtesse Lucia. »
Il jeta un dernier regard à la tête de Masio, en éprouva de la pitié, la ramassa et la remit dans le panier, qu’il referma avec son couvercle, puis se tourna vers Giovanni.
« Je suis content pour vous, messer Ludovico », dit-il en appuyant intentionnellement sur ce nom, conscient de combien il déplaisait à la personne en face de lui d’être appelée ainsi. « Je vous remercie pour tout et vous souhaite bonne chance. »
Sur ces mots, il se retourna, monta en selle, rejoignit Piero et Bono, qui avaient jusqu’alors été de silencieux spectateurs, et reprit avec eux le chemin de la forteresse, poussant sa monture à un pas rapide.
« Un fanfaron, rien d’autre à dire ! » lâcha Piero de Carpegna.
« C’est sûr ! » répondit Bono.
« Laissez tomber », intervint Andrea. « Il ne nous causera plus de souci, et c’est l’important. En revanche, faites récupérer le panier avec la tête de Masio. Je veux qu’elle reçoive une sépulture digne. Je ne supporte pas que quelqu’un se soit arrogé le droit de rendre justice en mon nom, et je ne veux pas qu’on dise que j’ai accepté avec plaisir l’exécution sommaire de ce lâche. Lâche il était de son vivant, et lâche il restera. Mais moi, je ne suis pas comme lui ! »
« Et c’est vrai ! » répondit Piero. « Vous avez une âme noble et généreuse, et nous l’apprécions tous. Nous veillerons à ce que les restes mortels de Masio soient convenablement enterrés. D’ailleurs, nous enverrons également quelqu’un chercher le reste du corps, une fois que Giovanni delle Bande Nere aura quitté San Leo. »
CHAPITRE 3
Eleonora était magnifique. Son corps nu, alangui sur le lit, perlé de sueur, reflétait les flammes de la cheminée, en prenant une teinte ambrée qui ravivait à nouveau le désir de Francesco Maria. Faire l’amour avec son épouse était infiniment plus gratifiant que le faire avec une servante ou, pire encore, avec une prostituée. Il tendit une main pour effleurer un de ses tétons. Il le sentit se durcir sous son toucher délicat, puis il vit Eleonora bouger, s’éveiller de sa torpeur et se pencher à nouveau vers lui. Leurs bouches se joignirent en un long baiser. Une rencontre de lèvres, de langues, de corps nus brûlants d’envie de s’unir encore, dans un enchevêtrement de longues chevelures, blondes pour elle, sombres pour lui.
Avant de pénétrer à nouveau sa femme, le duc plongea ses yeux sombres, presque noirs, dans ceux d’un bleu azur d’Eleonora.
« Je t’aime », lui murmura-t-il, conscient que ces deux mots, en apparence si simples et évidents, il ne les aurait jamais prononcés devant une autre femme. En réponse, Eleonora prit son visage entre ses mains chaudes, caressa sa barbe rêche et l’incita à s’allonger sur les draps de lin. Puis, elle se plaça à califourchon sur lui, faisant glisser son membre tendu entre ses cuisses. Francesco Maria était en extase. Il adorait qu’elle prenne l’initiative. Il regardait Eleonora osciller au-dessus de lui, dans une montée en puissance de mouvements ondulants, dans un rythme toujours plus rapide et insistant. Des gouttes de sueur, tombant de son front, perlaient son torse, ses joues, son propre front. Il glissa ses mains de guerrier le long des hanches de sa fougueuse cavalière, jusqu’à atteindre ses seins qu’il commença à caresser en mouvements circulaires. Il sentit Eleonora s’exciter davantage, son souffle haletant se transformant presque en cri de plaisir. Il comprit qu’il ne pouvait plus se retenir et inonda le ventre de sa femme, qui, atteignant l’orgasme, poussa un cri encore plus fort avant de s’effondrer sur lui, veillant à ce que son membre reste lové dans son giron. Francesco soupira, comblé par cette nuit d’amour, attendant que son érection s’apaise doucement, puis il déplaça délicatement le corps féminin inerte. Il savait bien qu’après un troisième ébat, Eleonora s’endormait profondément. Il s’assura que sa respiration était régulière, recouvrit son corps nu avec un drap et quitta le lit pour enfiler ses bas et ses braies.
Il porta à sa bouche quelques grains de raisin blanc et, pensif, s’approcha de la fenêtre pour admirer les reflets argentés de la lune sur les eaux du lac. Cela faisait quelques mois qu’il était hôte du château de la famille des Della Scala de Sirmione, une forteresse entourée d’eau de tous côtés et construite en position stratégique, sur la rive sud du lac de Garde, par les seigneurs de Vérone pour repousser les redoutables ennemis descendant inévitablement des Alpes le long de la vallée de l’Adige. Et en cette période, l’ennemi était encore plus redoutable, car il ne s’agissait pas d’une armée régulière, mais de bandes armées sanguinaires de mercenaires allemands, les lansquenets, qui combattaient au profit de l’empereur Charles Quint de Habsbourg, mais à leur manière.
Les eaux du lac étaient calmes en cette nuit de mi-novembre, et le paysage environnant, illuminé par la lune et surplombé par les silhouettes des montagnes, était véritablement enchanteur. Depuis la fenêtre, Francesco Maria pouvait jeter un coup d’œil sur le port en contrebas, une grande cour de forme irrégulière, délimitée par les murailles du château et envahie par les eaux du lac. Par une ouverture dans l’enceinte, des bateaux, même de bonne taille, pouvaient trouver un refuge sûr à l’intérieur. Le port servait de base pour la flotte de la famille des Della Scala, une flotte qui, rarement, voyait la mer ouverte, le lac ne possédant aucun émissaire navigable menant aux rivages de l’Adriatique. Ce n’était qu’au prix de manœuvres complexes à travers des canaux artificiels et des champs inondés que les embarcations pouvaient être transférées jusqu’au grand port de la citadelle fortifiée de Mantoue. De là, via le Mincio, elles pouvaient facilement rejoindre le grand fleuve Pô, l’antique Eridanos, et enfin naviguer vers les territoires vénitiens et la mer Adriatique.
En regardant au-delà des murailles nord, Francesco Maria ne pouvait pour l’instant observer que des eaux tranquilles, parsemées ici et là de coques de bateaux, et des bastions montagneux dont les sommets avaient déjà commencé à se couvrir de la première neige. Mais l’ennemi pouvait surgir à tout moment, et le Duc n’était pas à l’aise avec la présence de son épouse Eleonora et de sa suite en ce lieu. Certes, d’un côté, il était heureux de pouvoir profiter de sa compagnie et des étreintes amoureuses comme celle qui venait de s’achever, mais d’un autre, il craignait pour sa sécurité.
Près de vingt ans s’étaient écoulés depuis leur mariage. Bien sûr, ils n’étaient alors que deux adolescents de quinze ans, unis par un mariage politique destiné à renforcer l’alliance entre les familles d’Urbino et de Mantoue. Mais les occasions de passer du temps ensemble avaient été rares. Elle vivait à Mantoue, à la cour des Gonzague, tandis que lui se trouvait dans les Marches, engagé dans un combat perpétuel. Leur premier enfant, Guidobaldo, qui avait maintenant neuf ans, était arrivé près de dix ans après leurs noces, et ces deux derniers mois représentaient la première véritable période où Francesco Maria avait pu pleinement profiter de sa proximité.
Maintenant que la famille était réunie, il envisageait même d’avoir d’autres enfants, peut-être une fille, afin de ne pas léser son héritier Guidobaldo. Pourtant, malgré leurs récents moments d’intimité répétés, Eleonora ne semblait pas tomber enceinte. Était-elle déjà trop âgée pour concevoir à nouveau ? Mais non ! Après tout, elle n’avait que trente-trois ans. Ce n’était plus une jeune fille, certes, mais elle était encore en âge de procréer.
Dans tout cela, son cœur était partagé : d’un côté, il souhaitait garder sa femme près de lui pour profiter de son amour et de sa présence ; de l’autre, il pensait à la renvoyer à Mantoue pour la protéger des horreurs d’une éventuelle bataille contre les redoutables lansquenets.
Ces jours-là, la nouvelle de la mort du pape Adrien VI était parvenue, rapidement remplacé sur le trône pontifical par Giulio de’ Medici, sous le nom de Clément VII. Ce n’était pas un événement inattendu. Francesco Maria l’avait prévu, et ses émissaires avaient fait en sorte de conclure des accords avec le Médicis avant même son élection. Cependant, ce qui le préoccupait, au point de l’empêcher de dormir, même après une étreinte satisfaisante avec la belle Eleonora, était la réaction de Charles Quint face à cette nouvelle situation.
Il bougerait, bien sûr, et sur plusieurs fronts : officiellement contre la France de François Ier Valois, son éternel ennemi ; et officieusement, en laissant les lansquenets déferler sur l’Italie du Nord pour soumettre Milan, viser Florence et Rome, et réunir tous les territoires italiens – en plus de Naples, de la Sicile et de la Sardaigne déjà sous contrôle – sous une seule couronne impériale. Il serait difficile d’empêcher l’armée allemande, une fois la voie ouverte par les lansquenets, d’atteindre Rome, de la piller, puis de descendre jusqu’à Naples, alliée de Charles Quint.
Il ne restait qu’à espérer la bravoure et l’ingéniosité de Giovanni Ludovico de’ Medici, ainsi que celle de son fidèle homme, le marquis de l’Alto Montefeltro, qu’il attendait avec impatience chaque jour.
Les pensées de Francesco Maria furent interrompues par l’apparition d’un grand navire à trois mâts battant pavillon de la Sérénissime République. Depuis les eaux du lac, il demandait l’ouverture de la porte d’accès à la darse. Tandis que les gardes sur les remparts procédaient aux manœuvres complexes nécessaires pour ouvrir la porte, le duc remarqua, à côté de l’étendard arborant le lion de Saint-Marc couché avec le livre ouvert entre les pattes, un autre drapeau plus petit représentant un lion rampant couronné. À la lumière de la lune, il distingua clairement les motifs des bannières, malgré l’obscurité de la nuit. Son cœur s’allégea : ce drapeau était le signal convenu avec ses hommes. Le marquis Franciolino Franciolini, ou plutôt son condottiere de confiance, Andrea Franciolini de Jesi, était enfin arrivé.
Le cœur battant, Francesco Maria acheva de s’habiller et descendit rapidement les escaliers pour rejoindre un grand salon et attendre avec impatience l’arrivée des invités. Tous ceux qui débarquaient devaient passer par cette salle après les manœuvres d’amarrage. Le duc fit appeler quelques domestiques pour dresser une table afin d’accueillir comme il se devait les nouveaux arrivants. Même tard dans la nuit, un bon repas serait le bienvenu après un long voyage.
Les premiers à débarquer furent les serviteurs, qui entassèrent sur le quai malles et effets personnels des nobles guerriers ayant accompagné la traversée. Les domestiques du château se précipitèrent pour transporter les bagages vers les chambres attribuées à chacun et guider les serviteurs débarqués vers les ailes du château qui leur étaient réservées, où ils pourraient se restaurer, se reposer et, s’ils le souhaitaient, profiter de la compagnie de quelques courtisanes.
Les marins descendirent ensuite, et ils se dirigèrent rapidement vers les portes menant à la ville de Sirmione, au sud des remparts de la darse. Ils étaient impatients de rejoindre les tavernes, festoyer, boire du vin et séduire les villageoises locales, réputées dans toute la péninsule pour leur passion et leur disponibilité. Ces femmes, avec leur accent chantant, savaient ouvrir le cœur même du marin le plus bourru, pour quelques deniers seulement, bien moins qu’ailleurs.
Les derniers à descendre de la grande embarcation furent les nobles guerriers, chacun escorté par ses propres serviteurs. Un à un, ils franchissaient le seuil de la vaste salle où ils étaient accueillis par le duc Della Rovere, qui les invitait à congédier leurs subalternes et à s’asseoir à la table garnie. La fête allait bientôt commencer, la nourriture ne manquerait pas, et le vin coulerait à flots.
À un signe du duc, des servantes vêtues de robes colorées et transparentes, qui ne laissaient rien à l’imagination, commencèrent à danser de manière ondoyante sur un côté de la salle, au rythme d’un chant évoquant des atmosphères exotiques. Ces femmes, capturées et réduites en esclavage lors des campagnes de la Sérénissime contre l’Empire ottoman, venaient des terres du Proche-Orient et savaient faire onduler leur ventre de manière indépendante du reste de leur corps.
À un second signe du duc, les jeunes filles se débarrassèrent de leurs tuniques colorées, ne conservant que de minuscules costumes couvrant leur poitrine et leur pubis. La musique changea, et les jeunes servantes, toutes plus belles et plus sensuelles les unes que les autres, se mirent à exécuter une danse du ventre provocante.
Pendant ce temps, les serviteurs déposaient sur la table une profusion de mets exquis : pâtés de lièvre, rôtis de sanglier, gibier à la sauce aigre-douce, lapins en civet, légumes aux couleurs variées, bouillons de poulet et de bœuf parfumés aux épices. Les cruches de vin n’avaient pas le temps de rester sur la table qu’elles devaient déjà être remplacées par d’autres pleines. Francesco Maria passait en revue les visages de ses invités. Le duc d’Orvieto, une cuisse de poulet à la main et une chope de vin dans l’autre, s’était déjà rapproché de l’une des danseuses, envoyant des baisers avec ses lèvres grasses dans sa direction. Celle-ci, en réponse, s’était débarrassée de la partie supérieure de son costume et était restée seins nus en continuant à danser d’une manière encore plus provocante. Le marquis de Villamarina, de son côté, s’était installé à table avec l’intention sérieuse de manger et de boire à satiété, se moquant presque du spectacle de danse. Cependant, il hochait la tête au rythme de la musique. Messire Vittorio dei Gherardeschi, comte de la chasse et seigneur des terres de Polverigi, regardait autour de lui avec un air un peu perdu, comme si tout ce qui se passait dans le salon ne le concernait pas du tout. Il s’approcha de Francesco Maria, le salua respectueusement et demanda à être conduit à ses appartements, car il était très fatigué et souhaitait se reposer.
Le duc Della Rovere avait scruté tout le monde, mais il n’avait pas encore réussi à repérer Andrea. Ce dernier, de manière totalement inattendue, entra à un moment donné dans le salon par l’entrée opposée à celle utilisée par tous les autres, celle qui provenait de la terre ferme, du centre habité de Sirmione. Andrea avait l’air éprouvé, il était très pâle et ses yeux étaient cernés.
« Mon Dieu, Andrea ! On dirait vraiment que les bateaux sont ton pire ennemi ! » dit Francesco Maria en s’approchant de son ami pour l’étreindre affectueusement. « Heureusement, j’ai d’autres projets pour toi, et nous en parlerons tranquillement demain. Pour l’instant, installe-toi et profite pleinement de mon hospitalité. Tu pourras revigorer ton corps et ton esprit, et demain tu te sentiras comme un autre homme ! »
Il vit Andrea regarder autour de lui, admirer la table bien garnie, jeter un œil aux danseuses orientales qui, désormais presque toutes seins nus, certaines même complètement nues, s’offraient aux désirs réprimés des nobles guerriers. Puis le jeune condottiere s’approcha de la table, picora quelques olives en saumure, but une coupe de vin et exprima le souhait de se retirer.
« Raconte-moi ton voyage, Andrea ! Pourquoi as-tu quitté le bateau et es-tu arrivé ici par voie terrestre ? » tenta de le retenir Francesco.
« Mon cher ami, tu l’as toi-même dit à l’instant. Nous en parlerons demain calmement. Pour l’heure, je suis très fatigué et je veux simplement me retirer pour me reposer. »
« Veux-tu que je t’envoie de la compagnie dans ta chambre ? Ces beautés exotiques sont capables de ressusciter un cadavre ! »
« Mais pas moi. En ce moment, je ne pourrais pas effleurer une femme, autre que ma fiancée, même du bout des doigts. Fais comme si j’avais accepté ton offre et emmène la jeune fille dans ta chambre. »
Francesco Maria éclata de rire.
« Impossible ! Il y a déjà Eleonora dans mes appartements. Moi non plus, ces jours-ci, je ne peux effleurer aucune autre femme que ma bien-aimée. »
CHAPITRE 4
« Chacun est ce qu’il poursuit.
Je suis ce que je suis, je suis ce que j’aime,
j’aime ce que je suis. »
(Elio Savelli)
Andrea ne parvenait toujours pas à comprendre pourquoi il avait suivi sans hésiter les hommes du Duc, juste avant la cérémonie de mariage avec sa bien-aimée Lucia. Son puissant destrier blanc, encore paré pour la fête, avalait la route sans difficulté, suivant sans effort les hommes en armes qui galopaient à vive allure au-delà de l’Esino, en direction de Monte Returri. La chevauchée était aisée, sans armure ni heaume. La chevelure blonde et abondante d’Andrea flottait dans l’air, effleurant le vent. Les manches de son pourpoint cramoisi se gonflaient et se dégonflaient au gré des caprices de la brise. Mais l’esprit d’Andrea était en tumulte. Des pensées incontrôlables se bousculaient dans sa tête, cherchant à se frayer un chemin vers ses tempes, espérant être prises en compte avec sérieux.
« Tu as toujours voulu t’unir à Lucia par le mariage. Et maintenant que le moment était enfin venu, qu’as-tu fait ? Tu l’as abandonnée là, sur le parvis de l’église ! », l’attaqua la première pensée. Souviens-toi, Andrea ! Chacun est ce qu’il poursuit dans la vie ! Ne pas atteindre ses objectifs, c’est échouer misérablement. »
« Je suis ce que je suis ! », se défendit Andrea contre lui-même. « J’aime être ce que je suis. Et je suis un homme d’armes, et en tant que tel, je dois obéissance à mon seigneur. J’ai donc fait le bon choix. On ne peut se soustraire à son devoir pour une demoiselle. »
« Tu aimes ce que tu es, mais tu es aussi ce que tu aimes », riposta une seconde pensée, sans lui laisser de répit, dans un incroyable jeu de mots. « Et celle que tu aimes, c’est Lucia. Avec elle, tu devrais être un seul corps et une seule âme. Quelle différence cela faisait-il de suivre ces hommes maintenant, immédiatement, plutôt que demain, après-demain ou dans une semaine ? Et ta petite Laura, à qui tu as souri ce matin même pour lui faire comprendre qu’elle pouvait désormais compter sur l’affection d’un père, que pensera-t-elle de toi ? Que tu es un lâche, que tu te dérobes à l’amour et aux sentiments au gré du vent. N’aurais-tu pas au moins pu lui expliquer pourquoi tu t’en allais ? »
« Je ne suis pas une fillette, je suis un condottiere ! », répliqua vigoureusement l’esprit guerrier d’Andrea. « Si ces hommes étaient si pressés de m’emmener, il doit y avoir une raison grave, comme j’ai pu le lire dans la missive du Duc. Un guerrier ne se soustrait jamais à son devoir. Jamais ! Encore moins pour des questions d’amour. L’amour peut attendre, l’ennemi non. »
Perdu dans ces débats mentaux, Andrea ne s’était même pas rendu compte que, après avoir dépassé la tour de guet au sommet de Monte Returri et traversé le petit bourg de Santa Maria delle Ripe, le groupe de soldats descendait rapidement vers la vallée du fleuve Musone. Il mit un terme à ses pensées et se concentra sur le chemin. Si leur destination était Mantoue, la route qu’ils suivaient n’était pas la bonne : elle descendait vers le sud. Logiquement, ils auraient dû emprunter la route de Fiammenga jusqu’à Monte Marciano, puis remonter le long de la côte adriatique jusqu’à Ravenne, pour ensuite bifurquer vers Ferrare. De là, atteindre Mantoue aurait été facile et sans difficulté. Mais la route actuelle les menait directement au château souabe du port, au sud du mont d’Ancône, entre l’embouchure du fleuve Musone et celle du Potenza. Ce château avait été construit à l’époque par Frédéric II pour défendre et protéger un important port destiné à accueillir la flotte gibeline. Rien qu’à la pensée de la mer, Andrea sentit une nausée monter en lui.
Et bientôt, en effet, la vallée du Musone s’ouvrit vers la mer Adriatique. Ils laissèrent sur leur droite, en hauteur sur la colline, l’imposante basilique de Loreto, dédiée au culte de la Vierge et protégée par de puissants bastions. Andrea et ses compagnons empruntèrent une large route pendant plusieurs lieues, jusqu’à ce qu’ils aperçoivent leur destination. La silhouette du château souabe, avec son donjon imposant s’élançant vers le ciel, se rapprochait rapidement. Le soleil déclinait déjà vers l’horizon, et en ralentissant l’allure des chevaux, ils purent entendre le bruit des vagues et sentir l’odeur salée apportée par le vent.
Le coucher de soleil enflammait le ciel d’un rouge intense, se fondant en nuances d’orange là où le soleil disparaissait derrière la ligne d’horizon, marquée par les montagnes des Apennins. Des scènes et des couleurs qui auraient inspiré un sentiment de nostalgie dans le cœur de n’importe qui, et plus encore dans celui d’Andrea, déjà tourmenté par toute l’histoire qu’il vivait. Il aurait voulu tourner son cheval et galoper de retour à Jesi, auprès de sa bien-aimée, de sa maison, de ses proches. Mais une fois encore, les hennissements des chevaux et les cris des soldats le ramenèrent à la réalité.
Ils se trouvaient devant l’entrée principale du château, dans une grande esplanade quadrangulaire qui, de l’autre côté, s’ouvrait sur la mer. Tandis que ses accompagnateurs criaient aux gardes sur les remparts pour se faire reconnaître et faire abaisser le pont-levis, Andrea scrutait le port. La mer était calme, plate, presque comme un miroir. Quelques étoiles brillaient déjà dans le ciel, qui prenait des teintes turquoise et qui deviendrait bientôt bien plus sombre, enveloppant tout et tous dans le manteau noir de la nuit. La silhouette d’un énorme navire, un trois-mâts, attira l’attention d’Andrea. Jamais de sa vie il n’avait vu un vaisseau aussi grand. Et l’idée que le lendemain, il devrait monter à bord, lui noua le cœur. Sur le mât le plus haut, celui du centre, flottait l’étendard de la République Sérénissime : un lion couché, le lion de Saint-Marc, tenant l’Évangile ouvert entre ses pattes avant.
Quand le pont-levis fut abaissé et que les lourds battants de la porte s’ouvrirent, le capitaine des Gardes du château sortit et s’approcha d’Andrea, lui tendant une bannière pliée. Il s’inclina respectueusement devant lui et lui remit l’étendard.
Andrea descendit de cheval, fit signe au Garde de se relever de sa position de révérence et prit l’objet de ses mains. Il déploya la bannière, sur laquelle, sur un fond de tissu rouge, était brodé avec soin le dessin doré d’un lion rampant orné d’une couronne royale.
« Monseigneur, Marquis Franciolino Franciolini, vous combattrez sous le signe du lion ! » commença à déclarer le lieutenant. « Vous remettrez demain matin cette bannière à l’équipage du navire, qui s’occupera de la hisser sur le mât, aux côtés du drapeau de la Sérénissime. Le duc Francesco Maria Della Rovere a donné des instructions précises. Le lion rampant, symbole de votre ville, mais aussi de Frédéric II de Souabe, qui l’avait autrefois orné de la couronne impériale, sera le symbole de votre force et de votre autorité. »
Le Garde s’interrompit et se fit remettre un parchemin par un autre soldat resté à une courte distance derrière lui.
« Le duc Francesco Maria Della Rovere vous nomme également, comme cela est écrit dans ce parchemin, Grand Lion du Balì, un titre qui vous confère de grands pouvoirs et l’obligation, voire le devoir, d’assister le commandant vénitien sur le pont du galion de combat. »
Sur ces mots, il roula le parchemin et le remit aux mains d’Andrea
« Demain à l’aube, vous monterez à bord avec vos hommes et remettrez vos lettres de créance au Capitaine da Mar Tommaso de’ Foscari. Deux lions et deux capitaines d’armes seront unis contre des ennemis communs : d’un côté les Turcs du sultan Sélim, de l’autre les lansquenets teutoniques. Le duc Della Rovere compte sur vous pour défendre avec honneur votre bannière ainsi que celle de la République Sérénissime, notre alliée. Et maintenant, Monseigneur, permettez-moi de vous conduire à vos appartements pour un repos bien mérité. Demain matin, vous serez réveillé de bonne heure, avant même que le soleil ne se lève. »
Andrea était confus, il ne savait que répondre et resta silencieux. Certes, son ami le duc savait comment le flatter avec des honneurs, mais il trouvait toujours un moyen de l’envoyer au-devant du danger. L’idée de monter à bord d’un navire ne lui plaisait guère, mais puisqu’il était arrivé jusqu’ici, il ne pouvait certainement plus reculer.
La nuit, il se retourna sans cesse dans ses draps, dormant peu ou pas du tout. Quand il sombrait dans le sommeil, il était assailli par des cauchemars rappelant à sa mémoire la seule bataille qu’il avait livrée en mer. Mer et sang, feu et mort. Et la silhouette du Mancino qui le hantait, grandissant jusqu’à devenir un géant, l’accusant de l’avoir laissé mourir dans les flots. Et il se réveillait en sueur, réalisant qu’il n’avait dormi que quelques instants. Quand le serviteur chargé de le réveiller arriva, il ressentit presque un soulagement à l’idée de se lever. Il faisait encore nuit dehors, mais de la fenêtre, il pouvait apercevoir le trois-mâts au mouillage, illuminé par la lumière blanche et diffuse d’une lune presque pleine.
Le serviteur l’aida à revêtir une légère armure, composée d’un plastron en cotte de mailles renforcé par des plaques plus solides aux épaules, aux avant-bras et au cou. Par-dessus l’armure, un manteau de satin à moitié rouge et à moitié jaune. Sur la partie jaune était dessiné le lion de Saint-Marc, et sur la partie rouge, le lion rampant couronné.
« Ces vêtements ne me protégeront pas du tout ! » commença à se plaindre Andrea au serviteur qui l’aidait à s’habiller. « Une flèche en pleine poitrine et adieu marquis Franciolini ! Et ces bas, alors ? Juste des braies de cuir, même pas renforcées de rivets métalliques ! Passe-moi le heaume, dépêche-toi ! »
« Pas de heaume, Capitaine. Vous êtes parfait ainsi. À bord, il faut être léger, pouvoir se déplacer facilement, courir d’un côté à l’autre du galion et, si nécessaire, grimper aux mâts. Une armure comme celles que vous portez habituellement lors des combats terrestres ne ferait que vous encombrer. Croyez-moi, Monseigneur ! »
« Je te crois, et je crois aussi que je n’arriverai jamais vivant à Mantoue. Si le mal de mer ne me tue pas, ce sera l’ennemi. Je serai une cible facile pour les pirates turcs. Ils me cribleront de flèches et se nourriront de mon cadavre. Ah, quel beau destin qui m’attend, tout cela pour plaire à mon ami le Duc ! »
« Vous n’avez rien à craindre, Monseigneur. Le galion est vraiment sûr et conçu pour résister à toutes sortes d’attaques d’autres navires. Et le Commandant Foscari est un maître dans son art. Il sait gouverner un navire et combattre en mer comme nul autre au monde. Vous verrez. Et maintenant, mangez quelque chose. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour affronter le voyage. » Sur ces mots, il frappa dans ses mains, faisant entrer d’autres serviteurs avec des plateaux.