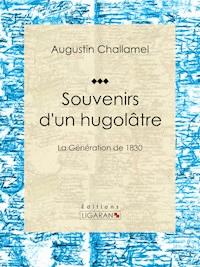
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait: " Depuis une vingtaine d'années déjà, sur la tombe de tel ou tel mort illustre, très fréquemment un orateur prononce cette phrase: "Il appartient à la forte, à la vaillante génération de 1830..." Cette phrase est comme stéréotypée dans la plupart des oraisons funèbres. Aussi certains moqueurs la traitent-ils de "cliché", d'observation banale, ou d'exagération de parti..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335038637
©Ligaran 2015
Depuis une vingtaine d’années déjà, sur la tombe de tel ou tel mort illustre, très fréquemment un orateur prononce cette phrase :
« Il appartenait à la forte, à la vaillante génération de 1830…. »
Cette phrase est comme stéréotypée dans la plupart des oraisons funèbres.
Aussi certains moqueurs la traitent-ils de « cliché », d’observation banale, ou d’exagération de parti. Par le temps actuel, lorsqu’on se rit volontiers des convictions et des principes, ils s’égayent en la reproduisant. Nombre de gens font chorus, sans savoir pourquoi, mais en suivant le courant des idées du jour.
Il n’y a rien à redire à cela. Toute génération possède, incontestablement, le droit de juger, d’imiter ou de renier les actes de la génération qui la précède. À une condition, pourtant, selon la loi du progrès : c’est de faire mieux que sa devancière, c’est de la dépasser.
D’autres écrivains, après moi, examineront si l’époque présente l’emporte sur celle qui achève de disparaître ; si elle produit des fruits meilleurs, et si elle a raison de plaisanter toujours en pareille matière.
Pour l’auteur de ces souvenirs contemporains, qui coordonne ces pages afin d’en former un chapitre d’histoire, il importe de retracer les faits, généraux ou particuliers, qui se sont accomplis sous ses yeux depuis son enfance.
Beaucoup de lecteurs y peuvent prendre intérêt, aussi bien parmi les vieillards que parmi les jeunes gens.
Ceux-ci apprendront, peut-être, des choses nouvelles et utiles ; ceux-là se rappelleront, sans doute, leurs propres émotions dans le temps où ils coudoyaient les acteurs qui occupaient la scène, en France, avant, pendant et après une révolution dans la politique, la littérature, les sciences et les arts.
Les Souvenirs d’un hugolâtre touchent un peu à tout, même à la vie intime. Si petit qu’on soit, durant une époque, on se trouve forcément mêlé à l’action générale.
Personne ne le niera : en politique, en littérature, en sciences et en arts, la génération de 1830, comprenant tous les Français vivants dans ce temps, où à peu près, a fait majestueusement son œuvre, depuis le commencement de ce siècle jusque dans sa dernière moitié.
Elle est représentée par une pléiade d’hommes supérieurs, qui n’ont pas tous été remplacés, ou dont les travaux ont frayé la route à leurs dignes successeurs.
Ce qui caractérise cette génération puissante, c’est d’abord l’enthousiasme ; c’est ensuite l’ardeur des sentiments ; c’est enfin la passion persévérante.
Ces moteurs sont indispensables pour aviver le progrès, tandis que l’indifférence, le scepticisme et la froideur ne peuvent rien créer que d’éphémère, en admettant qu’ils ne perdent pas le terrain précédemment gagné.
La génération de 1830 a montré presque toutes les audaces ; elle a tenté tous les essais religieux ou sociaux, scientifiques, artistiques ou littéraires.
Née au lendemain de l’effondrement du premier Empire, ayant pu entendre les récits des témoins oculaires de la Révolution de 1789, assistant à la lutte de la Restauration contre la démocratie naguère étouffée par Napoléon Ier, elle a rompu bien des chaînes pour s’élancer vers l’avenir.
Ses idées, tantôt lumineuses et fécondes, tantôt incohérentes et folles, ont renouvelé toute forme, sinon tout fondement des choses de l’intelligence.
En un mot, la génération de 1830, on doit le croire, a laissé une trace ineffaçable, en produisant des nouveautés de toutes les sortes, en donnant au dix-neuvième siècle sa formule principale.
La date de 1830 ne sortira pas de ma mémoire. Pour moi, elle se rapporte à un mouvement révolutionnaire coïncidant avec ma jeunesse, et, avant de parler des hommes qui influaient alors sur les destinées du pays, il convient de constater l’impression que je ressentis, à la suite du grand évènement de l’année qui vit la famille d’Orléans succéder à la branche aînée des Bourbons.
Le 27 juillet, nous revenions du collège Henri IV à notre pension, située rue des Fossés-Saint-Victor (depuis, rue du Cardinal-Lemoine), lorsque, mes camarades et moi, nous aperçûmes partout, sur notre passage, des rassemblements de Parisiens, – bourgeois et ouvriers, – qui criaient : Vive la Charte ! et dont les gestes animés ne laissaient pas de nous étonner un peu.
Ordinairement, la rue des Fossés-Saint-Victor brillait par son calme, presque par sa solitude.
C’était le matin. Dix heures venaient de sonner. Il faisait une chaleur accablante, un soleil de feu, que Victor Hugo a appelé
Notre maître de pension et nos maîtres d’études paraissaient fort émus.
Au lieu de faire sonner la cloche pour nous appeler en classe, comme d’habitude, ils déclarèrent aux élèves externes qu’ils pouvaient rentrer immédiatement chez leurs parents, voisins de l’institution ; ils ordonnèrent aux élèves pensionnaires d’écrire à leurs familles ou à leurs correspondants, pour que ceux-ci se hâtassent de les venir chercher.
Un congé ! Tout à coup, et sans qu’on en eût parlé dans le collège, sans circulaire du proviseur ! Cela nous intriguait tous.
Que se passait-il donc ? Nous avions déjà, fêté la prise d’Alger : il ne s’agissait plus, évidemment, de cette victoire.
Seulement, la veille, mon père ne prononçait-il pas les mots de fatales ordonnances et de coup d’État ! Ne parlait-il pas de collision imminente ?
J’avais douze ans et demi. Je ne tardai point à comprendre que Paris commençait une insurrection, car je me rappelais certains épisodes de la Révolution de 1789, par moi lus dans quelques ouvrages d’histoire.
J’éprouvais un indéfinissable serrement d’estomac. Pourquoi ne l’avouerais-je pas ? J’avais peur, – et je n’attendis pas un ordre réitéré de nos maîtres pour retourner à la maison paternelle, d’autant plus qu’elle était située tout près du pensionnat, dont deux jardins étroits la séparaient.
Comme je franchissais, en courant, le seuil de la porte-cochère de l’institution, je vis des hommes en bras de chemise qui roulaient des tonneaux vides, en les dirigeant vers la rue Saint-Victor ; je vis d’autres gens du quartier qui brouettaient des pavés et du sable ; je vis enfin, distinctement, que l’on élevait une barricade dans le carrefour, au bas de la rue des Fossés.
La curiosité me porta d’abord à examiner de plus près les choses, et je suivais les barricadiers, quand mon oncle, caporal invalide, se présenta à moi.
Il venait me chercher, et il m’emmena sans tarder chez mon père.
Nous allongions le pas. La bravoure chez l’invalide n’excluait pas la prudence.
Au même instant, une détonation se fit entendre.
J’accompagnai mon oncle, sans prononcer une seule parole, et bientôt toute la famille fut réunie, en attendant les évènements avec une anxiété à nulle autre pareille.
– Eh bien ! disait mon père, je l’avais prévu. Les ordonnances de Polignac ont amené les coups de fusil. On se bat. Comment cela finira-t-il ? Que de victimes, par suite de l’aveuglement des Bourbons ! Voilà où les mauvais conseils ont conduit Charles X !
Trois jours durant, je restai presque emprisonné dans notre maison, avec mon frère et mes deux sœurs.
Nous éprouvions, petits et grands, des commotions nerveuses, quand les fusillades ou les canonnades retentissaient.
On avait pillé les boutiques d’armuriers. Tout ce qui pouvait servir pour combattre avait été employé soudainement.
Le 27 juillet, Etienne Arago, directeur du Vaudeville, avait fermé les portes de son théâtre afin de protester contre les ordonnances et de donner le signal de l’insurrection. Il avait fait porter et distribuer chez Teste toutes les armes militaires qui se trouvaient dans son magasin. Lui-même, héros de juillet, devenait, deux jours après, aide de camp de La Fayette.
Audry de Puyraveau fit distribuer dix-huit cents baïonnettes qu’il avait chez lui.
Debout sur les barricades, un fusil à la main, Adolphe Nourrit chanta la Marseillaise et dirigea au feu ses auditeurs enivrés.
Le nombre des combattants augmentait chaque jour. Plusieurs grands manufacturiers avaient dit à leurs ouvriers :
« Allez vous battre ; vos journées vous seront payées ! »
La bataille eut des proportions énormes ; le 28 juillet, on prenait et reprenait l’Hôtel de Ville ; le 29, les insurgés parisiens, déjà maîtres d’une bonne moitié de la capitale, s’emparaient successivement du Louvre, des Tuileries et de la caserne de la rue de Babylone, dans le faubourg Saint-Germain.
Les coups de canon, les feux de peloton ne cessaient qu’à de rares intervalles, même pendant la nuit.
Le 30 juillet, la révolution était faite ; le peuple était victorieux ; Charles X tombait de son trône.
Tout Paris se métamorphosait ; on eût dit un changement à vue, – décors et costumes.
Plus de Suisses, plus de garde royale : les troupes s’évanouissaient. Dans plusieurs casernes et sur quelques places, des soldats de la ligne fraternisaient avec les vainqueurs, la crosse en l’air d’abord, puis le verre en main.
Mon oncle me conduisit, à travers les barricades ébréchées, jusqu’à la place Maubert, rendez-vous habituel des commères et des flâneurs du quartier, centre populeux du faubourg Saint-Marceau.
Ô surprise ! Des hommes sans uniforme, voire en haillons, y montaient la garde, et semblaient très sévères sur la consigne.
Au-dessus du poste flottait un drapeau tricolore.
La vue de ces trois couleurs, remplaçant le drapeau blanc, le seul que je connusse jusqu’alors, me fit une impression profonde.
Je lançai quelques phrases interrogatives, très pressantes.
Mon oncle m’expliqua bien vite, presque en pleurant de joie, que le drapeau tricolore était celui du régiment dans lequel il avait servi, sous la République et l’Empire ; que le drapeau tricolore, toujours victorieux, avait fait le tour de l’Europe, etc., etc.
Ai-je besoin d’en dire davantage ? Le vieil invalide m’apprenait ce que tous ses anciens compagnons répétaient comme lui….
Il confondait la République avec l’Empire, Hoche avec Napoléon, la liberté avec la gloire ; il parlait comme une chanson de Béranger, lui qui m’avait appris le Soldat, t’en souviens-tu ! d’Émile Debraux, auteur de la Colonne, du Prince Eugène, de Marengo, de Mont-Saint Jean, et d’autres rimes qui lui avaient valu « les persécutions du pouvoir » pendant la Restauration.
On vendait dans les rues, par milliers, des cocardes nationales.
Mon oncle et moi, nous en achetâmes avec enthousiasme, pour les attacher à notre vêtement, sur le cœur, en « bons patriotes ».
Comme nous rentrions à la maison, je rencontrai un vieil ami de mon père, un royaliste désolé, qui, apercevant ma cocarde tricolore, me dit moitié avec amertume, moitié avec colère :
« Tu portes là une jolie chose, va ! Avant six mois, le drapeau blanc et la cocarde blanche auront reparu. »
Le vieillard qui parlait ainsi était M. Delvincourt, ancien doyen de la Faculté de droit de Paris, qui mourut en 1831, « fidèle à son Dieu et à son roi », mais qui n’avait pas vécu en trop bonne intelligence avec les étudiants.
Notons, à ce propos, que, pendant plus de vingt années, une bonne dame de nos connaissances, non moins légitimiste que M. Delvincourt, nous a imperturbablement annoncé, en tirant les cartes devant nous, la rentrée du duc de Bordeaux (Henri V) dans le royaume de ses pères.
Henri V devait toujours revenir demain.
Les partisans d’un souverain tombé se bercent tous de ces illusions respectables ; mais, depuis 1789, aucun roi déchu, aucun prétendant n’est remonté en personne sur le trône de France.
Il n’y a eu d’exception que pour Napoléon Ier, à l’époque des Cent-Jours, – pendant laquelle s’opéra une réapparition fantastique du prisonnier de l’île d’Elbe, dirigé quelques mois après sur l’île de Sainte-Hélène.
Quoi que prétendit le vieux jurisconsulte, je portais fièrement ma cocarde, et je croyais, comme mon oncle et mon père, que tout était changé, puisqu’on avait « secoué la poussière qui ternissait ces nobles couleurs ».
Mon père applaudissait au triomphe des 221 députés opposants au ministère Polignac, et dont la réélection décida Charles X à violer la Charte ; il était heureux des ovations obtenues par La Fayette pendant son voyage dans le Midi, tandis que le duc d’Angoulême avait été accueilli froidement en Normandie.
Il était de l’avis du vieux général de 1789, disant à un ami, en mai 1830 : « Que voulez-vous ? Ils sont en arrière de trois siècles ; ce sont des fous : Charles X se fera renvoyer, et avec un peu de bon sens, il aurait pu être heureux comme une souris dans un pâté. »
Mais, bah ! les royalistes surnommaient La Fayette Gilles César.
Ainsi que beaucoup d’anciens soldats, mon oncle n’avait point d’opinion politique définie ; mais mon père était un libéral, un abonné du Constitutionnel, lequel était alors le grand électeur ; il redisait fréquemment cette phrase du Journal des Débats : « Malheureuse France ! Malheureux roi ! » pour laquelle Bertin aîné avait été condamné à six mois de prison par le tribunal correctionnel, et absous par la cour royale.
Somme toute, la révolution de 1830 ne déplaisait à aucun membre de ma famille, qui, sans faire la moindre politique active, s’associait de cœur aux efforts tentés par les libéraux depuis l’avènement de Charles X.
La révolution de juillet 1830 nous profita, à nous, collégiens.
Nous eûmes un congé d’une dizaine de jours. Congé suffisant pour qu’il nous fût possible de vaguer par les rues, sur la place de l’Hôtel de Ville, quand on y intronisa Louis-Philippe Ier, « la meilleure des Républiques », et dans la cour du Palais-Royal, pour applaudir le roi-citoyen paraissant à son balcon, entonnant parfois la Marseillaise que nous commencions à savoir par cœur, – ou, plus souvent, la Parisienne de Casimir Delavigne, chant approprié à la circonstance, populaire parmi les « philippistes ». Les philippistes trouvaient l’hymne de Rouget de l’Isle trop révolutionnaire.
Après le 7 août, après l’avènement du prince pour qui « une charte devait être désormais une vérité », nous rentrâmes dans la pension.
On reprit les classes au collège, où la distribution solennelle des prix retardée pour cause de batailles, n’eut lieu que le 31 août.
Hélas ! les vacances seraient donc diminuées ! Nous avions espéré mieux !
Nous avions vu assez fréquemment le duc d’Orléans, cousin de Charles X, se promener bras dessus bras dessous avec le proviseur, dans la grande cour des classes ; car le duc d’Orléans conduisait quelquefois au collège Henri IV, ses fils, – le duc de Chartres et le duc de Nemours, – comme eût fait un bon bourgeois du Marais.
Aux distributions de prix, nous avions presque toujours vu ce prince et sa famille mêlés avec les parents des élèves, et distingués seulement à cause des fauteuils velours et or sur lesquels ils étaient assis, en face de l’estrade des professeurs.
La popularité du disciple de Mme de Genlis y gagnait étonnamment ; la bourgeoisie française trouvait cela superbe, et, de fait, il nous plaisait d’avoir de tels camarades.
Le duc d’Aumale, le prince de Joinville et le duc de Montpensier ne s’asseyaient pas encore sur les bancs poussiéreux du collège. Ils ne parurent que quelques années plus tard.
À la distribution des prix du 31 août 1830, Louis-Philippe Ier, pourvu d’une couronne, ne vint pas occuper son fauteuil ordinaire.
Notre proviseur lui avait respectueusement manifesté ses craintes : les soins de la chose publique devaient peut-être enlever au collège, cette année-là, l’honneur de sa présence ?
« Vous avez raison, avait répondu le roi-citoyen, je n’ai plus, comme les années précédentes, deux heures par jour à donner à mes plaisirs. »
Paroles aimables, – citées textuellement dans le palmarès, – en admettant qu’elles aient été dites.
Mais si Louis-Philippe Ier n’assistait pas, pour cause de royauté, à la distribution des prix, la reine n’y voulut pas manquer.
L’entrée de Marie-Amélie fut très applaudie ; on fêta la mère de famille. Plus applaudie encore fut la première phrase de M. Alfred de Wailly, agrégé de rhétorique, lorsque, commençant la classique tartine qui sert de prélude à toute distribution de récompenses universitaires, il s’écria :
« Ce n’est pas le temps des longs discours…. »
Le jeune auditoire saisit et goûta l’allusion.
Quelle bonne fortune pour les lauréats impatients ! Pas de longs discours !
Cependant, en 1831, la solennité des prix ne fut pas honorée par la présence de la famille royale.
Quelques malins esprits le remarquèrent tout haut, et peut-être s’en préoccupa-t-on aux Tuileries.
Plus tard, la reine Marie-Amélie se fit un devoir de battre de ses propres mains – aux triomphes éclatants du duc d’Aumale, – aux faibles succès du prince de Joinville, – aux encouragements que reçut le duc de Montpensier.
Je dois être véridique, et déclarer que les enfants de Louis-Philippe méritèrent de figurer sur les tableaux du collège comme « bons élèves ».
Les légitimistes riaient de cette éducation. En 1835, non loin de la tour de Clovis, on lisait sur les murs la phrase suivante, bien intelligible : « Pour aller à Bordeaux, il faut passer par Orléans. » Certes, l’éducation du duc de Bordeaux ne ressemblait guère à celle des princes de la branche cadette. Son précepteur était l’abbé Tharin.
Revenons à 1830. Les journées de juillet avaient échauffé les têtes, surexcité la jeunesse française, secoué l’indolence des uns, éveillé l’ambition des autres, donné beaucoup d’espérances à tous.
Le mois des révolutions ne produisit pas absolument ce qu’on en attendait. En cela, les choses se passaient comme d’habitude.
Dans la politique, les amis de la monarchie tempérée étaient placés et satisfaits ; mais les républicains, estimant qu’on leur avait « escamoté » leur œuvre, s’apprêtaient à semer des articles violents dans certains journaux, – pour récolter une ample moisson d’emprisonnements ; les légitimistes, qui ne cessaient de croire à un nouvel et prochain épanouissement des lis, plaisantaient sur ce qu’ils nommaient « l’anecdote de juillet. »
Dans la littérature, les novateurs n’avaient pas suffisamment effiloqué les « perruques » de l’Académie, et étaient résolus à combattre les vieilles phalanges classiques, toujours en possession de l’institut, des Facultés et des théâtres. Ils fourbissaient leur grand sabre, – ou plutôt ils trempaient leur plume dans le vinaigre.
Certainement, il devait y avoir des récriminations, des plaintes, des vengeances. Le lecteur les appréciera ; il se méfierait peut-être de l’opinion d’un hugolâtre.
Gérard de Nerval écrivait :
Théophile Gautier remarquait :
Toutefois, avant d’entrer dans l’examen du mouvement général des esprits, ayant précédé, accompagné ou suivi les « journées glorieuses » de 1830, qu’il nous soit permis de ne pas encore quitter le collège, et de rappeler ce qui arriva dans plusieurs établissements de l’Université, où les révoltes se succédèrent.
Je faisais mes études, à Henri IV, avec les fils des généraux Foy et Lamarque, avec Xavier Eyma, qui devint romancier et journaliste, avec Privat d’Anglemont, qui fit plus tard sensation parmi les bohèmes, – et avec Armand Durantin, l’auteur d’Héloïse Paranquet.
Ce collège, qui donna la pâture latine et grecque à une foule de littérateurs, depuis Casimir Delavigne, Laya et les deux Musset, jusqu’à Emile Augier et Victorien Sardou, devait facilement adopter les idées du jour.
La Belgique avait imité la France, et, le 25 août 1830, elle avait accompli sa petite révolution ; l’Italie, la Suisse et d’autres pays n’allaient pas tarder à suivre le courant.
Bientôt le collège Henri IV imita la Belgique et organisa sa petite révolte. Les élèves internes n’appréciaient pas outre mesure le bonheur d’être réveillés au son du tambour, au lieu de l’être au son de la cloche.
Et puis, l’esprit de mouvement contre l’autorité gagnait tout le monde, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits.
Nos camarades s’insurgèrent ; seulement, je n’ai jamais su pourquoi. Les prétextes à insurrection, d’ailleurs, n’ont jamais manqué.
Avec quelle joie nous apprîmes, nous, externes, que les internes s’étaient barricadés dans leurs « quartiers », et qu’ils tenaient bon contre leurs maîtres, c’est-à-dire contre leurs tyrans !
La cour des anciens, au collège Henri IV, longeait la rue Clovis, et, par-dessus le mur de clôture, nous jetions à nos camarades révoltés toutes sortes de vivres, – pains, pâtés, saucissons et autres comestibles, – afin que le congé « par force majeure » durât le plus longtemps possible ; un mois, s’il se pouvait.
Force resta à l’autorité. Tout se calma, après l’expulsion de quelques meneurs.
Bon gré, mal gré, il fallut reprendre le collier de misère, manger les durs haricots et le poisson mal cuit ; il fallut retomber sous la coupe, j’allais dire sous la férule de nos professeurs ; il fallut se bercer de l’espoir d’une revanche.
D’autres collèges, qui avaient aussi levé le drapeau insurrectionnel, n’y gagnèrent pas davantage. Ils perdirent des élèves. Voilà tout.
Notre pension, d’ailleurs peu nombreuse, ne chercha pas à imiter ces grands établissements.
Elle ne fit pas sa révolution politique ; mais elle avait fait sa révolution littéraire, elle avait abandonné les routes banales et cherché des chemins nouveaux.
Je le déclare hardiment, fièrement, triomphalement : dans notre pension, nous ne nous enflammions que pour la jeune littérature.
Le romantisme nous avait conquis. Des élèves de sixième aux élèves de rhétorique et de philosophie, l’entente était à peu près complète. Nous marchions sous l’étendard de Victor Hugo, comme nous ne jurions, pour les hautes études, que par Villemain, Guizot, Cousin et Michelet, celui-ci étant alors maître de conférences à l’École normale. Michelet faisait du romantisme en histoire.
Stendhal (Henri Beyle), et d’autres écrivains de mérite, encouraient notre haine précoce, parce qu’ils méconnaissaient le génie du poète novateur.
Nous ne pardonnions pas à Stendhal d’avoir dit, en 1829 : « Victor Hugo, ultra, vanté, n’a pas de succès réel, du moins pour les Orientales, Le Condamné fait horreur et me semble inférieur à certains passages des Mémoires de Vidocq… M. Victor Hugo n’est pas un homme ordinaire, mais il veut être extraordinaire, et les Orientales m’ennuient. »
Nous ne pardonnions pas à Népomucène Lemercier qui, novateur dans la plupart de ses productions, n’en reniait pas moins la révolution littéraire dont il avait été un des précurseurs, et qui s’écriait :
Nous ne pardonnions pas à Duvergier de Hauranne cette phrase : « Le romantisme n’est pas un ridicule, c’est une maladie comme le somnambulisme et l’épilepsie. »
Nos « bandes romantiques » croissaient en nombre et en vigueur. Elles s’attaquaient aux « rococos », aux « perruques », et nous nous moquions bien d’être appelés par eux « décousus ».
Bignan, classique pur, maudissant le romantisme, entassait prix sur prix de poésie académique et se montrait digne de partager les couronnes de Baour-Lormian, que les Jeunes-France surnommaient balourd-dormant, et dont la mort inspira cette épigramme à Nestor Roqueplan :
L’apparition d’Hernani, surtout, en février 1830, était pour nous une renaissance. Ce drame pouvait être comparé au Cid de Pierre Corneille, renversait le trône vermoulu de Racine, la froide école de Voltaire, toutes les tragédies des auteurs à la suite ; elle donnait des Shakespeare et des Schiller à la France ; elle confirmait l’opinion de Châteaubriand, qui avait naguère appelé Victor Hugo « l’enfant sublime ».
Nous lisions avec avidité cette production, que les « classiques » regardaient comme « une fable grossière, jouée par des acteurs épileptiques » ; que les romantiques défendaient à outrance. À Toulouse, un jeune homme se fit tuer en duel pour Hernani.
Et nous, étions d’autant plus enthousiastes que notre admiration contre balançait les dédains d’un de nos professeurs.
Ce professeur, un pur soutien du cothurne tragique, et approuvant à peine les tentatives de théâtre mixte osées par Casimir Delavigne, avait des mois tout à fait réjouissants à l’endroit de l’Honneur castillan. Il avait coutume de dire, en classe, lorsque le vent ce glissait par une fenêtre entrouverte :
« Fermez cette fenêtre. Je n’aime pas l’air… nenni, je n’aime pas l’air ! »
Puis il s’applaudissait pour son atroce calembour, dont l’énoncé nous arrachait une longue suite de murmures, que parvenaient à peine à faire cesser les retenues les plus multipliées.
Je constate la chose, parce que cet homme, écho maladroit des classiques de haut lieu, a contribué au succès de Victor Hugo parmi nous, et parce qu’il rendait ses collègues ridicules en assurant que l’Université n’admettrait jamais le « mauvais français » des romantiques. Victor Hugo, alors, semblait être un barbare, qui écorchait la langue française.
Hernani nous avait portés vers l’héroïsme chevaleresque ; Marion Delorme nous transforma en rédempteurs des filles perdues. Lucrèce Borgia nous fit aimer le beau dans l’horrible ; avec Angelo, nous devînmes des fanatiques de Marie Dorval, cette interprète par excellence du drame moderne.
L’unique et bruyante représentation du Roi s’amuse, en 1832, nous rendit absolument fous de désespoir, – parce que nous n’avions pu y assister, pour soutenir par tous les moyens, fût-ce à coups de poing, cette pièce interdite par les suppôts du pouvoir, et dont la préface proclamait la liberté au théâtre.
L’unique ressource qui nous restât consistait à nous procurer le drame et à le lire, pour en apprendre les meilleures tirades, récitées par nous pendant les récréations.
Dans ce temps-là, il existait des cabinets de lecture, tels qu’on n’en trouve plus guère aujourd’hui. Les livres in-octavo à couverture beurre frais, à large justification, à pages remplies de blanc, coûtaient encore assez cher. Les in-douze à trois francs, les in-dix-huit à un franc n’étaient pas inventés.
Un volume, roman ou drame, valait sept francs cinquante centimes, et je vous assure que, au point de vue matériel de la lecture, on n’en avait pas souvent pour son argent. On dévorait le volume en moins d’une heure !
Il fallait donc s’adresser aux cabinets de lecture, ces bibliothèques payantes, ces entrepôts des livres à la mode, ces foyers du romantisme.
Dans le quartier Latin, rue Saint-Jacques, non loin de notre pension, il y en avait un, fort bien approvisionné d’œuvres nouvelles. Mme Gondar, qui le tenait, pouvait presque rivaliser avec Mme Cardinal, de la rue des Canettes, comme loueuse de romans et de pièces de théâtre.
Elle savait exploiter les ardeurs des séides de la jeune école ; quand un livre faisait fureur, elle le louait par heure, non par jour ; et si on le gardait trop longtemps, même en payant généreusement, elle administrait à l’abonné retardataire une semonce conditionnée ; elle lui refusait toute autre production recherchée, jusqu’à épuisement de lecteurs diligents.
Il semble à mes amis et à moi que nous la voyons encore, dans son comptoir surchargé de volumes cartonnés tant bien que mal, cette active Mme Gondar, notre providence d’alors.
Elle nous procura le Roi s’amuse, le jour même où il fut publié, et nous nous cotisâmes, afin de pouvoir satisfaire ses exigences.
Tous les élèves de la pension lurent le drame défendu, – au prix de vingt centimes par heure, pendant trois semaines au moins ! Le total du louage s’éleva à quarante francs.
Comment oublier de pareilles débauches ! L’argent de poche de chacun de nous y passa tout entier. Nous nous exécutâmes sans regret.
Pendant trois semaines, aucun devoir ne fut fait convenablement, aucune leçon ne fut proprement sue. Les pensums tombèrent sur nous comme grêle.
Mais bah ! Lorsque notre répétiteur s’indignait, en nous punissant, nous nous moquions, avec Triboulet…, « de cet âne bâté qu’on appelle un savant, » et nous attendions avec impatience la publication d’une nouveauté romantique, de de Vigny, de Delatouche, des Musset, d’Alexandre Dumas, de Frédéric Soulié, de Petrus Borel, de bien d’autres encore.
Peu de semaines s’écoulaient sans visite à Mme Gondar. Les romans beurre frais paraissaient à de rares intervalles : ils délayaient en quatre volumes in-octavo la matière d’un in-dix-huit actuel.
Que de pages blanches ! que de chapitres bien courts !
On pouvait aisément commenter le livre, écrire çà et là, soit à la plume, soit au crayon, les impressions que le lecteur ressentait : admirable, étonnant, sublime !
Mots auxquels des classiques répondaient, à leur tour : ridicule, incompréhensible, bête !
Ainsi les lecteurs d’avis différents s’injuriaient incognito, comme cela se voit encore dans nos bibliothèques publiques fréquentées par la jeunesse des écoles.
Nos passions littéraires nous ont incités à gâter bien des volumes ; je ne parle pas de ceux que nous avons usés.
L’Atar-Gull et la Salamandre d’Eugène Sue, où les paradoxes, les antithèses et les tableaux colorés abondent, nous plaisaient extraordinairement ; nous lisions et relisions l’Écolier de Cluny, par Roger de Beauvoir, ainsi que les Mauvais Garçons et Venezia la Bella d’Alphonse Royer, trois romans Moyen Âge écrits selon la mode nouvelle. Venezia la Bella était illustrée par une vignette de Célestin Nanteuil : la place Saint-Marc, – une gondole, – une jeune fille assassinée. L’Âne mort et la jeune femme guillotinée, la Confession et Barnave, où l’on trouve une satire violente contre la famille d’Orléans, nous passionnèrent ; le Chasseur noir et le Pape et l’Empereur, de Dinocourt, ne nous effrayèrent pas. Le « féroce et formidable roman de Han d’Islande » nous avait bronzés à cet égard.
Peu après, en 1838, les exubérances de Madame Putiphar, par Petrus Borel, nous semblèrent toutes naturelles. Ce roman passe pour être un spécimen des exagérations de l’époque dans le fond et dans la forme.
Pour beaucoup de jeunes, les scènes bien noires, les vengeances atroces, semblaient indispensables.
À peine âgé de quinze ans, je lus à mes parents, en manière de compliment de nouvelle année, une longue tirade d’alexandrins intitulée le Supplicié.
Comme mon père ne se souciait pas de me voir versifier, il m’adressa simplement ces mots, signe d’approbation plus que tiède :
« Est-ce que tu n’aurais pas pu choisir un autre sujet, un sujet moins lugubre ? »
Qu’eût-il ajouté, si je lui avais lu mes élucubrations poétiques de début, – l’Anthropophage, le Serment de mort, le Désespoir, etc ?
Mes camarades qui s’essayaient à la poésie cherchaient aussi leurs inspirations dans les choses monstrueuses et terribles.
Cependant George Sand publia Indiana en 1832, et, l’année suivante, Valentine parut. Elle fit diversion dans le genre moderne, sous le pseudonyme que lui avait forgé Henri Delatouche.
« Mme Sand, remarque Alphonse Esquiros, se donna pour une victime de notre société mal faite ; elle découvrit son flanc qui saignait…. La Revue des Deux Mondes, privée de nos trois grandes gloires littéraires (Châteaubriand, de Lamartine, Victor Hugo), s’empara de cette renommée naissante. »
Tout d’abord, George Sand représenta la condition de la femme dans l’avenir. Rôle trop philosophique, joué avec une forme qui ne ressemblait en rien à celle des romantiques. L’auteur d’Indiana et de Valentine soutenait des thèses, et la jeunesse d’alors préférait la peinture des passions. Mme Sand eut surtout des lectrices, à la suite desquelles lui vinrent plus tard une foule de lecteurs, lorsque ses ouvrages reflétèrent successivement Michel de Bourges, Chopin, Lamennais, Cousin et Pierre Leroux.
Son premier collaborateur Jules Sandeau, pour le roman de Rose et Blanche, ne nous était pas encore connu. Jules Sandeau devait sérieusement débuter, en 1834, par Madame de Sommerville, et protester, par la suite, au nom du devoir, contre les entraînements du paradoxe.
De véritables hugolâtres ne pouvaient complètement s’attacher au char de George Sand ; il fallut du temps pour qu’ils consentissent à admirer des triomphateurs autres que Victor Hugo, Alexandre Dumas et Balzac.
Lorsque Dumas fit jouer Henri III, on prétendit que « c’était encore Henri III à la Marivaux » ; l’auteur, ajoutait-on, n’était pas si novateur que ses amis voulaient bien le dire ; il se montrait moins hardi que plusieurs faiseurs de tragédies, que Népomucène Lemercier avec son Pinto, que Casimir Delavigne, dont le Marino Faliero et le Louis XI n’allaient pas tarder à constituer le « juste milieu » en littérature.
Alexandre Dumas faussait l’histoire, selon quelques critiques, en présentant au public un duc de Guise lâche et assassin ; dans les Barricades et les États de Blois, scènes dramatiques publiées quelques années auparavant par Vitet, mi-classique, mi-romantique, la grande figure du duc et le caractère hésitant du roi semblaient avoir été mieux tracés. Ludovic Vitet possédait de nombreux amis dans le libéralisme.
Les critiques piquèrent au vif Alexandre Dumas, dont le Théâtre-Français avait reçu une Christine de Suède ; et il se promit de ne plus commettre de marivaudages.
Son Henri III avait cependant obtenu un tel succès que l’alarme était au camp des soutiens de la tradition, – Arnault père, Etienne, Jouy, Delrieu, Viennet et tutti quanti.
Ces messieurs rédigèrent une Supplique au roi Charles X, qu’ils prièrent de maintenir le théâtre dans son antique dignité, d’éloigner par sa toute-puissance la tempête romantique, de repousser au-delà des frontières les conceptions anglaises ou allemandes, la barbarie de Shakespeare et la rêverie de Goethe, de faire respecter les lois d’Aristote et les ordonnances de Boileau.
« Que voulez-vous que j’y fasse ? avait répondu Charles X. Je n’ai comme vous qu’une place au parterre. »
Cette phrase spirituelle nous charma ; la guerre littéraire suivit son cours.
Soit au cénacle de Victor Hugo, formé depuis peu, soit dans les rangs des irréguliers de la nouvelle École, on se prêta assistance, on se serra les coudes pour marcher au feu. La camaraderie s’établit parmi les nouveaux contre la camaraderie des anciens. Jugez-en par ces exemples.
Frédéric Soulié, encore tout enivré du triomphe qu’il avait obtenu en 1828 avec sa tragédie de Roméo et Juliette, imitée de Shakespeare, fit représenter à l’Odéon, un an après, Christine à Fontainebleau, qui tomba complètement.
Alexandre Dumas, sur la demande d’Harel, directeur de ce théâtre, porta sa Christine de Suède de la rive droite sur la rive gauche, non sans hésitation et procès, parce qu’il ne voulait pas être désagréable à son co-lutteur Frédéric Soulié.
Celui-ci, faisant taire l’intérêt devant l’amitié, lui écrivit alors :
« Ramasse les morceaux de ma Christine, fais balayer le théâtre, prends-les, je te les donne. Tout à toi. »
Et il demanda cinquante places de parterre pour ses scieurs de long, – car le romantique Frédéric Soulié dirigeait une scierie mécanique près du pont d’Austerlitz. Les scieurs de long applaudirent vigoureusement l’œuvre d’Alexandre Dumas, dans le lieu où celle de leur patron avait été sifflée. L’œuvre nouvelle était intitulée Stockholm, Fontainebleau et Rome, trilogie dramatique sur la vie de Christine. Elle contient des beautés, noyées dans trop de longueurs.
Le surlendemain, Lamartine, le poète des Méditations et des Harmonies, prononçait son discours de réception à l’Académie française.
Sa brillante renommée, ses sympathies pour Victor Hugo, ses efforts afin d’élargir le domaine de la poésie, le désignaient, à nos yeux, pour remplacer avantageusement « l’immortel » Daru.
Le grand Cuvier, chargé de lui répondre, déclara « que l’Académie se ferait une loi d’appeler dans son sein tous les hommes qui, sans offenser la raison ou la langue, sauraient jeter dans leurs œuvres un intérêt de nouveauté véritable…. »
Allusion à l’auteur d’Hernani, qui attirait la foule, mais que le savant auteur des Révolutions du globe goûtait médiocrement.
Je ne vous parlerai pas d’Antony, de Charles VII, de Térésa, d’Angèle, qui valurent à Alexandre Dumas la réputation d’un auteur dramatique de talent, mais romantique, érigeant l’immoralité en système, – ce qui nous le fit placer parmi les maîtres, parmi les frondeurs des infâmes injustices de la société.
Révolutionnaires en littérature, nous ne reculions point devant le socialisme, quand nos auteurs aimés s’avisaient de vouloir réformer l’humanité, à leur manière, selon leurs fantaisies.
La Tour de Nesle, qui fut jouée le 29 mai 1832, mit toute notre pension en émoi.
Plusieurs de mes camarades avaient assisté à la première représentation ; j’assistai à la troisième, sans prévenir mes parents, entraîné que j’avais été par deux « grands » dans une escapade coupable, puisque je ne revins qu’à une heure du matin au logis, où ma bonne mère m’attendait anxieusement.
« D’où viens-tu, malheureux enfant ? me demanda-t-elle…. J’avais quatorze ans. Ton père s’est couché…. Il est fort en colère….
– Maman, je viens de voir un chef-d’œuvre, à la Porte-Saint-Martin…. Oh ! quelle magnifique pièce !…. la Tour de Nesle !…. Marguerite de Bourgogne et Buridan…. Le cachot ! »
Ma mère n’ajouta rien. Elle me voyait enthousiasmé.
Au lever, mon père me tança vertement. Je ne répondis mot. Que m’importait !… J’avais encore dans les oreilles les phrases terribles de Mlle Georges et de Bocage, de Marguerite et de Buridan, ainsi que l’apostrophe de Lockroy :
« Qui dit que Gauthier d’Aulnay est un bâtard ! »
Mon ivresse de la veille n’avait pas disparu le lendemain.
Huit jours après, loin d’être refroidi à l’endroit du drame où l’assassinat, l’adultère, l’inceste, le parricide, s’accumulent, je poursuivis une idée fixe : avoir sur ma tête un « chapeau à la Buridan », un feutre à retroussis sur le côté et pointu par le haut.
On en voyait beaucoup dans le quartier Latin. Ce chapeau avait toute l’importance d’une manifestation ; quiconque l’adoptait prouvait par là son amour du Moyen Âge. Or, le Moyen Âge nous envahissait depuis la publication de Notre-Dame de Paris, surtout depuis l’Écolier de Cluny, de Roger de Beauvoir, et les Mauvais Garçons, d’Alphonse Royer.
Je n’ai jamais obtenu ce « chapeau à la Buridan », tant désiré. Mes parents ont tenu bon contre mon effréné désir. Mais j’ai gardé les longs cheveux, comme bien d’autres adolescents de l’époque, et je me suis acheté un poignard semblable à celui d’Antony, une « bonne lame de Tolède, » avec les « semaines » qu’on me donnait.
Il faut rappeler, ici, que le feutre à retroussis sur le côté distinguait tout de suite un artiste ou un poète d’un bourgeois, et qu’il produisait le plus bel effet du monde au parterre des théâtres.
Avec cela, quelque juron haut en couleur vous plaçait presque au niveau des maîtres en herbe ou des génies incompris. On vous regardait autant qu’on regardait l’actrice en renom.
Chose remarquable, le chapeau ne fut pas seulement un signe de ralliement artistique ou littéraire ; il eut aussi sa signification politique, lorsque parurent les couvre-chefs gris dont se coiffèrent les républicains, pourvus également de gilets à la Robespierre, et se plaisant à évoquer les souvenirs de 93.
Pour le coup, les bourgeois s’indignèrent, et le chapeau gris fit sensation.





























