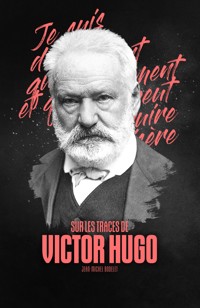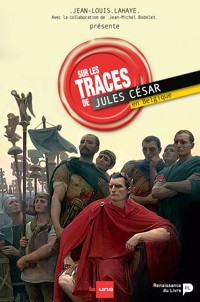
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Jules César. Un nom qui tonne. Un nom qui a traversé les siècles. Source d'inspiration et modèle pour certains hommes politiques, génocidaire pour d'autres, il ne laisse personne indifférent. Homme politique, général brillant, écrivain, Jules César est un personnage aux multiples facettes. Et ces "" Belges "" qu'il qualifiait de "" plus braves "", l'étaient-ils vraiment ? Quels sont les vestiges de son passage chez nous ? Du territoire ménapien à celui des Trévires en passant par celui des Eburons, cet ouvrage nous emmène dans le sillage de Jules César.
Cette collection est inspirée de l'émission Sur les traces de... Elle suit le parcours de femmes et d'hommes d'exception qui ont laissé à jamais leurs empreintes sur le sol belge.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Passionné par l'histoire,
Jean-Michel Bodelet décroche un diplôme de licencié en Histoire à l'université de Liège. Correspondant de presse pour L'Avenir du Luxembourg, il est également en charge du patrimoine pour la ville de La Roche-en-Ardenne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Remerciements
Jean-Michel Bodelet tient à remercier particulièrement le musée des Celtes de Libramont, la « cohorte tongrienne » et plus spécialement monsieur Étienne Willem, le Centre de documentation de l’Ourthe moyenne/ ASBL « Lire au fil de l’Ourthe » et sa responsable, Noëlle Willem.
Merci à la toujours présente Agnès Ledent.
Merci à Martine, soutien de tous les instants et aux deux p’tits gars, Augustin et Malo. Que la figure de César leur permette de se plonger dans nos racines et d’en appréhender les nombreuses richesses.
À ma filleule Chloé, que l’ombre de César lui permette d’appréhender le dur apprentissage du latin.
PRÉFACE
« Je préfère être le premier homme ici que le second dans Rome. » Le ton est donné !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jules César a de l’ambition dans tout ce qu’il entreprend : ascension politique, conquêtes militaires, carrière littéraire. Rien n’est impossible pour le général romain…
Peut-être parce qu’il était intimement convaincu d’être le descendant d’une déesse : Vénus.
Ou simplement parce qu’il pressentait que son destin serait exceptionnel… ou ne serait pas !
La persistance du mythe entourant le plus célèbre Romain de l’Antiquité est absolument fascinante ! Au moins tout autant que le personnage lui-même…
Car Jules César est un mythe. Et qui, mieux que lui-même, pouvait participer à l’élaboration de ce statut ? En effet, ses Commentaires sur la guerre des Gaules et son passage en Belgique n’ont pas une visée purement descriptive, mais bien politique : ils justifient la conquête du pouvoir suprême.
Et puis, quoi de mieux pour nourrir l’histoire belge que la légende d’Ambiorix – cet illustre Belge qui osa tenir tête à César, déclenchant la colère irrationnelle du général ? En effet, des peuples belges réunis face à la menace romaine parvinrent, par la ruse, à éliminer une légion et demie ! Ces « braves » guerriers, selon l’expression césarienne, n’échappent pas à la distorsion du fait historique à des fins géopolitiques.
Tour à tour admiré, respecté et craint – au point d’être assassiné au sommet de sa gloire –, la vie de César jalonnée de conquêtes est digne des meilleurs romans d’aventure !
Il y a définitivement un avant et un après J.-C. J.-C. pour Jules César bien sûr !
Ave.Jean-Louis Lahaye
INTRODUCTION
Jules César. Un nom qui sonne, qui tonne presque. Un nom connu de tous. À son évocation, certains fredonnent une chanson du Grand Jojo. D’autres l’imaginent criant, les armes de Vercingétorix sur les pieds dans un album d’Astérix. D’autres encore se souviennent de leurs premiers mots en latin, extraits de La Guerre des Gaules et appris par cœur. On le croit empereur alors qu’il ne l’a jamais été. On imagine son regard lorsque Brutus lui porte les coups de poignard fatals. On l’entend clamer « Veni, vidi, vici » ou « Alea jacta est ». Tout le monde sait qu’il est venu à bout de « nos ancêtres les Gaulois », que de grands personnages « belges » comme Ambiorix lui ont donné du fil à retordre ou encore qu’il y avait, dans la Belgique actuelle, des Ménapiens ou des Trévires.
Dans la préface de Jules César de Jérôme Carcopino, Jean-Louis Brunaux écrit : « César appartient au club très fermé des personnages historiques illustres qui, de leur vivant à nos jours, n’ont cessé de fasciner. Certes, il a travaillé lui-même à sa gloire immortelle. Convaincu, dès son plus jeune âge, de devoir accomplir la destinée exceptionnelle que ses lointains ancêtres lui avaient préparée. » César a influencé, servi de modèle à de « grands » hommes comme Napoléon, mis sur pied une politique qui, a posteriori, a été baptisée le « césarisme ». Deux mille ans après sa mort, il influence toujours le cinéma, la littérature ou la bande dessinée.
Pourtant, derrière des clichés universellement partagés, se cache un homme, une vie somme toute méconnue du grand public et une ambition : asseoir le pouvoir absolu à Rome. Cultivé, épris de littérature, écrivain lui-même, César aura été un grand homme d’État, fondant les bases de ce qui sera l’Empire romain. Un empire qui va considérablement influencer notre Europe occidentale. Guerrier, admiré de ses hommes, César est également celui qui réduira la civilisation celtique au silence, la fondant dans le moule romain.
Au-delà de l’image que nous nous faisons de lui, César est avant tout un homme de son temps. Il naît dans une république qui digère mal son expansion dans le monde méditerranéen. Une république en proie aux luttes intestines, aux conflits. Il choisit le camp des populares face à celui des optimates et se lance dans la célèbre « carrière des honneurs » qui fera l’objet de la première partie de ce livre.
La seconde et la troisième parties s’attacheront à la Guerre des Gaules, passage de César dans les régions « belges ». Impossible de passer sous silence sa célébrissime phrase : « De tous les peuples de la Gaule, les plus braves sont les Belges. » Une phrase qui doit évidemment être revue, elle aussi, dans son contexte. Nous découvrirons la civilisation celte, les batailles qui ont conduit les armées de César à la victoire. Si la conceptualisation est de mise, il nous a paru intéressant de recourir aux textes antiques pour que le lecteur plonge pleinement dans l’ambiance de cette époque.
La quatrième partie s’intéressera à l’homme immortel. César passe les siècles, devient un des Neuf Preux au Moyen Âge, est admiré par les princes et les rois avant de devenir héros de livres, d’opéra ou encore de bandes dessinées.
Derrière cette image d’Épinal, se cache également un personnage plus noir, laissant derrière lui des morts et des victimes. Certains verront même en lui un « génocidaire », rien de moins !
Les annexes vous permettront d’aller vous-mêmes à la découverte des traces du passage de César « chez les plus braves des peuples de la Gaule. »
Partie I : César, avant la guerre des Gaules
« Lorsque la Providence suscite des hommes tels que César, Charlemagne, Napoléon, c’est pour tracer aux peuples la voie qu’ils doivent suivre, marquer du sceau de leur génie une ère nouvelle, et accomplir en quelques années le travail de plusieurs siècles. Heureux les peuples qui les comprennent et les suivent ! Malheur à ceux qui les méconnaissent et les combattent ! »
Napoléon III, Histoire de Jules César, Tome I.
1.
CÉSAR, D’ORIGINE ROYALE ET DIVINE
« Par sa mère, ma tante Julie est issue des rois ; par son père, elle se rattacheaux dieux immortels. »
Suétone, Vie de César, VI.
Dans ce premier siècle avant Jésus-Christ, Rome a assis sa domination sur l’Italie en intervenant dans le bassin méditerranéen. En 146 avant Jésus-Christ, sa victoire sur Carthage, son ennemie viscérale, marque la fin de la troisième et dernière guerre punique. La même année, la ville grecque de Corinthe est rayée de la carte. Rome s’étend, intervient et rayonne. L’Espagne est à son tour conquise. La paix règne en Gaule cisalpine (nord de l’Italie). Rome traverse les Alpes et pénètre dans la Gaule dite transalpine. Après avoir donné du fil à retordre aux armées romaines, Cimbres et Teutons, des « Barbares », sont vaincus par Marius, l’oncle de Jules César. Marius vient ensuite à bout des Numides : Rome s’étend en Afrique.
Une telle expansion n’est pas sans conséquences. Les institutions dirigeantes de la ville ne sont plus adaptées. Il faut maintenant faire régner l’ordre aux quatre coins des territoires.
Vers une armée de métier
À l’origine, l’armée romaine était réservée aux citoyens riches. Les hommes devaient en effet s’équiper à leurs frais. Le « service militaire » était considéré comme un devoir. Cependant, au fil des conquêtes, un désintérêt certain est constaté pour la chose militaire. Marius décide de réformer profondément l’armée. Sur le plan de son recrutement tout d’abord : les pauvres peuvent désormais l’intégrer. Le « jeu en vaut la chandelle » puisque les conquêtes sont assorties de butins, en plus de la solde. L’État se charge d’équiper ses hommes. Outre des réformes organisationnelles, Marius s’inspire de la technologie militaire étrangère. Il adopte le glaive espagnol et puise dans les connaissances grecques pour faire évoluer son artillerie. Des troupes auxiliaires, nées des territoires conquis, font leur apparition. L’armée romaine compte maintenant en son sein des frondeurs baléares ou des cavaliers numides. Mais cette réforme qui débouche sur une armée de métier a un effet pervers. Les soldats sont plus enclins à prendre le parti de leur général que celui de la République.
Le rayonnement de Rome a de grandes conséquences économiques. Chaque conquête se décline en butins matériels et humains. Le sort des esclaves, peu enviable, donne lieu à des révoltes, dont la plus connue est celle de Spartacus en 73-71 avant Jésus-Christ. Les gros propriétaires terriens voient leurs possessions augmenter au détriment des petits qui émigrent alors hors d’Italie chercher de la terre à cultiver. Les régions conquises fournissent du blé concurrentiel. L’effet est immédiat : les hommes libres se retrouvent sans travail.
Dans les provinces contrôlées, l’affairisme est la règle. Un affairisme personnel au détriment du bien public. La classe des chevaliers qui pratique le commerce, en théorie interdit aux membres du Sénat, tire son épingle du jeu. Parallèlement, on voit apparaître à Rome le parti dit « populaire ». Ce parti veut lutter contre toutes ces inégalités, contre les problèmes nés des conquêtes et agir en faveur du peuple. Cependant, au sein de ses membres, les populares, on retrouve autant d’opportunistes que d’idéalistes. Ces populares vont entrer en lutte contre les optimates qui, composés de membres du Sénat et de leurs partisans, prônent en effet une politique conservatrice.
La société sous la République romaine
Rome, sous la République, est gouvernée par les chefs de grandes familles, les « patriciens ». Le reste de la population libre, la plèbe, n’a que des droits limités qu’elle va tenter d’étendre afin de se fondre, en partie, dans la noblesse. La plèbe peut s’exprimer via des comices dont le champ d’action est cependant plus que limité. Notons que le terme « plèbe » a deux sens : celui de « non patricien » et celui de « pauvre ». Les fonctions dirigeantes sont renouvelées chaque année et exercées par les consuls qui ont également un pouvoir dans le domaine militaire. Dans la réalité, le vrai pouvoir revient au Sénat.
Dans ce contexte difficile, malgré un essai de gouvernement autoritaire de la part du Sénat (121-109 av. J.-C.), les guerres civiles deviennent une constante. Elles dureront jusqu’à l’établissement de l’empire.
En 100 avant notre ère, dans cette Rome divisée, naît Jules César. Nous sommes au mois de juillet. Une certaine tradition affirme qu’il est né par césarienne. Dans Histoire naturelle, Pline l’Ancien écrit : « Les enfants dont les mères meurent en leur donnant le jour naissent sous de meilleurs auspices : c’est ainsi que naquit Scipion l’Africain l’Ancien et le premier des Césars, ainsi nommé de l’opération césarienne qu’on fit à sa mère. Cette même cause a fait donner à d’autres le nom de Céson Manillus, qui entra dans Carthage avec une armée, eut une naissance semblable. » Si cette méthode chirurgicale était connue dans l’Antiquité, elle n’était utilisée qu’en cas de décès de la maman. Or, nous savons que la mère de César n’est pas décédée en couche. Le nom de César viendrait plutôt d’une tradition familiale ancestrale. La glorification des ancêtres est importante dans l’aristocratie. Au sein des Jules, on affirme que lors d’une guerre contre Carthage, un des membres de la famille aurait tué un éléphant qui se disait « caesar » dans le langage des Carthaginois. Si cette affirmation sémantique est mise à mal par des études récentes, cette tradition est restée au sein de la famille.
Jules César a une très haute idée de ses ancêtres. Ainsi, lorsqu’il fait l’éloge funèbre de sa tante Julie, Suétone nous rapporte qu’il lance : « Par sa mère, ma tante Julie est issue des rois ; par son père, elle se rattache aux dieux immortels. En effet, d’Ancus Marcius descendaient les Marcius Rex, dont le nom fut celui de sa mère ; de Vénus descendent les Jules, dont la race est la nôtre. On voit donc unis dans notre famille et la majesté des rois, qui sont les maîtres des hommes, et la sainteté des dieux, qui sont les maîtres des rois eux-mêmes. » Au sein de la famille de César, une autre histoire, une autre « légende dorée », est racontée de génération en génération. Peu avant la guerre de Troie, la déesse Vénus, venue sur terre, s’éprit du Troyen Anchise.
Un enfant a vu le jour de cette union entre la déesse et un simple mortel : Énée. Énée, la perfection incarnée. Sa ville détruite, il s’exile en Italie où il a de nombreux enfants parmi lesquels Romulus, un des fondateurs de Rome et Iulius. Ce dernier était considéré dans la famille de César comme l’ancêtre des Jules.
De la jeunesse de Jules César, on ne sait presque rien. En effet, la première partie de De la vie des douze Césars de Suétone consacrée à Jules est perdue. Elle ne débute que lorsque César a 15 ans. La biographie que Plutarque lui dédie est également incomplète. Le premier chapitre qui est en notre possession fait état de la lutte entre Sylla et César.
Comment donc se sont dessinées les premières années de la vie de Jules César ? On peut supposer que le jeune César a suivi le chemin normal de tout enfant de l’aristocratie de l’époque. Jusqu’à 7 ans, le jeune garçon était placé sous l’éducation de sa mère, en l’occurrence ici Aurélia. Tacite souligne dans ses Dialogues : « Et ce n’étaient pas seulement les études et les travaux de l’enfance, mais ses délassements et ses jeux qu’elle (la mère NDLA) tempérait par je ne sais quelle sainte et modeste retenue. […] Ainsi Aurélie, mère de César, ainsi Atia, mère d’Auguste, présidèrent, nous dit-on, à l’éducation de leurs enfants, dont elles firent de grands hommes. Par l’effet de cette austère et sage discipline, ces âmes pures et innocentes, dont rien n’avait encore faussé la droiture primitive, saisissaient avidement toutes les belles connaissances, et, vers quelque science qu’elles se tournassent ensuite, guerre, jurisprudence, art de la parole, elles s’y livraient sans partage et la dévoraient tout entière. » Aurélia a sans conteste eu recours à un professeur particulier qui enseigna au jeune César les bases de l’arithmétique, de la lecture, du latin et du grec.
Passé l’âge de 7 ans, c’est le père qui reprend le flambeau. Le père de César, César, a exercé plusieurs fonctions militaires. À la naissance de son fils, il quitte la questure, fonction qui avait notamment la charge des finances. On le retrouve préteur, fonction judiciaire, en 92 et proconsul d’Asie en 91 avant Jésus-Christ. Son rôle de père est de poursuivre l’éducation initiée par la mère, notamment dans le domaine intellectuel avec, par exemple, la découverte et l’analyse des auteurs classiques. L’éducation physique n’est pas non plus négligée. Elle fera de César fils un excellent cavalier, un nageur patenté, un athlète complet.
Une éducation gauloise ?
Dans Des grammairiens illustres, Suétone évoque le parcours du précepteur Antonius Gniphon : « Né en Gaule de parents libres, avait été exposé par sa mère. Son père nourricier l’affranchit et le fit instruire à Alexandrie. On dit qu’il avait un esprit vaste, une mémoire étonnante, et un grand savoir dans les littératures grecque et latine : avec cela, un caractère facile et doux, et un désintéressement qui, en lui faisant toujours mépriser le salaire, lui valut des récompenses d’autant plus fortes de la libéralité de ses disciples. » L’auteur latin poursuit : « Il enseigna d’abord dans la maison de Jules César encore enfant, puis dans la sienne. » Le futur vainqueur de la guerre des Gaules aurait eu un précepteur gaulois ! Mais probablement un Gaulois cisalpin, du nord de l’Italie.
Sans doute César découvre-t-il les récits militaires à cette époque. Le contact avec son père doit l’aider dans sa découverte de « l’art de la guerre ». À 16 ans, le jeune César poursuit sa formation, notamment en rhétorique. Il fait des séjours à Rhodes, à Athènes, ce qui fait de lui un parfait bilingue. La formation se veut également encyclopédique, touchant à tous les domaines connus. Les anciens parlent dans ce sens de « philosophie ». C’est également à l’âge de 16 ans que César perd son père.
2.
LE DUR APPRENTISSAGE ET L’EXIL