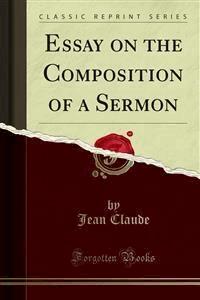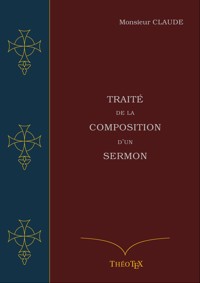
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Avant son exil aux Pays-Bas, suite à la révocation de l'Édit de Nantes, Jean CLAUDE, dit Monsieur Claude (ce qui évite la confusion avec un prénom), avait dicté ce traité d'homilétique, pour le bénéfice d'un de ses élèves. Il ne fut imprimé qu'en 1688, après sa mort, par son fils Issac, pasteur à La Haye. Maintes fois réédité dans sa version anglaise, il ne l'avait jamais été en français. Son utilité pour la prédication d'aujourd'hui n'est cependant pas négligeable : Claude y développe quatre voies de composition à partir d'un texte biblique : 1. par Explication, 2. par Observations, 3. par Exhortation continue, 4. par Propositions. Il qualifie les deux premières façons de prêcher de «textuaires», pour exprimer qu'elles s'attachent résolument au texte, sans s'en écarter (textuaire, et non pas textuelle, qui en français n'a pas le même sens). A l'heure d'un regain d'intérêt pour la prédication centrée sur l'Écriture, le lecteur découvrira avec intérêt, dans une orthographe modernisée, ce monument précieux de l'épopée protestante. Cette numérisation ThéoTeX reproduit en orthographe modernisée le texte de 1688.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322473915
Auteur Jean Claude. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Le Traité de la Composition d'un Sermon se trouve à la fin du Volume I des Œuvres Posthumes de Monsieur Claude, livre publié à La Haye en 1688 par Isaac Claude, fils de l'auteur. Dans la Préface, nous apprenons que MrClaude avait autrefois (c-à-d lorsqu'il était encore en France, avant la révocation de l'Édit de Nantes) dicté ce texte pour l'instruction d'une personne qui lui était chère, probablement un pasteur, dont le nom ne nous est pas révélé. Ainsi s'expliquent le caractère oral du style, nous donnant par la même occasion une indication fidèle de la manière dont Claude prêchait, et l'absence de divisions et de subdivisions, qui en général organisent un traité de cette étendue.
Unique en son genre à l'époque, l'ouvrage attire un siècle plus tard l'attention d'un pasteur anglais, Robert Robinson, qui le traduit et le fait paraître à Cambridge en 1779. Charles Simeon, prédicateur qui a joui d'une certaine notoriété en Angleterre, le publie à son tour en 1792, mais en l'abrégeant d'un côté, et en l'augmentant de l'autre, par l'ajout d'une centaine de plans de sermons de son propre crû. L'affaire lancée, après cette typique annexion anglaise, Claude' Essay on the Composition of a Sermon, connut une série de rééditions successives au cours du xixe siècle. Et en français ? Rien… Au xviiie s. le pasteur suisse A. Chavannes en recommande la lecture, au xixe A. Vinet consacre tout un chapitre au prédicateur Claude, dans son Histoire de la Prédication Parmi les Réformés de France, et où naturellement il analyse ce Traité, et en détaille les qualités.
Car, malgré son défaut de caractère systématique, qui ne permet pas de le comparer à des ouvrages exhaustifs comme l'Homilétique ou Théorie de la Prédication de Vinet, le discours de Claude n'est pas dépourvu d'une structure intéressante, dont les éléments peuvent toujours guider le prédicateur contemporain :
Pour Claude, à partir d'un texte biblique donné, et bien choisi, l'Action dans la Chaire (c-à-d le message) peut prendre quatre formes :
Ces quatre méthodes ne s'excluent pas l'une l'autre, mais peuvent être combinées en diverses proportions. Aucune d'elles, pas même la quatrième, ne correspond à ce que nous appelons une prédication thématique, car Claude se limite à un seul texte, sans courir après toutes les références possibles pour traiter un sujet.
La prédication de Claude est-elle pour autant textuelle ? Ce mot mis à la mode par la transcription de l'anglais textual sermon, ne convient guère en français. En effet, une prédication textuelle signifierait que l'on répète verbatim, mot pour mot, le passage biblique ; ou bien qu'on se limite à l'examen du vocabulaire et de la syntaxe du texte. Au début du chapitre vii, Claude signale que les deux premières façons de prêcher (Explication et Observations) sont dites textuaires, parce qu'elles collent au texte, sans s'en écarter. Voici donc le bon terme, qui se trouve encore aujourd'hui dans les bons dictionnaires, mot qui se rapproche d'ailleurs de scripturaire : MrClaude est le chantre, l'aïeul et le guide de la prédication textuaire.
Et à propos de vocabulaire, bien qu'ayant modernisé l'orthographe, nous avons tenu à conserver, sauf très rares exceptions, le français de Claude, ainsi que ses citations de la Bible Martin. Il serait inadmissible que les acteurs du pupitre français prétendent connaître un peu de grec, d'hébreu et de latin, et ne soient pas capables de comprendre un texte écrit au temps de Corneille et de Boileau. Dans tous les pans de la société française, des esprits criminels travaillent incessament à la ruine et à la fossilisation de notre belle langue ; il n'est pas nécessaire que la chaire évangélique, qui se doit d'être toujours respectueuse des individualités, s'associe à leur entreprise.
Pour terminer cette notice, un mot sur la valeur actuelle des sermons de Claude, dont on aura une idée assez complète en lisant son traité, car il contient d'abondants extraits d'Actions, qu'il a joué pour de vrai, dans les églises. L'auteur est un pur Réformé du xviie siècle, c-à-d que son calvinisme est un calvinisme de conviction, et non un calvinisme de posture, comme celui des néo-réformés que nous connaissons. On peut donc admettre, et comprendre, que Claude proclame, sans précautions oratoires, les doctrines de l'élection inconditionnelle, de la grâce irrésistible, de la damnation horrible et certaine des non-élus ; on peut même le lui pardonner : Claude est sincère, et cela se sent. Mais quel néo-réformé pourrait se permettre de faire de même ? S'il tentait d'affirmer avec autant d'aplomb que Claude les mêmes axiomes calvinistes, les petites blagues que selon sa coutume, il aura placées au début de son message et tout du long, suffiront à persuader ses auditeurs qu'il n'a jamais eu dessein de leur faire prendre au sérieux un tel déterminisme métaphysique. Et d'ailleurs où serait l'auditoire qui accepterait d'entendre que la plupart des hommes sont prédestinés aux peines éternelles avant que de naître ? La salle serait vide le dimanche d'après. C'est pourquoi le lecteur désireux d'appliquer de manière pratique ce qu'il aura appris dans ce Traité, conçu au temps de la monarchie absolue, sera bien avisé d'adapter les exemples qu'il y trouvera aux réalités humaines modernes.
Le sermon textuaire, connaîtra-t-il un renouveau au sein du peuple protestant qui lui a donné le jour ? Il faudrait pour cela plus qu'une imitation de mode, plus qu'une ambition d'orthodoxie, plus qu'un esprit clérical, mais une véritable passion pour le texte lui-même, pour sa signification propre. Autrement dit, la racine du sermon textuel, s'il faut céder à cet anglicisme, sa raison d'être, c'est l'exégèse. Dieu a accordé par le passé d'excellents exégètes de sa Parole, s'exprimant dans notre propre langue : les Du Moulin, Daillé, Drelincourt, Superville, Saurin, Monod, Vinet, Bonnet, Godet, Barde, Rilliet, Sardinoux etc., tous ceux-là écrivirent en français, et furent traduits en leur temps dans d'autres pays que le leur, où leur valeur reste reconnue. Mais avec le mépris d'une langue, vient l'oubli et la déconsidération de ses meilleurs auteurs ; l'amour du beau texte quitte le peuple qu'elle habitait, pour laisser place à des engouements d'apparence et à des traductions superficielles. Un vrai renouveau de la prédication française ne trouvera sa cause que par la grâce de Dieu, qui daignera rallumer dans son cœur un amour ardent pour la Parole de Vérité, dont les flammes de louange et de proclamation évangélique iront spontanément puiser leur huile dans les trésors souterrains de sa langue, que le Seigneur lui a donnée.
Il y a en général cinq parties dans un sermon : l'Exorde, la Connexion, la Division, la Tractation et l'Application ; mais parce que la connexion et la division sont des parties qui doivent être extrêmement courtes, on ne doit proprement compter que trois parties, l'exorde, la tractation, et l'application. Nous ne laisserons pas pourtant de dire quelque chose de la connexion, et de la division.
La connexion est la liaison de votre texte, avec les textes précédents ; et pour la trouver, il faut bien considérer la suite du discours, et consulter sur cela non seulement les commentaires mais particulièrement le bon sens ; car quelquefois les commentaires philosophent trop, et donnent des liaisons fortes et tirées de trop loin. Il faut éviter celles qui sont de cette sorte, car elles ne sont pas naturelles, et le bon sens découvre quelquefois bien plutôt la suite, que ne fait l'étude. J'avoue qu'il y a des textes dont la liaison avec les précédents ne paraît pas d'abord ; et alors il faut, ou tâcher de découvrir cette liaison par la force de la méditation, ou prendre celle que les commentaires vous fournissent ; et entre plusieurs qu'ils donnent, choisir celle qui vous paraîtra la plus naturelle, ou si l'on en trouve point, qui soit vraisemblable, le mieux est de n'en faire point. Quoi qu'il en soit la liaison est une chose sur laquelle il faut très peu insister ; parce que c'est une partie sur laquelle les auditeurs ne s'arrêtent presque point, et dont le peuple ne peut tirer que très peu d'instruction.
Quand la liaison peut nous fournir quelques belles considérations pour l'éclaircissement du texte, il la faut mettre dans la tractation, et cela arrive assez souvent. Quelquefois aussi vous en pouvez tirer un exorde ; et cela étant, l'exorde et la liaison sont confondus ensemble.
La division en général doit être restreinte à un petit nombre de parties, et elle ne doit jamais excéder le nombre de quatre, ou de cinq tout au plus ; les plus justes sont de deux, ou de trois.
Il y a deux sortes de division dont on peut justement se servir. L'une qui est plus ordinaire est la division du texte en ses parties. L'autre est la division du discours de l'action même qu'on a à faire sur le texte.
Cette dernière division des parties du discours a lieu, lorsque pour donner du jour à un texte, il faut nécessairement ramener plusieurs choses que le texte suppose sans les marquer formellement ; ou il les faut tirer d'ailleurs, pour pouvoir donner ensuite la juste explication de votre texte. En ce cas vous pouvez diviser votre discours en deux parties, dont la première contiendra quelques considérations générales, nécessaires pour l'intelligence du texte, et la seconde l'explication particulière du texte même. Cette méthode a lieu toutes les fois qu'on traite quelque oracle de l'Ancien Testament. Car le plus souvent le dénouement de ces oracles dépend de plusieurs considérations générales, qui rejettent les sens faux et mauvais qu'on y pourrait donner, et qui ouvrent le chemin à la véritable explication ; comme il paraît parce qu'on a dicté sur l'oracle de la Genèse : Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et la semence de la femme ; cette semence te brisera la tête, et tu lui briseras le talon, et sur celui de l'alliance traitée avec Abraham.
Cette même méthode a lieu, quand on traite un texte tiré d'une dispute, donc par conséquent l'intelligence doit dépendre de l'état de la question, de l'hypothèse des adversaires, et des principes de l'auteur sacré. Tous ces éclaircissements sont nécessairement préalables, et ils ne se peuvent donner que par des considérations générales. Par exemple, si on avait à traiter ce texte du chapitre trois de Romains : Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Il faudrait faire précéder des considérations générales qui éclaircissent l'état de la question entre saint Paul et les Juifs, touchant la justification ; qui marquent aussi la vraie hypothèse des Juifs sur ce sujet, et qui fassent voir le vrai principe que Paul veut établir, enfin qu'ensuite on pût clairement entendre le sens du texte.
Cette méthode a aussi lieu, quand il s'agit d'une conclusion qui est tirée d'un long discours précédent, comme par exemple ce texte du cinquième chapitre de Romains : Etant donc justifiés par la foi, nous avons paix envers Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs s'imaginent que pour bien traiter ce texte, il ne faut point parler de la justification par la foi, mais qu'il faut seulement traiter la paix que nous avons envers Dieu, par Jésus-Christ, comme un fruit de notre justification. J'avoue qu'il ne faut point faire de la matière de la justification une partie du texte, mais c'est une conclusion que l'apôtre tire de la division de la dispute précédente. C'est se moquer de s'imaginer qu'on puisse supposer cette dispute, comme connue aux auditeurs, sans qu'il soit nécessaire de la leur remettre devant les yeux ; car les auditeurs n'ont pas ces idées assez présentes, pour les pouvoir ainsi supposer. Il faut donc diviser le discours en deux parties. Dans la première faire des considérations générales sur la doctrine de la justification que saint Paul a établie dans les chapitres précédents, et puis en faire voir la conclusion qu'il en tire ; à savoir qu'étant ainsi justifiés, nous avons paix envers Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Il en est de même de Romains.8.1 : Ainsi donc il n'y a maintenant nulle condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne cheminent point selon la chair, mais selon l'Esprit. Car c'est une conséquence qu'il tire de ce qu'il avait auparavant traité.
Cette même méthode a lieu dans les textes du Nouveau Testament, où il y a quelque passage de l'Ancien, allégué ; car alors il faut faire voir par des considérations générales qu'il est allégué bien à propos ; et ensuite venir à l'explication. C'est ainsi, par exemple, qu'il faut traiter les textes Hébreux.1.5-6 : Car auquel des anges a-t-il jamais dit, c'est toi qui est mon Fils, je t'ai aujourd'hui engendré ? Et derechef, je lui serai Père, et il me sera Fils. Et encore quand il introduit au monde son Fils premier-né, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux.2.6 : Et quelqu'un a témoigné en quelque lieu, disant, qu'est-ce que de l'homme pour que tu aies souvenance de lui ; ou du Fils de l'homme pour que tu le visites ?Hébreux.3.7 : Partant ainsi que dit le Saint Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez point vos cœurs, et plusieurs autres semblables.
Dans ce genre des divisions du discours il faut mettre les divisions par différents égards ou par différents sens, qui à proprement parler ne sont point des divisions du texte en ses parties, mais sont plutôt des divisions des différentes explications, ou des différentes applications que vous faites des paroles du texte. Ces divisions ont lieu :
1o lorsqu'on traite un texte typique, comme par exemple, un nombre presque infini de passages tirés des Psaumes de David, qui ont du rapport non seulement à David, mais aussi à Jésus-Christ. Car alors on doit diviser le discours en deux parties, dont l'une considère le sens littéral, et l'autre le mystique : l'un par rapport à David et l'autre par rapport à Jésus-Christ. Il y a même quelquefois de ces textes typiques, qui outre le sens littéral en ont plusieurs de figurés, se rapportant non seulement à Jésus-Christ, mais aussi à l'Église, ou à chaque fidèle en particulier ; ou bien qui ont des degrés de leur accomplissement mystique. Par exemple, ces paroles Aggée.2.9 : La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, se doivent traiter en cinq égards :
De même ce passage : Je ne mangerai plus cet agneau de Pâque jusqu'à ce qu'il soit accompli au royaume de Dieu. Je dois diviser partout les différents égards que l'agneau pascal avait :
Ainsi ce passage de Daniel : A toi Seigneur est la justice, et à nous la confusion de face, qui est très propre pour un jour de jeûne, se doit diviser non par parties, mais par différents égards :
Ainsi ce texte de saint Paul Hébreux.3.7-8 : Aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ainsi qu'en l'irritation, au jour de la tentation au désert. Lequel est tiré du psaume 95 et qui est aussi fort propre pour un jour de censure ou de jeûne, ne se peut mieux diviser qu'en le considérant à trois égards 1o par rapport au temps de David, 2o par rapport au temps de saint Paul et 3o par rapport à nous-mêmes dans ce temps-ci.
Quant à la division du texte même, quelquefois l'ordre des paroles est si clair et si naturel, qu'il n'est pas nécessaire de faire d'autres divisions ; et en ce cas, il suffit seulement de marquer qu'on suivra l'ordre des paroles par exemple ce texte Ephésiens.1.3 : Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni en toutes bénédictions spirituelles, aux lieux célestes en Christ, est un de ceux auxquels il n'est point nécessaire de division, parce que les paroles se divisent d'elles-mêmes, et il ne faut que les suivre pour considérer :
Remarquez en passant sur ce texte qu'il y a une manifeste allusion à la première bénédiction dont Dieu bénit les créatures quand il les eut faites selon qu'il est marqué au premier chapitre de Genèse :
La plupart des textes pourtant, doivent être formellement divisés. Pour cet effet il faut principalement avoir égard à l'ordre de la nature, et tâcher de mettre la division qui naturellement précède, dans le premier lieu, et ensuite les autres chacune dans sa place ; ce qui se fera facilement, si l'on réduit le texte en proposition catégorique, commençant par le sujet, et ensuite mettant l'attribut, et puis les autres termes, selon que le bon sens dictera qu'ils doivent être placés. Par exemple, si j'avais à expliquer ces paroles de Hébreux.10.10 : Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés, à savoir par l'oblation une seule fois faite du corps de Jésus-Christ. Il y aurait de l'inconvénient de parler premièrement de la volonté de Dieu, ensuite de notre sanctification, et enfin de la cause de notre sanctification, qui est l'oblation du corps de Jésus-Christ. Il serait beaucoup mieux de réduire ce texte en proposition catégorique de cette manière : L'oblation du corps de Jésus-Christ une seule fois faite, nous sanctifie par la volonté de Dieu. Car il est plus naturel de considérer : 1o La cause prochaine et immédiate de notre justice, qui est l'oblation du corps de Jésus-Christ fait une seule fois. 2o Son effet, qui est notre sanctification. 3o La cause première et plus éloignée qui lui fait produire cet effet ; savoir la volonté de Dieu.
Au reste il faut se souvenir qu'il y a deux ordres naturels : l'un naturel à l'égard des choses mêmes ; et l'autre naturel à notre égard. Le naturel à l'égard des choses mêmes, est celui qui met chaque chose dans sa naturelle situation, de la manière qu'elles sont en elles-mêmes, sans avoir égard à l'ordre de notre connaissance. L'autre que j'appelle naturel à notre égard, observe la situation pour les choses lorsqu'elles paraissent en notre esprit, ou qu'elles entrent en notre pensée. Par exemple, dans le texte que je viens d'alléguer : Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés, à savoir par l'oblation une seule fois faite du corps de Jésus-Christ. L'ordre naturel des choses veut qu'on mette la proposition en cette forme : par la volonté de Dieu, l'oblation du corps de Christ nous sanctifie ; ou la volonté de Dieu par l'oblation de Jésus-Christ nous sanctifie. Car 1o la volonté de Dieu c'est le décret de son bon plaisir qui envoie son Fils au monde. 2o L'oblation de Jésus-Christ est le premier effet de cette volonté. Et 3o notre sanctification est l'effet de l'oblation par cette volonté. L'ordre au contraire naturel de notre connaissance, veut que premièrement nous considérions cette oblation ; en second lieu cette sanctification qu'elle produit ; et enfin la volonté de Dieu qui lui donne cette efficace. Quand on a des textes où l'ordre naturel des choses est différent de celui de notre connaissance, il est arbitraire de prendre l'un ou l'autre. Je crois néanmoins qu'il vaut mieux suivre celui de notre connaissance, parce qu'il est plus facile et plus clair pour les auditeurs.
Il y a des textes qui contiennent la fin et les moyens, la cause et l'effet, le principe et la conséquence déduite des principes, l'acte et le principe de l'acte, l'occasion et le motif de l'occasion. En ce cas il est arbitraire, ou de commencer par les moyens et ensuite traiter de la fin, par les effets et ensuite traiter de la cause, par les conséquences et ensuite traiter du principe, par l'acte et ensuite par le principe de l'acte ; ou de suivre un ordre contraire. Par exemple dans ce texte 2Timothée.2.10 : Pour cette cause je souffre toutes choses pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Il est évident qu'il y a dans ce texte trois parties : les souffrances de l'apôtre, la fin qu'il se propose, et le principe par lequel il se propose cette fin. Il est donc arbitraire ou de parler en premier lieu de la charité de saint Paul pour les élus ; en second lieu du salut qu'il désire qu'ils obtiennent en Jésus-Christ ; et en troisième lieu des souffrances qu'il endure pour cela ; ou de parler 1o des souffrances ; 2o de la fin qu'il se propose dans les souffrances, à savoir le salut des élus en Jésus-Christ avec gloire éternelle ; et 3o de son amour pour les élus qui est le principe par lequel il souffre. Mais bien qu'en général on puisse dire qu'il soit arbitraire, de suivre dans la division l'un ou l'autre de ces deux ordres, si est-ce qu'il y a quelquefois des textes qui vous déterminent, et vous obligent à suivre plutôt l'un de ces ordres que l'autre. Par exemple dans ce texte : Dieu produit en nous et le vouloir et le parfaire, selon son bon plaisir. Il est clair qu'il y a trois choses à traiter, à savoir l'action de grâce de Dieu sur les hommes : Dieu produit en nous avec efficace. L'effet de cette grâce, c'est le vouloir et le parfaire. Le principe de cette grâce : selon son bon plaisir. Il me semble que la division ne serait pas bonne si 1o on voulait traiter du bon plaisir de Dieu ; 2o de la grâce ; et 3o du vouloir et du parfaire de l'homme. Il faut à mon avis commencer par l'explication de ce vouloir et de ce parfaire qui est l'effet de la grâce ; ensuite parler de la grâce même qui le produit en nous avec efficace ; et enfin des principes de la grâce, à savoir le bon plaisir de Dieu. Il est donc nécessaire de consulter toujours le bon sens, et de ne se conduire pas tant par des règles générales, qu'on examine aussi les circonstances particulières.
Il faut éviter sur toute chose dans les divisions de mettre pour votre première partie, une chose qui suppose l'intelligence de la seconde, ou qui vous oblige de traiter la seconde, pour faire connaître la première ; car par ce moyen vous vous jetteriez dans une grande confusion, et vous seriez obligé à des répétitions ennuyeuses. Il faut tâcher de faire ses parties les plus dégagées l'une de l'autre qu'il se pourra ; et pour cet effet lorsque vos parties sont enchaînées l'une dans l'autre, il faut toujours choisir pour la première, celle qui a le plus de détachement, et tâcher que cette première serve de fondement à l'explication de la seconde, et la seconde, à l'explication de la troisième, afin qu'au bout de votre explication, l'auditeur voie d'un coup d'œil, un corps parfait et comme un bâtiment achevé. Car une des grandes perfections d'un sermon et que toutes ses parties s'entretiennent, que les premières conduisent aux secondes, que les secondes servent de lumière au troisième, que celle qui précède donne désir pour celle qui doive suivre, et enfin que la dernière rappelle toutes les autres, pour former dans l'esprit de l'auditeur une idée complète de toute la matière. C'est ce qui arrivera, non sur toutes sortes de textes, car cela ne se peut, mais sur plusieurs qui sont fort propres pour faire un projet. Mais en ce cas il faut non seulement que le projet soit bien formé, mais aussi qu'il soit heureusement exécuté.
Il y a souvent dans les textes que vous réduisez en proposition catégorique, de la nécessité à traiter le sujet de votre proposition, aussi bien que l'attribut ; et alors il faut faire du sujet, une partie. C'est ce qui arrive lorsque le sujet de la proposition est exprimé en des termes qui méritent explication, ou qui fournissent beaucoup de considérations à faire. Par exemple, ce texte Jean.15.5 : Qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruit, est une proposition catégorique dont il faut nécessairement traiter le sujet, à savoir, celui qui demeure en Jésus Christ, et en qui Jésus-Christ demeure. Je dis la même chose de ces textes : Qui croit en moi a la vie éternelle. Qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Ainsi donc maintenant il n'y a nulle condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne cheminent point selon la chair, mais selon l'Esprit. Si quelqu'un est en Christ, qu'ils soit nouvelle créature.
Les deux derniers doivent être réduits en proposition catégorique dont le sujet est : ceux qui sont en Christ. Et en cela, en tous les autres semblables, on doit faire du sujet une partie. Il faut même en faire la première ; car il est plus de l'ordre de la nature et de celui de la doctrine, de commencer par le sujet d'une proposition.
Quelquefois il est nécessaire, non seulement de faire du sujet une partie, et de l'attribut une autre ; mais aussi d'en faire une de la liaison du sujet avec l'attribut. En ce cas, il faut dire après avoir marqué en premier lieu le sujet, et en second lieu l'attribut, que l'on considérera pour une troisième le sens entier de toute la proposition. C'est ce qu'il faut faire dans ces textes : Si quelqu'un est en Christ, qu'il soit nouvelle créature. Qui croit en moi a la vie éternelle.
Quelquefois il y a dans les textes que l'on réduit à des propositions catégoriques, de ces termes qu'on appelle dans l'École syncatégorématiquesa ; et alors il les faut réduire ou au sujet ou à l'attribut selon, selon qu'on verra qu'ils s'y rapportent.
Quand dans un texte, il y a plusieurs termes qui méritent chacun une explication particulière, et que l'on ne peut pas sans confusion, ou sans faire une division de trop de parties, faire de chacun une partie, alors il ne faut pas diviser le texte, mais il faut diviser le discours en deux, en disant que premièrement l'on donnera l'explication des termes, et qu'ensuite on viendra à la chose elle-même. C'est ce qui doit avoir lieu dans ce texte, Actes.2.27 : Tu ne laisseras point mon âme au sépulcre, et tu ne permettras point que ton Saint sente la corruption. Car pour bien traiter ce passage, j'estime qu'il faut diviser le discours en trois parties. Dans la première, il faut faire des considérations générales pour faire voir que ce texte appartient à Jésus-Christ, et que saint Pierre l'a bien allégué. Dans la seconde, il faut faire des considérations particulières sur les termes d'âme, qui signifie la vie ; de sépulcre, qui dans l'original signifie aussi l'Enfer, sur quoi ceux de l'Église Romaine fondent leur imagination de la descente de Jésus-Christ aux Limbesb ; de Saint qui en ce lieu-là veut dire principalement immortel
, impérissable, et tout immuable ; et de corruption, qui signifie non la corruption morale du péché, mais la corruption physique de nos corps. La troisième enfin doit examiner la chose même dont il s'agit : à savoir, la résurrection de Jésus-Christ.
Il y a souvent des textes, où il n'est pas nécessaire de traiter, ni le sujet, ni l'attribut de la proposition, mais où toute la tractation doit tomber sur des termes syncatégorématiques. Par exemple, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La proposition catégorique est : Dieu a aimé le monde. Et là il n'est pas nécessaire, ni d'insister beaucoup sur le terme de Dieu, ni de se jeter dans le lieu commun de l'amour divin, il faut que la division se fasse en deux points, dont le premier est, le don que Dieu nous a fait de son Fils par son amour, et le second, la fin pour laquelle il nous l'a donné, à savoir, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quant au premier, il faut d'abord faire voir comment Jésus-Christ est un don de Dieu :
De là on peut passer au principe de ce don qui est l'amour : et après avoir établi que c'est un amour de bon plaisir, dont on ne peut rendre aucune raison de la part des créatures, il faut particulièrement presser le terme de tant, et faire voir la grandeur de cet amour, par plusieurs considérations. Ensuite il faut passer au second point, et examiner premièrement le fruit de l'envoi de Jésus-Christ qui est le salut de l'homme, représenté ici par deux expressions : l'une négative, qu'il ne périsse point ; l'autre positive, qu'il ait la vie éternelle ; et il faut traiter l'une et l'autre. Après cela, il faut examiner qui sont ceux pour qui ce fruit de l'envoi de Jésus-Christ est destiné, à savoir, les croyants. Enfin il faut presser le mot de quiconque, qui signifie deux choses : l'une, que nul croyant n'est exclus du bénéfice de Jésus-Christ ; et l'autre que nul homme, en tant que tel, n'est exclus de la foi, mais qu'ils y sont tous indifféremment appelés.
Dans les textes de raisonnement, il faut examiner les propositions qui composent le syllogisme, l'une après l'autre, et en faire de chacune une partie. Quelquefois même il sera nécessaire de considérer la force du raisonnement, et faire une partie, de cela même. Quelquefois il y a quelque proposition qui se trouve supprimée, et qu'il est nécessaire de suppléer. En ce cas, on verra si cette proposition supprimée est assez importante pour en faire une partie. C'est ce qui se trouve quelquefois comme dans ce texte de l'Épître aux Romains : Que dirons-nous donc qu'Abraham notre père a trouvé selon la chair ? Certes si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se vanter mais non pas envers Dieu. Là, premièrement, il faut faire deux parties, dont l'une est la question que se pose l'apôtre : Que dirons-nous donc, qu'Abraham notre père a trouvé selon la chair ? et l'autre, la solution qu'il donne à cette question. Et quant à la question, il en faut premièrement bien établir le sens, lequel dépend de l'intelligence de ces mots, selon la chair. Car cela veut dire selon les principes de la nature, par rapport à la naissance de son fils Isaac, lequel ne vint point au monde par les voies ordinaires, et selon les forces de la nature, puisque Sarah était stérile et hors d'âge d'enfanter. Or comme cela même, à savoir l'état naturel d'Abraham dans son mariage, était un type de l'état de son âme à l'égard de Dieu, ce selon la chair, signifie aussi selon les œuvres par égard à la justification devant Dieu. Le sens donc de la question est : Que dirons-nous d'Abraham notre père ? a-t-il été justifié devant Dieu par ses œuvres ? Et il ne faut pas manquer de remarquer que dans le sens de saint Paul, selon la chair s'oppose à selon la promesse, c-à-d la voie de la nature opposée à la voie surnaturelle.
Deuxièmement il faut faire voir l'importance de cette question à l'égard des Juifs, qui regardait Abraham comme leur père et la souche dont ils étaient les branches, tirant de lui tout ce qu'ils avaient. De sorte qu'il était extrêmement important de bien éclaircir ce qu'Abraham avait été, et de quelle manière il avait été justifié ; car de la dépendait la ruine de cette prétendue justification, que les Juifs voulaient établir par la voie de la loi, c'est-à-dire, par la voie des œuvres.
Passant après cela à la seconde partie, il est nécessaire de faire voir d'abord que cette solution de saint Paul est un raisonnement, et que cette particule que nous avons traduite, mais, peut être traduite par or, de cette sorte ; certes si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se vanter envers Dieu ; or il n'a pas de quoi se vanter envers Dieu. Ce qui fait voir qu'il y a une troisième proposition que l'apôtre a passé sous silence, mais qu'il faut nécessairement suppléer ; à savoir cette conséquence : donc Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Ainsi la solution de la question dépendant de cette proposition et de la preuve qu'il établit, il faut nécessairement traiter ces trois propositions et en faire de chacune, une partie. La première, que tout homme justifié par les œuvres a de quoi se vanter envers Dieu. La seconde, qu'Abraham quelques avantages qu'il ait eu d'ailleurs, n'a pas eu de quoi se vanter envers Dieu. Et la troisième qui est la conclusion supprimée, que donc Abraham n'a pas été justifié par ses œuvres.
Il y a des textes de raisonnement qui sont composés d'une objection et d'une réponse ; et de ceux-là, la division est claire, à savoir l'objection, et la solution de l'objection. C'est ainsi, par exemple, qu'il faut diviser ce texte du chapitre six de Romains : Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Ainsi n'advienne ! Car nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore pour lui ? Là il est clair qu'il y a deux parties : l'objection, et la solution de l'objection. Quant à l'objection elle est :
La solution de la question de même est proposée premièrement en des termes généraux, ainsi n'advienne. Deuxièmement en des termes particuliers, comment vivrons nous dans le péché ? Et troisièmement la raison en est ajoutée, à savoir, que nous sommes morts au péché.
Il y a des textes de raisonnements qui sont extrêmement difficiles à diviser, parce que leur réduction en plusieurs propositions ne se peut faire, sans que cela n'attire de la confusion, ou qu'ils ne sentent trop la manière de l'École, ou même qu'il n'y ait quelques défectuosités dans la division, c'est-à-dire, qu'elle ne soit insuffisante. En ce cas il faut que l'esprit et le bon sens agissent ; et il ne faut pas faire de difficulté de prendre quelque voie extraordinaire, laquelle si elle est heureuse, ne manquera jamais de produire un bon effet. Par exemple si on avait à traiter ce texte du quatrième chapitre de saint Jean : Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui en eusses demandé toi-même, et il t'eût donné de l'eau vive. Il me semble qu'on ne ferait pas mal de le diviser en deux parties ; dont la première serait les propositions générales, contenues dans ces paroles ; et la seconde, l'application particulière de ces propositions à la Samaritaine. Quant à la première, il faut remarquer ces propositions-ci :
Dans la seconde partie il faut examiner :
Il y a quelquefois des textes qui supposent plusieurs importantes vérités et sans les marquer expressément ; et cependant il est nécessaire de les représenter, et de les presser fortement, soit parce qu'elles sont importantes, ou parce qu'elles sont d'usage dans quelque particulière occasion ; alors on peut diviser le texte en deux parties, à savoir la partie supprimée, et la partie exprimée. J'avoue que cette division est hardie, et qu'il ne faut ni en abuser, ni en user trop souvent, mais il est certain qu'il y a des occasions où elle peut réussir heureusement. Un prédicateur dans un jour de jeûne, ayant pris pour sujet ses paroles d'Ésaïe : Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, le divisa en cette manière en deux parties, à savoir, la partie supprimée, et la partie exprimée. Dans la supprimée, il dit qu'il y avait trois importantes vérités qu'il était obligé de représenter. La première, que Dieu s'était éloigné de nous. La seconde, que nous nous étions éloignés de lui. Et la troisième, qu'il avait un temps auquel Dieu ne se trouvait point, encore qu'on le cherchât. Il traita ces trois vérités l'une après l'autre. Et dans la première, il fit l'énumération des afflictions de l'Église d'une manière fort touchante, faisant voir que toute cette triste image marquait l'éloignement de la grâce de Dieu. Dans la seconde il fit l'énumération des péchés de l'Église, et fit voir de quelle manière elle s'était éloignée de son Dieu. Dans la troisième il représenta ce funeste temps auquel la patience de Dieu se trouve poussée à bout, et fit voir qu'alors il déploie ses derniers jugements sans écouter plus la voix de la miséricorde. Ensuite venant à la partie exprimée, il expliqua ce que c'est que chercher l'Éternel, et par une pathétique exhortation porta ses auditeurs à cette recherche. Enfin il expliqua quel est ce temps auquel Dieu se trouve ; et là il renouvela ses exhortations à la repentance, en y mêlant l'espérance du pardon et de la bénédiction de Dieu. Son action fut trouvée belle, particulièrement à cause de l'ordre qu'il avait tenu.
Dans les textes d'Histoire, les divisions ne sont pas difficiles. Quelquefois il y a une action racontée dans toutes ses circonstances, et alors on peut considérer l'action en elle-même, et ensuite les circonstances de l'action. Quelquefois il est nécessaire de remarquer l'occasion sur laquelle l'action a été faite, et d'en faire une partie. Quelquefois il y a des actions, et des paroles, et alors il faut considérer les paroles, et les actions, séparément. Quelquefois il n'est pas nécessaire de faire de division, il faut suivre l'ordre de l'histoire. Enfin cela doit dépendre de l'état de chaque texte en particulier.
Pour rendre une division agréable et facile à l'auditeur, il faut tâcher de la réduire, autant qu'il se pourra, en termes simples. J'appelle le terme simple, un seul mot, au même sens que dans la logique, on appelle terminus simplex, pour l'opposer à terminus complexus. En effet ces divisions dont chaque partie est exprimée en plusieurs paroles qui font un discours, sont non seulement embarrassantes, mais aussi, inutile pour les auditeurs, parce qu'ils ne les sauraient retenir. Il faut donc les réduire autant qu'on peut à un seul terme.
Il faut autant qu'il se pourra faire en sorte, qu'il y ait du rapport entre les parties de la division, soit par voie d'opposition, soit par voie de cause et d'effet, ou d'action et de fin, ou d'action et de motif d'action, ou de quelque autre manière. Car de faire une division de plusieurs parties qui ne marquent avoir aucune liaison entre elles, c'est une chose qui choquerait extrêmement les auditeurs, et qui ferait juger que tout le discours qu'on bâtirait là-dessus ne serait qu'un galimatias. Outre que l'esprit humain aime naturellement l'ordre, on retient beaucoup plus facilement une division dont les parties se rapportent l'une à l'autre.
Quant aux subdivisions, il est toujours nécessaire d'en faire, car cela même aide à la composition, et répand beaucoup de clarté dans le discours ; mais il n'est pas toujours nécessaire de les dire ; au contraire, le plus souvent il faut les faut taire, parce que l'esprit de l'auditeur est accablé de cette multitude de membres. Néanmoins quand les subdivisions se peuvent faire avec grâce, soit à cause de l'excellence de la matière, et d'une grande espérance dont vous remplissez l'auditeur, soit à cause de la justesse des parties qui se répondent agréablement l'une à l'autre, on peut les marquer formellement, mais cela doit être rare. Et les auditeurs seraient bientôt ennuyés de cette méthode, car on se rassasie de tout.
Je viens maintenant à la tractation, sur laquelle d'abord je dirai quelque chose sur le choix des textes.
Il ne faut jamais prendre de texte qu'il n'y ait un sens complet. Car il n'appartient qu'à des impertinents et à des fous, d'aller prêcher sur un mot ou deux, qui ne signifient rien.
Il faut même non seulement prendre des paroles qui aient un sens complet en elles-mêmes, mais il faut aussi que ce soit le sens complet de l'auteur, duquel vous prenez les paroles. Car c'est son discours et sa pensée que vous expliquez. Par exemple, si quelqu'un prenait ses paroles de 2Corinthiens.1.3-4 : Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, et qu'il s'arrêtât là, il prendrait un sens complet, mais ce ne serait pas celui de l'apôtre. S'il allait plus avant et qu'il ajoutât : Qui nous console en toute notre affliction, ce ne serait pas encore le sens complet de saint Paul. Il faut donc aller jusqu'à la fin du verset quatre car alors on aura tout ce que saint Paul veut dire. Pourvu qu'on prenne le sens complet de l'auteur sacré, on peut s'arrêter là. Car il y a peu de textes dans l'Écriture de cette nature, qui ne fournissent assez de matière pour faire une juste action, et il est également incommode de prendre trop de matière, et de n'en prendre pas assez. Il faut éviter l'une et l'autre de ces deux extrémités.
Quand on prend un texte où il y a peu de matière, on est obligé de s'écarter assez loin de son sujet, pour aller chercher de quoi parler. On se jette dans des jeux d'esprit, et d'imagination qui ne sont pas trop du génie de la chaire. Et en un mot on fait naître dans l'esprit des auditeurs cette pensée que l'on se veut prêcher soi-même plutôt que Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'on veut paraître bel esprit, au lieu de se proposer l'instruction et l'édification du peuple. Quand aussi on prend trop de texte, et un sujet où il y a trop de matière à expliquer, on ne saurait qu'on ne laisse perdre beaucoup de considérations belles et importantes qu'on pourrait faire, ou qu'on ne se jette dans une longueur ennuyeuse. Il faut donc garder mesure dans le choix des textes, et tâcher de ne prendre, ni trop ni trop peu de matière. Il y en a qui disent que la prédication n'est destinée que pour donner l'intelligence de l'Écriture, et qu'ainsi il faut prendre beaucoup de texte, et se contenter d'en donner le sens et d'y faire les principales réflexions. Mais le principe de ces gens-là est faux ; car la prédication est destinée non seulement pour donner l'intelligence de l'Écriture, mais aussi pour donner l'intelligence de la théologie, et pour expliquer la religion ; ce qui ne se peut faire si l'on prend trop de matière. Ainsi je crois que la manière dont on en use communément dans nos églises, est la plus raisonnable et la plus conforme à la fin de la prédication. Chaque particulier peut lire chez soi d'Écriture avec des notes ou des commentaires, pour en avoir simplement le sens ; mais on ne saurait instruire, dénouer les difficultés, éclaircir les mystères, pénétrer bien avant dans les voies de la sagesse de Dieu, établir fortement les vérités évangéliques, réfuter les erreurs, consoler, corriger, censurer les vices, remplir l'esprit des auditeurs de l'admiration des merveilles de Dieu, enflammer leurs âmes de zèle, les porter efficacement à la piété, et à la sainteté qui sont les fins de la prédication, si l'on ne va pas plus avant que de donner la simple intelligence de l'Écriture.
Voilà en général ce qu'on peut dire touchant le choix des textes. Mais en particulier il faut aussi avoir égard aux circonstances des temps, des lieux, et des personnes, et choisir des textes qui aient du rapport.
A l'égard des temps, je n'approuve, ni ne désapprouve la coutume de feu Monsieur D… qui ayant à prêcher, les jours des fêtes de ceux de l'Église romaine, avait accoutumé de choisir des textes, sur le sujet de ces fêtes, et souvent il les tournait à la censure de la superstition. Je ne blâme point cela, mais je ne voudrais point en faire métier ; car les fêtes de ceux de l'Église romaine sont un temps pour eux, et non pour nous, et il est certain que l'esprit de nos auditeurs ne cherche guère, ni à être éclairci, ni à être édifié sur ces sortes de sujets. Il faut donc ce me semble user sobrement de cette manière d'agir. Il n'en est pas de même des temps particuliers qui nous appartiennent, qui sont de deux sortes. Ou des temps particuliers réglés, qu'on appelle Stata tempora, qui reviennent tous les ans dans les mêmes saisons ; ou des temps extraordinaires et non réglés qui n'arrivent que par accident ou pour mieux dire, lorsqu'il plaît à Dieu.
Cette première sorte de temps est, ou les jours de Cène, ou les jours qui sont solennels parmi nous, comme le jour de Noël, celui de Pâques, celui de la Pentecôte, celui de l'Ascension, le premier jour de l'an, le vendredi saint, comme on parle. Dans ces jours on doit choisir des textes particuliers qui regarde le sujet du jour ; car ce serait une trop grande négligence, de prendre en ce jour-là des textes qui ne s'y rapportent point. Il ne faut pas douter qu'on ne doive faire en ce jour-là de particuliers efforts, parce que ce sont des jours où l'auditeur est dans une grande attente, laquelle, si vous ne la remplissez pas, se tourne en mépris et en quelque espèce d'indignation contre le prédicateur.
Les occasions particulières non réglées, mais qui arrivent par accident, sont ou les jours de jeûne, ou les jours de l'imposition des mains du pasteur, ou des jours auxquels il faut extraordinairement consoler son troupeau, soit à cause de quelque grand scandale qui est arrivé, soit à cause de quelque grande affliction, ou enfin des jours auxquels il faut extraordinairement censurer. Pour les jours de jeûne, il est certain qu'il faut prendre des textes particuliers, choisis expressément pour cela, mais dans les autres occasions, cela doit dépendre du jugement du prédicateur. Car il y a peu de textes, sur lesquels il ne puisse prendre occasion de consoler, d'exhorter, et de censurer d'une manière extraordinaire. Et à moins que le sujet dont il s'agit soit extrêmement grand, le plus sûr est de ne changer point son texte accoutumé. Pour les jours où l'on impose les mains, il faut prendre des textes extraordinaires et convenables à l'action dont il s'agit, soit que l'on regarde la personne qui impose les mains, soit que l'on considère celui à qui l'imposition des mains a été donnée. Car le plus souvent celui qui a reçu la position des mains le matin, fait l'action l'après-dîner.
Je dirai un mot touchant les actions que l'on fait dans les églises étrangères :