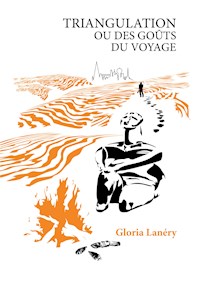
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Suivez Gloria Lanéry sur ses routes lointaines — en Chine, en Inde, en Sibérie, en Afrique —, où les rencontres et les événements forment un tableau saisissant de notre monde.
…Dans la quête géographique du point d’équilibre nécessaire à la marche entre le merveilleux et l’odieux, le monde, pas plus qu’il n’est plat sous nos semelles, n’est un objet étale de contemplation. Il est trop divers, trop complexe, trop brutal à l’autre bout d’un sourire accueillant pour ne lui accorder, en retour, qu’un fade enchantement.
Au fil de sept histoires fortes qui nous entraînent de la Sibérie aux déserts d’Afrique et jusqu’en Antarctique, Gloria Lanéry, une voix féminine assez rare dans le récit de voyage et de l’exploration, nous propose une réflexion audacieuse sur notre planète et sur celles et ceux qui l’habitent, quand on y regarde de plus près, en voyageuse plutôt qu’en touriste.
EXTRAIT
En quarante ans, l’avion a mis l’ailleurs à notre porte. Les distances se sont ratatinées. Le bout du monde est un saut de puce, l’aventure est une question de moyens et l’inconnu se mesure au bagage d’anglais dont on dispose pour retrouver le chemin de son hôtel. Si le mot « planète » évoque encore quelque espace, les routes aériennes qui la sillonnent se parcourent en termes d’heures. Le globe s’est rétréci à vous étriquer le rêve, et le mystère de ses enclaves inaccessibles est offert à l’oisiveté de chacun sur les écrans de télévision et l’internet.
Entre les aventuriers « inventeurs d’Amériques2 » et ceux d’aujourd’hui, il y a des sponsors qui vous financent, des hélicoptères qui vous transportent, l’électronique qui vous seconde. Les médias vous suivent, commentant vos « épreuves » à coup d’hyperboles, les liaisons satellitaires abolissent votre isolement, l’aléa tient lieu de risque et la nature régurgitée par l’image sert d’arrière-fond à l’image personnelle.
La dernière grande odyssée fut celle de la Lune, la prochaine sera peut-être celle des étoiles. Mais il n’y a pas de véritable danger là où il n’y a pas de rencontres, et ce qu’appréhendaient les grands marins ce n’était pas la haute mer, mais le rivage.
Nous sommes partout. Au lieu de « sauvages » tapis dans le sous-bois le long de grèves inabordées, la civilisation cache sous ses nippes contemporaines son ingrate nudité, et les côtes vierges des cartes anciennes sont colonisées, domestiquées, piscinisées par les hordes sans grâce des touristes.
Ce n’est donc pas un guide ni un récit flamboyant qu’on trouvera ici. Non que je boude une belle description qui propulsera le lecteur chez le voyagiste du coin et n’aie ma part de petites anecdotes, mais le paysage et la couleur locale sont, dans ces pages, les diversions à un voyage plus viscéral.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TRIANGULATIONouDes goûts du voyage
Pour la présente édition numérique :
© Publishroom Factory, 2020.
© Gloria Lanéry, 2019.
Illustration de couverture :
© camillegentil.com
ISBN de l’édition numérique :
9791023612318
Cet ouvrage a été numérisé
en 2020 par Publishroom Factory
La copie de ce fichier est autorisée pour un usage personnel et privé. Toute autre représentation ou reproduction intégrale ou partielle, sur quelque support que ce soit, de cet ouvrage sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est interdite (Art. L122-4 et L122-5 du Code de la Propriété intellectuelle).
Selon la politique du revendeur, la version numérique de cet ouvrage peut contenir des DRM (Digital Rights Management) qui en limitent l’usage et le nombre de copies ou bien un tatouage numérique unique permettant d’identifier le propriétaire du fichier. Toute diffusion illégale de ce fichier peut donner lieu à des poursuites.
Gloria Lanéry
TRIANGULATIONouDes goûts du voyage
À ma mère et à Nour
Table des matières
1. Avant-propos
2. Libye
3. Sibérie
4. Chine
5. Sinaï I
6. Inde
7. Sinaï II
8. Antarctique
9. Conclusion
Avant-propos
étonnants voyageurs ! Quelles nobles histoiresNous lisons dans vos yeux profonds comme les mers !Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires,Ces bijoux merveilleux, faits d’astres et d’éthers.
–Baudelaire, « Le Voyage », Les Fleurs du mal.
Un des grands malheurs de la vie moderne, c’est le manque d’imprévu, l’absence d’aventures. Tout est si bien réglé, si bien engrené, si bien étiqueté, que le hasard n’est plus possible.
– Théophile Gautier, Voyage en Espagne, 1843
Le voyage. L’aventure. Deux mots qui portent encore l’écho des grandes explorations, d’un inconnu redoutable qu’on croyait illimité.
Il ne s’agit pas ici de ceux qui ont avancé avec prudence − ils sont légion depuis la nuit des temps, testant à chaque pas la tiédeur de l’eau, l’hospitalité du nouveau territoire, l’éloignement du prochain horizon. Il s’agit de ceux partis recueillir les pépites d’un soleil plus éclatant dans ses lointains berceaux, qui se sont lancés tête baissée, cette courte poignée poussée par une curiosité sans bornes qui peu à peu nous a apprivoisé la terre.
Peu importe qu’ils aient connu des fins tragiques ou qu’ils soient morts au chaud dans leur lit. À peine avaient-ils quitté les eaux reconnues avant eux, qu’à leur tour ils abandonnaient leur destin à la bienveillance des vents et de peuples étranges. Puis certains revenaient, témoignant de nouvelles terres, laissant à chaque fois un peu moins de nouveau à leurs successeurs.
Leurs voyages et leurs aventures nous ont coûté les nôtres, et ces deux mots vivent aujourd’hui d’une gloire usurpée.
En quarante ans, l’avion a mis l’ailleurs à notre porte. Les distances se sont ratatinées. Le bout du monde est un saut de puce, l’aventure est une question de moyens et l’inconnu se mesure au bagage d’anglais dont on dispose pour retrouver le chemin de son hôtel. Si le mot « planète » évoque encore quelque espace, les routes aériennes qui la sillonnent se parcourent en termes d’heures. Le globe s’est rétréci à vous étriquer le rêve, et le mystère de ses enclaves inaccessibles est offert à l’oisiveté de chacun sur les écrans de télévision et l’internet.
Entre les aventuriers « inventeurs d’Amériques1 » et ceux d’aujourd’hui, il y a des sponsors qui vous financent, des hélicoptères qui vous transportent, l’électronique qui vous seconde. Les médias vous suivent, commentant vos « épreuves » à coup d’hyperboles, les liaisons satellitaires abolissent votre isolement, l’aléa tient lieu de risque et la nature régurgitée par l’image sert d’arrière-fond à l’image personnelle.
La dernière grande odyssée fut celle de la lune, la prochaine sera peut-être celle des étoiles. Mais il n’y a pas de véritable danger là où il n’y a pas de rencontre, et ce qu’appréhendaient les grands marins ce n’était pas la haute mer, mais le rivage.
Nous sommes partout. Au lieu de « sauvages » tapis dans le sous-bois le long de grèves inabordées, la civilisation cache sous sa livrée contemporaine son inconvenante nudité, et les côtes vierges des planisphères anciens sont colonisées, domestiquées, piscinisées par les hordes sans grâce des touristes.
Ce n’est donc pas un guide ni un récit flamboyant qu’on trouvera ici. Non que je boude une belle description qui propulsera le lecteur chez le voyagiste du coin et n’aie ma part de petites anecdotes, mais le paysage et la couleur locale sont, dans ces pages, les diversions à un voyage plus brut, une triangulation de mes cartes plus viscérale.
Ayant fait le tour du monde d’un pôle à l’autre, je m’aperçus que mes pérégrinations se cristallisaient autour d’un arrêt sur image, un instantané d’une chose vue ou vécue qui avait provoqué chez moi une méditation sauvage au rythme de mes pas. J’en livre ici quelques-unes des plus marquantes qui pourraient interpeller le voyageur insatiable. Ce qui me lie à mes voyages, ce sont des visages, des attitudes, un moment ; des gens à qui parfois je n’ai même pas parlé, qui par leur présence, dans leur silence, m’ont raconté une histoire, que j’ai tenté de traduire, sur l’infinie noblesse d’être et la tristesse parfois infinie d’être humain.
L’idée de ce livre est née justement lors d’un dîner chez de vieilles connaissances à leur retour d’Inde. Sur une photo qu’ils me montraient, deux gamins baignés de soleil occupaient le premier plan à s’envoyer en riant une boîte de conserve du bout de leurs bâtons. Une vache décharnée, rongée de furoncles, fouillait les immondices sur le tiers gauche. Derrière, contre un mur éclaboussé d’urines et couvert de placards en lambeaux, se tenait une jeune fille un peu floutée, les pieds nus dans une rigole de pisse. Elle regardait l’objectif avec des yeux énormes, les yeux sans fond et vides des effacés. Je n’ai pas supporté son regard ni qu’on l’escamote par un jeu d’enfants.
Dans une formule paraphrasée à l’envi par les aventuriers actuels, Montesquieu dit : « Les voyages donnent une très grande étendue à l’esprit : on sort du cercle des préjugés de son pays, et l’on n’est guère propre à se charger de ceux des étrangers2. »
Avec mon respect intégral pour eux tous et Montesquieu, s’ils y parviennent vraiment, sous une belle tournure c’est une autre définition de l’indifférence.
Pour apprécier sans entrave la beauté du monde et de ceux qui l’habitent, il faut accepter d’en ignorer les victimes ou se voir accusé de préjuger. Car jamais autant qu’en voyage on ne ressent combien les sociétés traînent loin, tels des boulets, derrière les techniques qui les ont tirées, contraintes et forcées, dans le xxie siècle. L’individu est semblable à ces vaisseaux d’hier et d’aujourd’hui, si vite, si loin qu’il aille, ce ne sont pas les idées qu’il fait avancer.
Un autre aspect, celui d’être une femme, m’empêche aussi d’avoir ce souverain recul. L’homme qui voyage seul n’a pas à essuyer l’agression constante du regard masculin, où même le dernier des rustres s’arroge le droit d’évaluer le coefficient sexuel d’une femme qui passe et conteste sa liberté d’être là. Comme chez nous, dans de nombreux pays on se sent profanée, très sale, à la fin du jour. Cette autorité atavique qu’ils se pensent sur nous, et que nous-mêmes avons laissé s’enkyster au plus profond de nos cultures3, est en soi révoltante et provoque son lot de ruminations.
L’homme en voyage voit l’élan irrésistible d’autres hommes qui s’activent et tentent de vivre. La femme en voyage s’afflige de celles invisibles, voilées, violées de mille façons. Le labeur des premiers est le gage de leur liberté, celui des secondes, le sceau de leur servitude. Une Occidentale qui ne voyage pas pour bronzer ne peut en aucun cas diluer dans le pittoresque, et travestir sous la correction politique qui aujourd’hui nous muselle mieux qu’aucune censure, l’affligeante condition de la femme dans la majeure partie du monde. Et tous les « Droits de l’homme » n’y font rien. Cette formule générique ne sert qu’à occulter encore mieux ses droits humains derrière ceux des hommes et de lents progrès qui souvent ne profitent qu’à eux. Jusque dans nos pays, elle se fraie encore entre les balles une voie vers la reconnaissance et le respect.
Alors, un livre sur le voyage ? Oui, mais une approche dépouillée de la sensiblerie bien-pensante qui masque la réalité parfois sinistre des horizons que l’on admire et, envers ceux qui la souffrent, trahit de notre part une empathie factice, voire une franche hypocrisie.
Dans la quête géographique du point d’équilibre nécessaire à la marche entre le merveilleux et l’odieux, le monde, pas plus qu’il n’est plat sous nos semelles, n’est un objet étale de contemplation. Il est trop divers, trop complexe, trop brutal à l’autre bout d’un sourire accueillant pour ne lui accorder, en retour, qu’un fade enchantement.
1 Charles Baudelaire, « Le Voyage », Les Fleurs du mal, 1857.
2Mélanges inédits, 1892.
3 Voir Sinaï ii.
Libye
Celui qui ne voyage pas ne connaît pas la valeur des hommes.
–Sagesse saharienne
Une brume jaunâtre d’harmattan dissolvait le ruban d’asphalte gris qui filait plein sud. Dans l’espace obstrué, notre seul repère, depuis cinq cents kilomètres, était le court segment de route devant nous à travers le tunnel de poussière. Animées par le vent, des flammèches de sable se tordaient sous nos roues. Depuis notre départ de Tripoli, à l’aube, après des heures de musique arabe sur la radio éraillée, nous nous repassions pour la troisième fois une cassette entière de chants corses que j’avais eu la malencontreuse idée de faire connaître à mon chauffeur Targui libyen, littéralement marabouté par leurs polyphonies. Rien d’autre à l’heure où nous roulions ne pouvait tenir Ramdan éveillé ni apaiser sa soif et sa faim que le jeûne lui imposait.
Considérant les mille kilomètres à parcourir et la semaine de négociations incertaines et pénibles qui s’annonçait, j’avais bien tenté, la veille, d’invoquer le verset du Coran qui le dispensait du jeûne en voyage4, mais Ramdan m’avait assuré qu’il n’était pas affaibli et que, portant le nom du mois saint, il aurait l’air de quoi s’il se défilait, mais que je devais manger si j’avais faim. Rien ne me l’interdisait, en effet, mais je n’allais pas me nourrir devant lui alors qu’il mâchait sa langue.
Depuis que je bourlinguais dans les déserts d’Afrique saharienne, j’avais suivi plus d’un ramadan avec mes équipes musulmanes. La seule entorse à cette ascèse est que je ne savais pas résister à la soif – un comble pour une amoureuse des déserts. J’usais donc de subterfuges, demandais un arrêt technique pour boire en douce. Je dois dire, pourtant, que cette solidarité que je tenais à leur témoigner quand je le pouvais m’a valu, en échange, de précieux égards de la part des hommes de ces régions.
Bref, me voici dans mon élément, l’habitacle d’un 4x4 caduc tenu par des années de rafistolages, qui vibre à vous déboîter le squelette, aux portières duquel manquent les poignées, aux vitres rongées par la silice, fermées contre le vent, sans autre résultat que d’y suffoquer un peu plus. Une farine pâle s’infiltre par le moindre interstice et vous cimente les bronches. J’ai la tête enveloppée d’un long chèche et des lunettes de glacier sur le nez. Malgré novembre, il fait une chaleur à lyophiliser un chameau. J’ai soif et suce un petit galet de rivière pour me faire saliver. Rien de bien saillant ne vient marquer cette fin de l’an 2000. À notre insu, l’avenir est fécond d’un proche désastre.
Ramdan, arc-bouté sur son volant, comme à son usage roule à vive allure, guettant, les yeux plissés, l’éventuel écueil sur la route, la barkhane5 déguisée en fumée de sable sur le sol, qui pourrait nous catapulter dans le décor. Pas un véhicule ne nous a croisés ni doublés depuis deux heures. À cet endroit, le désert, infiniment plat, s’étend mille cent kilomètres à gauche jusqu’à l’Égypte, sept cents à l’ouest vers l’Algérie, et l’on n’y voit goutte à cent mètres. Le rivage des Syrtes, le bleu mouvant des flots et les cités romaines que le soleil habille sont loin, là-haut, au nord, un souvenir marginal.
Au sud, un passé bien plus reculé repose entre les mers de sable d’Oubari et du Mourzouk, sur les grès patinés du Messak Settafet, quand le Sahara préhistorique était encore une belle prairie en eau que parcouraient la grande faune africaine et les premiers pasteurs-cueilleurs. Par centaines, éléphants ciselés et lions en poursuite, crocodiles et hippopotames y témoignent, là où rien ne pousse plus, d’un âge ancien verdoyant, propice à la vie et à l’émergence des mythes. Des scènes d’une stupéfiante beauté s’y déploient, incisées au silex, où des chasseurs couronnés de têtes de lycaons et de girafes, d’antilopes et de rhinocéros, créatures dansantes mi-hommes, mi-monstres préfigurent les dieux. Au fil de mes passages, j’ai noué un lien particulier avec la mémoire gravée des ancêtres du Messak sur les parois ferriques et rouges des oueds encaissés. L’on peine à s’expliquer qu’une conscience tout juste naissante, dont l’entité humaine est encore obscure, ait su ruser avec la lumière et les tourments de la roche en une poésie des formes, un rendu du mouvement aussi éblouissants et aboutis. Ce musée de l’âge de pierre est l’exubérante déclaration de ces hominidés à la nature de leur volonté d’être plus que ce qu’elle avait prévu pour eux, plus que des bestioles près de leurs bestiolières. Devant leurs œuvres, ou en ramassant un de leurs burins ou grattoirs qui affleurent sur les planchers dunaires, on a la conscience aigüe de notre filiation ininterrompue. Ce n’est pas une abstraction scientifique pour les férus du passé de la terre, mais une apothéose incarnée aujourd’hui dans les foules modernes. Or, au regard de leur nombre et de leurs moyens insignifiants, de leur savoir inexistant, sapiens balbutiants qu’ils étaient, on a le sentiment que leurs prémices dans ces gravures magistrales s’annonçaient plus prometteuses que notre apparent avancement douze mille ans plus tard.
I Muvrini entonnent A voce Rivolta pour la énième fois et je sature à présent.
Il est là, le désert, fait de pierre et de sable si dépouillés qu’il semble montrer l’armature du monde. Ce soir, je me loverai dans cette matrice aréneuse, ce soir je boirai à son silence, mon corps à même la dune, la tête dans les étoiles, à flotter dans son vide où je suis seule à régner, animé par mes délires tissus d’enchantements et de peurs.
Mais revenons à notre ferraille.
Bien que fréquentant la Libye régulièrement, je me lançais cette fois-ci dans une entreprise risquée, attendu les relations antagoniques entre Kadhafi et le reste du monde, les méthodes policières odieuses du bonhomme et l’embargo international qui pesait sur le pays. Quand j’avais soumis mes sujets à la chaîne française, le directeur des programmes s’était montré très sceptique, au point de me demander si j’avais des accointances avec le régime, comprenez un galant dans les hautes sphères. Non, j’avais seulement beaucoup d’amis touareg dans le sud, quelques Libyens de confiance au nord, et une bonne dose de démerde. Aussi étais-je parvenue à convaincre la chaîne de me laisser tourner mes sujets sans autorisations, clandestinement ; d’infiltrer le matériel par la Tunisie, à condition de trouver un caméraman assez fondu pour se jeter avec moi dans l’aventure. Je ne leur avais rien caché des risques très réels auxquels nous nous exposions, le moindre étant de finir dans un bac de chaux vive. Le pire… je n’osais y penser.
Ce qu’en revanche j’avais tu, est que le Sud libyen observait la ségrégation sexuelle absolue, à savoir que les femmes étaient voilées, recluses et rigoureusement séparées des hommes hors la famille directe, conformément aux prescriptions du Coran6. Ainsi, rien n’était moins sûr que de pouvoir persuader le chef et les hommes de la tribu des Dawadas7 de laisser filmer leurs épouses à visage découvert, par un opérateur mâle, pour être ensuite offertes en pâture aux téléspectateurs occidentaux. C’est donc pourquoi je roulais vers Oubari, anticipant la bataille, affûtant mes arguments et redoutant la défaite.
Ce faisant, je ne quittais pas Ramdan des yeux, surveillant ses paupières, l’invitant à me raconter, dès qu’elles devenaient un peu lourdes, les dernières facéties de ses gamins, ou en haussant le son sur le lecteur de cassettes crachoteux. Ramdan et moi nous connaissions depuis quelques années déjà. J’avais rencontré sa femme, ses deux enfants et son vieux père, un homme charmant avec qui j’aimais boire le thé en l’écoutant me narrer la Libye au temps honni des Italiens. Mon compagnon, garçon peu instruit, mais sensible et intelligent, était un fier Targui, un Imochar ainsi qu’ils s’appellent entre eux, qui comme tel nourrissait un souverain mépris pour les Libyens du nord, leur régime politique et leur Guide à lunettes. Je lui servais d’exutoire et le laissais épancher ses ressentiments touchant surtout aux revenus du pétrole dont les Touareg voyaient peu la couleur.
C’est ainsi que passant Sebha, seule ville du grand sud, nous fusions cap à l’ouest vers Qasr Khulayf. L’air s’éclaircissait, le vent semblait tomber, une accalmie de fin d’après-midi dégageait légèrement la perspective proche, permettant de distinguer les pauvres habitations en parpaing cru, pas même des hameaux, qui de loin en loin piquetaient la route, adossées au désert immense. Ramdan leva un peu le pied.
… Le gosse surgit de nulle part poussant son cerceau.
Un effroyable hurlement de freins, un cri d’enfant, un choc à l’avant, le sentiment que mon sang se vidait, la voiture – ou était-ce mon cœur – qui s’arrêtait. Je tirai, fébrile et sans force, sur le fil de métal qui me servait de poignée et me jetai dehors. Encore aujourd’hui, le moment de l’impact me fait l’effet d’un coup de poing au visage.
Je ne comprenais pas ce que je voyais. Le garçon était couché deux mètres à gauche de la voiture, alors que l’avant du 4x4 braquait à droite contre un tas de parpaings sur le bas-côté. Je courus à l’enfant. Une tache de sang s’étendait à son genou, tournait rouille au contact du sable et me paraissait une mare. Ramdan, déjà auprès de lui, s’apprêtait à le bouger. Je l’arrêtai d’un geste urgent et lui demandai de surveiller l’arrivée d’éventuels véhicules tandis que j’examinais le petit. Dans un état second nauséeux, mes mains agitées de trépidations incoercibles, j’appliquai sur son corps mes notions de secourisme. Le pouls, la carotide, les yeux, le crâne, le cœur, les membres… tout – j’en étais étourdie de soulagement – tout semblait normal, hors sa blessure au genou et une au coude. Je remarquai enfin qu’il geignait. Il avait les yeux ouverts sur moi et pleurait doucement. Seulement alors je compris qu’il nous avait miraculeusement évités par la gauche tandis que Ramdan avait foncé à droite et emplâtré les briques. Réalisant aussi que le garçon ne pouvait me voir sous mon chèche et mes lunettes, je les retirai.
En arabe, je lui demandai son nom et son âge et lui dis de ne pas bouger. Encore chancelante, je courus chercher ma sacoche à pharmacie pour nettoyer ses plaies et annonçai à Ramdan que nous allions le conduire à l’hôpital de Sebha dès que j’aurais trouvé ses parents. Je reprenais mes esprits et mon calme, sans pouvoir gommer pour autant le moment hideux de la collision où j’ai cru qu’on venait d’écraser un enfant. Il était là, bien vivant devant moi, mais je restais enrayée à le voir sous nos roues.
Quelque chose frémit à gauche de mon champ de vision. Je levai la tête, vis une silhouette furtive s’effacer derrière une toile sombre dans le logis en bord de route.
J’eus un détestable pressentiment.
Tout en désinfectant les blessures de Fahim, je lui demandai :
« Al mar’a wara l’birdaya, oummak ? (La femme, derrière le rideau, est ta mère ?)
— Aywa (oui) », me répondit-il avec un coup d’œil, le temps d’une seconde, farouche, dans sa direction.
Je finis de le panser, le soulevai dans mes bras et le portai vers la maison. Ramdan, c’était clair à présent, resterait dehors. Je frappai à la porte qui s’ouvrit doucement après que Fahim eut rassuré sa mère, à l’intérieur, que j’étais une femme – car je portais un pantalon et les cheveux attachés.
Je passais à peine le seuil en terre battue envahi de sable, qu’elle se jeta sur son enfant, m’obligeant à le protéger de l’assaut maternel tant qu’il n’était pas examiné par un médecin. C’est ce que j’expliquai à la femme qui, tout en se couvrant partiellement le visage de son foulard, même devant moi, se mit à parler fiévreusement à son fils, lui posant plus de questions qu’il n’y pouvait répondre. Elle finit par me dire que son mari étant absent jusqu’au soir, elle ne pouvait m’accompagner à Sebha ni, par conséquent, confier son fils à une étrangère.
L’étrangère, en l’occurrence, s’occupait de son gosse tandis qu’elle était restée planquée derrière son rideau, pensai-je, le cœur mauvais, tout en souriant à la petite fille hirsute et à l’œil tout rond, accrochée aux jupes noires élimées de sa maman.
Je remarquai l’outre d’eau en peau de chèvre, l’abayour suspendue au pauvre mur non enduit, et la fraîcheur qu’elle évoquait me pacifia un peu.
Dans une tentative futile de comprendre la jeune mère, je lui demandai comment elle pouvait rester claquemurée dans la pénombre alors que son fils gisait sur la route, à dix pas d’elle.
« Haram », dit-elle. Un mot simple, deux syllabes qui expriment la condition misérable de la femme dans le monde arabe. Haram, l’interdit, la honte. Le nom, également, du voile qui la dissimule pour « mettre un frein aux propos des hommes8 », ou sinon endurer leurs pulsions légitimes.
Quel haram pouvait donc tenir, lui demandai-je, intérieurement révoltée par tant de soumission criminelle, quand aussi bien son enfant était en train de mourir dehors ou était déjà mort ?
Elle me regarda silencieusement.
« Hâzihi takâlîdina (ce sont nos traditions) », prononça du creux de mes bras la voix grêle de Fahim avec une tranquille évidence.
Si le petit avait été tué, elle n’aurait pas même eu le droit de suivre son linceul.
La tradition. Synonyme commode d’archaïsmes sordides. Sur les routes du monde, les traditions ne sont souvent qu’une barbarie bigarrée dans l’objectif amblyope du voyageur béat.
Je les dévisageais tous les deux, lui, ce petit d’homme déjà moulé en homme d’ici qui, à huit ans à peine, se posait en gardien de mœurs contre nature et en tuteur de sa mère.
Et elle. Qu’était-elle au fond sur l’échelle du vivant ? Oblitérée sous son voile, elle venait de faillir à sa fonction biologique et sociale de mère, abdiquait ses droits humains, offusquait le cerveau dont la nature l’avait dotée, pour se résumer à une bête domestique qu’on enferme, à un fourreau de copulation, ravilie, quoique nécessaire.
Voyant la futilité de mon indignation, j’enjoignis à… ce non-être consentant… de garder à tout prix Fahim éveillé durant les quatre heures à suivre pour parer un éventuel coma. Je lui donnai de l’argent à remettre à son mari, ainsi qu’un mot écrit en arabe à l’intention de ce dernier, afin qu’il conduisît son fils à l’hôpital de Sebha à la moindre alerte. J’avais au moins l’assurance qu’il le ferait, s’agissant d’un garçon. On sauve aussi les filles, notez bien, mais – j’eus l’occasion de l’observer – avec moins d’urgence ou d’empressement.
Ayant promis à Fahim de passer le voir à mon retour dans une semaine, je sortis de là démoralisée et, pour tout dire, aussi horrifiée par la passivité de la mère que par le souvenir du petit corps immobile sur le bitume.
Ramdan m’attendait à la voiture sans avoir jamais approché la maison où se trouvait une femme seule ni rien tenté pour la persuader de nous laisser emmener son fils à la ville. Haram.
Je commençai par lui annoncer que dès cette minute il ne jeûnerait plus. S’il refusait, malgré notre longue collaboration, j’étais prête à me rendre à l’oasis de Ghat lui chercher un remplaçant moins dévotieux. Secoué par l’incident, il se rangea sans discuter à ma décision, mangea le pain et le halva que je lui offris et s’engagea à ne pas dépasser les cinquante à l’heure tant que l’air ne se serait pas éclairci.
Nous reprîmes la route dans le silence. À cette vitesse, je pouvais voir, en bordure, les touffes de graminées, où s’agrégeaient de petits monticules de sable, dessiner des cercles fous de leurs tiges recourbées aussitôt effacés par le vent tournant. Je me raccrochai à leur mouvement pour retrouver un sens au mien.
J’étais prise d’un de ces vertiges qui me visitent parfois quand les événements me forcent à contempler le gouffre humain qu’est notre absurde petite planète.
« Quand on ne voyage qu’en passant, on prend les abus pour les lois du pays », écrit Voltaire9… Et quand on s’attarde, on s’en forge souvent la conviction.
Quelle tradition digne de respect interdit à une mère d’aller au secours de son enfant ? Quelle mère digne du rôle accepte pareil dictat ? Et que dire des pères qui dépouillent leurs femmes de ce qu’eux-mêmes considèrent leur essence et seul objet ?
La négation de soi ne peut être plus complète.
Et tandis que Fahim accèdera à la supériorité coranique accordée à son sexe, sa petite sœur rejoindra le térébrant purgatoire où expier à vie sa faute génésique d’être femme.
Regardant défiler le paysage, je me surpris à penser à la parabole de la femme adultère :
« Les scribes et les pharisiens amenèrent à Jésus une femme prise en délit d’adultère, et lui demandèrent, pour l’éprouver, s’ils devaient la lapider comme l’ordonnait la loi de Moïse. Jésus répondit simplement que celui d’entre eux qui était sans péché lui jetât la première pierre10. »
Il y a deux mille ans, un de ces philosophes errants de l’Antiquité – comme je me l’expliquais, ne pouvant croire à la version convenue – allait par une pensée révolutionnaire donner naissance à un courant qui se promettait lumineux.
Révolutionnaire, dans cette parabole, est qu’à l’époque où une sentence de mort était la réponse à la moindre peccadille et la femme à peine plus qu’un calamiteux cheptel, un homme, par ce seul défi, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre », vingt siècles trop tôt, l’élevait au rang d’individu, la posait à l’égal des hommes de son temps et prononçait son adultère implicitement de même nature qu’une transgression masculine, bravant d’un coup les préjugés culturels et religieux immémoriaux. Jamais on n’avait rien entendu de semblable ni montré une telle hauteur de vues. On peine encore à s’y hisser. Jamais on n’a autant régressé après lui.
Pour renchérir sur une chrétienté qui n’aura de cesse de défigurer cet enseignement, six siècles plus tard, un nouveau prophète faisait faire à sa postérité un bond arrière dans les âges fossiles.
Sous le ciel vert d’ici, d’ailleurs et de Barbès, les femmes en sont toujours là, et le tressaillement infirme d’un rideau au bord d’une route reste empreint dans ma rétine.
Un jour, certainement, verra la décomposition de ces survivances, inéluctable, non sans quelques funestes regains, mais il poindra. Quand l’écart deviendra infranchissable entre ces valeurs sans noblesse et le progrès dont ces cultures convoitent les accessoires, il leur faudra bien franchir le pas. Par ici, ce sera aux femmes de forcer le blocus prophétique. Leurs hommes ont trop à y perdre.
Alors que la nuit tombait sur les grandes dunes accotées au firmament et que nous approchions de Jermah, je sentis une lueur intrépide dans le lointain. J’eus la certitude qu’une arrière-descendante de Fahim jetterait un beau matin son haram au vent en dansant sous le ciel bleu.
*
Après quatre jours entiers et quatre soirées passés avec le chef des Dawadas et les hommes les plus influents de la tribu – accompagnée de Ramdan qui me fut d’une aide inappréciable ; après avoir beaucoup mangé et bu beaucoup de thé… et d’alcool de palme, je parvins à m’assurer leur protection et à les convaincre qu’il était vital pour eux et notre patrimoine commun de conserver la trace de certaines traditions vouées à disparaître avec la sortie des dunes. Ainsi, la pêche aux vers, pratiquée par les seules femmes, était, leur dis-je, une des plus insolites et remarquables. Je désespérai de leur arracher jamais un accord quand ils comprirent, comble des tabous, que chacun verrait la femme de l’autre ; puis je dus encore les persuader que l’opérateur était « tout juste un prolongement de la caméra » et qu’il ne s’adresserait jamais directement à elles. Moyennant quoi ils devaient jurer sur l’honneur que leurs épouses seraient filmées sans leurs voiles et − c’était capital – qu’ils se chargeraient des repas ! Il n’était pas question, en effet, que les femmes s’éclipsassent aux meilleures lumières du matin et du soir pour préparer la chorba. Ce point faillit tout faire capoter. Les Dawadas ayant encore des habitudes alimentaires, disons, particulières, cela excluait d’engager un cuisinier étranger au groupe. Mon éloquence – j’avoue n’être pas peu fière de cet exploit – et la promesse d’acheter un gros mouton emportèrent finalement le marché, ainsi que celle de ne pas filmer les hommes aux marmites.
Quelques arguments dans le sens du poil et un mouton, rien de plus, avaient suffi pour entamer des coutumes inviolables et soulever le haram.
Enfin autorisée à rencontrer les femmes, je passai la cinquième journée avec elles à apprendre à les connaître pour choisir mon personnage principal. Elles ne se rendaient pas bien compte de ce qu’il leur arrivait. Certaines s’inquiétaient d’être répudiées après notre départ.
À la fin du tournage – durant lequel nous avions tous ensemble partagé les repas préparés par les hommes cachés derrière un bouquet de palmiers, et où deux fois le mari de mon héroïne, probablement affriolé par sa femme simplement coiffée de soleil, vint me la piquer en plein filmage pour une partie rapide de bac à sable dont elle revenait avec un embarras télégénique aux joues – les femmes, encore incrédules, rentrèrent au village le front insolemment découvert. Le monde pour elles, le temps de quelques prises, avait un peu changé.
*
Le foulard est depuis retombé sur leurs visages. Un simulacre de printemps a fleuri par tout le monde arabe sans porter aucun fruit, laissant après lui une saison arrêtée en enfer.
4 Sourate ii, verset 185. Traduction Kasimirski, Paris, GF Flammarion, 1970.
5Succession de micro dunes, très dures, qui courent au gré du vent et, paraissant plates, peuvent provoquer de graves accidents sur la route.
6 Coran,s. xxiv, v. 31 et xxxiii, 53, 57.
7 Les Dawadas sont une vieille tribu qui vivait dans la Grande mer de sable d’Oubari, au bord de lacs magnifiques et insoupçonnés : Gabr’aoun, Oum el Ma’, Mandara et quelques autres, nichés dans les dunes. Ils se nourrissaient de dattes et d’un minuscule crustacé pullulant dans ces eaux très saumâtres, l’artemia salina que les autochtones prenaient pour des vers, d’où le nom de la tribu, « Ceux des vers ». Un village en dur à la frange de l’erg leur fut construit par le régime de Kadhafi, où ils furent tous déplacés en 1990.
8Coran, s. xxxii, v. 57
9Le Sottisier, « Pensées détachées ».
10Évangile de Jean (8, 1-11).
Sibérie
La Terre n’est qu’un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens.
–Bahá’u’lláh, fondateur du bahaïsme.
« Deux intellectuels assis vont moins loin qu’une brute qui marche. »
–M. Audiard, Un taxi pour Tobrouk, 1961





























