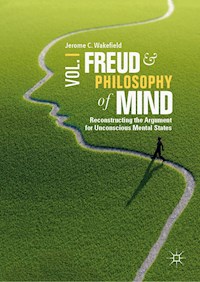Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Quand on a fait de la tristesse une maladie… Critique du diagnostic de la dépression
Ce livre dresse une critique rigoureuse de la manière dont la psychiatrie américaine a réformé, dans les années 1980, le diagnostic de la dépression. Selon les auteurs, le diagnostic actuel de la dépression est trop inclusif et trop large ; il tend à « pathologiser » les réactions normales d’abattement qui se produisent à l’occasion de certaines situations difficiles de la vie.
Les auteurs accusent précisément le DSM-III (texte de référence internationale de la classification américaine des troubles mentaux, troisième version) d’avoir contribué à faire de la tristesse une maladie et, du coup, à en favoriser la médicalisation, avec des conséquences financières très favorables pour l’industrie pharmaceutique. Tandis que la tradition médicale, depuis l’Antiquité, avait clairement cherché à distinguer entre les épisodes de tristesse qui affectent toute vie humaine et cette pathologie de la dépression qui frappe l’individu sans raison apparente, le DSM-III, dans son souci de rendre les définitions cliniques plus opérationnelles, a malencontreusement négligé l’importance de la prise en compte du contexte dans l’établissement du diagnostic de dépression. Les conséquences en matière de recherche sur le trouble dépressif et d’épidémiologie, donc de mobilisation des ressources des services de santé, sont également analysées.
L’ouvrage entend réhabiliter la tristesse, aussi intense puisse-t-elle être, comme un événement normal de la vie humaine, pour ensuite caractériser à rebours la dépression comme une tristesse proprement pathologique, c’est-à-dire dysfonctionnelle. Pour les auteurs, la tristesse est un fait biologique avant d’être un fait social – même si les facteurs culturels ont un poids important dans la modification et la modulation de cette émotion naturelle. Les sociétés individualistes contemporaines refusent bien souvent de l’accepter comme telle, sans reconnaître que cette tristesse normale est sans doute bien davantage le résultat plutôt que la cause des problèmes sociaux.
Un ouvrage guide pour les professionnels de la santé, chercheurs en psychiatrie, en sciences humaines et sociales, travailleurs sociaux et sociologues
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
- « Ce livre se veut une incitation des professionnels de santé à connaître cette fragilité diagnostique pour mieux prendre en charge les patients. »
Pratiques et Organisation des Soins
- « Une critique de l’évolution de la psychiatrie américaine qui a réformé, dans les années 1980, le diagnostic de la dépression. »
La Recherche, n°87
A PROPOS DES AUTEURS
Allan V. Horwitz est Professeur de sociologie à l’Université Rutgers dans le New Jersey. Il est spécialisé dans la sociologie du contrôle de la santé mentale et a publié en 2002
Creating mental Illness.
Jerome C. Wakefield est Professeur à la Faculté de Médecine de l’Université de New York. Il est spécialiste des fondements conceptuels de la psychiatrie.
Françoise Parot est Professeure d’Épistémologie et d’Histoire de la Psychologie à l’Université Paris Descartes. Auteure d’un
Dictionnaire de la psychologie (PUF) et d’une
Introduction à la psychologie (PUF), elle a dirigé, en 2008, l’ouvrage collectif
Les fonctions en psychologie (Mardaga).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
La traduction d’un ouvrage scientifique exige le recours à un vocabulaire spécialisé. J’ai bien entendu utilisé pour les termes scientifiques les traductions françaises des ouvrages concernés par les thèmes abordés et des manuels utilisés pour les diagnostics psychiatriques. Cependant, chaque fois que c’était possible sans trahir les auteurs américains bien sûr, j’ai préféré un vocabulaire aussi peu technique que possible de manière à ce que le lecteur intéressé mais non spécialiste puisse comprendre clairement le propos du livre. De même, les notes qui accompagnent le propos principal sont reportées à la fin de chaque chapitre pour ne pas interrompre une lecture cursive. J’ai choisi, dans la bibliographie terminale, la traduction française des ouvrages cités, quand elle existe bien entendu.
Les noms de médicaments commenceront par une majuscule mais ne seront pas suivis du ® habituel, de manière à ne pas surcharger certains passages. Les noms de troubles divers abordés dans le livre commenceront pas une majuscule lorsqu’ils désignent une entité identifiée dans les DSM.
Je tiens à remercier très vivement Steeves Demazeux pour l’aide qu’il n’a cessé de m’apporter pendant toute cette traduction. Sans lui sans doute, je ne l’aurais pas entreprise. Enfin, Bernard Granger, Jean Gayon, Valérie Aucouturier et Étienne Aucouturier m’ont aidée aussi, par les solutions aux problèmes que je leur posais, et par leur précieuse amitié. Je les en remercie.
Françoise Parot
Introduction
Qu’est-ce que la dépression?
Comme l’a écrit le poète W. H. Auden, la période qui a suivi la Deuxième Guerre Mondiale a été «l’âge de l’anxiété»1. Selon lui, l’anxiété intense de ces années-là constituait la réponse humaine normale aux circonstances extraordinaires que furent les destructions totales de la guerre moderne, l’horreur des camps de concentration, le développement de l’arme nucléaire, puis les tensions entre les États-Unis et l’URSS au moment de la Guerre Froide. Si Auden était encore parmi nous, il nous dirait sans doute que ce tournant du XXIe siècle est «l’âge de la dépression»2. Il y a évidemment une différence décisive entre ces deux époques: alors qu’après la guerre l’anxiété était considérée comme une réponse normale à des circonstances sociales qui nécessitaient des solutions collectives et politiques, nous considérons aujourd’hui la tristesse comme anormale: comme un désordre psychiatrique qui requiert un traitement par des professionnels.
Prenons l’exemple de Willy Loman, le personnage principal de la célèbre pièce d’Arthur Miller Mort d’un commis voyageur, qui est peutêtre le personnage de fiction qui représente le mieux le mode de vie américain pendant les décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre3. Au moment où il aborde la soixantaine, et malgré sa foi dans le rêve américain en vertu duquel travailler dur mène à la réussite, Willy Loman n’a jamais vraiment réussi. Il est criblé de dettes, sa santé se dégrade, il lui est de plus en plus difficile de faire son travail de commis voyageur, et son fils le méprise. Quand il perd son travail, il est forcé d’admettre son échec; il se suicide dans sa voiture, en espérant que sa famille touchera l’argent de l’assurance. La pièce a eu un succès considérable dès qu’elle a été jouée à Broadway en 1949 parce que Willy Loman incarnait le mode de vie de l’Américain moyen, qui avait voulu s’enrichir mais qui se retrouvait détruit par cette ambition.
La pièce reçut un accueil très différent lorsqu’elle fut rejouée cinquante ans plus tard4. Selon un article du New York Times, titré «Donnez du Prozac à cet homme», le metteur en scène de cette nouvelle version avait envoyé le script à deux psychiatres et leur diagnostic fut que Loman souffrait d’un trouble dépressif5. L’auteur de la pièce, Arthur Miller, a réagi contre ce diagnostic: «Willy Loman n’est pas dépressif… Il est écrasé par son existence. Il en est là pour des raisons sociales». Le diagnostic des psychiatres est aussi caractéristique de notre époque que Loman l’était de la sienne. Ce que notre culture voyait alors comme réaction à l’échec, nous le regardons maintenant comme maladie psychiatrique. Cette transformation d’un problème social en problème psychiatrique traduit un changement majeur du regard que nous portons sur la nature de la tristesse.
LA DOUBLE NATURE DE LA DÉPRESSION
La place prise par la dépression, qui est une tendance sociale lourde, s’exprime de différentes manières:
Le nombre de dépressions dans la société: la plupart des spécialistes affirment que des proportions toujours plus importantes d’individus souffrent de dépression. Selon les études épidémiologiques, environ 10% de la population adulte des États-Unis sont touchés chaque année par une dépression majeure et près d’un cinquième des individus en souffrent à un moment de leur vie6. Ces proportions sont même environ deux fois plus élevées chez les femmes que chez les hommes7. Selon la définition qu’on en donne, la dépression peut même toucher la moitié des membres de sous-groupes comme les adolescentes ou les personnes âgées8. Qui plus est, ces chiffres augmentent régulièrement. Depuis plusieurs décennies, les études de chaque tranche d’âge montrent de plus en plus de troubles dépressifs9. Même si cette élévation des taux peut être due plus à un élargissement des populations sur lesquelles on fait des mesures qu’à une réelle augmentation des taux de malades10, on a le sentiment que la dépression se répand de manière alarmante.
Le nombre de patients traités pour dépression: aux États-Unis, ce nombre a explosé depuis quelques années. La plupart des patients sont traités en ambulatoire; dans ce cas, leur nombre a augmenté de 300% entre 1987 et 199711. En 1997, 40% des patients en psychothérapie, soit deux fois plus que 10 ans auparavant, le sont pour un trouble de l’humeur, c’est-à-dire la catégorie constituée surtout par la dépression12. Le pourcentage de gens en traitement pour dépression, qui était de 2,1% dans les années 1980, est au début des années 2000 de 3,7%, soit une augmentation de 76% en 20 ans13. Dans certains groupes, comme celui des personnes âgées, l’accroissement a été encore plus considérable: entre 1992 et 1998, on a diagnostiqué 107% de dépressions en plus14.
La prescription d’antidépresseurs: même si les médicaments ont constitué un traitement banal des problèmes de l’existence depuis 1950, leur usage a connu une croissance atterrante ces dernières années. Des antidépresseurs comme le Prozac, le Paxil15, le Zoloft et l’Effexor sont aujourd’hui parmi les médicaments les plus prescrits, toutes catégories confondues16. Leur usage par les adultes a presque triplé entre 1988 et 200017. Chaque mois, 10% de femmes et 4% d’hommes se mettent à prendre l’un de ces médicaments18. Au cours des années 1990, les dépenses en antidépresseurs ont augmenté de 600% aux États-Unis, en dépassant les 7 milliards de dollars par an en 200019.
Les estimations du coût social de la dépression: on la considère comme une source de dépenses sociales énormes. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la principale institution internationale qui s’occupe de la santé, prévoit qu’en 2020 la dépression sera devenue la 2e cause d’invalidité dans le monde, juste derrière les maladies cardiaques. L’OMS estime qu’elle constitue déjà la première cause d’invalidité des 15-44 ans20. Aux États-Unis, des économistes considèrent que la dépression coûte environ 43 milliards de dollars par an21.
Les publications scientifiques sur la dépression: la recherche sur la dépression est devenue une industrie majeure22. En 1966, 703 articles contenant le mot «dépression» dans le titre ont été publiés dans les journaux médicaux. En 1980, l’année où l’Association de Psychiatrie Américaine (APA) a publié sa troisième édition du Manuel diagnostique et statistique sur les troubles mentaux (DSM-III) comportant de nouvelles définitions du trouble dépressif, 2 754 articles sur la dépression ont été publiés. Ce nombre a régulièrement augmenté pendant les quinze années qui ont suivi puis a explosé au milieu des années 1990. En 2005, on a publié 8 677 articles sur la dépression, plus de douze fois le nombre de 1966. Ce nombre dépasse aujourd’hui celui de n’importe quel autre problème psychiatrique et s’est accru bien plus vite que le nombre de publications dans le domaine de la recherche psychiatrique.
L’intérêt des médias pour la dépression: la dépression est devenue un souci général de notre culture; on la retrouve dans les séries télévisées populaires, les succès de librairie et la plupart des magazines. Beaucoup de livres de témoignages de ceux qui en ont fait l’expérience, comme Face aux Ténèbres de William Styron, De l’exaltation à la dépression de Kay Jamison, Prozac nation: Avoir 20 ans dans la dépression de Elizabeth Wurtzel et Le Diable intérieur; anatomie de la dépression de Andrew Solomon sont devenus des best-sellers. Quand on regarde dans une librairie les parutions récentes en psychologie, on est devant un raz-de-marée de livres sur la manière de prévenir ou de vivre une dépression. La célèbre série télévisée Les Soprano a pour personnage principal un parrain de la mafia qui (entre autres problèmes psychiatriques) souffre de dépression et la consommation d’antidépresseurs est un thème récurrent de la série. Les révélations de beaucoup de personnalités publiques de premier plan, comme Tipper Gore23, Mike Wallace24 et Brooke Shields25, sur leur dépression ont été bien relayées dans les médias.
TRISTESSE NORMALE ET TRISTESSE PATHOLOGIQUE
Nous croyons que la dépression est un phénomène qui s’est récemment répandu; mais les symptômes que nous lui associons comme la grande tristesse, diverses autres émotions et les symptômes physiques qui accompagnent souvent la tristesse sont connus depuis les commencements de l’histoire de la médecine26. Pour comprendre l’augmentation récente des diagnostics de dépression, il faut d’abord savoir que jusqu’à une période récente, on distinguait nettement deux grands types d’états: le premier, la tristesse normale, ou «avec cause», était associée à l’expérience de la perte27 ou à d’autres circonstances douloureuses qui semblaient être les causes évidentes de la détresse. L’attitude devant ces réactions normales consistait à apporter un soutien, à aider la personne à supporter puis à dépasser cette perte, et à éviter de confondre sa tristesse avec une maladie.
Le second, connu généralement comme «mélancolie», ou dépression «sans cause», constitue un trouble médical distinct de la tristesse normale par le fait que les symptômes n’ont pas de raison apparente dans la vie du patient. Cet état est relativement rare mais il a tendance à durer et à se répéter. Parce qu’il ne constitue pas une réponse proportionnée à des événements réels, on a fait l’hypothèse que cette pathologie procède de quelque défaut ou dysfonctionnement interne qui requiert l’attention de spécialistes. Et pourtant cet état pathologique est constitué de la même sorte de symptômes que la tristesse normale intense (tristesse, insomnie, retrait social, perte d’appétit, perte d’intérêt pour les activités habituelles, etc.).
Cette distinction entre tristesse normale et trouble28 dépressif est décisive et fondée. Non seulement elle est cohérente avec la différence générale entre normalité et pathologie que font la médecine et la psychiatrie traditionnelles, mais elle l’est aussi avec le bon sens; elle est importante sur le plan clinique et scientifique. Et pourtant la psychiatrie contemporaine en est arrivée à ignorer largement cette distinction.
Nous pensons que la récente explosion d’un supposé trouble dépressif ne vient pas en fait d’une diffusion réelle de cet état. C’est bien plutôt le produit du mélange entre les deux catégories conceptuellement distinctes de tristesse normale et de trouble dépressif qui revient à considérer des cas de tristesse normale comme des troubles mentaux. L’«épidémie» actuelle, bien que résultant de nombreux facteurs sociaux, a été produite par la modification de la définition psychiatrique du trouble dépressif qui inclut la tristesse comme maladie, même quand elle ne l’est pas.
LES ENJEUX D’UNE DÉFINITION ERRONÉE DE LA DÉPRESSION
L’«âge de l’anxiété» d’Auden tenait à une situation sociale particulière; l’augmentation récente des troubles dépressifs ne tient pas à des circonstances déterminées. Les raisons qu’on invoque le plus souvent – la vie moderne crée moins de lien social, est plus aliénante, les médias nous confrontent à la santé ou à la beauté parfaites et nous nous sentons infériorisés – pourraient expliquer une réaction normale de tristesse (comme l’anxiété pointée par Auden était normale) mais pas cette croissance massive d’un trouble mental. On n’a identifié ni même envisagé théoriquement aucun environnement pathogène qui produirait des accroissements réels de dysfonctionnements cérébraux physiologiques, psychologiques ou d’origine sociale. Sans aucun doute, les progrès indéniables accomplis dans le traitement médicamenteux du trouble dépressif ont induit à traiter des états que les médecins croient pouvoir soulager, et cela a peut-être, sur des cas à l’origine ambigus, incliné à diagnostiquer une dépression pour apporter une réponse efficace. Mais c’est insuffisant pour expliquer l’énorme augmentation du nombre de gens qui paraissent atteints de ce trouble et qui sont soignés en conséquence; habituellement, l’amélioration des traitements médicamenteux n’augmente pas la fréquence de la maladie. Et cette amélioration n’expliquerait pas non plus les résultats des études épidémiologiques qui ne s’intéressent pas aux patients mais directement aux gens qui ne sont pas traités. Cette explosion de cas de dépression est donc troublante. Qu’est-ce qui a bien pu provoquer cette apparente épidémie?
Ce qui est arrivé, selon nous, c’est que ce diagnostic de plus en plus fréquent a été fondé sur une définition relativement nouvelle et imparfaite qui, conjuguée à d’autres évolutions de la société, a incroyablement étendu le domaine du trouble présumé. Pour comprendre comment cela a pu se passer, nous situerons les pratiques actuelles des psychiatres dans leur contexte historique et nous verrons à quel point les définitions diagnostiques contemporaines du trouble dépressif paraissent étranges au regard des habitudes anciennes. Nous devrons également analyser dans le détail comment ont été construites les classifications psychiatriques modernes proposées dans les versions successives du DSM, souvent présentée comme la «bible de la psychiatrie» qui donne les définitions diagnostiques de tous les troubles mentaux.
Mais comment quelque chose d’aussi simple et limité qu’une définition peut-il avoir des conséquences importantes sur un domaine comme la psychiatrie, donc sur les médias qui diffusent les découvertes et les conceptions qu’on défend dans ce domaine, sur les idées qui ont cours dans une société? En réponse aux critiques qui, dans les années 1960 et 1970, affirmaient que des psychiatres différents ne porteraient pas le même diagnostic sur un patient donné qui a les mêmes symptômes (absence de fidélité interjuges), le DSM dans les années 1980 a commencé à dresser des listes de symptômes en vue d’établir une définition claire pour chaque trouble29. Presque tous les professionnels de la santé mentale, dans une grande variété de contextes allant des hôpitaux aux pratiques privées, recourent aujourd’hui à ces définitions formelles pour porter un diagnostic. Qui plus est, ces définitions ont filtré hors du champ de la clinique mentale et sont utilisées dans les études épidémiologiques des troubles présents dans la société, dans les recherches sur les résultats des traitements, dans la commercialisation des antidépresseurs, dans les efforts préventifs à l’école, dans le dépistage en médecine de ville, dans les affaires judiciaires et dans bien d’autre situations. Ces définitions du DSM sont de fait devenues le critère qui fait autorité pour décider de ce qui doit être ou non considéré comme un trouble mental dans notre société. Ce qu’elles peuvent avoir d’abstrait, de lointain, de technique a en réalité des conséquences importantes pour les individus et sur la manière de comprendre leur souffrance et de la traiter.
Puisque ces définitions centrées sur la symptomatologie constituent la base des recherches et des traitements dans le domaine de la santé mentale, leur validité est de la plus haute importance. La recherche et les traitements sont comme une pyramide inversée: les définitions des troubles mentaux données par le DSM, qui déterminent ce qui est considéré comme maladie, sont la pointe de la pyramide, sur laquelle repose la solidité de tout l’édifice. Aucune histoire de cas, aucun entretien diagnostique en clinique, aucun choix d’échantillon, plan expérimental ou analyse statistique des données en matière de recherche ne peut donner des résultats intéressants s’il recourt à une définition du trouble inadéquate qui mélange des aspects normaux et des aspects anormaux. Archimède déclarait à qui voulait l’entendre: «Donnez moi un point d’appui et un levier assez long, et je soulèverai le monde». Dans la psychiatrie contemporaine, les définitions «soulèvent» le traitement et la recherche, et les cliniciens contemporains, avec une définition beaucoup trop large, peuvent élever le nombre de troubles diagnostiqués autant qu’ils le veulent, surtout quand il s’agit d’un trouble comme la dépression, qui inclut des symptômes comme la tristesse, l’insomnie, la fatigue, symptômes qui sont très répandus dans la population normale. Voilà pourquoi la focalisation récente de la psychiatrie sur la fidélité des diagnostics fondés sur les symptômes en a fragilisé la validité, à savoir leur capacité à repérer correctement le trouble30. Les critères utilisés par ce DSM pour diagnostiquer le Trouble de Dépression Majeure sont un exemple où l’accroissement de fidélité a eu comme effet imprévu de créer des problèmes importants de validité.
LA DÉFINITION DE LA DÉPRESSION MAJEURE DANS LE DSM
C’est dans la version la plus récente (la 4e) du DSM qu’on trouve la définition officielle du trouble dépressif qui est la base des diagnostics cliniques et des recherches31. Cette définition du Trouble de Dépression Majeure (TDM), qui englobe la plupart des diagnostics de dépression, est longue et comporte plusieurs critères d’inclusion et d’exclusion. Nous ne ferons qu’au chapitre 4 l’analyse et la critique de l’approche du DSM; pour l’instant, nous ne nous arrêtons qu’aux caractères les plus importants de cette définition: les symptômes; les durées concernées; l’exclusion du deuil.
Selon le DSM, pour que soit diagnostiqué le TDM, il faut que 5 symptômes parmi les 9 suivants aient été présents pendant une période de 2 semaines (parmi les 5 doit figurer l’humeur dépressive ou la diminution marquée d’intérêt et de plaisir): (1) l’humeur dépressive; (2) la diminution marquée d’intérêt ou de plaisir dans les activités; (3) la perte ou le gain de poids ou des modifications de l’appétit; (4) l’insomnie ou l’hypersomnie (sommeil excessif); (5) l’agitation ou le ralentissement psychomoteur (la lenteur); (6) la fatigue ou la perte d’énergie; (7) des sentiments excessifs ou inappropriés de dévalorisation ou de culpabilité; (8) la diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision; (9) des pensées de mort récurrentes, des idées ou des tentatives de suicide32.
Ce sont ces critères symptomatiques qui constituent le cœur de la définition du TDM, mais celle-ci comporte une clause supplémentaire importante: «Ces symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil, c’est-à-dire après la mort d’un être cher, les symptômes persistent pendant plus de 2 mois ou s’accompagnent d’une altération marquée du fonctionnement de préoccupations morbides, de dévalorisation, d’idées suicidaires, de symptômes psychotiques ou un ralentissement psycho-moteur»33. En d’autres termes, les patients échappent au diagnostic si leurs symptômes relèvent de ce que le DSM définit comme la période normale de deuil après la disparition d’un être cher, qu’ils n’excèdent pas 2 mois et ne sont pas accompagnés de symptômes particulièrement graves comme la psychose ou des pensées suicidaires. Dans la définition, ce n’est que par cette «exclusion du deuil» qu’on reconnaît que certains cas de tristesse intense, en fait normaux, pourraient tomber sous les critères symptomatiques de dépression pathologique.
La définition du DSM est raisonnable à bien des égards. Ses critères peuvent donner lieu à des désaccords sur des symptômes particuliers, mais chacun de ces critères est largement reconnu comme un indicateur du trouble dépressif y compris par la psychiatrie d’avant le DSM. On peut discuter du nombre exact de symptômes qui doivent être réunis pour qu’on diagnostique une dépression; certains peuvent être plus laxistes, d’autres plus exigeants pour être sûrs qu’il y a bien dépression; pour d’autres encore il ne faudrait pas un seuil net mais un continuum dimensionnel de gravité du trouble34. On pourrait aussi se demander si la durée de 2 semaines pendant lesquelles persiste le trouble est suffisante, mais il est quelquefois évident, au cours même des 2 semaines, que quelqu’un souffre de dépression et les cliniciens ne devraient pas se garder de diagnostiquer de tels cas comme dépression même si la durée canonique du trouble n’est pas atteinte. De la même manière, il semble raisonnable d’exclure les gens qui ont récemment vécu un deuil. Les critères enfin sont assez clairs et, dans la plupart des cas, pas plus difficiles à mesurer que les symptômes typiques d’autres troubles psychiatriques. Et c’est parce qu’elle est raisonnable, claire et efficace que la définition du TDM a été quasi universellement adoptée.
Où est donc alors le problème? Dans la définition, mises à part quelques exceptions, la présence d’un groupe déterminé de symptômes suffit à diagnostiquer le trouble. Or, certains de ces symptômes, l’humeur dépressive, la perte d’intérêt pour les activités habituelles, l’insomnie, la diminution d’appétit, la difficulté de se concentrer etc. peuvent apparaître naturellement pendant 2 semaines sans qu’il y ait de pathologie, et cela à la suite d’un grand nombre d’événements négatifs: la perte de la personne dont on est amoureux, une promotion qu’on attendait et qu’on ne reçoit pas, l’échec à une épreuve décisive pour sa carrière, la révélation d’une maladie très grave d’un proche ou de soi-même, l’humiliation qui suit la découverte d’un comportement condamnable. Ce genre de réactions, même intenses quand elles font suite à des événements durs, font évidemment partie de la nature humaine. Tout comme on comprend bien pourquoi le DSM exclut les cas de deuil du diagnostic, on comprendrait qu’il écarte aussi ces réactions à des circonstances dramatiques. Pourtant le diagnostic ne les exclut pas. Parce que ses critères sont fondés sur des symptômes, toute tristesse incluant un nombre suffisant des symptômes prévus pendant au moins 2 semaines sera à tort considérée comme pathologique, à ranger à côté d’autres perturbations psychiatriques véritables. En caractérisant les différents symptômes dont souffrent ceux qui sont atteints de dépression sans s’intéresser au contexte dans lequel ils apparaissent, la psychiatrie contemporaine a également sans le vouloir caractérisé la souffrance intense mais normale comme maladie.
Prenons par exemple les cas suivants:
Cas 1: la fin d’une relation amoureuse passionnée
Un professeur célibataire de 35 ans va consulter un psychiatre pour avoir des médicaments contre ses insomnies. Elle doit présenter un article pour son travail et craint de ne pas être à la hauteur. Elle raconte que depuis 3 semaines elle est déprimée, se sent triste et vide, que son travail ne l’intéresse pas (elle a en fait passé la plupart de son temps au lit ou à regarder la télévision). Elle a moins d’appétit, et reste éveillée la nuit, est incapable de s’endormir parce qu’elle est trop triste. Elle est fatiguée pendant la journée, manque d’énergie et n’arrive pas à se concentrer. Parce que sa douleur la distrait pendant son travail, elle est à peine capable de satisfaire aux obligations minimum (elle arrive en cours mal préparée, ne va pas aux réunions, n’est pas assez concentrée pour ses recherches). Elle se soustrait à des obligations sociales.
Quand on lui demande ce qui a bien pu provoquer ces sentiments dépressifs, elle dit qu’il y a un mois, un homme marié avec lequel elle a vécu pendant 5 ans un amour passionné a décidé qu’il ne pouvait pas quitter son épouse et a mis fin à leur relation. Cette femme avait vu dans cette relation l’amour qu’on ne vit qu’une fois dans sa vie, fait d’un mélange extraordinaire d’intimité émotionnelle et intellectuelle.
Cette personne a accepté de rencontrer régulièrement le psychiatre. Par la suite, au fur et à mesure que les semaines sont passées, sa sensation de perte s’est lentement atténuée et a été remplacée par un sentiment de solitude et le besoin de recommencer sa vie en rencontrant quelqu’un. Finalement, elle a rencontré à nouveau des gens et, après plusieurs mois, elle a connu à nouveau l’amour et les symptômes qui restaient encore ont disparu.
Cas 2: la perte d’un bon travail
Un homme de 64 ans, marié, s’est mis à avoir une impression de tristesse et de vide, une absence de plaisir dans ses activités, de l’insomnie, à se sentir fatigué et à manquer d’énergie, à se dévaloriser; il n’a aucun plaisir à voir ses amis et semble incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Il hurle sur sa femme quand elle essaie de le rassurer et repousse tous ses efforts pour le réconforter.
Cet état a été déclenché 2 semaines auparavant quand l’entreprise où il travaillait l’a licencié de manière inattendue, dans le cadre d’un plan de compression du personnel. Ce licenciement s’est produit tout juste 6 mois avant qu’il ne parte à la retraite. Or l’une des principales raisons pour lesquelles il avait choisi de travailler dans cette entreprise et y a passé deux décennies était qu’il en attendait une bonne retraite. La perte de cette perspective signifie que sa femme et lui vont avoir une petite retraite en plus de celle prévue par les assurances.
Le couple est donc obligé de vendre sa maison et d’emménager dans un petit appartement. L’homme a trouvé un travail à côté qui, avec ce que lui donnent les assurances, leur permet tout juste de vivre. Il reste dégoûté par la façon dont on l’a traité, mais ses symptômes régressent graduellement.
Cas 3: réaction à un diagnostic éventuellement fatal d’un être cher
Une femme de 60 ans, divorcée, qui consulte un médecin dans un cabinet éloigné de chez elle demande un médicament pour l’aider à dormir. Trois semaines plus tôt, on a diagnostiqué une maladie rare du sang et qui engage le pronostic vital chez sa fille qui est avocate et qui est son seul enfant, dont elle est très proche et qui est la fierté de sa vie. Après avoir appris ce diagnostic, la mère est accablée de tristesse et de désespoir et incapable de continuer sa vie professionnelle et sociale. Bien qu’elle fasse bonne figure devant sa fille et qu’elle soit capable de l’aider dans son parcours médical, la mère demeure dans un état de grande détresse depuis que le diagnostic est tombé; elle pleure souvent, ne parvient pas à dormir, ne peut pas se concentrer, se sent fatiguée et ne parvient pas à s’intéresser à ses activités habituelles dans l’attente de nouvelles sur l’état de sa fille.
Ces symptômes diminuent graduellement au cours des mois pendant lesquelles sa fille suit son traitement et lutte contre la maladie, qui finit par se stabiliser mais demeure une menace. La mère continue de se sentir de temps à autre triste à propos de l’état de sa fille, mais les autres symptômes régressent et elle s’adapte aux circonstances nouvelles et aux problèmes que subit sa fille.
Chacune des personnes évoquées dans ces cas présente les symptômes du TDM et le DSM les auraient classées comme atteintes d’un trouble psychiatrique. Leurs symptômes durent plus que 2 semaines; elles font l’expérience d’une dévalorisation ou de détresse et ne sont pas dans le cas de l’exclusion du deuil. Or leurs réactions semblent être normales pour des gens qui subissent la fin brutale d’une relation amoureuse, la perte d’un bon travail ou un diagnostic très grave pour un être cher. Les symptômes que ces personnes décrivent ne sont ni anormaux ni inappropriés en regard des circonstances qu’elles vivent.
Qu’est-ce qui suggère, parmi ces caractéristiques, qu’il ne s’agit pas de pathologies? Dans chaque cas, les symptômes surviennent après un événement identifié qui implique une perte importante. Qui plus est, la sévérité des réponses à cette perte, même si elle est intense, est raisonnablement proportionnée à la nature des problèmes qui touchent ces gens. Et pour finir ces symptômes disparaissent quand les choses s’améliorent, persistent parce que la situation demeure stressante ou régressent avec le temps. Probablement que la plupart des médecins sensés devant juger ces cas sans se référer au DSM ne considéreraient pas aujourd’hui ces réactions comme des troubles, pas plus que leurs prédécesseurs ne l’auraient fait.
Montrer que la définition du trouble dépressif donnée par le DSM inclut à tort des cas de réactions émotionnelles normales ne signifie nullement qu’il n’existe pas de cas de véritable dépression. Il en existe, et ils peuvent être très graves, et le DSM les inclut. Mais ils ne ressemblent pas du tout aux cas que nous venons d’évoquer. Le portrait que tout le monde dresse de la dépression comporte toujours une souffrance profonde, immense, qui immobilise, une souffrance qui empêche de manière épouvantable toute vie sociale, et cette expérience est vraiment celle d’une maladie réelle.
Voici le cas de Deanna Cole-Benjamin, raconté dans le New York Times Magazine à propos d’un nouveau traitement de la dépression:
Elle n’avait subi aucun trauma dans sa jeunesse; elle disait avoir eu une vie d’adulte bénie des dieux. À 22 ans, elle avait épousé Gary Benjamin, un officier de carrière de l’Armée canadienne, et son mariage lui avait apporté beaucoup de bonheur; en 1990, elle avait 3 enfants. Ils vivaient dans une maison confortable de Kingston, une ville universitaire agréable sur la rive nord du lac Ontario; et Deanna, qui était nourrice, aimait son travail. Mais dans les derniers mois de l’année 2000, sans raison (aucun changement dans sa vie, aucune perte), elle est tombée dans une dépression d’une profondeur et d’une durée extraordinaires.
«Ça a commencé avec l’impression de ne plus me sentir connectée au monde comme d’habitude», me dit-elle un soir à table. «C’était comme si les murs s’effondraient tout autour de moi. Je me sentais de plus en plus triste et comme engourdie».
Son médecin lui prescrivit de plus en plus d’antidépresseurs, mais ça lui faisait à peine de l’effet. Quelques semaines avant Noël, elle cessa d’aller à son travail. Les actes les plus simples, décider quoi mettre, préparer le petit-déjeuner, exigeaient d’elle une immense volonté.
Alors un jour, seule dans la maison quand Gary était parti déposer les enfants à l’école et travailler, elle se sentit si incapable de se sortir de sa maladie qu’elle se rendit au cabinet de son médecin et lui dit qu’elle ne pouvait pas continuer.
Elle me raconta plus tard: «Il m’a jeté un regard et m’a dit qu’il voulait que je reste ici dans son cabinet. Puis il a appelé Gary, Gary est venu au cabinet et il lui a dit de m’emmener immédiatement à l’hôpital»35.
Outre la gravité extrême et la durée des symptômes, il est évident que cet état de profonde dépression est sans relation avec des événements connus pour déclencher normalement de tels épisodes.
Voilà comment Andrew Solomon décrit sa dépression:
(La dépression) avait eu une vie propre qui petit à petit avait étouffé toute vie en moi. Au pire stade de ma dépression, j’avais des humeurs qui n’étaient pas les miennes: elles appartenaient à la dépression (…). Je me sentais fléchir sous quelque chose de beaucoup plus fort que moi. D’abord, je ne pus faire usage de mes chevilles, puis le contrôle de mes genoux m’échappa, mes reins se brisèrent sous le poids de la tension, mes épaules s’affaissèrent et à la fin, je n’étais plus qu’un fœtus compact, épuisé par cette chose qui m’écrasait sans me tenir. Ses vrilles menaçaient de pulvériser mon cerveau, mon courage et mon estomac, de fendre mes os et de dessécher mon corps. Elle continuait de se repaître de ma substance alors qu’il semblait ne plus rien rester36.
Là encore, la dépression profonde «a sa vie à elle» en ce sens que sa gravité n’est pas liée à une perte déterminée ou à de quelconques événements négatifs qui entraîneraient normalement de tels sentiments.
Dans ce qui est peut-être la description la plus fine de la dépression, Face aux Ténèbres, William Styron explique la réaction qu’il eut quand il apprit qu’il avait remporté un prestigieux prix littéraire:
Au musée, la douleur persista durant toute ma visite et atteignit son paroxysme au cours des quelques heures qui suivirent lorsque, de retour à l’hôtel, je m’affalai sur mon lit et restai là, les yeux fixés au plafond, virtuellement paralysé par une transe marquée par une extrême souffrance. D’ordinaire en de pareils moment, toute lucidité désertait mon esprit, d’où le terme de transe. Je ne vois pas de mot plus pertinent pour qualifier cet état, un état d’hébétude dans lequel la conscience faisait place à cette «angoisse positive et active»37.
L’état de Styron perdure indépendamment de tout contexte social: dans la dépression «La souffrance est implacable, et ce qui rend cette condition intolérable est de savoir à l’avance qu’aucun remède ne se matérialisera – fût-ce dans un jour, une heure, un mois ou une minute. Si se présente un peu de répit, on sait qu’il est temporaire et qu’il sera remplacé par plus de douleur encore»38. Les symptômes ne surviennent pas après un moment stressant mais après ce qui aurait dû occasionner une fête.
Le sociologue David Karp, dans Speaking of Sadness, offre lui aussi un portrait caractéristique:
Objectivement, j’aurais dû me sentir tout à fait bien. J’avais un statut académique solide à Boston, je venais de signer mon premier contrat avec un éditeur, j’avais une femme formidable, un fils parfait et une toute petite fille… Chaque nuit sans sommeil, ma tête était envahie de ruminations et pendant la journée je ressentais une blessure insupportable, comme si quelqu’un de très proche venait de mourir. J’étais agité, je me sentais mélancolique, dans un état différent de tout ce que j’avais connu dans le passé… J’étais persuadé que cette dépression avait ses racines dans des pressions sociales et qu’une fois que ma carrière serait plus avancée, ma dépression s’envolerait. Je fus promu en 1977, et en fait ma dépression devint plus grave39.
Tout comme la dépression de Styron se déclara dans des circonstances positives, l’état très grave de Karp était indépendant des circonstances réelles de sa vie.
Comme l’illustrent ces exemples, les médias comme les psychiatres décrivent des cas qui sont clairement de vraies dépressions. Pourtant ces descriptions montrent également que ce ne sont pas les symptômes en eux-mêmes qui permettent de distinguer le trouble dépressif de la tristesse normale; ils ne sont pas d’une qualité différente de ceux dont un individu fait normalement l’expérience après une perte dramatique, comme celles que nous avons vues dans les cas de réactions normales à des événements terribles. C’est en fait l’absence d’un contexte pertinent pour l’apparition de ces symptômes qui signe qu’il y a pathologie. La dépression émerge en l’absence de toute perte ou se développe après un événement positif, comme une récompense prestigieuse ou l’obtention d’un poste. La sévérité des troubles est d’une intensité totalement incohérente avec les circonstances que vivent ceux qui en souffrent. Et les symptômes persistent indépendamment de tout contexte stressant, vivent leur propre vie, sont imperméables aux changements des circonstances extérieures. L’insistance de la littérature spécialisée sur de tels exemples peut nous induire à oublier que les critères diagnostiques du DSM ne se limitent pas à ces cas typiques mais incluent aussi à tort une grande variété de réactions intenses certes mais normales.
Le problème principal que posent la définition par le DSM du TDM et tous les travaux qui s’appuient sur elle, c’est donc tout simplement qu’elle ne prend pas en compte le contexte dans lequel apparaissent les symptômes et ne parvient donc pas à exclure du trouble pathologique la tristesse intense (en dehors de celle qui suit le décès d’un être cher), tristesse qui accompagne de multiples réactions humaines normales à des pertes graves. Ce qui en résulte, c’est une confusion entre les réactions normales et les symptômes causés par le dysfonctionnement dépressif, c’est la réunion des deux dans la classe des troubles mentaux; ce qui constitue un problème fondamental pour la recherche, les traitements, la politique publique à l’égard de la dépression. Et comme nous le verrons, le problème s’est aggravé récemment avec la tendance croissante à se contenter, pour le diagnostic de la dépression, d’un nombre plus petit de symptômes, quelquefois seulement deux. Le risque de diagnostics positifs mais faux, portés sur des patients qui répondent à ces critères restreints mais ne souffrent pas en fait d’un trouble mental (les faux positifs), s’accroît de manière exponentielle au fur et à mesure que le nombre de symptômes utilisés pour le diagnostic diminue.
Les critères trop larges du DSM pour un diagnostic de dépression finissent par compromettre les ambitions et les concepts de la psychiatrie elle-même. Le DSM à pour but de permettre d’identifier des états psychologiques qui peuvent être considérés comme de vrais troubles médicaux et de les distinguer d’états problématiques mais non pathologiques40. C’est pourquoi l’erreur que nous soulignons dans des catégories de trouble comme le TDM constitue un problème pour les ambitions déclarées du DSM.
LA DISTINCTION ENTRE NORMALITÉ ET PATHOLOGIE
Au cœur de notre argument contre la définition de la dépression donnée par le DSM, il y a la conviction que la tristesse normale peut être intense; qu’elle peut s’accompagner d’insomnie, de difficultés de concentration, de modifications de l’appétit, etc.; qu’elle peut être invalidante et poignante; qu’elle peut durer plus de deux semaines… Mais sur la base de quelle conception de la normalité et de la pathologie peut-on faire la distinction entre la tristesse profonde normale et celle qui est pathologique?
Fonctionner normalement, ce n’est pas seulement être conforme à la majorité statistique. Certains troubles peuvent être statistiquement «normaux» dans une population, comme la gingivite ou l’artériosclérose dans notre société, mais ce sont quand même des pathologies. Il faut aussi distinguer la pathologie des attentes ou des valeurs sociales. Même dans le DSM on admet qu’un individu déviant socialement ou dont le caractère est en conflit avec les valeurs en vigueur dans la société n’est pas nécessairement atteint d’un trouble41. Une conception adaptée du trouble ne doit pas seulement le distinguer des valeurs sociales mais expliquer aussi en quelle manière le trouble est une maladie réelle qui constitue, au moins en partie, un problème objectif dans le fonctionnement individuel.
Nous considérons que la meilleure manière de distinguer le normal du pathologique chez l’homme est de faire la différence entre le fonctionnement tel qu’il a été biologiquement façonné42 par la sélection naturelle et l’échec de ce fonctionnement, c’est-à-dire le dysfonctionnement43. Ce point de vue est cohérent avec les intuitions de bon sens et il est accepté et défendu par la plupart de ceux qui s’intéressent aux fondements conceptuels de la psychiatrie, et de la médecine en général44. Ainsi par exemple, le critère du fonctionnement normal des organes du corps est qu’ils font ce qu’ils sont biologiquement destinés à faire comme ils sont constitués pour le faire: le cœur sert à pomper le sang, les reins éliminent les déchets, les poumons permettent de respirer, et si ces fonctions sont accomplies par les structures destinées à le faire, le fonctionnement est normal. Il y a pathologie quand l’organe est incapable de remplir la fonction pour laquelle il a été modelé par la sélection naturelle.
De la même manière, les processus psychologiques qui ont été sélectionnés comme faisant partie de la nature humaine ont des fonctions naturelles, c’est-à-dire des effets pour lesquels ils ont été sélectionnés par la nature. Un nombre considérable de recherches en neurobiologie et en psychologie laissent penser que l’esprit est constitué de beaucoup de modules ou de mécanismes spécifiques destinés à répondre à des défis environnementaux particuliers45. Et la situation contextuelle est un aspect essentiel de nombre de ces mécanismes psychologiques; ils sont faits pour s’activer dans certains contextes et pas dans d’autres. Les réponses de peur, par exemple, ont été biologiquement modelées pour réagir à des situations de danger et non à des situations de sécurité. De la même façon, des mécanismes innés qui régulent les réactions de tristesse, de désespoir et de retrait surviennent naturellement quand des êtres humains vivent des moments de perte46. À l’inverse, il y a dysfonctionnement et donc pathologie quand les mécanismes de la tristesse ne réalisent pas ce à quoi ils sont destinés. Ce qui implique que ce n’est qu’à la lumière d’un exposé, même provisoire et incomplet, de la manière dont fonctionnent les mécanismes de réponse à la perte – et donc de leur activité normale – qu’on peut être fondé à qualifier certaines réactions de pathologiques.
Comme pour tous les traits humains, il y a beaucoup de variations entre les individus quant à la sensibilité avec laquelle ils répondent à la perte par la tristesse. La culture influence de multiples façons les modes de réaction et c’est pourquoi ce n’est pas toujours facile d’évaluer si une réponse relève de la variabilité naturelle. Néanmoins, dans les conditions normales, presque tous les humains ont la capacité de développer une tristesse normale comme réponse biologiquement adaptée à la perte d’objet. En principe, sur la base de cette capacité biologique, on peut classer les cas comme des exemples clairs de normalité ou de pathologie.
Une remarque importante: en raison de nos connaissances encore très incomplètes sur le fonctionnement mental, notre compréhension des mécanismes naturels des émotions, y compris de la tristesse, demeure assez spéculative et susceptible d’être révisée. Cependant, quelques principes fondamentaux, au moins sous une forme provisoire, semblent tout à fait plausibles et sont suffisants pour un examen critique de la validité des critères du trouble dépressif. Ces principes nous autorisent à distinguer les cas qui relèvent de la tristesse normale de ceux qui relèvent d’un trouble dépressif, même si les frontières ne sont pas toujours très nettes, même s’il faut reconnaître qu’il existe de nombreux cas ambigus, flous. Dans le chapitre 1, nous étudierons trois caractéristiques essentielles du sentiment de perte non pathologique: il survient en raison de déclencheurs environnementaux spécifiques; il est relativement proportionnel en intensité à ce qui l’a provoqué; il prend fin lorsque cesse la situation déclenchante ou s’apaise graduellement quand les mécanismes naturels d’adaptation permettent à l’individu de supporter les circonstances nouvelles et de revenir à l’équilibre psychologique et social.
Des questions importantes se posent encore parce que nous ne connaissons pas assez précisément les mécanismes internes qui produisent les réponses à la perte, ce qu’ils sont vraiment. Puisque ces mécanismes sont inférés alors que nous ne connaissons pas leur véritable nature, comment affirmer que les réponses normales à la perte font réellement partie de notre héritage biologique? Et, sans connaître ces mécanismes, comment décider de ce qui est normal et de ce qui ne l’est pas?
Bien qu’une telle distinction ne puisse être établie avec précision, l’histoire de la médecine et de la biologie montre de fait que les scientifiques ont toujours fait des inférences sur le fonctionnement normal et anormal à partir de données circonstancielles, sans rien connaître des mécanismes sous-jacents. Hippocrate par exemple savait que la cécité ou la paralysie sont des pathologies et qu’il existe des mécanismes destinés à permettre aux humains de voir avec leurs yeux et de se mouvoir grâce à leurs muscles, mais il ne savait pas grand-chose sur ces mécanismes eux-mêmes et donc bien peu des causes spécifiques des cas de cécité ou de paralysie (autre que les blessures importantes). Il a fallu des milliers d’années pour expliquer ces mécanismes, mais pendant tout ce temps on a universellement su, sur la base des observations, que voir et se mouvoir font partie de l’équipement humain. Il n’en va pas autrement en principe des capacités mentales humaines qui font partie de notre nature biologique, comme les émotions de base.
Notre ignorance sur les mécanismes de la réponse à la perte peut poser un autre problème: on ne peut pas avec certitude établir la fonction de cette réponse et donc savoir ce qui est normal et anormal. C’est que contrairement aux fonctions de l’œil ou des muscles, celles de la réponse à la perte ne sont pas visibles et sont donc l’objet de désaccords47. Heureusement, on peut bien souvent, à partir d’observations disponibles, inférer grossièrement les réponses normales d’un mécanisme, même si l’on ignore les motifs de ces réponses: par exemple, tout le monde s’accorde à dire que le sommeil est une réponse adaptée, et que certains types de sommeil sont normaux et d’autres non, mais il n’y a pas de véritable consensus scientifique à propos des fonctions qui expliquent pourquoi nous dormons. Sans une bonne compréhension de la fonction des réponses à la perte, nous devons quand même procéder à des inférences, certes hypothétiques mais que nous croyons plausibles.
En parlant de trouble dépressif, nous entendons donc une tristesse causée par un dysfonctionnement préjudiciable (DP) des mécanismes de réponse à la perte48. Selon la définition du DP, un ensemble de symptômes indique un trouble mental si et seulement s’il satisfait à deux critères. Le premier est le dysfonctionnement: quelque chose a mal tourné dans la capacité d’un mécanisme interne de réaliser l’une des fonctions pour lesquelles ce mécanisme a été biologiquement sélectionné. Le second est que ce dysfonctionnement doit être préjudiciable. Il est bien évident que les valeurs culturelles jouent un rôle fondamental dans la définition des dysfonctionnements qu’il faut considérer comme préjudiciables. En somme, il y a trouble mental lorsque l’échec des mécanismes internes d’un individu à remplir la fonction que leur a assignée la sélection naturelle porte préjudice au bien être de cet individu, tel qu’il est défini par les valeurs et les significations sociales.
L’analyse en termes de DP ne prétend pas établir une frontière conceptuelle précise entre les concepts de normalité et de pathologie parce que ces concepts, comme bien d’autres, n’ont pas en eux-mêmes des limites précises et sont en partie indéterminés, ambigus, embrouillés, vagues, ce qui rend bien des cas indécidables. Malgré cette complexité, le concept de dysfonctionnement préjudiciable est utile et cohérent parce qu’il permet de faire la distinction entre un ensemble de cas clairement normaux et un ensemble de cas clairement pathologiques. De la même façon, il y a des différences réelles entre le bleu et le vert, les enfants et les adultes, la vie et la mort, même s’il n’y a pas de frontière nette entre les deux. Nous affirmons que les critères diagnostiques actuels du trouble dépressif ne permettent pas vraiment de faire la différence entre les cas clairs de tristesse normale et les cas clairement pathologiques.
Les mécanismes façonnés par la sélection naturelle pour produire les réponses à la perte peuvent ne pas parvenir à remplir leurs fonctions dans les circonstances habituelles, et cela de diverses manières49. Ces réponses peuvent survenir dans des situations pour lesquelles elles ne sont pas faites, elles peuvent être disproportionnées en intensité et en durée aux circonstances qui les déclenchent, et dans les cas extrêmes, elles peuvent apparaître spontanément, sans aucune raison. La dépression de William Styron, par exemple, qui apparaît après la remise d’une distinction prestigieuse, ou celle de David Karp, qui survient après un succès professionnel, montrent que les mécanismes de réponse à la perte ont eu des déficiences. Les dysfonctionnements de ces mécanismes peuvent également entraîner des distorsions de la perception de soi, du monde, et de l’avenir qui déclenchent une tristesse inadaptée50. Ces distorsions peuvent entraîner de manière inappropriée des mécanismes qui exagèrent la signification de pertes mineures au-delà de la moyenne culturellement normale. Quelqu’un qui devient profondément déprimé après la perte d’un poisson rouge ou après un affront mineur, par exemple, témoigne d’une sensibilité exagérée, de mécanismes de réponse à la perte disproportionnés, à moins que des circonstances spéciales ne donnent à des choses de ce genre plus d’importance que d’habitude.
Ce n’est donc pas seulement l’apparition d’une dépression en l’absence d’une cause appropriée qui permet de définir le dysfonctionnement. Les troubles peuvent survenir après une réponse à la perte de niveau normal, mais qui peut devenir ensuite déconnectée des circonstances et persister avec une intensité hors de proportion longtemps après que soient terminées les situations qui l’ont initialement provoquée. Ou bien, chez des individus sensibles, l’expérience d’une perte peut quelquefois produire des vulnérabilités biochimiques et anatomiques qui rendent de plus en plus probables des épisodes dépressifs avec des déclencheurs de moins en moins puissants51. Même si elles commencent par des réactions normales, les émotions qui se détachent d’une période, d’un endroit ou de circonstances particulières indiquent un dysfonctionnement des mécanismes de réponse à la perte.
Enfin, le dysfonctionnement de ces mécanismes provoque quelquefois des symptômes qui sont si massifs qu’ils témoignent en eux-mêmes d’un dysfonctionnement. Les réactions dépressives qui provoquent une immobilisation complète prolongée ou la perte de contact avec la réalité, comme des hallucinations ou des délires, ne relèvent pas d’un fonctionnement normal et ont toujours été identifiées comme pathologiques. De telles réactions inappropriées et excessives sont comme des fièvres dangereusement élevées ou des vomissements irrépressibles qui caractérisent l’échec des réponses normalement adaptatives.
Il faut remarquer que la distinction que nous faisons entre la tristesse due à un dysfonctionnement interne et la tristesse qui est une réaction biologiquement adaptée à des événements externes est à bien des égards différente de la distinction psychiatrique traditionnelle entre dépression endogène (spontanément déclenchée par des mécanismes internes, sans déclencheur extérieur) et la dépression réactionnelle (déclenchée par un événement extérieur)52. Par définition, les premières surviennent en absence de perte réelle et sont donc presque toujours dues à des dysfonctionnements internes; les secondes au contraire sont relatives à des événements environnementaux et sont donc des réactions normales.
Cependant, toutes les dépressions réactionnelles ne sont pas normales: des événements externes peuvent affecter si profondément des individus qu’ils déclenchent des dysfonctionnements internes. Les traumas provoqués lorsqu’on perd soudainement un être cher par exemple, qu’on est expulsé ou qu’on est victime d’un crime violent peuvent briser les mécanismes de réponse et des troubles douloureux peuvent alors apparaître53. Comme nous l’avons souligné, les réactions émotionnelles peuvent être si disproportionnées par rapport à ce qui les déclenche qu’elles évoquent un dysfonctionnement; ou bien les symptômes peuvent évoluer selon leur propre dynamique et ne pas disparaître lorsque prennent fin les problèmes. Au sein des dépressions réactionnelles à la perte, certaines sont des troubles et d’autres non. C’est la présence d’un dysfonctionnement interne, et non la cause de ce dysfonctionnement (qui peut être endogène ou réactionnelle) qui définit le trouble dépressif. La distinction traditionnelle entre dépression endogène et dépression réactionnelle et celle que nous faisons entre dysfonctionnement interne et réponse façonnée par la sélection naturelle ne se recouvrent donc pas totalement.
Un dernier point, à propos d’une éventuelle confusion: recourir à l’approche évolutionniste pour distinguer un état normal d’un état pathologique ne signifie pas que tous les troubles dépressifs ont des causes physiologiques ou qu’il y a toujours une pathologie du cerveau quand il y a dépression. Même si les causes physiologiques produisent des troubles pathologiques, les facteurs psychologiques ou sociaux peuvent aussi entraîner un dysfonctionnement. La sélection naturelle porte sur des mécanismes mentaux variés (les croyances, les désirs, les émotions, les perceptions) qui fonctionnent via les significations que les êtres humains attribuent aux événements réels, et les descriptions physiologiques peuvent très bien ne pas avoir accès à la manière d’opérer de ces significations. Il peut exister des troubles mentaux qu’on ne peut pas décrire comme des mauvais fonctionnements de la machinerie physiologique mais comme des mauvais fonctionnements des significations au niveau mental. Ce n’est pas aussi mystérieux qu’on peut le croire: le software d’un ordinateur peut dysfonctionner avec un hardware intact. Les processus d’attribution de significations que la science cognitive contemporaine assimile au «software» du cerveau peuvent peut-être marcher de travers sans aucun mauvais fonctionnement physiologique. Notre discussion est indifférente à ces questions d’étiologie, même si nous croyons généralement qu’il existe un ensemble de causes biologiques, psychologiques et sociales tant pour la tristesse normale que pour le trouble dépressif; c’est à la recherche qui porte sur les différentes théories des causes de la dépression de trancher ces questions.
L’un des grands avantages de notre critique, fondée sur la notion de dysfonctionnement préjudiciable, est qu’elle reconnaît l’existence des troubles dépressifs et apporte des éléments sérieux pour perfectionner les critères diagnostiques en psychiatrie. Il existe d’autres critiques que la nôtre, plus radicales, qui nient tout fondement à tout diagnostic et ne laissent aucune place à un dialogue constructif; pour le psychiatre Thomas Szasz, par exemple, il n’existe aucun trouble mental parce que les pathologies impliquent des lésions organiques; la «théorie de l’étiquetage»54 du sociologue Thomas Scheff réduit le diagnostic à une forme de contrôle social; la thèse behavioriste considère que tout comportement résulte d’un processus d’apprentissage et qu’il n’existe donc aucun trouble mental; des anthropologues soutiennent que les distinctions entre fonctionnement normal et pathologique sont purement culturelles et donc arbitraires et nient qu’on puisse faire un diagnostic conceptuellement cohérent distinguant le trouble dépressif de la tristesse intense normale55. Tous sous-estiment donc les problèmes réels et spécifiques que posent les troubles dépressifs et ne se donnent pas les moyens de critiquer de manière efficace les définitions psychiatriques trop larges du trouble.
L’INTÉRÊT D’UNE DISTINCTION ENTRE TRISTESSE NORMALE ET TROUBLE DÉPRESSIF
Si les critères du DSM sont imparfaits parce qu’ils autorisent un nombre exagéré de diagnostics de dépression, pourquoi est-il si important de les corriger? Quels bénéfices peut-on en tirer?
• La pathologisation des états normaux peut être préjudiciable et il vaut mieux l’éviter. Non seulement les patients peuvent être invités à se considérer à tort comme malades et à entreprendre un traitement non nécessaire, mais la réponse à l’état normal et à l’état pathologique n’est pas la même. Le réseau social répond d’habitude par un soutien moral et par la compassion à la tristesse normale qui apparaît après des événements traumatisants56. Au contraire, les dépressions pathologiques déclenchent une certaine aversion, une stigmatisation, un rejet et en fait une absence de soutien social57. Exposer ceux qui ressentent une tristesse normale au préjudice social que subissent ceux qui ont une maladie mentale ne sert en rien à combattre ce préjudice. Il reste cependant vrai que pour ceux qui souffrent d’une vraie dépression, les désavantages de la stigmatisation doivent être contrebalancés par les soulagements que peut leur apporter, en matière d’accès à des services, le diagnostic de leur état.
• La distinction entre normal et pathologique peut améliorer la valeur du pronostic: prédire l’évolution du trouble constitue le but essentiel du diagnostic, et le pronostic n’est pas le même pour ceux dont les symptômes relèvent d’une tristesse normale et pour ceux qui sont atteints d’un trouble pathologique58: les premiers sont susceptibles de décroître avec le temps sans qu’on intervienne, de disparaître en cas de changement brusque des circonstances et d’être sensibles au soutien social habituel; les seconds, qui relèvent de dysfonctionnements internes au contraire, risquent d’être chroniques et récurrents et de persister indépendamment des circonstances de l’existence59. La distinction entre ces deux types de cas peut donc permettre de meilleurs pronostics.
• Un diagnostic correct débouche sur un traitement approprié: même si des médicaments ou une thérapie peuvent permettre de mieux supporter le chagrin qui survient dans le cas normal comme dans le cas pathologique, ils ne sont pas nécessaires en cas de tristesse normale, qui ne suppose aucun dysfonctionnement interne. Dans certains cas comme le deuil, il peut même être pénalisant de traiter la tristesse normale comme maladive parce que cela peut exagérer et prolonger les symptômes60. Au contraire, en cas de pathologie dépressive, il faut une pharmacothérapie, une thérapie cognitive ou une psychothérapie ou une combinaison de l’ensemble pour venir à bout du dysfonctionnement. Une distinction conceptuelle correcte entre dysfonctionnement et normalité peut permettre de déterminer quelle réponse sera la plus efficace devant des états qui se ressemblent sur le plan symptomatique mais sont en fait différents.
• La séparation entre tristesse normale et dépression peut permettre d’identifier le lien entre la tristesse et des conditions sociales difficiles et donc de savoir comment intervenir socialement: on a aujourd’hui tendance en psychiatrie à considérer que la dépression est une cause majeure de beaucoup de problèmes sociaux, comme la dépendance à l’égard du système d’aide sociale, la toxicomanie, la pauvreté61. La première chose à faire serait de traiter les malades puis de les aider à surmonter leurs autres problèmes. La tristesse normale est cependant plus souvent l’effet que la cause de problèmes sociaux; reconnaître l’impact de ces problèmes sur les émotions humaines normales ferait peut-être comprendre qu’on pourrait commencer par résoudre ces problèmes.
• Cette séparation pourrait permettre une estimation épidémiologique plus précise de la prévalence de la dépression et du coût de son traitement: ne pas faire cette distinction entraîne une surestimation du nombre de patients atteints de troubles mentaux, et induit les décideurs à mettre en place une mauvaise politique de santé publique. Les chiffres de la prévalence incluent tous ceux qui souffrent de symptômes suffisamment intenses, qu’ils soient ou non pathologiques62. L’attention des politiques et des professionnels de la santé est donc dirigée vers des états qui peuvent ne pas nécessiter l’attention des spécialistes et non vers ceux qui ont le plus besoin d’aide. Et ce mélange des cas de tristesse normale et de vraies dépressions, qui induit une surestimation des coûts économiques de la dépression63, peut avoir des conséquences politiques négatives puisque cela fait hésiter les élus, les assurances, les décideurs en général à apporter une réponse économique suffisante à cette maladie. Même si aucune personne qui souffre ne devrait se voir refuser un accès aux soins, la séparation des cas normaux des cas pathologiques appelle les professionnels de la santé mentale à se centrer sur les vrais troubles mentaux et à faire meilleur usage des ressources allouées à la santé mentale.
• La distinction entre les deux types de tristesse devrait permettre de mieux estimer les besoins de soins mentaux non satisfaits: parce que les études sur la population ne font pas cette distinction, parce que ceux qui ne sont pas vraiment malades sont moins enclins à demander un traitement, on a l’impression que seule une minorité des vrais dépressifs sont traités. Et c’est ce qui a mené les politiques sociales à s’intéresser à ce nombre supposé très important de besoins de traitement non satisfaits64: on cherche à détecter la dépression sur des échantillons très larges de population, y compris donc chez ceux qui n’ont jamais demandé de traitement. Avec ce type d’étude, on trouve probablement plus de cas de tristesse normale que de trouble dépressif mais on traite ces deux états comme s’ils étaient des troubles. La réduction de ces diagnostics inexacts pourrait diminuer les traitements médicamenteux non nécessaires et éventuellement nocifs.
• Établir une distinction nette entre tristesse normale et pathologique permettrait aux chercheurs de s’arrêter à des échantillons quireflètent avec plus d’exactitude les vrais troubles mentaux: la recherche sur les causes de la dépression et sur les meilleures façons de traiter la tristesse normale et le trouble dépressif exige que les groupes étudiés soient à peu près homogènes, de manière à ce que les résultats puissent être compris correctement et généralisés. Or les causes des symptômes de dépression qui résultent d’un dysfonctionnement sont généralement différentes de celles de la tristesse normale; c’est donc le domaine entier de la recherche sur la dépression qui demeure problématique tant qu’on ne les distingue pas correctement.
• Cette distinction permettrait d’éviter de médicaliser la tristesse normale et donc de maintenir la crédibilité conceptuelle de la psychiatrie:à côté de tous les autres avantages, la crédibilité de la psychiatrie et de ses diagnostics dépend à long terme de sa capacité à faire cette distinction en ne désignant comme trouble que ce qui constitue un état réellement psychiatrique. L’incapacité de distinguer la tristesse naturelle des dysfonctionnements internes mène à interpréter à tort comme trouble mental un aspect fondamental et universel de la nature humaine et donc à pathologiser par erreur un nombre considérable de comportements humains, ce qui met en cause la crédibilité de la psychiatrie.
Mais comprendre comment la psychiatrie a brouillé une distinction capitale et comment elle a classé à tort la tristesse profonde comme maladie, c’est aussi utile pour chacun d’entre nous. Chaque fois que quelqu’un entre dans un cabinet médical, chaque fois qu’un enfant à l’école passe des tests de prévention, la confusion conceptuelle que nous dénonçons pourrait conduire à un diagnostic et à un traitement incorrects. Pour bénéficier correctement des traitements médicaux, les patients informés devraient d’abord comprendre comment les professionnels parviennent aux diagnostics qu’on leur livre, et savoir quelles questions poser sur les problèmes que ces diagnostics peuvent entraîner.
On doit pour finir se souvenir que ce qu’on dit de l’état normal ou pathologique de la tristesse de quelqu’un est d’une importance pratique parce que les diagnostics de pathologie mentale ont de lourdes conséquences. Ils peuvent par exemple rendre plus difficile la souscription d’assurance-vie ou d’assurance-maladie ou augmenter le prix de ces assurances; ils peuvent être utilisés à charge dans des procédures de divorce pour la garde des enfants; ils excluent les gens des essais cliniques de médicaments nouveaux pour des maladies graves comme le cancer. Cette confusion entre la dépression et la tristesse normale n’est donc pas un problème secondaire; on a tendance à accorder du crédit à ces diagnostics, or ils jouent un rôle décisif dans bien des situations de la vie.
INCONVÉNIENTS DE CETTE DISTINCTION
On pourrait nous opposer que faire la distinction entre tristesse normale et pathologique, quels qu’en soient les mérites intellectuels, peut pour diverses raisons présenter des dangers. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les critiques potentielles, mais considérons-en quelques-unes.
Négligeons-nous d’une manière ou d’une autre la souffrance de ceux qu’afflige une tristesse normale? En qualifiant certaines réponses de «normales», nous ne voulons nullement minimiser, encore moins mépriser, la profondeur de la douleur vécue: la souffrance extrême de la tristesse normale atteint souvent celle de la dépression. Mais tout comme on tient à faire la distinction entre la douleur d’un accouchement ou d’une jambe cassée (qu’il faut traiter) et une douleur équivalente relevant d’un trouble de la sensation douloureuse, dans lequel la douleur ne constitue pas une réponse normale à une lésion physique (ce qui a des implications décisives pour le traitement), ces formes intenses de tristesse doivent être distinguées pour être comprises et traitées au mieux.