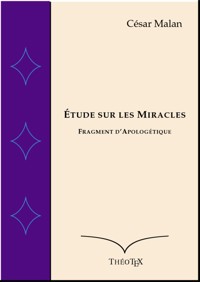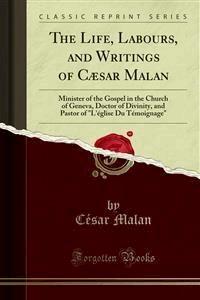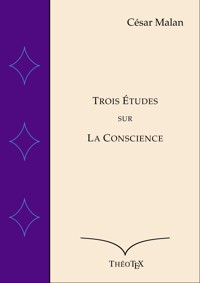
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
César Malan fils (1821-1899), a laissé dans la mémoire protestante une trace moins remarquée que celle de César Malan père (1787-1864), l'homme du Réveil genevois, l'auteur des Cantiques de Sion ; et cependant son influence théologique a été profonde sur les hommes qui l'ont fréquenté, sur Gaston Frommel en particulier. Élève d'Alexandre Vinet, il fut d'abord pasteur à Hanau, à Gênes, puis revint en 1857 à Genève, sa ville natale. Sa santé défaillante le confina dès lors dans une solitude où son esprit introspectif et méditatif put s'exercer sur le problème qui lui tenait à coeur. César Malan a essayé de découvrir dans l'expérience intérieure la confirmation de ce que le dogme biblique révèle, de manière extérieure, sur notre nature. C'est par l'examen de la conscience morale qu'il retrouve ce que déclare Paul dans l'épître aux Romains, à savoir l'existence de deux 'moi', l'un intérieur, gouverné par la conscience et paradoxalement inconscient, l'autre extérieur, siège de la volonté. A la lecture de ces trois études, on ne peut s'empêcher de penser que César Malan fils a été comme une sorte de précurseur chrétien de Freud ; ou encore qu'il a pu dépasser le William Wilson d'Edgar Poe, en éclairant le mystère de la conscience à la lumière de la révélation biblique. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1886.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322483990
Auteur César Malan. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Deux raisons nous engagent à faire de la conscience l'objet d'une étude attentive. La première est l'importance essentielle du fait lui-même au point de vue religieux. L'autre est une raison spéciale qui, surtout à cette heure, rend cette étude nécessaire pour nous protestants de langue française.
L'importance religieuse du fait de conscience ne saurait être mise en doute par quiconque a le sentiment de la faiblesse essentielle de l'homme. Convenir de cette faiblesse, c'est en effet avoir reconnu qu'il faut à l'homme non seulement une lumière pour son ignorance, mais encore une autorité pour sa liberté elle-même. Or cette autorité, qui ne saurait être perçue que par la conscience, est nécessairement un fait religieux, puisque c'est Dieu qui seul peut imposer une loi à notre liberté.
Il est vrai que cette question de l'autorité concerne aussi bien la vie sociale de l'homme que sa vie personnelle, et que c'est même du premier de ces deux points de vue qu'on se préoccupe le plus généralement. Ce n'est cependant pas sous ce rapport-là que nous voulons l'étudier ici. Il semble, d'ailleurs, que la question de l'autorité dans le fait social — la question des gouvernements et des constitutions des peuples — soit destinée à se poser toujours de nouveau sans jamais arriver à une solution définitive. Le fait est que la vie politique des peuples embrasse nécessairement une succession de générations, qui ne se transmettent que très imparfaitement le résultat d'une expérience toujours inachevée par chacune d'elles. Aussi bien, par dessus cette vie des nations subsiste celle de l'humanité, dont, en dehors des lumières spéciales de la foi, l'évolution elle-même demeure encore pour nous une énigme.
Quant à l'autorité qui a pour objet la liberté personnelle, on peut entendre par là deux choses entièrement différentes, suivant qu'il s'agirait d'une autorité dont l'homme aurait lui-même revêtu tel ou tel fait extérieur à sa personne, — ou qu'il serait question d'une autorité directement imposée à sa liberté personnelle, indépendamment de sa volonté propre, et parfois même en opposition à la direction foncière de cette volonté.
Dans le premier cas, nous avons devant nous, pour nous en tenir ici au point de vue religieux, l'autorité dont on aurait revêtu tel ou tel fait traditionnel ; comme par exemple le dogme, les cérémonies, ou même les officiers, d'une Eglise historique, ou bien encore tels écrits généralement regardés comme sacrés.
Quant à l'autorité imposée au sentiment que chacun possède de sa liberté, elle ne peut évidemment être rapportée qu'à une action directe de l'Être qui, parce qu'il a tout d'abord créé cette liberté, parce qu'il en surveille et qu'il en jugera l'usage, en est regardé à juste titre comme le maître, et qui, par là même, demeure le Seigneur de celui qui possède cette liberté.
La première de ces deux autorités, on la décrit, on en formule, et on en fixe soi-même l'expression. Attachée à un fait qui existe indépendamment de celui qui s'y soumet, cette autorité est avant tout pour cet homme un objet de connaissance, ou de science.
Il n'en est pas de même de l'autorité qu'on peut appeler « intérieure. » On ne commence pas par la voir placée devant soi. C'est elle qui vient nous atteindre, en nous imposant l'expérience de sa présence en nous. Nous en avons donc conscience, comme d'une autorité déjà exercée au dedans de nous, et cela au moyen d'une action dont nous nous sentons les objets.
On comprendra, d'après ces quelques mots, l'importance spéciale que doit revêtir à nos yeux l'organe à l'aide duquel nous percevons une semblable expérience. Cet organe, — nous venons de le nommer, — c'est cette conscience, grâce à laquelle nous nous apercevons de ce qui se passe au dedans de nous. Le fait est que de l'action de cette conscience dépendra nécessairement pour nous, et la connaissance de l'action vivante de Dieu en nous, et, partant de là, l'expérience aussi bien de son caractère que de ses intentions à notre égard.
On comprendra de plus, que nous aurons ainsi devant nous deux faits religieux essentiellement différents l'un de l'autre, suivant que nous mettrons à la base de notre religion une autorité extérieure ou historique, ou que cette religion reposera avant tout sur l'autorité directement ressentie d'une expérience intérieure, c'est-à-dire d'un fait de conscience. Dans le premier cas, nous l'avons dit, le fait religieux est tout d'abord un fait historique, placé devant nous au même titre que tout autre fait semblable. Nous l'apprécions ; nous l'analysons ; nous le formulons plus ou moins exactement. Mais en lui-même il demeure ce qu'il est. Nous ne saurions avoir, avec un fait semblable, un rapport vivant. Nous ne pouvons, le cas échéant, que le respecter de loin comme on respecte un fait sacré. Notre seul rapport avec ce « fait religieux » sera un rapport de connaissance, ou de science.
Un fait semblable est cette « religion de nos pères, » — cette religion traditionnelle des honnêtes gens, — d'autant plus respectée de ceux qui s'en contentent, qu'ils s'abstiennent soigneusement d'en faire l'objet d'un examen attentif et consciencieux. Cette espèce de religion, qui est toujours tout d'abord celle de la grande majorité des hommes, ne repose, dans le fond, que sur l'autorité dont l'a entourée l'adorateur lui-même. C'est bien lui, en effet, qui, grâce à une acceptation le plus souvent passive, revêt des faits qui lui sont parvenus par la tradition, d'un respect dont tous les motifs sont en lui.
La seconde de ces autorités est tout autre chose. Existant indépendamment de nous, elle s'impose elle-même à nous dans un fait intérieur qui domine la vie même de notre âme. Aussi bien tout dépendra-t-il, dès lors, pour nos intérêts suprêmes et éternels, de la soumission que nous aurions ou accordée ou refusée, à ce qui se fait sentir à nous comme une action dont nous ne sommes ainsi que les objets.
Tout ce que demandera l'autorité extérieure, c'est donc un regard tant soit peu attentif, et une mémoire qui ne soit pas trop infidèle. L'autorité intérieure a de tout autres exigences. Elle attend de nous des vertus morales de premier ordre. Faisant appel à l'obéissance du cœur lui-même, elle ne sera conservée entière que grâce à la fidélité des affections les plus profondes de notre être. Ce n'est plus uniquement pour nous un fait. C'est une action vivante qui, nous ayant nous pour objets, exige à son tour de notre part un acte personnel, un acte qui lui aussi devra être vivant, et par conséquent soutenu et progressif, au dedans de nous. Cette autorité intérieure ne sera donc regardée par nous ni comme l'ornement, ni comme le joug, de notre existence. Elle sera pour nous, au sein de notre existence passagère actuelle, le point de départ de notre vie éternelle elle-même. Elle sera le début, ou l'inauguration, du rapport de notre moi lui-même avec le Seigneur de notre vie. Telle demeure, à nos yeux, l'importance religieuse du fait de conscience.
Quant à l'importance spéciale de ce même fait de conscience pour nous protestants, elle ressort des circonstances qui sont actuellement les nôtres.
S'il est un fait qui donne à penser dans l'état actuel du Protestantisme, et tout spécialement dans la position présente de nos Eglises réformées, c'est certainement, — surtout depuis les attaques dirigées de nos jours contre l'autorité des Ecritures, — l'ébranlement de ce qui jusqu'ici avait constitué pour ces Eglises l'autorité suprême en matière de foi.
Ce fait est d'autant plus grave que, dans cette portion du Protestantisme qui nous concerne comme réformés de langue française, l'autorité des Ecritures jouait jusque-là un rôle tel, qu'elle y était hautement maintenue même par le parti hétérodoxe. Aussi bien ces Eglises n'en possédaient-elles aucune autre, depuis qu'elles avaient mis de côté leurs confessions de foi et leurs symboles officiels.
Jusqu'à celle heure, les croyants se sont contentés chez nous d'opposer à cette négation, une protestation souvent aussi éloquente que prononcée, mais qu'ils ne se sont pas appliqués à justifier.
De là vient aussi que nous voyons, chaque jour plus, nos jeunes hommes commencer à hésiter à cet égard ; et plusieurs d'eux courent-ils même le risque de devenir, pour cette question de l'autorité de l'Ecriture, les victimes de tels ou tels représentants aussi superficiels que bruyants « d'une science faussement ainsi nommée. »
Evidemment, de semblables faits nous forcent à nous demander comment nous, qui croyons aux Ecritures, devons nous y prendre pour reconquérir, au sein de nos Eglises, la seule autorité sur laquelle puisse reposer le Christianisme traditionnel dont on y fait encore profession.
On a essayé dans ce but, sinon d'affirmer de nouveau cette doctrine de « l'inspiration littérale, » dont la proclamation imprudente avait été dans le temps l'occasion des attaques dirigées contre l'autorité religieuse de l'Ecriture, — du moins d'en formuler une autre plus acceptable. On a aussi voulu, en dehors des auditoires de théologie et devant le grand public religieux, se transporter au point de vue d'une critique plus ou moins étrangère à la foi, — oubliant ainsi que quelles que fussent les victoires qu'on estimait avoir remportées sur tel ou tel point spécial, on avait dû commencer par délaisser le terrain de l'expérience de la foi, et l'autorité du témoignage dont cette expérience demeurera toujours la preuve pour les fidèles. — Aussi bien ces efforts sont-ils demeurés inutiles.
Ce qui le prouve, c'est qu'à cette heure l'honneur rendu aux Ecritures s'est comme réfugié dans le sanctuaire des familles pieuses. Il a, en particulier, déserté entièrement nos écoles. On dirait même parfois qu'on y veuille persuader à nos enfants qu'il faille, aux jours où nous vivons, avant d'être à même de profiter des résultats de la science, avoir d'abord mis de côté tout respect pour la Bible de leurs pères ; ou du moins, si l'on n'a pas devant soi les fils de pères croyants, qu'il faille avoir entièrement oublié cette Parole qui, jusqu'ici, avait toujours été, pour tout esprit sérieux, le témoignage vénéré du Dieu de la conscience.
A nos yeux, une science qui ne fait pas cas de la conscience est jugée par cela seul. Avoir rattaché la cause de l'Ecriture à celle de la conscience, équivaudra donc pour nous à l'avoir recommandée à la sérieuse attention de toute science digne de ce nom.
Pour cela, cependant, il faudra d'abord être parvenu à faire reposer l'autorité de l'Ecriture, non pas sur une tradition qui, à mieux prendre, a besoin elle aussi d'une sanction supérieure ; encore moins sur telle « explication » de mystères, dont on ne peut entrevoir la vérité que grâce à une expérience spéciale, — mais bien sur un fait d'expérience universelle, sur un fait dont on ne saurait nier la réalité, et que chacun porte en soi-même. Ce fait, c'est précisément cette obligation de la volonté, dont le sentiment, ou la perception, dans la conscience morale, constitue ce qui caractérise l'être humain en face de l'animal.
Nous sommes persuadés que l'étude du fait de conscience livrera seule la réponse à la question que voici : « Pour quelle raison et de quel droit, la Bible nous a-t-elle été transmise comme la Parole, ou le témoignage, du salut de Dieu, — par des hommes dont la valeur, la piété, et le dévouement soutenu, demeurent la gloire de notre passé ? Qu'est-ce qui, déjà avant eux, avait porté leurs ancêtres à laisser là, au prix des plus douloureux sacrifices, toute autre autorité religieuse extérieure, pour s'en tenir toujours plus résolument à la seule autorité de l'Ecriture ? »
Tels sont les sentiments qui m'amenèrent, il y a quelques années, à faire une étude spéciale de ce sujet de la conscience, sur lequel, dans les ouvrages à ma portée, je ne trouvais rien qui me satisfit pleinementa.
Soumise d'abord au jugement de quelques amis, cette étude parut alors dans une Revue. M. E. Naville jugea cette publication assez digne d'intérêt pour en faire, au point de vue spécial de la philosophie, l'objet d'une appréciation qu'il m'a autorisé à publier, et qui m'a fait espérée que mon petit travail pourrait être utile à notre jeunesse studieuse.
S'il était accueilli favorablement par ceux que j'ai eus en vue en l'écrivant, je pourrai peut-être le faire suivre d'études analogues sur la foi, sur l'objet de la foi, ou sur l'Eglise visible.
Messieurs !
On entend parfois opposer, dans la recherche de la vérité, ce qu'on appelle une expérience positive, à ce qui aurait été présenté comme une expérience de conscience.
A-t-on réellement le droit de statuer une semblable opposition ?
Et d'abord, qu'est-ce que cette expérience positive, dont on met ainsi la réalité en face de ce qui ne serait, dit-on, qu'une expérience de conscience ?
Une expérience positive, — c'est ainsi qu'on la présente, — est celle que l'on aurait eue d'un fait « objectif ; » c'est-à-dire d'un fait à l'égard duquel on aura le droit d'affirmer, qu'il subsiste indépendamment de l'expérience dont il aurait été l'occasion.
Rien de plus légitime, sans doute, que de revendiquer ce caractère pour tout objet d'expérience. D'où vient cependant que, dès qu'on l'attribue à l'objet d'une expérience de conscience, il est des esprits qui protestent, on du moins qui hésitent à se prononcer clairement à cet égard ?
Ce n'est pas que l'on ne regarde l'expérience de conscience comme un fait de première importance.
Toute doctrine philosophique, en effet, je dis plus ! toute croyance religieuse, repose en fin de compte sur une expérience semblable. Sans doute, c'est de la négation de ce que nous disons là que l'école positiviste a fait son drapeau ; comme c'est l'hésitation sur ce point spécial qui s'oppose encore, ici et là, à une franche admission du « surnaturel. »
Il n'en est pas moins vrai que l'expérience à laquelle seule on donne le nom d'expérience positive, — que l'expérience par le moyen des sens, — est elle-même si loin de pouvoir être mise en contraste avec le fait de conscience, qu'elle implique bien plutôt elle-même nécessairement un fait semblable. Et ce qui est tout aussi vrai, c'est qu'on ne saurait vouloir affirmer que toute expérience, ou impression, de conscience, n'ait pas nécessairement impliqué un fait objectif à celui chez qui cette expérience aurait eu lieu.
Il serait superflu de nous arrêter à démontrer la première de ces assertions. Personne ne niera que l'impression matérielle par le moyen des sens n'exige, pour parvenir jusqu'à notre pensée réfléchie, un acte de la conscience que nous avons de nous-mêmes. Nous convenons tous que la beauté d'une fleur, ou que les charmes d'une mélodie, demeureront pour nous comme s'ils n'étaient pas, aussi longtemps que « nous n'en aurons pas eu conscience. »
Aussi bien désiré-je m'appliquer surtout ici à exposer les faits qui me semblent établir la seconde de ces assertions, — savoir cette proposition : que toute perception, ou expérience, de conscience, implique nécessairement l'existence d'un fait positif ; et, qui plus est, d'un fait qui, bien que ressortissant au monde intérieur de celui qui fait cette expérience, y demeure objectif à cette expérience ; de telle sorte que tout fait de conscience demeure ce qu'il est, indépendamment et de la perception qu'on en aurait, et de l'idée qu'on arriverait à s'en faire à l'occasion de cette perception. De plus, comme c'est un intérêt moral et religieux qui me porte à aborder avec vous cette étude, j'aurai surtout en vue dans mon analyse, cette activité spéciale de la conscience, à laquelle on a donné le nom de la conscience morale, ou de la conscience de l'obligation morale.
Ma première tâche sera donc de définir le phénomène de vie intérieure auquel on donne ce nom, et d'en revendiquer l'objectivité essentielle.
Je chercherai ensuite à préciser ce qui découle de la définition à laquelle je me serai arrêté, soit à l'égard de la vérité sur l'homme, soit à l'endroit de la doctrine de Dieu.
Enfin, dans une troisième étude, j'examinerai le rapport qui subsiste entre les lumières résultant ainsi du fait de la conscience morale, et celles qui proviennent pour nous soit de la vue de l'univers que nous habitons, soit des faits dont témoignent les Ecritures.
Cherchons d'abord à fixer le sens du mot conscience.
Il semble, à première vue, que qui dit conscience, dit une espèce spéciale de science.
Par science, cependant, on désigne, non pas, comme par le nom de conscience, ce qui serait en nous une impression, mais plutôt ce qui résulte pour nous d'une activité réfléchie de la pensée à l'occasion de telles ou telles impressions. Un fait de science sera donc toujours ou l'ensemble, ou telle ou telle portion spéciale, des images intelligibles que notre esprit aurait formulées comme répondant chez nous soit à des impressions, soit à des réalités positives. C'est ainsi que notre science sera, à chaque fois, le résultat pour nous d'une activité volontaire, et facultative, de notre pensée réfléchie.
Ce qu'on appelle un phénomène de conscience ne présente pas ce même caractère. C'est une impression qui nous arrive pour ainsi dire toute faite, en dehors et indépendamment de notre activité. Le fait est que nous ne disposons pas de l'apparition au dedans de nous des impressions de conscience. Elles nous sont imposées directement, et souvent même malgré nous.
Et il y a plus encore. Si la science est ce qui résulte pour notre pensée d'impressions produites par des objets perçus comme subsistant au dehors de nous, l'impression de conscience sera toujours celle d'un fait subsistant au dedans de nous-même. Pour atteindre à la science, nous avons dû commencer par détourner notre vue de ce qui ne serait que nous-même. Pour discerner ce que nous appellerons un fait de conscience, nous devons au contraire fixer notre attention sur ce qui se passe au dedans de notre vie personnelle.
Il est vrai qu'il peut nous arriver de parler soit d'une science de nous-même, soit aussi de la conscience que nous aurions d'un objet situé hors de nous.
Mais ces expressions n'infirment en aucune façon ce que nous venons d'avancer. En effet, lorsque je parle d'une science de l'âme par exemple, je désigne par là, non pas le sentiment spécial que je posséderais de ma propre âme, mais la connaissance que j'ai de l'âme humaine en général, considérée, dans ce cas-là, comme un fait qui subsiste devant moi et indépendamment de moi-même. D'un autre côté, lorsqu'il serait question de la conscience d'un objet situé hors de moi, je désignerais simplement par là une impression qui aurait coïncidé, au dedans de moi-même, avec l'existence extérieure de cet objet. C'est ainsi que quand j'affirme, — sur le témoignage de mes sens, — que mon ami est devant moi, c'est là pour moi un fait de science. Je puis cependant baser la même affirmation sur ce qui ne serait qu'un pressentiment intérieur. Dans ce cas spécial, — si tant est qu'il se présente ! — je me bornerai à dire que j'ai eu conscience de la présence de mon ami.
Sans doute, aussi bien que la science, la conscience constitue en nous un fait de connaissance. Mais, tandis que dans le cas de la conscience, cette connaissance est le résultat d'une impression purement passive, et qui a sa raison d'être au dedans de nous, — lorsqu'il s'agit de science, cette connaissance est le produit direct d'une activité de perception qui porte à chaque fois sur un objet situé hors de nous. Aussi est-ce toujours là le résultat d'un acte facultatif de notre libre volonté.
On ne saurait donc vouloir confondre ces deux faits. En particulier, on ne pourra jamais voir un fait de conscience, dans ce qui n'est qu'un fait de science. Quant à la thèse inverse, — quant à donner le nom d'un fait scientifique à ce que nous devons à la seule perception de notre conscience, — tout dépendra du sens qu'on attacherait alors à ce mot de science. Si l'on s'en tient au sens propre, il est évident, qu'on ne saurait parler de la sorte. Science et conscience demeurent deux choses essentiellement distinctes.
Il se pourrait, cependant, que par ce mot de science on entendit désigner, non pas autant la nature spéciale du fait lui-même, que le caractère de vérité, de justesse, et par conséquent de certitude, qui se rattache à la perception scientifique. Dès lors, en affirmant que les faits de conscience ne sauraient être regardés comme des faits scientifiques, on aurait précisément préjugé la question qui nous occupe à cette heure.
Bornons-nous donc, pour le moment, à reconnaître que, si la conscience est bien une science, pour autant que ce mot implique l'idée de certitude et de vérité, c'est alors la science de nous-même, la science de ce qui se passe au dedans de nous. Dans le fond, c'est bien aussi ce qu'exprime ce mot de conscience, c'est-à-dire de science avec soi C'est la science qui résulte, pour l'être pensant, du fait qu'il se place exclusivement en face de lui-même, qu'il demeure seul avec lui-même.
Après avoir ainsi distingué entre le sens du mot conscience et celui du mot science, appliquons-nous à analyser le phénomène spécial que désigne le premier de ces deux termes.
Pour cela, commençons par nous demander quelle espèce de perception caractérise ce que nous appelons en nous la conscience. Cela fait, nous chercherons à définir quel est, au dedans de nous, l'objet dont cette perception nous transmet l'impression.
Considérée comme une activité de perception, la conscience répond à ce que nous nommons un sens ; ce dernier mot signifiant alors ce qui demeure en nous le lieu, et l'organe, d'une perception.
C'est là, du reste, ce qui ressort du langage lui-même. Ce mot de sens s'emploie, en effet, aussi bien des impressions que nous reportons à ce qui vit en nous, que de celles qui proviennent de l'extérieur, ou que de ce que l'on nomme les sensations. On parlera de notre sens intime, comme on parlera de nos cinq sens.
Il est évident que dans ce cas-ci, l'épithète d'intime se rapporte à l'objet, et non à ce qui ne serait que le lieu spécial de ce sens. L'expression de sens intérieur, par cela même qu'elle n'indiquerait que le lieu, serait insuffisante ; vu que, comme nous l'avons déjà constaté, les impressions qui nous arrivent par le moyen des sens extérieurs, se perçoivent elles aussi en vertu d'une perception intérieure. Le sens intime signifie donc le sens par lequel nous percevons ce qu'il y a en nous d'intime, ou la sphère intérieure de notre être personnel.
Remarquons de plus qu'il n'est jamais question que d'un seul sens intime. Nos rapports avec le monde extérieur étant nécessairement fragmentaires, sont par là même multiples. Aussi avons-nous besoin, en face de ce monde là, de plusieurs « sens. » Mais le monde intérieur » le monde que nous portons au dedans de nous-même, n'a avec nous qu'une seule espèce de rapport, celui qui résulte d'une impression immédiate ou instinctive. Aussi ne parlera-t-on à cet égard-là que d'un seul sens.
Sans doute si, lorsque nous ne le considérons que dans son mode de perception, ce sens-là ne peut être qu'un, il n'en est plus de même quand il s'agirait de ses diverses activités. L'activité du sens intime, — de ce que nous appelons « notre conscience, » — prendra même plusieurs noms, suivant les divers objets auxquels elle s'appliquerait au dedans de nous.
Avant de spécifier ces objets, arrêtons-nous un instant devant ce fait, que le sens intime, — ou la conscience de notre moi central, — ne dispose au dedans de nous que d'une seule et unique perception. C'est de là, dans le fond, que provient ce sentiment de l'unité du moi, qui domine et réunit l'ensemble des activités si diverses de la conscience.
Cette impression d'unité, qui devient une habitude et un besoin pour notre pensée, aussi bien dans la vue du monde extérieur que dans notre expérience intérieure, a certainement sa source dans cette unité de perception du sens intime. En effet, vu leur caractère fragmentaire et multiple, les sensations qui nous viennent du monde extérieur ne sauraient, à elles seules, produire une impression d'unité dans notre perception actuelle, et par conséquent pour notre être lui-même. Cette impression d'unité ne résultera pas non plus, du fait que ces sensations se présenteraient comme ressortissant toutes à un même ensemble de phénomènes, ou à la manifestation d'une seule et même pensée suprême.
Ce qui semble prouver la justesse de cette remarque à l'égard du monde extérieur, c'est que l'animal, qui reçoit de ce monde-là les mêmes sensations que nous, demeure certainement étranger au sentiment de l'unité de ce monde, ou à l'impression de « l'univers. » Quant à ceci qu'à elles seules ces sensations ne suffisent pas à nous révéler l'existence d'une volonté une et suprême, le fait si général du polythéisme suffit pour le prouver.
Sans poursuivre plus avant l'étude de ce trait spécial, je me borne à constater que, si toute impression de conscience implique pour nous le sentiment de l'unité du moi, cela ne saurait provenir que de ce fait, que toute impression de ce genre découle de ce qui est en nous une seule et même faculté de perception.
Avec cela, nous l'avons vu, on parlera de plusieurs « consciences, » suivant la portion spéciale de notre vie intérieure qui, dans tel ou tel moment, serait l'objet de cette seule et même perception.
C'est ainsi que nous possédons tous, au dedans de nous, la conscience de deux faits essentiellement distincts. L'un est l'activité vivante de notre moi. L'autre est un fait qui préside au dedans de nous à cette activité.
Sans doute, cette première « conscience » n'est pas uniquement la vue de l'activité du moi. C'est encore la vue de l'évolution régulière et normale de cette activité. Un exemple de ce que nous disons-là, est la conscience que nous possédons tous de la loi intérieure du vrai et du beau. (Un fait qui montre jusqu'à quel point la simple perception de conscience, ou la seule conscience de l'activité du moi, est digne d'être étudiée pour elle-même, c'est l'état de cette conscience pendant te sommeil. Pour n'en dire que ces deux mots, il est évident, par exemple, que, tandis que le rêve est un phénomène de conscience auquel manque la vue de la forme dans l''impression elle-même, le cauchemar est un fait de conscience qui, en face des impressions, demeure privé du sentiment de la liberté du moi.)
Quant à la conscience d'un fait qui présiderait en nous à l'activité de notre vie, c'est bien là proprement ce que nous désignons comme notre conscience morale. L'objet de cette conscience n'est pas l'activité régulière du moi ; c'est un fait qui nous apparaît comme subsistant au dedans de nous avant cette activité, puisqu'il se fait sentir comme exerçant une sollicitation sur la décision qui inaugure en nous cette activité.
Ce n'est donc pas, comme dans le premier cas, la vue d'un fait que cette activité réaliserait sous nos yeux. C'est au contraire le sentiment d'un fait que cette activité ne réalise pas nécessairement ; bien plus ! qu'elle pourrait ne pas réaliser.
Nous appelons la conscience que nous avons de ce fait préalable, la conscience de l'obligation morale, ou la conscience morale. C'est cette perception spéciale de conscience que nous aspirons à étudier ici.
La perception dont il s'agit se reconnaît d'abord à ceci : qu'elle nous transmet une impression immédiate. Elle présente de plus ce caractère, d'être une expérience imposée directement à notre volonté elle-même.
Disons d'abord ce que nous entendons par ce mot impression immédiate.
Nous désignons par là une impression qui nous arrive pour ainsi dire toute faite ; une impression que nous ressentons sans avoir rien fait pour cela ; sans même l'avoir vue se former au dedans de nous ; en sorte que nous ne saurions la discuter, n'ayant pu en observer ni la genèse ni les intermédiaires, et son apparition en nous n'ayant rien eu à faire avec notre propre initiative. A la différence d'autres impressions que nous pouvons susciter à notre gré, cette impression spéciale constitue donc au dedans de nous une expérience purement passive, une expérience qui nous est imposée.
Au premier abord, on pourrait croire qu'elle possède ce caractère en commun avec d'autres expériences de conscience, comme par exemple, avec la conscience que nous avons de notre propre existence. En effet, tandis que nous pouvons réveiller, ou laisser sommeiller en nous, la conscience de l'activité du moi réfléchi et de ses lois, nous ne saurions nous refuser à faire l'expérience de notre existence elle-même. Aussi est-ce là, pour nous, beaucoup plutôt une impression qu'une perception.
Mais si cette expérience, elle aussi, nous est de la sorte imposée, elle ne l'est pas malgré nous, comme c'est le plus souvent le cas pour celle de la conscience morale. Cela provient de ce que l'expérience de notre existence a lieu dans les limites de notre sentiment ; tandis que celle de notre conscience morale est imposée directement, nous venons de le dire, à notre volonté elle-même. Aussi bien, tandis qu'il n'y a rien en nous qui s'oppose à cette expérience de notre existence, — tandis que rien ne nous pousse à en mettre en doute la réalité, — n'en est-il pas de même de l'expérience que nous devons à notre conscience morale. Nous ne ne saurions même alors demeurer indifférents, puisque cette expérience possède ce caractère distinctif, qu'elle s'impose à notre volonté. — Ajoutons aussitôt, que ce n'est pas une expérience que nous ferions par notre volonté ; que c'est bien plutôt une expérience que subit notre volonté. Elle a lieu au dedans de nous non pas en vertu, mais le plus souvent en dépit de notre volonté. Notre volonté en est elle-même l'objet.
La preuve de ce que nous disons là, c'est qu'il nous est impossible de séparer, par la pensée, l'impression spéciale dont il s'agit, de quoi que ce soit qui l'aurait précédée, et qui l'aurait acheminée, en nous ; de quoi que ce soit qui en serait l'organe permanent ; en sorte que nous puissions en susciter, ou même en diriger, l'apparition au dedans de nous.
Il est vrai qu'on parlera quelquefois de la conscience morale, comme d'un fait qui subsisterait au dedans de nous à part de l'impression qu'il nous aurait transmise. Ce n'est là, cependant, qu'une figure de langage ; analogue à celle dont nous usons lorsque nous parlons de notre imagination, de notre pensée, ou même de notre volonté, comme de facultés qui subsisteraient en nous à part des images, ou des sentiments suscités par ces diverses activités de notre âme.
Dans le fond, ce qui perçoit en nous, — ou notre âme elle-même, — est bien toujours présent tout entier dans chacune de ces activités ou de ces impressions. Tandis que les organes de nos sens extérieurs subsistent pour nous indépendamment des impressions qu'ils nous transmettent, — en sorte qu'ils peuvent ou demeurer inactifs ou agir simultanément, sans que pour cela leurs activités disparaissent, ou qu'elles se confondent, à nos yeux, — il n'en est pas de même des impressions transmises par le sens intime. Celles-ci sont toujours imposées directement à notre être lui-même.
Ce qui prouve que ces impressions-là impliquent à chaque fois la réceptivité entière du moi lui-même, c'est qu'elles ne sauraient avoir lieu simultanément. L'activité de l'imagination exclut celle de la pensée pure, comme cette obéissance immédiate de la volonté qui s'appelle la foi, est incompatible avec la marche méthodique de la logique. Aussi bien ne saurait-on se former une idée quelconque de ce qui, au dehors de ces impressions, en représenterait au dedans de nous la faculté ; de ce qui demeurerait en nous comme un organe permanent de l'imagination, de la morale, ou de la religion, abstraction faite de l'impression poétique, morale, ou religieuse elle-même.
Cette remarque n'est pas sans importance. L'objectivisation