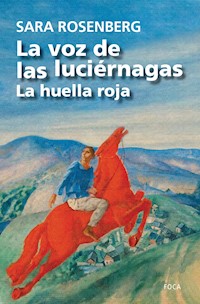Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Contre Allée
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Sous la forme d’ un puzzle narratif,
Un fil rouge raconte l’ histoire de Julia Berenstein, jeune femme engagée dans l’ action révolutionnaire en Argentine, dans les années 1970. À travers le discours et la perception des personnes qui l’ ont connue, le lecteur découvre petit à petit un aspect de l’ histoire de l’Argentine, dans un contexte de lutte armée et de « guerre sale ».
À PROPOS DE L'AUTEURE
Écrivaine, dramaturge et artiste visuelle,
Sara Rosenberg est née en Argentine (Tucumán) et réside actuellement à Madrid.
Un fil rouge est son premier roman paru à La Contre Allée, suivi de
Contre-jour.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À tous ceux qui se souviennent, parce que « la tendresse est un acte de résistance civile ». À Juan.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
Y besarte la noble calavera
Y desamordazarte y regresarte.
Elegía, Miguel HERNÁNDEZ
Je veux miner la terre jusqu’à te retrouver
Et embrasser ton humble crâne
Te démuseler et te faire revenir.
Elégie, Miguel Hernández
I Enregistrement n°1 (Catamarca, avril 1990, après Madrid)
La maison a explosé tellement fort qu’on a même retrouvé des décombres sur le chemin des oliviers. Les animaux ont été bien secoués par la détonation, du coup, le percheron s’est échappé dans la montagne. On ne savait pas encore si Julia se trouvait à l’intérieur avec son fils Federico. Des hommes, une quinzaine, armés jusqu’aux dents, sont descendus de quatre voitures ; ils se sont divisés en groupes avant d’encercler la maison en criant et en mitraillant la porte et la fenêtre, puis ils ont posé des explosifs. Ensuite, ils ont couru jusqu’au chemin et ils ont disparu à toute vitesse.
Ma sœur et moi nous étions là-bas à épier, derrière la palissade, où on fait sécher les figues sur les roseaux tressés. Ils ne pouvaient pas nous voir et, en plus, ils étaient tellement pressés qu’ils n’ont même pas regardé, comme s’ils étaient poursuivis par le diable. La plupart des gens se sont cachés dans la grande bâtisse où nous avions tous l’habitude de nous réunir pour regarder la télévision. Quelques-uns étaient restés chez eux et d’autres ont entendu la détonation dans toute la vallée, sans savoir d’où ça venait exactement. Le bruit a été si fort qu’il nous a rendues complètement sourdes toute une journée.
À mes soixante-dix ans, j’ai vu bien des guerres passer sur ce chemin, mais jamais aucune n’était arrivée si près, juste là, en face.
Quelques jours avant l’explosion, à l’aube, ils avaient tué tous ces jeunes endormis dans un autobus de tourisme parce que soi-disant, ils comptaient attaquer la caserne de la route principale. Ils étaient, à ce qu’il paraît, en tenue de militaires, les pauvres malheureux.
On a appris qu’un seul d’entre eux s’était sauvé. Il était sorti pour aller se soulager quelques minutes avant, il est tombé dans un puits et il est resté caché là-bas, à faire le mort, pendant que l’armée en finissait avec tous les autres. Après plusieurs jours, il est réapparu dans les villages de la montagne, déambulant dans Tucumán, avec ses habits tout déchirés et le corps plein de blessures. Depuis, il a été surnommé « Petit Miracle ». Ici quand quelqu’un survit, c’est un saint. Près du Portezuelo, les gens lui ont fait un autel. On dit qu’il a été tué un an plus tard, mais il a toujours des fleurs fraîches.
Nous, nous avons fait la promesse, il y a plusieurs années, de garder les affaires de Julia, en prenant le risque qu’on vienne nous emmener, nous aussi. Mais nous sommes chrétiennes et nous croyons en Dieu qui nous a bien protégées.
Avant de recevoir sa lettre, nous savions déjà que quelqu’un allait venir les chercher. Julia nous apparaît toujours. Nous allumons les bougies, nous nous donnons la main, nous pensons à elle et elle apparaît. Comme nos parents qui, eux aussi, reviennent de temps en temps. La dernière fois, elle nous a dit qu’il était temps de déterrer les tableaux et les caisses, mais nous l’avons entendue moins distinctement, c’est pour cela que nous ne savions pas qui viendrait exactement. Elle ne nous a pas dit son nom, puis elle est partie très vite.
Par chance, quelques jours avant la bombe, nous avions sorti de la maison trois caisses de livres et les tableaux que Julia avait peints ; il n’y avait pas grand-chose de plus. Un grand lit, un plus petit, le linge dans l’armoire et puis à l’extérieur, dans l’ancien laboratoire du vétérinaire qu’ils utilisaient comme cuisine et salle à manger, quelques affaires. Les tableaux étaient grands, peints avec des couleurs vives. Sur toutes les toiles, il y avait des femmes et des poules égorgées, et d’autres animaux qui n’existent pas. Moi, je ne les aimais pas ceux-là, mais bien sûr, je ne les comprends pas bien et je n’y connais rien en peinture pour pouvoir donner mon avis.
Les autres tableaux, ceux que nous n’avions pas sortis, n’étaient pas encore terminés, ce qui montrait bien qu’elle en peignait deux ou trois à la fois, comme si le temps allait lui manquer. Elle n’a jamais voulu comprendre que par ici, on ne peut pas vivre toujours dans l’urgence, en voulant tout faire en même temps. Ah, si seulement elle nous avait écoutées !
Nous l’avions vue se rendre plusieurs fois au laboratoire le matin, à l’heure où on trait les vaches, pour peindre dès le lever du jour, et rester là-bas jusqu’au moment où se réveillait le gamin. Elle lui donnait son petit déjeuner et bavardait avec Javier jusqu’à ce qu’il parte au travail. Ensuite, elle avait l’habitude de traverser pour venir chez nous, pour organiser les tâches quotidiennes des coopératives de lait, d’œufs et de figues que nous, les gens du village, avions créées tous ensemble. Celle des figues a commencé à bien fonctionner dès que nous avons pu utiliser les réfrigérateurs de la station agronomique.
Les camionneurs et les commerçants étaient très mécontents ; ils ne pouvaient plus fixer comme ils voulaient le prix des récoltes quand elles étaient insuffisantes, parce que les figues ne se gâtaient plus. Nous pouvions les conserver pendant des mois plutôt que de mal les vendre, et marquer nous-mêmes les prix. Nous avons gagné un peu d’argent et nous avons pu commencer à acheter plus de poules et à avoir des œufs pour les cent cinquante habitants du village. Bien sûr pas tous les jours, et au début trois par semaine pour tous les enfants, ensuite pour les vieux, et ainsi de suite en fonction des besoins.
Nous lui disions toujours que les gens d’ici étaient très méfiants, que ça ne durerait pas, qu’on n’allait pas les laisser tranquilles. Dans tout le village, on racontait qu’ils étaient communistes. Elle riait et nous disait que cela allait prendre encore beaucoup de temps, que peu importait ce que disaient les gens et que plus nous saurions défendre ce qui était à nous, mieux ça irait. Et elle avait raison, bien qu’on n’ait rien pu sauver du tout. Regardez comment c’est maintenant, plus de réfrigérateurs, plus de contrôle sanitaire pour le lait de chèvre, plus rien. Une douzaine d’œufs coûte plus cher que deux ceintures tissées qui nous demandent presque une semaine de travail. Les gens meurent toujours de ces mêmes tremblements de froid, ces poussées de fièvre habituelles de la brucellose, comme l’appelle le docteur Ramírez.
C’est arrivé très vite. Après le jour de l’explosion, tout a commencé à changer, le village a été envahi par des troupes descendues de la montagne qui allaient et venaient. Nous avions très peur, c’est pour ça que ce tableau que nous avons osé laisser dehors est celui qu’elle nous avait offert. C’est nous qui sommes dessus, la pauvre avait mis le figuier derrière et elle nous avait représentées avec des robes très colorées, alors que nous sommes toujours habillées en noir ou quelquefois en blanc, certains dimanches. Les autres tableaux sont bien enveloppés dans du plastique et du papier journal, tout comme les livres, enterrés dans le vieux puits qui a des parois en ciment. Nous avons attendu longtemps pensant qu’un jour, ils se souviendraient de nous et reviendraient les chercher. Ils n’ont même pas envoyé une lettre, rien. Comme si la terre les avait engloutis. Au début, nous attendions quelque chose, mais après, nous avons appris par les journaux qu’ils avaient été accusés, son mari surtout, d’être de ceux qui avaient pris d’assaut la caserne.
Ça c’était à la fin de l’année 74, je m’en souviens bien, ils avaient été dénoncés par deux journaliers qui passaient par là. Les militaires sont arrivés et ont tué presque tous ceux qui étaient dans l’autobus, pendant qu’ils dormaient, avant qu’ils puissent se rendre compte de quoi que ce soit.
Pendant trois jours, les cadavres de ceux qui avaient réussi à s’enfuir dans la campagne sont apparus dans tout Catamarca. Moi, je suis sûre qu’eux, en revanche, n’avaient rien à voir avec l’assaut de la caserne. Je me rappelle très bien que ce jour-là, nous étions ensemble à l’épicerie. Ensuite, il est parti travailler alors que Julia est restée avec le petit et nous sommes allées ensemble voir des femmes du marché à laine, des tisseuses qui voulaient rentrer à la coopérative. C’est là-bas que nous avons entendu les informations à la radio, alors elle nous a serrées très fort dans ses bras, elle est devenue pâle et elle est sortie en courant dans la rue avec le petit dans ses bras. C’est la dernière fois que nous l’avons vue.
Le lendemain, ces hommes sont arrivés et ont fait exploser la maison.
Il me semble qu’il y a un peu d’ingratitude de sa part. Elle aurait pu nous envoyer au moins une carte postale ou un message. Nous, nous l’avons toujours traitée comme un membre de notre famille, et dès leur arrivée, nous les avons présentés à tout le village. Vous savez ici, il y a deux villages qui n’en font qu’un, séparés par une rivière et par des années de rancune dont plus personne ne sait quand elle a commencé. Nous sommes les seules ma sœur et moi à avoir des amis des deux côtés. C’est nous les plus âgées et nous savons que si les motifs de l’offense ont été oubliés, il ne faut plus se sentir offensé. Elle aussi, elle traversait avec nous pour aller de l’autre côté.
Quelquefois nous nous occupions de Federico, qui est sûrement un jeune homme maintenant. Il ne doit plus se souvenir de nous. C’était un beau garçon, avec ses boucles couleur châtain et les mêmes yeux que sa mère, verts, grands et comme bouleversés. Elle allait partout avec lui. Ils avaient même fait venir un âne sauvage de la montagne qu’ils avaient apprivoisé et qu’ils utilisaient pour promener Federico en le faisant monter dessus, avec le boa qu’ils avaient dressé, enroulé au cou de Gardel, comme l’avait surnommé le petit. Quand ils sont partis, nous avons dû le ramener dans la montagne parce qu’un âne ici ne sert à rien et qu’il n’y a pas assez de pâturages. Le boa aussi est parti.
Nous lui avions appris à laisser les bougies allumées pendant la nuit, dans la chambre du petit, pour le protéger des bestioles. Je me souviens qu’elle nous a dit en souriant qu’elle croyait que les gens ici faisaient ça pour demander des choses aux saints. Mais non, comme vous savez, la vinchuca sort la nuit et pique, mais si elle voit de la lumière, elle ne descend pas. C’est pour cela que dans les chaumières, il y a toujours une bougie allumée près des lits. Après la piqûre, l’œil enfle et finalement, en un an ou deux, parfois plus, parfois moins, le cœur s’arrête. Comme ça, d’un seul coup, et on ne peut plus rien faire. Mais vous voyez bien, nous sommes toujours là nous, encore debout, comme il faut et avec nos bougies allumées.
Quand ils sont arrivés, elle était très jeune, elle devait avoir environ vingt ans. Son mari par contre était plus âgé, beaucoup plus réservé, et il n’arrêtait pas de fumer. Il partait en ville et revenait manger à midi avec elle. Le soir, il restait très tard au laboratoire à écouter la radio ou à jouer de la guitare ; il était bon musicien et chantait volontiers. Il nous arrivait quelquefois de traverser pour leur rendre visite et rester à bavarder jusqu’à la tombée de la nuit. Nous nous sentions en confiance. Nous savions que c’était bien possible qu’ils soient mêlés à quelque chose, mais ils ont toujours été très affectueux, et il faut reconnaître qu’avec les coopératives ça allait mieux pour tout le monde. Ce qu’il y a c’est que les gens oublient vite et se mettent à critiquer. Tout le monde a peur et on est devenu égoïste. Maintenant, pour deux pesos, n’importe qui dénonce son voisin.
Elle avait ses idées à elle, c’est sûr, autrement pourquoi une fille si jeune et de la ville serait venue s’enterrer dans un endroit pareil ? Nous, nous pensions que c’était à cause de son travail à lui, à la station agronomique. Mais après, nous nous sommes rendu compte, à sa façon de parler et à ce qu’elle disait, qu’elle ne croyait pas en Dieu, qu’elle n’était même pas chrétienne et qu’ils n’avaient jamais mis les pieds dans une église. C’est le curé qui nous a prévenues le premier, mais nous, nous ne l’avons pas écouté ; nous ne sommes pas non plus de celles qui croient tout ce que racontent les curés. C’étaient de braves gens, malgré leurs idées.
Les décombres de la maison ont été recouverts de terre et cette palissade a été installée autour pour ne pas qu’on la voie. Il paraît qu’il y a eu des problèmes parce que la maison appartenait à la station agronomique, au gouvernement de la province. Elle avait été prêtée à son mari comme toutes les autres maisons des employés. Lui était ingénieur agronome ou chercheur, quelque chose dans le genre. Ce qui est sûr, c’est qu’il était toujours en train de lire. Ils passaient tous les deux beaucoup de temps à la campagne à lire et à lire. Ils faisaient même la lecture au petit qui allait et venait avec ses bottes en caoutchouc et sa chienne marron, toujours devant, pour le protéger.
C’est qu’ici, il y a beaucoup de vipères. Quelques-unes sont très venimeuses, comme le serpent corail, pas le faux mais celui qui a un anneau complet. Contre lui, il n’y a rien à faire : s’il pique, on meurt dans les heures qui suivent, aucun sérum ni rien pourra vous sauver. Ils en avaient tué plusieurs devant la maison. Nous leur avions appris à leur retirer la peau et elle avait peint un tableau où on voit une vipère morte accrochée comme un pendu, avec la coupure circulaire autour du cou, pour que le cuir se dégage comme un gant, en entier.
Le tableau est horrible, une vipère toute nue, on ne pouvait pas la regarder. Nous l’avons rangé celui-là aussi.
Quelquefois, le samedi, ils venaient nous dire au revoir ; ils nous confiaient la chienne et partaient pour Tucumán voir la famille de Julia. Son père et sa mère sont venus une seule fois ; c’étaient des gens riches, ça se voyait : ils sont arrivés dans une belle voiture, une grosse. Sa mère est descendue de voiture, elle a regardé tout autour, ils ont franchi la clôture de la maison et tout de suite elle est ressortie en pleurant. Julia s’est approchée, lui a pris le bras et a commencé à lui montrer les arbres comme l’énorme noyer, les deux amandiers et plus loin le chemin des oliviers. Alors la femme sembla se calmer peu à peu. Elle se mouchait le nez tout le temps. Ensuite, elle leur a montré le devant de la maison ; on aurait dit que ses parents ne voulaient ni rentrer ni en voir davantage.
Ils parlaient et parlaient. De temps en temps sa mère sortait un mouchoir et elle pleurait encore en montrant la maison, en tendant la main. Après ils s’embrassaient, et nous, on entendait le rire de Julia qui essayait de les amuser, en montrant ses bras dorés par le soleil. Je m’en souviens parfaitement, comme si c’était hier. Elle s’arrêtait et tournait en riant, et elle remontrait les muscles de ses mollets, en leur expliquant des choses sur la vie à la campagne. D’ici, on pouvait les entendre distinctement.
Petit à petit, sa mère s’est calmée, elle n’a plus pleuré et elle a même commencé à rire. Son père, un homme bien planté, qui avait une grosse moustache presque blanche, je m’en souviens comme s’il était là, lui disait avec une certaine tristesse qu’il ne comprenait pas lui non plus pourquoi, alors qu’ils avaient tout pour eux, ils avaient décidé de venir s’enterrer ici, sans électricité, sans eau potable, au milieu de ce paysage triste. Julia lui a caressé les mains, les a embrassées et lui a dit, comme si elle était vieille et qu’elle parlait à un enfant, qu’elle se sentait bien et qu’elle aimait cet endroit, et que pour le moment rester à Tucumán ou à Buenos Aires c’était dangereux pour eux.
C’est là que ma sœur et moi nous avons compris que nos soupçons, les doutes que nous avions sur les raisons qui la retenaient dans cette montagne étaient vrais. Parce qu’ensuite, elle a continué à expliquer que des avocats commençaient à être menacés, tous les gens qui ne pensaient pas comme le gouvernement, et surtout ceux qui avaient été amnistiés. Nous avons demandé au contremaître, qui est péroniste et s’y connaît en politique, ce que ça voulait dire. Elle ne nous a jamais raconté qu’elle avait fait de la prison. Elle s’en était bien gardée. Sa mère lui demandait de quitter le pays, pour finir ses études, et en même temps elle séchait ses larmes à chaque instant. Si seulement elle avait été moins têtue !
Javier, qui avait apporté sa guitare, a chanté deux ou trois chansons, et sans trop tarder, ils sont repartis, après de longues embrassades et après s’être fait la bise plusieurs fois. Son père lui caressait les cheveux et elle se laissait faire, en souriant, avec Federico dans les bras. Après ces derniers moments de tranquillité, ils n’ont plus reçu de visites. À partir de ce moment-là, c’est eux qui partaient de bonne heure le matin. Deux ou trois fois par mois, ils traversaient les très hautes montagnes qui séparent Tucumán de Catamarca et ils revenaient toujours avec des sacs pleins de nourriture et de linge que Julia distribuait à leurs amis. Elle n’aimait pas revenir chargée parce qu’elle, elle disait qu’elle n’avait nulle part où ranger tout ça, que sa mère aimait acheter des choses pour lui faire sentir qu’elle avait besoin d’elle et qu’elle ne pouvait pas refuser.
Dans mon for intérieur, moi je pensais qu’elle avait bien de la chance d’être aidée, mais elle se plaignait toujours du fait que ces voyages lui faisaient perdre beaucoup de temps.
C’était cette phrase sur tout le temps qu’elle perdait qu’elle répétait le plus souvent. Elle sentait que son temps passait plus vite que celui des autres.
Nous l’avions surnommée « ututa », qui est ce petit lézard qui n’arrête pas de bouger, et elle nous appelait les « fillettes », surnom qui nous est resté pour toujours. Les derniers mois, elle descendait presque tous les jours à la ville avec le petit et elle revenait avec Javier plus tard que d’habitude. Elle nous a dit qu’il y avait une grève d’instituteurs et de professeurs qui durait depuis un mois. Elle venait moins à la maison et on ne se voyait plus qu’aux réunions du jeudi ou aux heures d’atelier. À la dernière réunion, elle nous a raconté que les propriétaires des camions et les commerçants avaient commencé à faire pression. Ça faisait deux semaines que des inconnus venaient à la station agronomique pour dénoncer les « subversifs », c’est-à-dire eux et nous, leurs amis du village et des coopératives. Apparemment ils allaient se retrouver sans travail et ils seraient obligés de partir.
Nous, on savait que c’était vrai parce qu’on écoutait la radio qui en parlait. L’Union des chefs d’entreprise faisait de longs communiqués contre les nouvelles coopératives de la région, et je me souviens aussi que c’est à cette époque-là qu’on a entendu dire que, sur les voies de chemin de fer, près de Morón, on avait retrouvé un jeune avocat mort, avec les mains coupées. Sur son torse il y avait une affiche avec les trois lettres : A.A.A.1
C’était la première fois. On ne savait pas encore que tout ça pourrait être possible.
Quand Julia nous apparaît, elle nous demande toujours des figues. Nous lui laissons les meilleures, les plus mûres, sur la margelle du puits, alors elle semble contente et elle s’en va tout doucement, en marchant au bord de la rivière et en les savourant.
1 l’Alliance Anticommuniste Argentine était une organisation paramilitaire qui, à l’initiative du ministre López Regá, commença ses actions répressives contre les artistes et intellectuels en 1974, sous le gouvernement de Perón [NdT].
II
Naître si près l’un de l’autre nous avait transformés peu à peu en un animal à deux têtes.
Sans aucun doute, même si nos mères, ces artistes de l’oubli, ne l’avouent pas, nous sommes-nous sentis et goûtés avant même d’apprendre à parler, tandis qu’elles pensaient que nous dormions sur la terrasse et nous laissaient seuls sur la même couverture. J’ai de vagues souvenirs de quelqu’un toujours à mes côtés, lorsque découvrir l’existence de nos pieds occupait tout le firmament ; le monde commençait à se dessiner et les odeurs cédaient aux formes, une chose se détachant de l’autre jusqu’à nous arracher définitivement à l’immédiateté pour découvrir les espaces vides, les distances. Mais au commencement étaient tes pieds contre mon visage, sous un soleil d’hiver au parfum d’orange.
Plus tard, ce fut ton dos, tombé si profondément dans l’oubli. Nous disposions nos vertèbres qui s’emboîtaient doucement, et nous tenant par le bras, nous roulions en nommant chacune des choses que nous percevions comme un seul corps, en cercle parfait, avec quatre yeux simultanés. Nous étions polaires. Un de nous deux devait faire et l’autre rester, oublier ce que l’autre se rappelait, parler lorsqu’il se taisait, regarder lorsqu’il ne voyait pas. C’était ainsi. C’est toujours ainsi, Julia. Dans la division des corps, l’accomplissement attendait, mais c’était encore trop tôt.
***
Les lacets de la route donnent la nausée. Je suis sur le chemin du retour, au milieu des nuages bas qui se confondent avec les sommets. Il me reste encore quelques kilomètres à parcourir avant d’atteindre le point limite où la montagne change et où commence la forêt immense, ce grand vert sombre qui remet en marche nos poumons, rassasiés de terre et de minéraux. Je suis resté deux jours de plus que prévu. Le puits, où se trouvaient tes tableaux et les caisses, était profond, comme l’effroi de toutes ces années.
À la frontière, on peut voir l’affiche presque effacée : « Tucumán, berceau de l’indépendance. Sépulture de la subversion ».
C’est curieux comme tout ce que j’entreprends semble inversé : je déterre pour te trouver, je te veille dans les airs, je me perds tout doucement en te cherchant. À l’arrière, il y a tes tableaux, les livres, Journal de Bolivie, les poèmes de Trakl, l’Odyssée, Kafka et Jenofonte, curieux mélange de toutes ces choses qui ne sont pas parties en fumée et qui retrouveront leur place dans ma bibliothèque, à l’endroit même où tu les avais prises.
Partir de chez toi n’avait pas été chose facile. Mais tu voulais tourner le dos à ton enfance. Pour toujours. Si tu avais agi comme la femme de Loth qui s’était retournée, tu aurais été punie et tu te serais transformée en statue de sel.
Les dix premières années, tu dormais sur un lit pliant, au pied du grand lit de tes parents et soudain, du jour au lendemain, le déménagement. Une chambre immense, pour toi toute seule, avec des murs où mettre tes croquis, les brouillons de tes poèmes, les affiches des concerts qui arrivaient parfois du Nord. C’était trop de changement à la fois, alors tu m’as abandonné, laissant mon dos sans défense.
Que faire de la petite fille élevée dans les quartiers du centre-ville, qui avait appris avec moi à descendre les dix étages en glissant sur la rampe de l’escalier, et qui sautait d’un étage à l’autre depuis l’ascenseur en marche, avec les portes ouvertes ? Que faire de celle qui se déshabillait et qu’aucun de nous n’eut jamais l’audace de toucher ?
Rien dans cette maison n’a jamais pu être à toi. Une greffe. Comme si on transplantait un cactus dans les racines d’un oranger. Tu nous as abandonnés à contrecœur, mais jamais tu n’as pu repousser ailleurs.
Nous, nous avons continué à vivre dans notre appartement de deux pièces du centre-ville, courant dans les galeries commerciales, attendant que les magasins soient fermés pour envahir un territoire marqué, chaque jour. Catacombes de Tucumán. Avant de partir, tu avais promis de revenir, mais tu as mis bien longtemps.
Tu as toujours aimé les grands abandons. Des mois se sont écoulés avant que tu ne viennes à la terrasse te déshabiller encore une fois pour jouer au jeu des quatre coins avec les piliers et l’étoile qui règne au centre.
Rites de la sieste auxquels on finit par renoncer lorsque surgit un dieu trop habillé qui ne montre que sa tête foudroyante ; un déplacement à peine perceptible et le torturé occupe la place du quinconce ; il efface les points cardinaux, laisse couler son sang de ses mains et de son front, mais sans en abreuver les champs. Il demande à obéir, à se prosterner. Il exige oubli et sacrifice. Il est immobile, parle de désert, d’exode et d’assassinat.
Nous savions, toutefois, que l’unique crime parfait est celui que l’on commet contre soi-même. Nous l’avions appris, allez savoir comment, en jouant, en changeant de coin. Abel et Caïn n’étaient pas encore entrés dans notre territoire. Il n’y avait pas non plus de grands troupeaux, ni d’agneaux sacrificiels ; éventuellement quelques insectes, chauve-souris ou punaises et de nombreux nuages, les après-midi.
Pour repartir, confuse, tu as dû te marier. Ton prince est arrivé et t’a sauvée, il a suffi qu’il te sorte de là-bas. Tu étais incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Le jeu des quatre coins était bien fini.
Je n’avais pas non plus grand-chose à t’offrir, si ce n’est être ce que toi-même tu étais pour moi, cette espèce d’ami de l’âme. Mais tu es partie, attirée par une vérité assurée, je ne dis pas confortable, mais comme toutes les grandes vérités du moment, urgente, faite d’un seul bloc.
Tu as pris ce bateau-là et pendant la traversée, ils t’ont noyée, comme nous nous sommes noyés aussi, nous qui n’avons pas traversé.
Ton seul mérite est de ne pas avoir survécu au naufrage. Je ne sais pas si maintenant, à l’heure actuelle, nous pourrions nous regarder avec le même visage, sous un ciel si haut. Au-delà, il y a la terrasse, les quatre piliers, nous, courant nus dans la chaleur des après-midi, chacun de nous occupant l’espace de l’autre, nous interchangeant.
***
Nous vieillissons. Les propriétaires et leurs inspecteurs de police également, mais ils sont nombreux et tous sont encore là. C’est terrible de les croiser dans la rue : ils se reproduisent comme des fruits tropicaux, ils changent de nom, forment des partis politiques et c’est vrai que ce qu’ils appellent la majorité vote pour eux. Ce siècle qui s’achève nous retrouve fatigués, vivant solitaires au milieu d’une gigantesque confusion, nébuleuse puissante qui peu à peu dévore nos meilleures énergies. Disneyland en guise de cathédrale, énorme et monolithique. Nous survivons. C’est tout. Nous n’avons rien, rien devant, tandis que derrière, s’étend un immense désert.
Maintenant, tout juste maintenant, la femme de Loth t’aurait trouvée. Comme elle nous aurait tous trouvés. Le sel fait mal à l’âme, et je t’invite à sauter par-dessus l’horreur et à entrer dans la mémoire. Je n’ai pas d’autre endroit. Mon existence est devenue insignifiante ; j’apprends à vivre silencieusement, je me laisse aller à des tâches qui n’ont rien à voir ou presque avec moi-même. Je les accomplis et parfois, je peux même acheter une nouvelle robe à ma mère. Je me suis séparé de ma femme après des années de vie commune, mais je n’en pouvais plus. L’amour s’est délité peu à peu entre mes doigts, sans que je ne puisse rien faire pour l’éviter, alors qu’elle se livrait à l’étude des doctrines ésotériques et qu’elle remplissait la maison de signes, de bougies et de santons qui me rendaient plus malade chaque jour. J’ai développé une allergie furieuse à l’encens et au langage qui l’entoure, et bien que je me sois toujours cru capable de tolérer toutes les différences idéologiques, filles du marasme, cette fois-là, je n’ai pas pu, aussi ai-je quitté la maison. Elle insistait, le problème était lié aux astres, disait-elle. C’est mieux ainsi.
C’est terrifiant de voir aujourd’hui toutes ces voitures aux petits drapeaux ou aux autocollants sur lesquels on lit : « En Argentine, nous sommes droits et humains. » Je ne comprends pas d’où sortent tous ces gens et j’ai du mal à réaliser que celui qui est ailleurs, c’est moi et que tout était ainsi depuis toujours. Des siècles de frustration et de méfiance approchent. Les gens aspirent à un ordre qui s’abat de façon implacable sur eux. Quel cirque ! À chaque nouveau mort, on avance la réponse désormais classique : « Ils sont sûrement coupables de quelque chose. » Bien sûr, pense-t-on, effrayé par ce juge mystérieux et ses actions sans appel, tandis qu’il vous est de plus en plus difficile d’imaginer quoi que ce soit et que semble plus épaisse chaque jour la chape de plomb qui pèse sur ce que vous supposez être raisonnable. Au début, vous ne vous reconnaissez pas dans ce rôle d’animal apeuré. Une voiture qui ralentit l’allure fait accélérer votre cœur et les palpitations mettent longtemps à vous abandonner. Vos genoux vacillent devant certains visages tandis qu’un trou se creuse au fond de votre poitrine. Ce sont de nouveaux réflexes qui fonctionnent, vous occupez absolument toutes les heures de la journée à votre survie, les mots commencent à vous trahir et vous apprenez à mentir quitte à vous perdre complètement dans ce que l’on appelle l’opinion publique. Jusque-là vous êtes sauvé. On ne percevra plus vos hésitations ni le tremblement de votre menton, signe que vous êtes sur le point de flancher.
Je me rappelle que la victoire du Vietnam avait coïncidé avec le coup d’État militaire de Videla. Des paradoxes qui trouvent leur résolution dans les rêves en changeant de forme, mais qui, dans la réalité, demeurent insolubles. On n’avait même pas pu fêter ça. On courait tous comme des rats. On nous chassait comme des rats. Le grand camion nettoyeur était payé par tous les citoyens honorables, dans un acquiescement unanime.
Après toutes ces années de paralysie, je sors pour te chercher autrement, plus seulement les jeudis sur la place, à implorer le vent. Je ne sais s’il s’agit de justice, de rage ou de vengeance. Je respire profondément et je te veille patiemment sous les grands arbres.
Tel fut notre sinistre déluge. Deux de chaque espèce ont survécu, mais ne crois pas que la colombe ait annoncé qu’il n’y aurait plus d’eau. Nous savons qu’il ne s’agit pas de notre premier déluge et qu’à n’importe quel moment, Dieu recommence à nous inonder de son urine et à tout dévaster. Voilà pourquoi il faut à tout prix construire un pont sur l’eau trouble de la peur et ses rares trous de clarté, pour le franchir, en aimant éperdument le dos de l’autre, gardien de la mémoire.
III
Dans cette partie d’échecs que je joue seul, le cavalier noir vient de sauter et termine en faisant échec et mat. D’une façon bien ordonnée, depuis son premier mouvement jusqu’au dénouement, que maintenant je peux voir.
Il semblait si difficile de dire non. Savoir dire non. On assimilait toujours cette difficulté à une carence intérieure ou à une espèce de lâcheté innée qui rendait suspects tous ceux qui doutaient de quelqu’un ou de quelque grande vérité du moment.
J’ai toujours pensé que José était un menteur, et quand, après plusieurs bouteilles de vin partagées, j’ai eu la certitude de ne pas m’être trompé, j’ai conclu que c’était un type pour le moins ambigu, sans me risquer à un jugement plus sévère encore. On me disait que ma version était typique d’un petit bourgeois, s’évertuant à boire en compagnie des honnêtes camarades ouvriers, pour les corrompre avec les tares propres à leur classe sociale. J’étais possédé par le démon, moi, fils d’architecte et non de coupeur de cannes.
Lorsque le cavalier s’est enfin déplacé à travers tout le champ délimité, on peut alors comprendre son premier mouvement et s’en souvenir. Et au bord du plateau de jeu, je te vois en train de pédaler sur ta vieille bicyclette, en direction de la maison de José, pour imprimer à la ronéo les dernières conclusions de la soirée. Je vois ton front doré, malgré tes cheveux ras, tes pantalons larges serrés à la taille grâce aux lacets de tes baskets pour ne pas que ces hommes, qui n’ont pas encore compris que les femmes ont le droit de marcher tranquillement dans la rue, ne te confondent avec un garçon et soient tentés de te dire des grossièretés. Il fallait écrire de toute urgence sur la nécessité de conjuguer les luttes des étudiants et des ouvriers, avant l’aube, pour qu’ils sachent qu’en ville, ils avaient un soutien, qu’au restaurant universitaire, il y avait un fonds de solidarité pour les grévistes, et que chaque étudiant était prêt à apporter son repas ou une partie de son argent. Au bas de la page, un texte du Che et les nouvelles de l’avancée du Front populaire, la dénonciation de l’intervention en Tchécoslovaquie et la condamnation radicale de l’impérialisme soviétique.