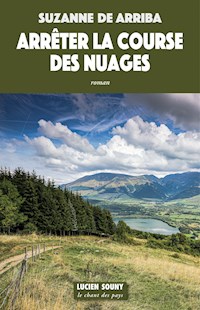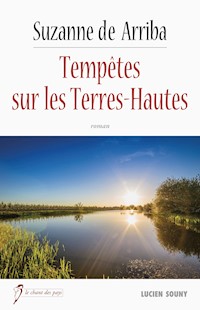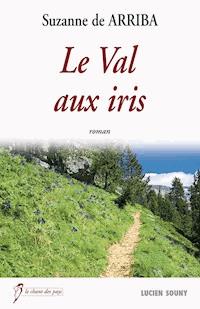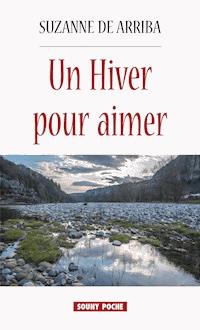
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un hiver rigoureux, sous l'occupation allemande...
Nous sommes au milieu de l'hiver 42-43. Veuve d'un marinier, Camille Chastain a confié son fils petit-lou à sa mère Antonia, professeur à l'institution Sainte-Marie-des-Anges, en Dauphiné. Camille découvre que ses élèves hébergent en secret un résistant, Emmanuel. Mais il est en danger et Camille à son tour le cache chez elle. c'est le début d'un grand amour. Emmanuel, qui a été blessé, est soigné par Victor, un ami de Camille, médecin. À peine rétabli, il doit rejoindre le maquis. Elle lui promet de l'attendre. Un jour, Victor apprend à Camille la mort du jeune résistant. Anéantie, elle accepte alors sa demande en mariage. ils vivront à la maladière, la propriété du médecin. Camille n'est pas très enthousiaste, car à la Maladière vivent aussi Réjane, la belle-soeur de Victor et son fils Guy, qui lui sont hostiles. Et puis, Camille n'accepte pas la disparition d'Emmanuel. Camille, gardée comme une prisonnière à la maladière, sombre dans la dépression, tandis que dans la vallée, Tonia, sa mère, lutte pour survivre avec Petit-Lou. Mais, un jour d'hiver, après la guerre, un homme se présente à la Maladière et demande à parler à Camille.
Une romance riche en rebondissements qui prend la Seconde Guerre mondiale comme toile de fond.
EXTRAIT
L’année 1942 s’était achevée dans le froid. Après le jour de l’An, il avait neigé. Un bref redoux avait suivi, mais, dès la première semaine de février, le gel avait
étreint dans ses serres glacées le nord du Dauphiné qui ne se trouvait plus en zone libre depuis quelques mois, et une température polaire régnait dans les appartements mal chauffés.
Aussi, Camille Chastain s’éveilla transie, en dépit du gros édredon de plumes qui recouvrait son lit. Un de ses affreux cauchemars l’avait encore hantée. La jeune
femme passa une main tremblante sur son front et elle s’assit, s’adossant aux oreillers. Il faisait sombre, encore, et elle distinguait à peine les contours de la chambre, la forme de l’armoire et de la commode.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Signant également sous le nom de Cécile Berthier,
Suzanne de Arriba est l’auteur d’une quarantaine de romans. Elle situe la plupart de ses intrigues en milieu rural, dans une nature enchanteresse, qui apaise les tourments de l’esprit et soigne les blessures du coeur. Ses personnages, fort attachants et passionnés, nouent des rapports complexes entre eux. Le courage, la volonté, la détermination et l’amour leur font passer les caps les plus difficiles et les plus délicats.
Originaire de la vallée du Rhône, elle vit aujourd’hui en Isère, à la Côte-Saint-André.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’année 1942 s’était achevée dans le froid. Après le jour de l’An, il avait neigé. Un bref redoux avait suivi, mais, dès la première semaine de février, le gel avait étreint dans ses serres glacées le nord du Dauphiné qui ne se trouvait plus en zone libre depuis quelques mois, et une température polaire régnait dans les appartements mal chauffés.
Aussi, Camille Chastain s’éveilla transie, en dépit du gros édredon de plumes qui recouvrait son lit. Un de ses affreux cauchemars l’avait encore hantée. La jeune femme passa une main tremblante sur son front et elle s’assit, s’adossant aux oreillers. Il faisait sombre, encore, et elle distinguait à peine les contours de la chambre, la forme de l’armoire et de la commode.
Elle se leva, enfila vite ses bas et des chaussettes pardessus, glissa les pieds dans ses mules. Elle passa une épaisse robe de chambre, guère seyante mais chaude, et se rendit à la cuisine pour y prendre son petit-déjeuner. L’évier était installé dans un des deux grands cagibis dont l’appartement était doté. Elle avait aménagé l’autre, contigu à la cuisine, en cabinet de toilette, avec l’aide de son propriétaire et voisin, le docteur Victor Devillequiers.
Elle appréciait ce confort, pourtant tout relatif, car les toilettes se trouvaient sur le palier, mais la jeune femme n’avait pas oublié qu’au début de son mariage avec Roland Chastain, elle ne bénéficiait pas même de l’eau courante.
Tout en faisant sa toilette et en s’habillant, Camille pensait à sa mère, Antonia Girod. Quand la guerre avait été déclarée, elle était retournée vivre à Luiri, un village rhodanien, dans la ferme de son frère aîné, Claudius Montand. Camille lui avait alors confié son fils Louis — surnommé Petit-Lou — qui avait aujourd’hui cinq ans.
Elle souffrait d’être séparée de son petit garçon, mais elle ne pouvait pas faire autrement depuis qu’elle était professeur à Sainte-Marie-des-Anges, à deux kilomètres de La Côte-Saint-André, où elle habitait. De toute façon, en ces temps troublés, Petit-Lou était beaucoup plus en sécurité à Luiri, sur le coteau, à l’écart de la vallée et surtout de Givors, cible de choix de l’ennemi avec ses usines métallurgiques, ses ponts, ses gares et ses triages.
Lorsque les nazis avaient envahi la zone libre, en novembre 1942, de nombreux convois défilaient sur la route nationale 7, se dirigeant vers le sud qui passait sous leur domination. En décembre, une unité d’artillerie s’était arrêtée à Luiri durant trois semaines. Chevaux et hommes avaient été casés de force chez les villageois. Mais, au hameau des Cottes, relativement éloigné du centre du bourg, les habitants n’avaient pas été inquiétés.
À la ferme Montand, il fallait tirer l’eau d’un puits, et Camille imaginait sa mère, en cet hiver impitoyable, traînant les seaux jusqu’à la vieille cuisine enfumée de la demeure ancestrale. Mais au moins, sur les hauteurs du village, Antonia et Petit-Lou jouissaient du bon air et d’un voisinage tranquille. Avantage non négligeable : le potager, le verger et la basse-cour leur permettaient de se nourrir convenablement et même de varier leurs menus.
Tout de même, comme ses êtres chers lui semblaient loin ! Depuis le début de cet hiver qui la séparait des siens autant que la guerre, Camille se sentait écrasée par le poids du souci qu’elle se faisait pour ceux qu’elle aimait. Sa mère, si forte en apparence, souffrait d’un mal inguérissable, dû à la disparition de Jean-Marie, l’homme qu’elle avait épousé et passionnément aimé.
Pourtant, Antonia avait fait face. Elle avait pleuré le mari, comme la fille avait pleuré le père. Et peu à peu, en apparence du moins, le vide que Jean-Marie avait creusé dans leur existence en les quittant s’était comblé. Pour Camille, la sève de la vie avait cicatrisé cette première blessure. Elle, si jeune encore, avait fait confiance « à l’infini pouvoir de guérison qui réside en chacun de nous », disait sa mère, et qui concerne l’âme comme le corps. « Les deux ne sont-ils pas étroitement liés ? » insistait Antonia.
Camille lui donnait raison. Mais elle ne savait pas qu’une nouvelle épreuve l’attendait.
La jeune femme écarta les lourds rideaux imposés par la défense passive et repoussa les volets. Le jour se levait à peine. L’immeuble donnait sur la place de la Halle. Elle se pencha un peu et vit que le cabinet du docteur, au rez-de-chaussée, était encore fermé.
Elle referma la fenêtre et prépara tout ce qui lui serait nécessaire pour allumer le feu à son retour, ce soir. Ensuite, elle enfila son manteau, sur lequel elle jeta un châle, et cacha ses boucles rousses sous un bonnet de laine bleu roi que sa mère lui avait tricoté.
Elle prit son sac, vérifia qu’elle n’avait pas oublié ses tickets d’alimentation car après le dernier cours, en sortant du collège, elle ferait la queue pour acheter un peu de viande. Avant de sortir, elle regarda, avec un sourire plein de douceur et de nostalgie, le dessin que Petit-Lou avait glissé dans la dernière lettre d’Antonia. Il représentait un arbre rose, un pêcher sans doute, comme il en poussait sur les îles du fleuve et dans les vergers du coteau. Et la mère de Camille avait écrit dessous, de son écriture un peu tremblée : « Le printemps finira bien par revenir, ma chérie ! »
Camille ferma la porte et descendit l’escalier raide. Elle s’arrêta devant la grande boite aux lettres où son nom s’inscrivait sous celui du docteur Devillequiers, qui, la plupart du temps, lui remettait son courrier. Elle le croisa dans la rue. Il venait de garer sa Traction avant près de la Halle. Il l’avait fait peindre en gris métallisé pour qu’on ne la confonde pas avec celles des miliciens qui se déplaçaient dans des voitures noires.
On chuchotait que, sans pour autant faire partie de la Résistance, qui, timide encore, s’était organisée dès 1941, le docteur était souvent appelé au chevet des blessés, et qu’il ne s’était jamais dérobé. On avait confiance en lui, on savait qu’il ne trahirait pas.
— Bonjour, Camille !
Elle lui rendit son salut. Le docteur était un homme d’une cinquantaine d’année, grand et massif, aux épaules larges, au visage un peu sévère couronné d’une épaisse chevelure grise. Son regard, d’un gris assez froid, s’adoucit quand il se posa sur la jeune femme.
— Hé bien ! Vous êtes en avance pour prendre le car ?
— Je crois que c’est vous qui êtes en retard, docteur, répondit Camille malicieusement.
— C’est possible.
Peut-être avait-il été appelé cette nuit encore pour soigner un de ces hommes que les Allemands et les miliciens appelaient des « terroristes ». Il ne laissait rien paraître en tout cas de sa fatigue.
Camille, qui avait adoré son père, décédé l’année précédant son mariage avec Roland, retrouvait en Victor Devillequiers, si attentif, si chaleureux envers elle, un parent de remplacement. Elle était à cent lieux d’imaginer que le quinquagénaire brûlait pour elle en secret…
Camille aurait trente-deux ans au mois d’avril 1943. Elle était née à Givors, au bord du Rhône. Antonia, sa mère, était native de Luiri, un village voisin de quatre kilomètres, dont les maisons semblaient grimper sur le coteau, à la queue leu leu.
Antonia et Jean-Marie Girod, ses parents, formaient un couple exemplaire. Ils s’adoraient. Blessé grièvement pendant la première guerre mondiale, Jean-Marie travaillait cependant, occupant un poste à la SNCF. Mais il avait dû s’arrêter l’année de ses cinquante ans. L’éclat d’obus qu’il avait reçu dans l’abdomen et qui n’avait pu être extrait, avait abîmé irrémédiablement son foie. Rongé par un cancer, Jean-Marie s’était un jour alité pour ne plus se relever, et il était décédé sans avoir eu la joie de conduire sa fille à l’autel. Camille était effondrée. Elle avait pris sur elle pour réconforter sa mère, désespérée, mais digne.
Son mariage célébré en 1936 — l’année de ses vingt-cinq ans — avait donc débuté sous le signe de la tristesse et s’était achevé dramatiquement. Pourtant, pendant quelques mois intenses, elle avait été heureuse, assez pour faire moisson de souvenirs qui l’aidaient à supporter son deuil. Elle connaissait Roland depuis longtemps. Il était ébéniste. Son atelier, hérité de son père, ouvrait sur une ruelle qui conduisait sur les quais. C’était un beau garçon joyeux et généreux. Jouteur, il était connu pour les championnats qu’il avait remportés. Mais, comme tous ceux qui se disaient fils du fleuve, Roland faisait aussi partie des Sauveteurs.
En 1937, un peu avant le retour du printemps, grossi par les pluies abondantes et la fonte des neiges, le Rhône avait enflé, grondé, roulé en aval des eaux troubles, charriant des troncs, des débris de toutes sortes. Il n’avait pas tardé à s’infiltrer dans les caves. C’était le signal, les gens s’attendaient comme d’habitude à la crue, plus ou moins forte. La rue principale de Givors avait été transformée en large canal et des services de barques s’y succédaient pour transporter les écoliers, les ménagères qui avaient été faire leurs courses, les hommes qui s’étaient rendus à leur travail.
Il avait plu encore, pendant des jours, et le géant s’était répandu beaucoup plus loin que ses berges. Par un matin blafard, alors que Roland traversait une fois de plus le Rhône pour porter secours à une famille réfugiée au premier étage de sa maison inondée, sa barque avait chaviré. Un tronc qui filait dans le courant l’avait heurté de plein fouet. Assommé, Roland, pourtant excellent nageur, n’avait pas réagi. Un tourbillon l’avait happé sous les yeux de ses camarades qui repêchèrent un plus tard son corps sans vie.
Camille était alors enceinte de cinq mois. Elle avait cru devenir folle de douleur, mais l’enfant qu’elle attendait la reliant à la vie, l’avait obligée à prendre soin d’elle. Et Louis était né, un petit gars qui allait grandir sans connaître son père.
Camille avait terminé sa dernière année d’études, courageusement, et cherché du travail. D’abord, elle avait enseigné à Grigny, remplaçant un professeur de français qui voulait s’arrêter quelques mois pour mettre au monde son bébé. Pour elle, il n’était pas question de pouponner, il lui fallait gagner sa vie. Et puis, Antonia s’occupait de son adorable petit garçon pendant la journée. À la rentrée suivante, par l’intermédiaire du rectorat, on avait offert à Camille un poste de professeur principal au collège privé Notre-Dame-des-Anges, situé sur les hauteurs de La Côte-Saint-André. C’était bien loin de Luiri, mais elle avait accepté, suivant les conseils d’Antonia. Elle avait loué cet appartement dans le bourg, en pensant reprendre très vite son fils, confié à sa mère. Mais la guerre avait éclaté.
Victor Devillequiers connaissait les grandes lignes de l’existence de sa locataire, et il trouvait Camille aussi courageuse que belle.
— J’ai bien encore quelques instants avant de commencer mes consultations, ma petite Camille. Permettez-vous que je vous accompagne jusqu’à l’arrêt du car, sur la place ?
Elle fut étonnée, mais ne le montra pas. Ce jour-là, Victor Devillequiers n’avait manifestement pas envie de la quitter.
— Comment vont le petit Louis, et madame votre mère ?
— Aussi bien que possible dans les conditions actuelles. Dans sa dernière lettre, Petit-Lou m’a envoyé un joli dessin.
— Il vous manque, votre bambin ?
— Oh oui ! Beaucoup ! Et maman aussi me manque.
— Vous étiez très proches l’une de l’autre, si j’ai bien compris !
— En effet. Je suis sa seule enfant, mais ce n’est pas uniquement pour cette raison. Il y a toujours eu une belle complicité entre nous. Je l’ai soutenue de mon mieux quand papa était malade et quand il nous a quittées. À son tour, elle a su m’entourer quand j’ai perdu Roland, d’une manière si dramatique. Elle était à mes côtés quand j’ai mis mon fils au monde. C’est elle qui l’a reçu dans ses mains, qui l’a baigné, me l’a déposé dans les bras… Oui, tant de choses nous lient, en plus des liens du sang…
— Vous devriez l’inviter à passer quelques jours à La Côte-Saint-André, avec votre petit garçon.
— J’y pense ! Et, de mon côté, j’irai bien les voir plus souvent, mais le trajet est si long, si pénible d’autant plus qu’il faut changer de car à Vienne.
— Si vous le voulez, un dimanche, je pourrais vous y conduire. Il suffirait de partir de bonne heure.
Camille essaya de cacher son étonnement.
— C’est vraiment gentil à vous, mais il est si difficile de se procurer du carburant, il vaut mieux le garder pour vos visites !
— Oh ! Je m’arrangerai, ne vous en faites pas ! Cela me ferait plaisir. Je serai si heureux de vous aider, Camille !
Elle ne répondit pas, tentée tout de même. Cependant, une lueur dans le regard de Victor la fit réfléchir pour la première fois. Elle devina confusément que, sous l’intérêt paternel de cet homme se dissimulait autre chose, et elle en fut troublée, mais aussi contrariée. Elle l’aimait beaucoup et ne souhaitait pas perdre son amitié.
Aussi, la jeune femme s’empressa-t-elle d’orienter la conversation différemment.
— Et vous, docteur, avez-vous des nouvelles de votre famille ?
— Ma famille ! s’exclama-t-il avec une grimace. Si l’on peut dire…
— Vous avez un neveu, je crois ?
— Oui, Guy Devillequiers. Et j’ai aussi une nièce, Olympe.
— Olympe Devillequiers ? À Notre-Dame-des-Anges, il y a un professeur de mathématiques qui se nomme ainsi.
— Il s’agit bien de ma nièce. Une peste ! Elle tient de sa mère, ma belle-sœur Réjane, une véritable harpie, je vous l’assure ! Mon pauvre frère a été héroïque de la supporter jusqu’au bout ! Je me demande comment Olympe se comporte avec ses élèves…
— Elle est plutôt du genre sévère, un peu rigide, concéda Camille, qui ne voulait pas s’étendre sur le sujet.
Elle ajouta toutefois :
— Je ne savais pas que vous étiez apparentés, en dépit du nom de famille identique.
— Apparentés… hélas ! Quand je pense que cette fille est de mon sang, je ne pavoise pas ! Mais comme je vous l’ai dit, elle tient surtout du côté de sa mère. Je vais vous expliquer, ma chère Camille, reprit le médecin. Il y a une quinzaine d’années, j’ai acquis avec ma part d’héritage une importante propriété sur la commune de Saint-Hilaire : la Maladière. Cette propriété comporte une maison de maître et une ferme, habitée par un couple de métayers, les Béroud. Tout autour, s’étendent des hectares de prés et de bois.
— C’est un excellent placement ! approuva Camille. Mais pourquoi n’habitez-vous pas la Maladière ? Saint-Hilaire n’est pas si loin.
— Mon cabinet, comme vous le savez, se trouve dans cet immeuble dont j’ai également hérité, de mon parrain cette fois. J’exerce ma profession ici, à La Côte-Saint-André. Aussi, ai-je installé là-haut à la Maladière mon frère Henri, sa femme Réjane et leurs enfants. Mon frère, je dois l’avouer, a eu moins de chance que moi. Mais il était joueur, il avait fait de mauvaises affaires et avait tout perdu de ce qui lui revenait de l’héritage de nos parents. Il a donc été bien content de pouvoir gérer en mon nom la Maladière. Il ne s’en est pas trop mal tiré et a initié son fils Guy, qui n’était pas doué pour les études comme sa sœur.
Assez surprise de cette avalanche soudaine de confidences de la part d’un homme beaucoup plus âgé qu’elle et qui s’était montré si réservé jusque-là, Camille ne fit aucun commentaire. Son silence, pourtant, sembla encourager le docteur, qui poursuivit :
— À la mort d’Henri, il y a trois ans, j’ai laissé ma belle-sœur Réjane dans les lieux, et j’ai chargé Guy de s’occuper de la Maladière comme le faisait son père, par pure charité, je dois dire, car je n’estime guère ce garçon, malgré ses compétences. Si, un jour, il me prenait envie de me marier, je crois que Réjane et Guy feraient grise mine à mon épouse, et dans ce cas, je n’aurai plus aucune pitié, je leur montrerai la porte !
Victor s’était emporté en prononçant ces derniers mots, tout en couvant la jeune femme d’un regard enflammé. Camille, gênée, avait hâte de voir arriver l’autocar qui devait la déposer avec quelques élèves externes, deux kilomètres plus loin, au pied de l’éminence où se dressait Notre-Dame-des-Anges.
Ils arrivèrent au bas de la rue pavée et tournèrent le coin du Café des Voyageurs. En face, sur la place, la statue d’Hector Berlioz, natif de La Côte-Saint-André, semblait grelotter dans la brume. Tout près du monument érigé à la gloire du célèbre musicien, attendait une calèche attelée à un cheval placide. Avant la guerre, André, le cabaretier, promenait les touristes dans son attelage. Désormais, il servait de taxi pour les petits trajets, on savait toujours où le trouver pendant la journée, et quand il s’absentait sa femme le relayait auprès des consommateurs.
Au bord de la place, sous les platanes, là où s’arrêtaient les cars — quand il y en avait — le docteur Devillequiers saisit dans un geste inattendu les mains de la jeune femme et les serra chaleureusement entre les siennes.
— À bientôt, ma chère Camille. Ah ! Je voulais vous dire… Réfléchissez à ma proposition, pour aller voir votre famille. Et n’hésitez pas à faire appel à moi en n’importe quelles circonstances. Je serai toujours heureux de vous rendre service !
Installée dans l’autocar qui filait sur la route de la plaine, et bientôt obliquait vers le coteau, Camille se rappela brusquement son cauchemar. Il n’avait rien à voir avec la guerre. Comme toujours il s’agissait de Roland, son mari. Il se débattait dans les eaux noires du fleuve et l’appelait. Il tendait la main vers elle, debout sur la rive. Elle se penchait et essayait d’attraper cette main. Au moment où elle allait y parvenir, Roland coulait…
— Arrêt pour le quartier du Chuzeau, annonça le chauffeur de car.
Puis, deux minutes plus tard, il s’arrêta pour déposer Camille et les élèves face au chemin qui montait vers le pensionnat, entre les talus poudrés de givre, où de vieux noyers, ça et là dressaient leur silhouette noire.
* * *
Camille remit une bûche dans le poêle et remua les braises avec le pique-feu. Puis elle tapota le tuyau et vérifia si la clé qui réglait le débit d’air se trouvait sur la bonne position. Tout était normal, et pourtant le poêle se refusait à remplir honnêtement ses fonctions. C’était souvent le cas avec ce vieil appareil en fonte, que l’on disait bon pour la ferraille, il n’y a pas si longtemps.
Arthur, le jardinier, époux de la cuisinière et homme à tout faire de Sainte-Marie-des-Anges, l’avait installé depuis qu’il était devenu impossible de se servir du chauffage central pour l’ensemble du collège. Seule, la chaudière destinée aux dortoirs des pensionnaires fonctionnait encore, mais très chichement. Car des pensionnaires, il n’y en avait plus, à part trois adolescentes séparées de leur famille par les événements. Aussi, la directrice les avait installées dans une petite chambre près de celles qui étaient réservées au personnel, contiguës à son appartement privé.
Les radiateurs, à peine tièdes, réussissaient tout juste à adoucir l’atmosphère. On gelait dans toutes les classes, garnies de poêles disparates, exhumés des remises ou des profondeurs des caves. Un demi-siècle de progrès technique partait en fumée avec la guerre ; on était revenu à l’âge de fer !
Camille fixa son regard sur l’une des hautes fenêtres. Elle apercevait, dans les jardins, les grands arbres dépouillés qui semblaient transis de froid, eux aussi.
« Un malheur ne vient jamais seul », disait souvent son père ! Le fait se vérifiait souvent. Ce début des années 1943 ne manquait pas à la règle. L’hiver se révélait très rigoureux, alors que les moyens de lutter contre le froid faisaient défaut, du moins pour la majorité des habitants des villes car, à la campagne, le bois ne faisait pas défaut.
Camille se remémora d’autres hivers terribles, celui de 1928 par exemple. L’année de ses dix-huit ans. Elle était alors pensionnaire à Lyon et préparait ses examens. Il y avait un autre hiver qu’elle avait gardé en mémoire, malgré son jeune âge — elle avait onze ou douze ans —, c’était après la Première Guerre mondiale. Son père avait cloué des bourrelets contre les portes et les fenêtres, mais la bise s’insinuait malgré tout dans leur maison, et sifflait dans la cheminée qui tirait mal. Le matin, les vitres étaient fleuries comme un coupon de dentelle du Puy. Pour apercevoir un bout de la rue, il fallait frotter énergiquement. Camille faisait chauffer un sou sur le poêle et l’appliquait sur le carreau. Il dégageait une petite lucarne ronde où l’on pouvait approcher tout juste un œil. Mais c’était suffisant. Dehors, il ne se passait pas grand-chose. Les gens se calfeutraient chez eux. Malgré le froid polaire, Camille manquait rarement l’école. Fille unique par la force des choses — sa mère, après plusieurs fausses couches, ne pouvait plus avoir d’enfants —, elle avait été choyée par ses parents. Elle portait un manteau douillet garni d’un col de fourrure, elle possédait des mitaines, un bonnet assorti et d’épais bas de laine. Ses pieds étaient toujours au sec dans des galoches de cuir souple, entourées au cou-de-pied d’un bourrelet qui avait pour but d’empêcher une irritation due au frottement du cuir contre la cheville.
En traversant leur quartier, elle retrouvait ses camarades de classe qui sortaient de leur maison. La plupart allaient nu-tête, grelottant dans un manteau trop léger, leurs gants troués ne protégeant pas leurs mains percluses d’engelures, leurs jambes rougies mal protégées par de minces chaussettes tire-bouchonnant sur des galoches au cuir rigide qui leur écorchait la peau.
La vie était difficile, autrefois, et ses parents avaient travaillé dur pour lui assurer bien-être et confort et, surtout, lui permettre d’accéder à des études supérieures. En pensant aux épreuves que sa mère avait subies, Camille ne se lamentait pas sur son sort, en dépit de la guerre. Elle était née en 1910 et elle avait quatre ans quand son père était parti au front.
Camille soupira. La folie des hommes ne cesserait donc jamais ? La jeune femme laissa son regard errer sur la quinzaine d’élèves qui constituaient sa classe de quatrième. Les fillettes étaient engoncées dans des lainages et chaussées de galoches, pour la plupart.
Certes, on n’aurait pas songé à tolérer un tel laisser-aller avant la guerre, mais tout avait changé. Avant les événements, l’uniforme était obligatoire pour les élèves qui fréquentaient l’établissement, aussi bien pour les externes que pour les internes. Le trousseau se composait de deux jupes plissées bleu marine, de deux chemisiers blancs et d’un chandail. Pour sortir, on mettait un blazer sur lequel on jetait une cape, l’hiver. Un béret crânement penché sur le côté complétait l’ensemble, sans oublier les chaussettes blanches qui devaient être impeccables. Une blouse grise, marquée au chiffre du collège, préservait les vêtements pendant la semaine.
Les classes allaient de la sixième à la troisième. On entrait à Sainte-Marie-des-Anges petite fille, jouant encore à la poupée, et parfois, on en ressortait jeune fille accomplie.
Camille demanda à Clotilde, une excellente élève, de lire à haute voix les trois meilleures rédactions, dont la sienne. Clotilde était une mignonne adolescente aux longues tresses brunes. Comme elle manipulait son cahier avec une certaine gaucherie, Camille remarqua qu’elle avait les doigts rougis par des engelures, et elle n’était pas la seule dans ce cas.
Le sujet de la rédaction était la camaraderie et l’entraide. Les petites s’étaient bien tirées pour la plupart de ce devoir difficile, qui nécessitait beaucoup de réflexion… et de cœur ! Camille sourit. Clotilde, qui admirait beaucoup son professeur, mettait en scène dans son texte une héroïne imaginaire, aux cheveux d’une belle nuance fauve. La jeune femme s’était reconnue sans peine dans ce personnage, tout au moins pour le physique, elle qui tentait de son mieux, chaque matin, de discipliner sa crinière de lionne.
La voix de Clotilde se tut. Le silence régna un instant sur la classe, tandis que quinze regards brillants se posaient sur le professeur.
— Très bien, Clotilde. Ton texte est remarquable et tu nous as tenues en haleine pendant la lecture.
Elle regarda les élèves et reprit :
— Est-ce que l’une de vous a encore des remarques à faire, à propos de l’entraide ?
Sur son banc, au premier rang, Sylviane Moirans s’agita, apparemment très intéressée par le cours, ce qui n’était pas toujours le cas. Elle était facilement distraite.
— Vous voudriez intervenir, Sylviane ?
Sylviane sembla se concentrer et elle allait parler quand, du fond de la classe, Jeannette, une petite rouquine maigriotte, prit brusquement la parole :
— L’entraide, Madame ? En temps normal, ou en temps de guerre ?
Camille était sur le point de répondre que les deux cas pouvaient être envisagés, quand elle eut conscience qu’un remous parcourait sa classe. Les yeux des gamines brillaient, elles ne tenaient plus en place. Toutes se mirent à parler à la fois. Il était question, non plus d’entraide, mais d’acte de courage, d’héroïsme, même.
Fascinée, Camille les écouta quelques instants sans intervenir. Elle venait de s’aviser que les regards des élèves se portaient sur les trois adolescentes pensionnaires à Sainte-Marie-des-Anges, Elvire, Margaux et Olga, comme si ce trio constituait le centre brûlant d’où partaient les rayons de cette étrange ardeur qui soulevait la classe.
La jeune femme se leva et fit quelques pas sur l’estrade où était installé son bureau. Perplexe, elle regarda les fillettes, véritablement déchaînées. Alors, elle frappa dans ses mains et le silence se fit.
— Nous reparlerons de tout cela une autre fois, et d’une manière plus… posée. Le cours va bientôt se terminer.
Elle avait oublié Sylviane, qui se tortillait toujours sur son banc. Aussi, fut-elle surprise quand la fillette leva la main.
— Oui, Sylviane ?
— Je voulais dire quelque chose, moi… Je peux ?
Camille, d’une voix douce, l’encouragea à s’exprimer… et tant pis si l’on débordait un peu sur l’horaire.
— Bien sûr, Sylviane. Nous vous écoutons. Mais dans le calme !
— Doit-on, même au péril de sa vie et de celle de son entourage, aider quelqu’un à sauver la sienne ?
Un silence total se fit, comme si les filles attendaient beaucoup de la réponse de leur professeur, et en même temps, quatorze regards étincelants, remplis d’inquiétude et d’une sorte de colère, toisaient Sylviane. Comme Camille hésitait, le tumulte revint brusquement, et elle mit longtemps cette fois à se faire obéir de ces enfants pourtant faciles, et à ramener le calme dans la classe. Il se passait quelque chose. Elle n’avait pas répondu à la question de Sylviane, et ne souhaitait pas y répondre, comme cela, de but en blanc, car le sujet lui semblait trop grave.
D’ailleurs, la fin du cours était dépassée depuis cinq minutes, la cloche avait sonné, et c’est avec soulagement qu’elle vit les fillettes se calmer et se lever pour se rendre dans la cour de récréation. Tandis qu’elles sortaient, Camille les observa. Son regard s’attarda sur Sylviane, menue et enfantine, qui ne paraissait pas ses treize ans, puis se porta sur les trois élèves les plus âgées, Elvire, Margaux et Olga, dont les quinze ans en imposaient un peu aux fillettes de quatrième, d’un ou deux ans plus jeunes qu’elles.
Une blonde à la peau claire, une brune à la peau mate, une autre blonde à la chevelure de lin, à la beauté nordique. Pensionnaires toutes les trois, elles étaient séparées de leurs parents que la guerre avait surpris à l’étranger. La similitude de leur situation les avait encore rapprochées et elles se comportaient comme si elles appartenaient à la même famille, celle des exilés, en fait.
Les adolescentes se répandirent dans les cours désertes et glaciales. Camille demeura encore un moment dans la classe, rangeant livres et cahiers. Elle réfléchissait à ce qui venait de se passer, et qui, sans aucun doute, tournait autour des trois inséparables. Puis elle s’avisa qu’il faisait froid. Avec tout ça, elle avait pratiquement laissé le poêle s’éteindre. Elle s’empressa de le regarnir et, quand elle quitta la classe, une cloche s’ébranlait à nouveau, conviant les demi-pensionnaires et les trois internes à rallier le réfectoire pour le repas de midi.
À son tour, Camille gagna la salle à manger des professeurs où elle retrouva ses collègues et la directrice de l’établissement, Odile Berthet, que l’on appelait derrière son dos « le dragon ». Certes, elle était sévère, mais juste, et son cœur débordait d’amour pour ses élèves.
Camille salua à la ronde. Sa collègue et amie Élise qui enseignait les sciences naturelles lui avait gardé une place près d’elle. Elles s’embrassèrent. Le repas fut pris rapidement, depuis qu’on avait plus les moyens de chauffer convenablement, il faisait froid même dans les pièces qui servaient tous les jours, et ce n’était pas très agréable de manger dans ces conditions.
Sans attendre le dessert, qui était constitué modestement d’une pomme cuite au four, la directrice quitta les lieux ; elle avait rendez-vous avec un parent d’élève. Camille échangea quelques mots avec Élise avant de se lever à son tour. Il était à peine treize heures lorsqu’elle retraversa les longs couloirs hantés par les courants d’air.
Les élèves étaient retournées en récréation, et certaines se réchauffaient en jouant au ballon prisonnier. Pensive, elle écouta la rumeur provenant des cris des enfants qui montaient de la grande cour et du préau. Elle ajusta son bonnet sur sa toison rebelle, resserra son châle autour de ses épaules et sur son manteau puis s’éloigna, contournant les bâtiments annexes, en suivant une petite allée bordée de rosiers taillés courts par Arthur.
Elle disposait de son après-midi ; elle pourrait corriger des copies et préparer la prochaine leçon. Mais rien ne pressait, et elle avait besoin de marcher. Aussi, elle ne descendit pas tout de suite vers la départementale où elle pouvait attraper un car. Comme elle le faisait souvent en sortant de Sainte-Marie-des-Anges, elle franchit les quelques cinq cents mètres qui séparaient La Côte-Saint-André du village de Gillonnay et elle grimpa jusqu’à la chapelle de Notre-Dame-du-Mont.
De là-haut, on jouissait d’une vue sublime sur les Alpes. Comme en gros plan, le massif de la Chartreuse, la chaîne de Belledonne aux pics aigus, et les falaises dentelées du Vercors se détachaient devant ses yeux. Plus à l’est, par temps très clair, on pouvait découvrir le Mont Blanc, et à l’ouest, le regard pouvait même s’attarder sur le massif du Pilat, ourlant la vallée du Rhône. Le panorama formait un grand cercle, et, à cet endroit, on réalisait vraiment que la terre est ronde.
Pratiquement par tous les temps, après le déjeuner, Camille marchait jusqu’à la minuscule chapelle. Généralement, la porte était ouverte, et elle entrait pour prier, mais elle pouvait aussi bien méditer en contemplant ce paysage dont elle ne se lassait pas. Quand la journée était claire, les montagnes couvertes de neige étincelaient sur l’immensité bleue du ciel. Ce jour-là, à cause de la brume et de la grisaille, seuls, les sommets de la grande Sûre et du Grand Sum, à l’est, étaient en partie visibles, et leur masse rocheuse où s’incrustait la neige semblaient supporter les nuages comme un fardeau.
À cet endroit, elle éprouvait toujours une impression de paix et de détachement profond. Elle ne faisait qu’un avec la nature. Camille avança jusqu’au bout du pré légèrement en pente qui s’étendait devant la chapelle. Elle s’arrêta au bord du fossé rempli d’une eau stagnante, prisonnière d’un épais couvercle de glace. Le manège d’un couple de bergeronnettes l’amusa un moment. Les deux oiseaux, de cette espèce qu’on appelle aussi hochequeue, voletaient au-dessus de la flaque d’eau entièrement gelée. Ils avaient soif ! Et, déconcertés, ils atterrissaient sur cette eau solidifiée. Ils glissaient sur leurs plumes ébouriffées, les pattes en déroute. C’était drôle et triste à la fois. Camille ne voulut pas prolonger inutilement leurs acrobaties pitoyables. Elle s’approcha davantage, faisant fuir malgré elle les étranges patineurs. D’un coup de talon, la jeune femme libéra l’eau captive et s’éloigna. Les oiseaux comprirent et revinrent sans peur. Ils se posèrent au bord de la flaque et burent.
Camille sourit et, un peu plus loin, malgré le froid, elle s’assit sur un tronc d’arbre mort. Les mains dans ses poches, son col relevé sous le châle, les oreilles bien au chaud sous le bonnet de laine, comme d’habitude, elle laissa son regard errer sur l’horizon. La plaine de la Bièvre s’étalait, découpée en rectangles et carrés, labours qui attendaient les semailles de maïs, parcelles où, déjà, le blé levait. Mais il y avait aussi les nombreuses jachères, résultat de la guerre, de la pénurie de main-d’œuvre masculine.
Vue d’en haut, la plaine ressemblait à un immense patchwork. C’était très différent de la vallée du Rhône et de ses îles luxuriantes cernées par les bras morts du fleuve — les lônes — où, depuis des générations, on avait planté des pêchers et des abricotiers, et où l’on pratiquait des cultures maraîchères. Sur le coteau ensoleillé, largement échancré vers le fleuve, s’étageaient des vignes et encore des vergers.
Ici, il y avait bien quelques vignobles qui donnaient un vin de pays qui se laissait boire, la Candive, une production toute locale, avec des ceps qui s’alignaient sur les marches les plus ensoleillées, mais ce n’était pas comparable avec les productions de la vallée où Camille avait grandi. Pourtant, comme elle s’était attachée à cette région ! Elle rêvait de la faire découvrir à son fils. Elle eut une pensée émue pour sa mère, pour son oncle et pour Petit-Lou. Elle allait leur écrire dès ce soir et leur raconter les exploits de patineurs sur glace de deux petits hochequeues assoiffés.
* * *
Le lendemain, à l’heure du déjeuner, Camille se hâtait vers la salle à manger des professeurs. Toutes les pelouses, les massifs si bien soignés qui faisaient l’orgueil de l’établissement avant la guerre, avaient été transformés en potager, aussi les légumes ne manquaient-ils pas, surtout en été et au début de l’automne. Hélas, ce n’était plus le cas en cet hiver rigoureux.
Un enclos abritait des poules, qui donnaient des œufs en temps normal. Mais en ce moment, avec le froid, les gallinacés ne pondaient guère, ce qui désespérait Marinette, la cuisinière.
Camille retrouva ses collègues autour de la grande table. Il y avait le professeur de mathématiques, Olympe Devillequiers, cette nièce du docteur Devillequiers dont il avait parlé à Camille lors de ses confidences inopinées, avouant qu’elle avait un caractère « spécial » et n’était jamais contente. On racontait qu’elle était dure avec ses élèves. Elle n’était pas tendre non plus pour les autres professeurs ! Camille n’éprouvait aucune sympathie pour Olympe, mais observait à son égard une très stricte politesse.
Marinette entra, avec le potage, que l’on consommait en toutes saisons, mais qui était particulièrement apprécié pendant ces périodes de grand froid. La directrice présidait le repas. Elle annonça aux professeurs qu’on bénéficierait pendant quelques jours de repas plus copieux. Étienne Moirans, le père de la petite Sylviane, avait fait parvenir au collège un don important — et bienvenu — de nourriture.
— En quel honneur a-t-il fait cela ? demanda Olympe en fronçant les sourcils.
— C’est un geste de sympathie. Ce monsieur en a les moyens et il veut nous aider, c’est tout.
— Il pratique le marché noir ! lança Olympe d’une voix pointue.
Personne ne releva l’accusation. On parla de Sylviane, si gentille et touchante, mais qui avait un peu de mal à suivre les cours. Elle vivait avec son père à Izeaux, à une quinzaine de kilomètres de là. Étienne Moirans la faisait conduire par un chauffeur le matin et, parfois, venait la chercher lui-même le soir.
On appréciait le bon repas, surtout la viande, qui manquait si souvent. Mais Olympe Devillequiers manifesta de nouveau son hostilité :
— Oui, j’aimerais savoir comment cet individu justifie la provenance de ces provisions.
La directrice se mit à rire.
— Monsieur Moirans possède, à ce qu’il m’a dit, une vaste ferme au pied de la Grande Sure, à Saint-Julien-de-Ratz, au-dessus de Voiron, dont il est, en titre du moins, propriétaire exploitant. Malgré les réquisitions, cela lui donne quelques facilités, m’a-t-il confié. Mais vous devez connaître tous ces détails, Olympe ? Il paraît que vous êtes apparentée à Étienne Moirans.
Olympe Devillequiers fit la grimace.
— Du côté de ma mère, oui… C’est un bien lointain cousin ! Mais nous ne l’estimons pas et ne nous vantons certes pas de cette parenté !
Camille pensait à ce que lui avait révélé le docteur Devillequiers. Certes, en ces temps de guerre, les Béroud, les métayers de la Maladière, ne fournissaient aux maîtres que le strict nécessaire, mais enfin, là-haut, ils avaient de la viande pour tous, puisqu’ils élevaient des moutons. Et leurs quelques vaches fournissaient du lait.
Olympe mangeait sans regarder personne, comme si chaque bouchée lui coûtait. La directrice soupira. Avec l’âge, cette excellente personne, veuve d’un officier de police, était devenue indulgente. Tout en se resservant sans aucun complexe, Odile Berthet s’exclama :
— C’est fou ce que, parfois, un bon repas peut réconcilier avec l’existence !
Tout le monde applaudit, sauf Olympe. Il y eut comme une trêve. On oublia un instant le froid, les restrictions, et même la peur, qui restait tapie dans tous les cœurs. Avec bonhomie, Odile Berthet s’enquit :
— Êtes-vous satisfaite de vos élèves de quatrième, Camille ?
Le regard insistant de la directrice s’attardait sur la jeune femme, tandis qu’elle poursuivait :
— On m’a laissé entendre qu’elles étaient particulièrement difficiles, en ce moment !
Camille garda prudemment le silence.
— C’est une classe intenable, lança Olympe Devillequiers, et, perfide, elle regarda Camille :
— Vous qui êtes leur professeur principal, vous devez tout de même avoir remarqué leur indiscipline !
Camille secoua la tête.
— Ce sont de bonnes petites, promptes à s’enflammer, et encore espiègles, c’est vrai, mais c’est bien de leur âge !
— Leur niveau en mathématique est bien faible ! poursuivit Olympe d’une voix acerbe. En tout cas, moi, si la jeune Sylviane continue à obtenir d’aussi mauvais résultats dans ma partie, je m’opposerai certainement à ce qu’elle passe en troisième l’année prochaine !
Odile Berthet et Camille se regardèrent, esquissant un sourire résigné. Et parmi les professeurs, personne ne fit écho à la déclaration d’Olympe, qui en fut pour ses frais.
Camille enfila son manteau et, saluant à la ronde, se leva pour sa promenade habituelle.