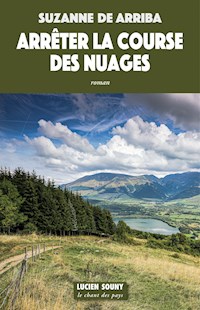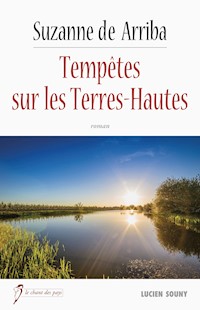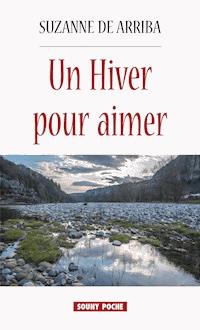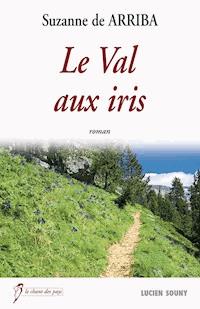Loin sur la gauche, des moutons bêlaient avec cette petite voix qui paraît toujours un peu triste quand on n’a pas l’habitude de l’entendre. Puis ces faibles cris qui ressemblaient à des pleurs d’enfants se firent plus ténus et se diluèrent parmi les autres sons.
Mélodie n’avait pas accompagné son père, car c’était le dernier jour de classe. Jean Lebrun faisait pâturer les chèvres du côté du dolmen au lieu-dit la Pierre Blanche. Pendant les vacances, cette tâche incombait souvent à la fillette et elle en était heureuse. Le moment du retour était aussi plaisant que celui du départ. Espiègles, les biquettes étaient un peu fofolles tout le long du chemin. Pour franchir la porte étroite de l’étable, encadrées par Mélodie et par le chien, elles se plaçaient en rang, deux par deux, comme des écolières. Mélodie aimait aider son père à s’occuper de leur troupeau, une fois rentré. Elle passait beaucoup de temps à étriller les bêtes, ôtant de leurs longs poils d’un brun roux les débris végétaux, les piquants de chardon que les gloutonnes avaient croqués après s’être roulées dessus. Pourtant, quand elles en avaient l’occasion, elles choisissaient leurs herbes avec gourmandise.
Mélodie préférait les chèvres aux moutons, qu’elle trouvait parfois un peu bêtes. Sa vieille amie Wanda était de son avis, bien qu’elle soit très attachée à ses brebis. Les chèvres sont si malignes, si coquines, affectueuses, aussi. Mais pas toujours
simples à gérer !
La fillette sourit. Les gens s’imaginent le métier de chevrier comme quelque chose de romantique, une promenade dans la nature
avec des biquettes une fleur entre les dents. En réalité, c’était un travail très prenant.
Mélodie poussa la lourde porte de chêne de leur ferme, et rentra, déposa son cartable dans un coin de la pièce à vivre. En vacances ! C’était grisant. Elle allait pouvoir s’occuper chaque jour du troupeau avec son père. Rendre visite aussi à Gillian Lestraz et à son mari Paul, qui était en outre son instituteur. Et passer du temps avec Wanda, dont le modeste
logis se trouvait à moins de cinq cents mètres de leur demeure familiale. Tout le long de leur chemin privé, de vieux arbres morts avaient été transformés en sculptures par Jean. Après la mort de sa femme, il avait travaillé ces troncs promis à la hache, pour consoler Mélodie, encore si petite. Et pour se donner un but, également, pour ne pas sombrer dans le désespoir et être tenté de laisser tomber ceux qui comptaient sur lui. À cette époque, il avait bien failli perdre la foi. Lui, qui soignait les autres, il n’avait rien pu faire pour sa bien-aimée. Elle n’était même pas décédée à la maison, comme elle l’aurait souhaité. Tout était allé si vite, la leucémie qui l’avait emportée en quelques mois ne pardonnait pas. Et puis Wanda avait enterré son vieux compagnon, Lazare. Elle aussi avait besoin d’aide.
Entre les personnes qui réclamaient ses services, Wanda, le quotidien à gérer, Mélodie et bien sûr les chèvres, il lui restait peu de temps pour pleurer sur son sort. Alors il se
couchait plus tard et se levait plus tôt.
Mélodie prit du pain dans la maie et deux barres de chocolat. Elle sortit. Draco
avait accompagné son père, mais en fait c’était elle la véritable maîtresse de l’énorme chien blanc, et tandis qu’il remplissait très sérieusement son rôle de berger, supposait-elle avec raison, il devait être pressé de la retrouver.
La fillette suivit le chemin du dolmen. Dans la montagne, tout était si beau, si pur, si frais. La lumière du ciel bleu allait illuminer l’été de Mélodie. Elle avait commencé un herbier et, à la maison, quand elle triait son butin, elle s’aidait de livres spécialisés traitant de la flore de montagne. Paul Lestraz lui en avait offert un
exemplaire relié pour son anniversaire, avec des photos magnifiques.
Émerveillée, elle découvrit des épilobes et des plants d’arnica dont les fleurs n’étaient pas encore écloses. Elle avait dressé une liste des espèces qu’on ne devait pas cueillir. Cependant il en restait tant d’autres dont certains spécimens enrichiraient bientôt son trésor.
Les pieds dans les fleurs, elle se redressa brusquement. Elle avait perçu le chant cristallin d’un instrument à vent. Cette musique l’attira comme un aimant. Mélodie contourna un tertre recouvert d’une herbe drue. Derrière, se trouvait une pâture tout en longueur. Quelques moutons y broutaient, éparpillés près d’une maison basse dont le toit prolongeait la pente. C’était la demeure de Wanda.
La femme jouait de la flûte. Elle était grande et sèche, robuste, pourtant, le visage tanné par la vie au grand air. Ses cheveux blancs étaient noués en arrière par un foulard rouge. Elle avait les pieds nus dans des sandales et elle
portait une longue jupe chamarrée et un poncho marron. Ainsi accoutrée, Wanda ne manquait toutefois pas d’allure. Elle était arrivée dans la montagne après les événements de mai 1968, avec son compagnon. Elle n’avait pas eu d’enfant et n’en souffrait pas, enfin, on le disait. Elle se complaisait dans la solitude, on
le disait aussi. Cependant, elle avait de l’amitié pour son plus proche voisin, Jean, qui veillait sur elle discrètement. De son côté, elle l’aidait à choisir les plantes dont il avait besoin pour ses préparations et elle en récoltait souvent pour lui.
Brunette et Loupiot, les chiens de Wanda, qui avaient reconnu Mélodie faisaient les fous autour d’elle.
— Bonjour, Wanda.
— Ah ! Te voilà, ma petite Mélodie ! Ça me fait plaisir de te voir. Et l’école ?
— L’école ? C’est fini, Wanda. Jusqu’à la rentrée.
— Je parie que tu es contente !
— Oh oui ! Je l’ai même dit à M. Lestraz qui m’a remontée à Combelouve, pourtant ça ne l’a pas vexé. Lui aussi est content d’être en vacances. Vous avez trouvé des plantes pour papa ?
— Oui, et pour ton herbier également. Tiens, si tu veux m’accompagner chez moi, je te les donnerai. J’en ai assez pour aujourd’hui et les moutons aussi !
Le petit troupeau suivit docilement la bergère, recadré il est vrai par les chiens bien dressés. Bientôt tout ce petit monde arriva devant la vieille maison, qui semblait faire corps
avec la montagne.
— Tu entres une minute, Mélodie ?
La demeure de Wanda était vraiment très modeste, mais quand il faisait beau le soleil y pénétrait à flots et la pièce principale où une cheminée monumentale tenait un pan de mur scintillait de lumière. Il n’y avait pas l’électricité. Wanda puisait son eau au puits ou à la source proche. Elle vivait de peu, presque de rien. Ses quelques brebis lui
donnaient des agneaux qu’elle vendait. Elle confectionnait aussi du fromage, pour son propre usage. Elle
percevait une petite retraite, car, naguère, avant l’ère de l’ordinateur, elle avait été correctrice dans une imprimerie, où son compagnon était linotypiste. Qui l’aurait cru, quand on ne connaissait pas cette femme et que l’on voyait sa masure de l’extérieur ? Une étagère occupait toute la cloison en face de la cheminée et tous les rayonnages étaient remplis de livres.
Une fois par mois, Wanda s’habillait en personne civilisée et descendait au bourg afin de se rendre à la poste et d’y retirer la majeure partie de sa mince retraite. Elle en profitait pour faire
les courses indispensables. Jean Lebrun la conduisait parfois, mais souvent,
pour ne pas déranger, elle prenait un taxi, boudant l’autocar qui ne passait que le matin et le soir, car elle détestait attendre.
Wanda n’était pas une Dauphinoise pure souche ; toutefois on avait oublié qu’elle venait de Paris, tant elle s’était intégrée et fondue dans l’environnement. Hormis le père de Mélodie et les Lestraz, on ne savait pas qu’elle avait pratiqué un métier ni qu’elle avait fait sa révolution en 68, ce qui lui avait donné des idées pour changer radicalement son mode de vie. Lazare, son compagnon adoré, qu’elle n’avait pas voulu épouser pour rester en accord avec leurs opinions, se louait à droite, à gauche. Il était décédé subitement, quelques années plus tôt, d’un problème cardiaque qu’il ignorait. Seule désormais, Wanda vivait toujours comme elle l’avait fait en compagnie de Lazare, très simplement, entre ses moutons, ses volailles, son chien Loupiot, sa chienne
Brunette et ses livres.
Wanda posa sur la table le panier qu’elle transportait quand elle sortait ses bêtes. Il contenait son tricot, son casse-croûte, également quelques bouquins, ceux qu’elle relisait sans cesse ou bien ceux que lui prêtait Jean Lebrun, qui lisait beaucoup lui aussi, pendant les longues soirées d’hiver, lorsque ses nombreuses activités lui en laissaient le loisir.
— Wanda, vous avez aperçu mon père du côté de la Pierre Blanche ?
— Je ne l’ai pas vu, mais je pense qu’il se trouvait là-bas avec vos biques. Il y a une heure, j’ai entendu aboyer ton chien ; sa grosse voix est reconnaissable.
— Draco doit m’attendre avec impatience. On ne se quittera pas pendant mes vacances. Je lui ai
expliqué.
— Et je suis bien certaine qu’il a compris ! commenta Wanda, attendrie.
Elle-même entretenait une grande complicité avec ses chiens, néanmoins l’attachement entre Mélodie et Draco était vraiment exceptionnel. De son côté, Mélodie scrutait le visage de sa vieille amie. Cette figure cuivrée par le grand air, dont la peau collait aux méplats, ne l’effrayait pas ; il émanait d’ailleurs de cette femme une dignité singulière.
La bergère et l’enfant s’étaient assises l’une près de l’autre, devant le feu que Wanda avait ranimé et qui brûlait en toutes saisons. Wanda semblait avoir oublié tout à coup sa petite compagne. Mélodie devina qu’elle était retournée dans son passé, quand Lazare vivait. Elle se leva doucement, déposa un baiser sur le front barré de trois rides profondes, et se sauva, pressée de retrouver son père et bien sûr Draco.
***
Collines et champs cultivés laissèrent la place à des garennes et à des guérets. La végétation s’était raréfiée et de grands pins noirs bordaient la route. Après un virage plus raide encore que les autres, les arbres s’écartèrent et les montagnes apparurent, majestueuses, écrasantes aussi, faisant sentir à celui qui les contemplait son insignifiance. Dans les combes et les ravines
cascadait une eau dont le bruit frais montait jusqu’au chemin.
Paul et Gillian supposèrent, avec une certaine émotion, qu’il s’agissait du ruisseau de la Salette. Celui-ci se précipitait dans le Drac qui moussait au fond de son lit de rochers.
Après un dernier virage en épingle à cheveux, ils trouvèrent Corps. Ils dépassèrent la bourgade. Elle se tenait frileusement à l’abri des montagnes et elle avait à peine changé au cours des dernières décennies. Gillian sentait son cœur battre plus vite, plus fort, tandis que ses oreilles bourdonnaient. Ils étaient tout de même à plus de mille deux cents mètres d’altitude. Enfin, ils arrivèrent en vue du lieu de pèlerinage. Il ne restait plus que quelques kilomètres à parcourir et la récompense était au bout du chemin. Malgré sa fatigue, Gillian ne pouvait s’empêcher d’admirer le paysage grandiose et impressionnant, et la barrière des rochers déchiquetés au-dessus du torrent qui grondait.
La jeune femme ne détacha son regard du panorama que lorsque Paul arrêta la voiture, tout en haut de la route.
— Eh bien, nous y voilà, ma chérie. C’est une véritable expédition que tu m’as fait entreprendre ! lança-t-il gaiement en se tournant vers son épouse.
Ils sortaient peu, en effet, sauf quand Gillian exposait dans les environs. Ils
se trouvaient si bien chez eux ! Paul n’était pas tellement attiré par les sanctuaires. Pour lui, les édifices religieux représentaient avant tout des œuvres d’art, un témoignage de ce que pouvaient accomplir les hommes au nom d’un idéal. Mais Gillian avait insisté. Elle était croyante, sa femme ! Et elle avait une grâce à demander à la Vierge de La Salette. Oh ! Paul savait laquelle, cependant il se gardait bien d’en parler, afin de ne pas raviver la blessure.
— La Salette-Fallavaux, dans le Haut-Dauphiné…, récita Gillian avec sérieux, comme une petite écolière. La première pierre du sanctuaire haut perché a été placée en 1852. Celui-ci fut ouvert au public avant que soit achevée la construction des deux flèches dominant l’édifice.
— Tu es parfaitement documentée, ma chérie.
— Tu sais bien que l’histoire de ce sanctuaire me passionne.
Gillian sourit, songeuse, et expliqua :
— C’est à La Salette, en 1846, que Marie, la mère de Jésus, est apparue à deux jeunes bergers, Mélanie, quatorze ans, et Maximin, onze ans, des enfants de la montagne – comme Mélodie, notre petite protégée.
— Mélodie, elle, n’a jamais eu d’apparition !
— Ne te moque pas, Paul. Et laisse-moi poursuivre. Ces enfants savaient à peine réciter le Notre Père et le Je vous salue Marie. Ils ne fréquentaient pas souvent l’église et pourtant le Créateur les avait choisis pour instruments de ses desseins.
Gillian racontait l’histoire pour la centième fois à son incrédule de mari. Il était ému par sa foi si profonde…, faute d’être touché par la grâce ! Quant à Gillian, elle eut soudain la certitude que son vœu allait être exaucé.
Paul regardait sa femme. Il avait bien fait de l’accompagner à La Salette, elle avait l’air si heureuse ! Le vent soulevait ses cheveux, ses joues se coloraient de rose. Elle était jolie et paraissait plus jeune. Il entoura les épaules de Gillian d’un bras protecteur. Il en oubliait presque Jenny qui, depuis quelque temps,
avait pris autant d’importance dans leur vie… Dans son cœur aussi, et cela, Gillian l’ignorait. Elle ne devait pas s’en douter. Pour rien au monde il n’aurait voulu la blesser.
— Il paraît que Marie leur est apparue, assise sur un rocher, le visage enfoui dans ses
mains, poursuivit Gillian. Elle semblait pleurer. Ses vêtements irradiaient, sa voix était mélodieuse. Elle leur a dit : « Ne craignez point, mes enfants, je suis ici pour vous annoncer une grande
nouvelle ! » Puis elle leur a parlé en patois parce qu’ils ne comprenaient pas bien.
Gillian s’enfiévrait. Paul, lui, restait calme. C’était un sceptique, elle le savait, mais il était si bon, si humain. Il ne croyait pas à la survie de l’âme. Il prétendait que l’on saute dans la mort comme on saute dans le vide.
Depuis quelques mois, Gillian avait remarqué un changement : il était souvent songeur, absent même, et, quand elle s’adressait à lui, il sursautait, comme pris en faute. Du moins, c’était l’impression qu’il donnait. Elle ne voulait pas le questionner. S’il avait un problème, il finirait bien par lui en parler. Sans doute souffrait-il, lui aussi, de
ne pas avoir un petit être de son sang à chérir. Elle en ressentait de la culpabilité. Lui, il pouvait faire des enfants, il avait passé des examens qui s’étaient révélés positifs. De son côté, elle n’était pas stérile, elle avait seulement des difficultés à concevoir. Alors un miracle était toujours possible.
Paul tenait encore Gillian par l’épaule. Ils s’éloignèrent de la voiture.
— Tu n’as pas froid, au moins, ma chérie ?
— Je suis bien couverte, mais je vais mettre mon foulard.
Il l’aida à nouer la mousseline légère autour de sa tête. Dans ces étendues sauvages, le vent soufflait constamment. Il faisait frais, même durant l’été. En ce mois de septembre, les pèlerins et les touristes qui n’avaient pas pris soin de revêtir un anorak ou un polaire claquaient des dents.
Le foulard glissait. Gillian le passa autour de son cou et remonta sa capuche.
— Nous aurions dû emmener Mélodie, elle aurait été contente de découvrir ce paysage grandiose.
— Il aurait fallu aussi prendre Draco avec nous, répliqua Paul en riant, et tu l’imagines au milieu des pèlerins ?
— Généralement, la petite vient chez nous sans qu’il la suive forcément.
— Parce qu’il a réussi à lui fausser compagnie, pour vaquer à ses propres affaires. Ou que Jean l’a réquisitionné pour l’aider à rentrer le troupeau.
— Non, ce n’est pas ça. Mélodie a peur qu’il dérange. Il est énorme et si pataud…
— C’est vrai que je ne le connais guère, ce fameux Draco. Draco… Pourquoi ce nom ?
— À cause du Drac, je crois, « l’impétueux fiancé de l’Isère »… Ou plus exactement de la légende qui en a fait un monstre.
— Draco n’a rien d’un monstre, je suppose !
— Oh non ! répondit Gillian en riant. C’est le bon gros ! Il a un caractère en or et il se ferait hacher pour la petite ! C’est curieux que tu ne l’aies jamais vu !
— Il ne la suit pas à l’école, que veux-tu ! Et c’est fort heureux !
Gillian saisit Paul par la main et ils se dirigèrent vers une statue à l’effigie de la Vierge. Celle-ci avait été représentée debout, s’entretenant avec les deux enfants. Son visage pur exprimait une infinie
tristesse. Le sculpteur avait reproduit très précisément le costume décrit par les bergers : la robe couverte de perles, comme en portaient autrefois le dimanche les
paysannes, le petit crucifix autour du cou, qu’on apercevait dans le V formé par le fichu croisé sur sa poitrine, et les souliers ornés de roses écloses.
Gillian alluma plusieurs cierges et pria, de tout son cœur, pour que son vœu soit exaucé. Ce n’était pas un souhait égoïste et sa réalisation comblerait aussi Paul.
Puis ils redescendirent la nef, poussés par le flot humain que grossissaient sans cesse de nouveaux groupes de pèlerins. L’édifice résonnait d’une musique que Gillian trouva céleste. L’odeur des fleurs épanouies et des bougies qui se consumaient doucement étourdissait quelque peu la jeune femme.
Paul, prosaïque, chuchota qu’il avait faim. Gillian le suivit à l’extérieur, encore tout émue et troublée. Le vent froid les surprit. Elle resserra son foulard sur sa tête et respira profondément. Ce grand souffle vivifiant nettoyait l’âme en même temps que les poumons. En bas, au fond de petites vallées, les prairies en pente verdoyaient et le village de Corps, ainsi que les
hameaux disséminés autour, montraient leurs toits au ras des nuages.
— Il est trop tard pour déjeuner, trop tôt pour goûter, mais c’est tout de même l’heure de se remplir l’estomac ! lança Paul avec bonne humeur.
Ils dévorèrent leur pique-nique, debout dans une nappe de soleil, puis réintégrèrent leur véhicule ; il fallait bien songer au départ. Gillian, avant de partir, avait acheté quantité de cartes postales et de menus souvenirs pieux, chapelets, médailles ; pourtant elle s’en allait à regret. Elle aurait aimé rester plus longtemps à La Salette. Paul, pour sa part, avait hâte de rentrer, à présent. Il devait assurer ses cours, le lendemain. Toutefois, il conduisait
lentement, pour laisser à son épouse le temps de faire la transition. Et ils s’arrêtèrent à plusieurs reprises afin d’admirer des sites et de prendre des photos.
Ils arrivèrent chez eux tard dans la nuit. Gillian emportait avec elle le souvenir d’heures bien émouvantes avec un Paul qui, pour une fois, n’était pas du tout triste ni pensif. Elle conservait la vision de la basilique
flottant très haut au-dessus des toits et de la brume montagnarde. Toutes ces images lui
avaient donné envie de peindre et de dessiner.
***
Ce même dimanche, Mélodie courait dans la montagne avec son chien.
— Plus vite, Draco ! Allons, ne me fais pas attendre !
Cependant Draco ne se pressait pas. Tout le sollicitait au cours de leurs
promenades : une odeur, une fleur, un oiseau qui s’envolait juste devant lui. Quant à Mélodie, elle adorait rechercher des traces de passages d’animaux sauvages. Elle savait reconnaître celles laissées par les sabots des chevreuils, celles de la belette si friande de petits
rongeurs et aussi de lézards. Celles de la fouine, qui avait le même menu, sans oublier des fruits, des baies et des insectes, et qui avait volé parfois des œufs chez Wanda. Et Mélodie n’aurait pas confondu les empreintes d’un renard avec celles d’un chien, bien que pour le profane elles soient presque semblables. Car la trace
du chien se distingue surtout de celle du renard par le resserrement des
pelotes antérieures.
Mélodie et son inséparable Draco étaient passés voir Wanda, comme ils l’avaient fait tout l’été. À présent, la fillette avait moins le temps ; il avait bien fallu retourner à l’école. Néanmoins elle profitait à fond de son mercredi après-midi et des fins de semaine. Wanda lui avait préparé des tartines de confiture. Elles avaient goûté ensemble ; après quoi la gamine lui avait demandé de lui jouer un air sur sa flûte, avant de s’envoler comme un moineau.
— Allez, dépêche-toi, traînard ! gronda gentiment Mélodie.
Draco faisait la sourde oreille. Indulgente, elle attendit son compagnon qui s’attardait au pied d’un arbre, flairant la mousse, y détectant des odeurs qui paraissaient le laisser perplexe. Le temps était très chaud et l’enfant retroussa les manches de son pull-over.
Tout en bas, elle apercevait les champs où les maïs destinés au bétail étaient encore sur pied pour plusieurs semaines. Les prairies très vertes, les premiers bosquets couleur de rouille qui précédaient l’étage des forêts et les modestes parcelles labourées, façonnaient une campagne pareille à un habit d’Arlequin. Encore plus bas, pointait le clocher, qui semblait signaler aux
passants le chemin du ciel.
Mélodie n’était pas descendue jusqu’au hameau où vivaient les Lestraz. À quoi bon ! Ses amis étaient partis pour La Salette. « C’est un lieu de pèlerinage ! » avait expliqué Gillian, qui avait quelque chose à confier à Marie du Ciel. Une grande faveur à réclamer. Mélodie n’avait pas osé lui demander de quoi il s’agissait ; pourtant, elle croyait deviner.
Draco l’avait rejointe enfin et, à présent, l’enfant se faufilait à travers la végétation encore épaisse, escaladant les talus, sautant à pieds joints les ruisselets, dévalant les pentes sur ses petites jambes infatigables.
Un instant, elle s’arrêta pour suivre des yeux l’énorme insecte volant au-dessus de la grande combe : quelqu’un faisait du deltaplane.
Elle repartit, flanquée de l’énorme chien. La montagne était son domaine et Jean la laissait vagabonder à sa guise. Il avait confiance en elle, lui, au moins. Comme Wanda. Mais pas
Gillian ni Paul qui se faisaient toujours du souci ! Ils avaient tort. Il ne pouvait rien lui arriver de mal. Elle n’était pas seule : elle avait Draco.
La fillette franchit par un gué de pierres le torrent où se regroupaient tous les ruisselets de cette partie de la montagne. Sur la rive
opposée se mêlaient sureaux, prunelliers et épines-vinettes. Certains de ces derniers arbustes atteignaient trois mètres de haut. Mélodie savait qu’on ne devait pas cueillir leurs baies avant maturité, car elles étaient légèrement toxiques. Néanmoins, en automne, son père et Wanda en ramassaient pour les consommer crues ou cuites. La plante était considérée dans son ensemble comme assez vénéneuse. Cependant, l’écorce des tiges et des racines possédait des propriétés anti-inflammatoires et même antimicrobiennes, après préparation. Toutes les particularités du vinettier étaient inscrites dans le grand cahier tenu à jour par Jean, et Mélodie y apprenait bien des choses.
Il était trop tard pour monter vers la forêt, marcher dans le sous-bois et sa lumière glauque. Sur les versants semés de gros cailloux, des traînées d’un rose terne signalaient que la floraison des bruyères s’achevait.
L’enfant s’assit sur un rocher à la forme élancée. Elle avait l’impression de chevaucher une bête préhistorique. Draco s’était allongé à quelques mètres, un peu haletant. L’horizon se diluait dans une brume blanche, un silence extatique régnait.
— C’est beau, mon chien, n’est-ce pas ?
Draco ne réagit pas. Son regard demeurait braqué sur un point précis. La petite abandonna à regret sa monture de pierre. Le chien la suivit sur quelques mètres.
— Chut ! Draco, ne bouge plus, reste tranquille, chuchota Mélodie.
La fillette retenait son souffle. Plus bas, à l’endroit où le torrent s’élargissait en calmant les ardeurs de son cours, un bel animal s’avançait pour boire. C’était un cerf venu de la forêt. Un jeune, un hère, aux bois inachevés.
— Sois sage, Draco ! Il ne faut pas l’effrayer. Il est si beau !
Déjà, l’animal apeuré détalait. Il fonçait vers la ceinture de taillis et se faufilait par une trouée de la végétation. Ses sabots véloces couchaient les branches basses et déchiquetaient les frondaisons jaunies.
L’enfant remonta le cours du torrent sur quelques mètres, comprimant sous ses mains les battements fous de son cœur. Mais le cerf était déjà loin. Elle se résigna à faire demi-tour.
Il fallait rentrer, à présent, et par le chemin le plus court, sinon son père s’inquiéterait. Elle se mit en route, suivie par Draco. Passant sous un pin planté comme une borne à l’entrée de son territoire, elle donna une caresse furtive à cet arbre qu’elle connaissait bien. Il ferait beau encore quelque temps. Les écailles des babets – les pommes de pin – s’ouvraient pour libérer leurs graines.
Et pourtant bientôt le soleil cesserait de prodiguer sa chaleur. Il deviendrait paresseux et
sortirait de plus en plus tard de dessous sa couette de nuages. Il finirait par
se cacher pour dormir plus à son aise. Les nuits redeviendraient longues. Mélodie s’en moquait. Elle aussi adorait paresser sous l’édredon, l’hiver.
***
Jenny Martin, docteur en médecine générale, était montée jusqu’au domaine des forestiers. Un homme s’était blessé sur une coupe et on avait fait appel à elle. Dieu merci, ce n’était pas très grave.
En redescendant, elle avait eu envie de mieux connaître cet endroit. Elle avait laissé sa voiture au bord de la route, et elle avait marché dans un chemin tapissé d’aiguilles de pin, jusqu’au moment où elle était arrivée sur une espèce de grand replat cerné de genêts et de bruyères. Par temps clair, de ces hauteurs, la vue était admirable, et la nature où Jenny évoluait apaisait quelque peu sa douleur, douleur morale qui ne lui laissait
aucun répit. Soudain, elle aperçut la petite fille. Celle-ci portait un chandail troué aux coudes, un blue-jean plutôt élimé, et ses baskets avaient connu des jours meilleurs.
La gamine l’avait vue aussi.
— Qu’est-ce que tu fabriques ici toute seule ?
Mélodie recula vers un sentier caché sous les frondaisons.
— Je cherche Draco.
— Draco ?
— C’est mon ami. Il est parti se promener seul aujourd’hui. Papa dit qu’il est amoureux. Mais ça ne dure jamais bien longtemps.
— Qui est ton père ? demanda Jenny qui ne comprenait rien aux paroles de l’enfant.
— Jean Lebrun.
Jenny se raidit. C’était un nom qu’elle n’aimait pas entendre.
— Il est vraiment imprudent de te laisser vagabonder comme cela toute seule !
— Oh ! Je ne suis pas loin de la maison. Elle est au bout du sentier et c’est comme pour le proverbe à propos de Rome : « Tous les chemins mènent à Combelouve ! »
Jenny ne daigna pas sourire de la répartie. Troublée par l’air sévère de cette dame, la fillette s’enfuit brusquement. Jenny essaya d’abord de la rattraper. Les branches basses, sous lesquelles Mélodie passait sans difficulté, la frappaient au visage, et la végétation touffue où se faufilait la sente l’impressionna. Elle renonça et fit demi-tour. Cette rencontre, Dieu sait pourquoi, avait gâché sa promenade.
Elle remonta dans sa voiture. À présent, la route descendait, engagée entre les taillis, sous la futaie où avait déjà eu lieu le balivage, action qui consiste à faire évoluer un taillis en futaie. Elle l’avait appris par ses amis Lestraz. L’odeur balsamique de la résine flottait dans l’air. Les cimes des arbres cachaient le ciel. Quand il reparut, l’ombre des nuages sembla plus légère.
***
D’habitude, Mélodie remontait seule de l’école, ou bien avec Paul Lestraz. Mais ce jour-là, son père ayant eu à faire au village, il s’était arrêté pour la prendre en voiture.
Mélodie sauta au cou de l’homme jeune encore qui lui souriait. Elle jeta son cartable à l’arrière du véhicule. Jean Lebrun l’aida à boucler sa ceinture de sécurité et démarra aussitôt.
Bientôt ils traversaient le bourg. L’enfant restait muette.
— Tu boudes, ma chérie ?
— Non, papa.
— Tu en fais une tête, pourtant !
— Je déteste l’école, déclara Mélodie âprement.
— Ce n’est pas nouveau, ça. Cependant tu aimes bien ton maître.
— Oui, mais ça n’empêche pas.
— Pourquoi n’aimes-tu pas l’école, me le diras-tu, Mélodie ?
La fillette haussa les épaules. Jean n’insista pas. Il chercha à la distraire en lui désignant les pentes reboisées. Toutes ces dernières semaines, suant malgré le froid, les hommes avaient creusé des trous pour repiquer les jeunes sapins, à cet endroit fortement incliné que d’anciennes coupes avaient nettoyé plusieurs décennies auparavant.
— Tu grandiras plus vite que ces sapins ! Et dans quelques années, tu verras comme ce sera un coin agréable.
L’enfant sourit. Rien, ici, ne lui demeurait étranger. Elle connaissait chaque sentier indécelable à l’œil sous le couvert des arbres, chaque pouce de la route qui s’entortillait et se déroulait tour à tour le long de la forêt. Le col de l’Âne était là-haut. C’était aussi un lieu qu’elle aimait. Et il y avait les sources qui surgissaient, si limpides à fleur de terre après des périples souterrains et compliqués. Quand on buvait cette eau, tout le corps s’emplissait de vent frais, et la bouche s’imprégnait d’un goût d’herbes aromatiques et de cresson sauvage.
— Les jeunes sapins ont l’air d’avoir bien pris, pas vrai, papa ? Tu crois qu’ils vont donner beaucoup de pousses ?
— Oui, ma chérie. Ils vont croître tout doucement. Je suis content de voir que l’on reboise ce versant, cela fait des années qu’on aurait dû s’en occuper. Enfin, le résultat est là et les arbustes se sont parfaitement acclimatés. À présent, rentrons vite. Les chèvres nous attendent pour la traite.
— Et Draco aussi nous attend ! s’exclama Mélodie qui avait recouvré sa bonne humeur. Tu ne l’as pas laissé sortir, au moins, aujourd’hui ?
— Si. C’est sans risque, la saison des amours est passée, je crois. Et puis tu n’as pas de souci à te faire. Quand Draco te fausse compagnie – bien rarement –, il revient toujours à la maison.
— Je l’aime tellement, mon Draco. C’est mon seul ami, je veux dire… de mon âge.
— Oh ! Tu sais, Draco est certainement plus vieux que toi, si l’on compte en années « chien » !
— Oui, mais lui, il est à mon niveau. On se balade et on joue ensemble sans problème. Remarque, il y a aussi des adultes que j’aime bien.
— Wanda et les Lestraz, je sais, ma chérie.
— On peut leur faire confiance, j’ai l’impression. Ils ne me décevront pas.
— Je le pense, chérie. Et je suis là aussi, et tu peux tout me dire !
— Oui, mon papa. Je t’aime fort.
Jean Lebrun regarda tendrement sa fille. Elle était tout ce qui lui restait d’un grand amour de jeunesse.
Ils rentrèrent. Mélodie prépara son goûter, le dévora avec un bel appétit et rejoignit son père à l’étable. Leurs chèvres étaient de race alpine et donnaient beaucoup de lait. Elles étaient robustes, rustiques, belles aussi avec leur robe chamoisée ou noire et brune. L’étable, où elles demeuraient pendant la mauvaise saison, était vaste, orientée à l’est, et le soleil pénétrait généreusement par les deux lucarnes. Le sol pavé de larges pierres plates était légèrement incliné pour que les urines puissent se déverser dans une rigole. Les bêtes, que Jean n’attachait pas hormis pour la traite, avaient à leur disposition un râtelier toujours bien garni, une auge remplie d’eau, un bachat contenant de l’avoine mélangée à de l’orge, céréales qui complétaient, le soir, leur nourriture à base de foin et bien sûr d’herbe fraîche et fleurie quand les chèvres sortaient. Leur litière était constituée de paille craquante, renouvelée chaque jour.
Jean les avait d’abord nourries, car ensuite ces dames souvent capricieuses et exubérantes étaient plus tranquilles pendant qu’il leur soutirait leur lait. Mélodie imita son père et prit un tabouret qu’il avait fabriqué exprès pour elle, l’adaptant à sa taille. La fillette attacha la chèvre qu’elle voulait traire, lui plaça sous le nez quelques branches de noisetier, une friandise qui allait l’occuper suffisamment pour qu’elle se laisse faire avec docilité. Mélodie nettoya consciencieusement les trayons avec un tissu humide, les sécha avec soin. Au début, les pis lui semblaient élastiques ; à présent, elle se débrouillait presque aussi bien que son père. Elle saisit un trayon entre son pouce et son index, serra, ferma le poing.
Le lait jaillit dans le seau avec son petit bruit caractéristique, que Mélodie adorait entendre.
Après la traite, Jean avait l’habitude de masser les mamelles des biques, car le lendemain il était plus facile de tirer le lait. Mélodie fit de même. Son père arrivait à traire trois chèvres alors qu’elle en était toujours à la première ; c’était normal, il le lui assurait, et il ne manquait jamais de la féliciter pour son travail, ce qui la rendait très fière.
— Tu as eu beaucoup de patients aujourd’hui, papa ? demanda-t-elle plus tard.
— Une demi-douzaine. Est-ce que tu peux mettre le couvert ? J’ai préparé ta soupe préférée, celle au potiron.
— Et il y aura de la crème ?
— Bien sûr.
L’enfant avait regagné la maison, flanquée de son inséparable Draco. Tout était si calme ! Et, de l’extérieur, seul lui parvenait le murmure des feuillages en mouvement.
Après le souper, devant le feu, Jean fit réciter sa poésie de la semaine à la petite fille. Il avait conscience de ce qui la tourmentait à l’école : les autres ! Comme il la comprenait ! Cependant il devait l’encourager à se montrer un peu plus sociable. Pour son bien.
Jean lava la vaisselle, et Mélodie l’essuya et la rangea dans le buffet. Elle monta se coucher la première, mais il savait qu’elle l’attendrait. Quand tout fut en ordre, il la rejoignit, s’assit près de son lit et lui raconta une histoire. Il ne tenait aucun livre entre ses
mains. Pourtant, il n’inventait pas. Chaque soir, lorsqu’il n’était pas appelé d’urgence au chevet d’un patient – ce qui, Dieu merci, n’arrivait quand même pas tous les jours –, il mettait en scène, pour sa fille, les animaux des bois ou les oiseaux, dans le cadre le plus
fabuleux dont on puisse rêver enfant : la montagne et la forêt.
Jean contempla Mélodie endormie. Très jeune, il avait aimé ; il avait eu cette petite. La douleur d’avoir perdu sa bien-aimée lui avait fait sublimer les exigences de son corps. Il avait sa fille, ses
patients, son troupeau, et l’on ne pouvait pas dire qu’il avait le temps de s’appesantir sur ses états d’âme. Mais parfois la solitude lui pesait, le soir, surtout, quand il regagnait
son lit. Alors il rêvait d’un visage de femme, qu’il inventait.
***
Jenny Martin avait la quarantaine, mais conservait une apparence juvénile. Son visage était encore avenant, malgré un passé douloureux qui aurait pu marquer ses traits. Elle avait espéré l’apaisement en s’installant dans ce petit village du Haut-Dauphiné.
Elle se souvenait de ce premier printemps où elle avait découvert les champs et les arbres en pleine floraison. L’odeur de la campagne lui avait rappelé ces mois de mai et de juin, tout de sève et de fleurs, avec les processions le long des chemins, dont lui parlaient
ses parents.