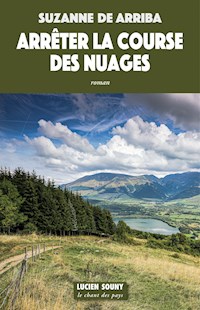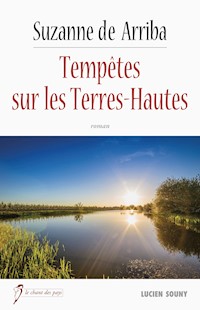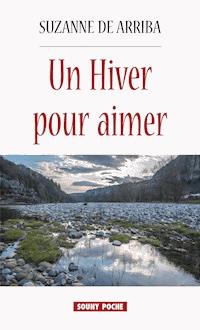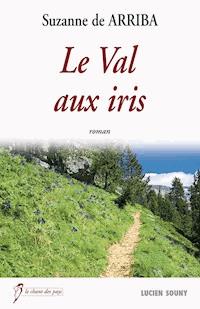Quand il contemplait l’horizon grandiose qui s’offrait à lui chaque jour de sa vie, Thomas Garon, réputé sauvage et bourru, sentait son cœur s’émouvoir. Il ne croyait ni en Dieu ni au diable ; pourtant, dans ces moments-là, il éprouvait le besoin de crier : « Merci ! » Merci à qui, à quoi ? Il ne savait pas et ne voulait pas savoir.
Tout était encore très vert dans la campagne et les moutons dispersés semblaient rivés à leur touffe d’herbe. Satisfait, l’homme leva la tête vers le ciel. Il se révélait d’un bleu fragile, presque transparent. Le vent s’était mis à souffler, balayant le moindre recoin de ce ciel trop limpide. Ce n’était pas un vent d’ouest, prophétisant quelque averse. L’automne ne s’annonçait pas encore. Thomas n’était pas pressé, mais une bonne pluie n’aurait pas été pour lui déplaire, au contraire. Le vert immuable des sapinières ne signalait pas de changement, pourtant un peu partout, précocement, s’insinuaient des taches couleur de rouille. Les arbres aussi avaient soif et,
bientôt, le jaune safran des bouleaux, le rouge flamboyant des merisiers, les cuivres
des hêtres et des chênes composeraient une symphonie de couleurs. Les pentes, le matin, du côté de l’ubac, se napperaient de la blancheur d’une gelée encore inoffensive.
Thomas aimait ce moment passé près des moutons, laissés la plupart du temps à la garde de sa chienne Frisquette, un animal de pure race briarde. La bête était bien charpentée ; vigoureuse, elle pesait ses quarante kilos. Elle savait se comporter avec le
troupeau, son autorité et son esprit d’initiative étaient remarquables.
L’éleveur avait la chance de posséder de grandes parcelles de prairies ; aussi, il utilisait la méthode du pâturage tournant. Les ovins y étaient installés dès les premiers beaux jours jusqu’à l’automne – en fait, jusqu’au moment où l’herbe avait jauni et s’était raréfiée. Son seul problème était l’absence d’une source ou d’un puits, et cette année l’été avait été torride, même dans leurs collines au pied du Vercors, où la bise soufflait souvent.
Son regard s’attarda sur sa gardienne à quatre pattes. Frisquette était indispensable au troupeau, car les pâtures n’étaient pas totalement closes, il lui restait des kilomètres de grillages à poser. Pour fermer, il avait privilégié les endroits qui présentaient quelque danger pour les ovins. Mais l’éleveur ne désespérait pas de protéger entièrement son domaine. Il passait beaucoup de temps chaque année à compléter les clôtures, autant qu’à les réparer. Il se promit d’y travailler avant l’hiver, quand ses livraisons de bois s’espaceraient.
L’hiver, Thomas ne le craignait pas. Et il n’avait pas l’occasion de s’ennuyer ; il fallait se lever tôt pour aller nourrir les bêtes, avec du foin et des grains. Sa journée n’était pas terminée avant vingt et une heures, quelquefois davantage.
Il imaginait déjà ses longues soirées paisibles au coin du feu, lisant sous la lampe, avec Frisquette couchée à ses pieds et ronflotant de plaisir. Ce serait un répit bien mérité, qui lui permettrait de faire face, ensuite, aux nombreuses heures de veille du
mois de février, au moment de la naissance des agneaux. Certains éleveurs provoquaient un agnelage à l’automne, lorsque les jours raccourcissent, par injections d’hormones. Thomas, pour sa part, restait fidèle au cycle naturel. Il était passionnément attaché à son troupeau, mais s’efforçait de ne pas s’attendrir devant les jolis agneaux. Car leur destin, sauf exception pour les
femelles et certains mâles destinés à devenir des béliers reproducteurs, était d’être vendus et abattus.
Thomas Garon était grand et costaud, avec un regard gris qui vous fixait droit dans les yeux,
pas souvent, car il vivait plutôt retranché du monde, sur les hauteurs du village, très précisément aux Sapets.
D’un pas alerte, l’homme termina son inspection. Il connaissait si bien les alentours de sa demeure
qu’il aurait pu se déplacer les yeux fermés. Mais pour l’instant, ses yeux étaient bien ouverts et venaient de remarquer deux points qui avançaient entre les bouquets de bouleaux dispersés sur la pente. Deux personnes montaient. Bientôt il reconnut une femme et une petite fille.
— Boudiou ! Qui vient nous déranger ?
La chienne pointait les oreilles, remuait la queue d’une manière apaisante. Elle n’aboyait pas. Pourtant, elle était aussi bonne gardienne que bergère. Et son regard d’ambre rassurait le maître. Allons ! Les collines appartenaient à tout le monde. Sauf que ces gens se trouvaient sur ses terres, aux Sapets. Il n’aimait pas les invasions d’enfants bruyants avec leurs moniteurs chargés de guitares et de sacs à dos, qui venaient randonner, ou bien les promeneurs, les touristes, parfois,
car on n’était pas loin des stations du Vercors, agréables aussi bien l’été que l’hiver. Alors, lui, il s’arrangeait pour se claquemurer dès qu’il entendait l’écho des rires de gosses ou des refrains que des voix enfantines scandaient.
La femme qui avançait sur le sentier était très jeune. Et la fillette n’avait sûrement pas plus de huit ans. Elle était blonde, et ses mèches pâles se dispersaient autour de son visage mince, rougi par l’effort. Frisquette battait de la queue de plus belle. « Tu as intérêt à être poli ! » semblait lui signifier sa chienne.
Curieuses, les brebis avaient tourné la tête vers les arrivantes et elles bêlaient, dans un bel ensemble.
— Bonjour, monsieur.
La jeune femme était vêtue d’un blue-jean, coupé à hauteur des genoux, et d’un tee-shirt de coton. En dépit de cette tenue, elle avait une allure très féminine. Elle se présenta avec simplicité, elle s’appelait Annelise Boulet. Elle expliqua sa démarche. Elle était correspondante locale du quotidien, mais à l’occasion elle effectuait quelques reportages, que le journal passait en pages régionales.
— Vous signez vos articles ?
— Rarement. Mais ça arrive, tout de même.
— Vous n’êtes pas d’ici, je ne vous ai jamais vue au bourg. Il est vrai que je ne descends pas
souvent, et, quand je vais faire des courses, je ne m’attarde pas.
— Je ne suis pas du coin, en effet, répondit-elle. Je me suis installée au village l’année dernière.
Thomas ne lui demandait rien, mais elle se confia, et pourtant l’attitude bourrue de son interlocuteur ne l’y encourageait pas. Elle élevait seule sa fille, Florette. Elle avait loué une vieille maison au hameau des Pins, dans cette partie du village que l’on appelait les Froides-Collines et à laquelle les Sapets appartenaient.
— Une maison pas très confortable, remarqua Thomas. Je connais le propriétaire, il n’est pas du genre à faire des travaux !
— Oui, mais le loyer est vraiment à ma portée.
Elle avait une voix douce, elle semblait si vulnérable que Thomas, à sa grande surprise, sentit son cœur s’émouvoir. S’il avait eu une fille, il aurait aimé qu’elle lui ressemblât. C’était lui à présent qui l’interrogeait, tout en regardant la fillette qui jouait avec la chienne.
— Et vous gagnez votre vie au journal ? On m’a dit que les correspondants ne sont guère payés.
— C’est juste un complément, mais qui n’est pas négligeable. Je fais surtout des traductions pour un éditeur, ce qui me permet de rester chez moi et d’élever ma fille.
Il la trouvait courageuse. Elle ne le dérangeait pas ; au contraire, il était content d’avoir fait sa connaissance et aussi celle de ce petit bout de gamine aux cheveux
si blonds, vive comme un lutin. Et l’élan de sympathie qu’il ressentait était assez nouveau. Il n’avait pas l’habitude d’aller vers les autres, de les accueillir. À force de vivre en ermite, avec ses moutons ou dans la forêt, il avait perdu le contact avec ses semblables.
Annelise Boulet en vint au but de sa venue.
— J’ai l’intention de me lancer dans un reportage sur les éleveurs de la région. J’ai déjà vu votre voisin, Aloïs Castanet, et il m’a bien reçue.
— Aloïs aime avoir de la visite, il n’est pas aussi sauvage que moi.
— Je ne vous trouve pas du tout sauvage, s’écria-t-elle spontanément.
La fillette se retourna et se mit à rire. Thomas adoucit sa grosse voix pour poser cette question :
— Pourquoi ris-tu, petite ?
— Parce que je trouve que vous êtes très grand et très large…
— Large ? Tu veux dire « gros » ?
— Non, non, très costaud, et vous ressemblez à un dessin qu’il y a dans un de mes livres.
— Ah bon ? Que représente ce dessin ?
Florette pouffa, et avoua, un peu confuse :
— Un ogre !
Il prit le parti d’en rire.
— Je n’ai encore jamais mangé personne, même si j’ai mauvais caractère.
Annelise Boulet aurait voulu faire taire sa fille, mais il était trop tard, et l’éleveur ne paraissait pas fâché. Le portrait qu’en avait fait Florette était juste. Thomas était une force de la nature. Ses épaules larges semblaient faites pour porter le poids du monde. Sa moustache
rousse lui donnait l’air d’un Gaulois. Il avait une chevelure fournie et, si sa tenue avait été moins négligée, il aurait été très séduisant, en son genre. Annelise, qui, par sa fonction, rencontrait beaucoup de
personnes, savait que ce robuste quinquagénaire avait eu dans sa jeunesse une histoire sentimentale avec Marianne
Lebreuil, le maire de la commune. Une histoire qui n’avait pas abouti. C’était Marianne, selon la rumeur, qui avait interrompu l’idylle naissante.
Quel dommage que ces deux-là ne puissent se réconcilier ! Marianne Lebreuil était veuve, Thomas Garon était toujours célibataire. Ils allaient vieillir chacun de leur côté, en ennemis intimes, alors qu’ils auraient pu unir leur solitude et retrouver l’émoi de leurs jeunes années. Annelise, très sentimentale, trouvait que c’était du gâchis. Oui, ils étaient jeunes encore et pouvaient envisager l’avenir. Puis elle se morigéna. Elle n’avait pas à juger. Pas à rêver la vie des autres, même si Marianne autant que Thomas lui étaient sympathiques. Et elle, dans ce cas, pourquoi s’obstinait-elle dans ce célibat qui lui pesait pourtant ? La réponse coulait de source : tout simplement parce que son expérience avec Alexandre, le père de sa fille, l’avait vaccinée contre le fait de se risquer dans une nouvelle relation. Peut-être aussi qu’elle n’avait pas eu l’occasion de rencontrer la bonne personne. Jusqu’à Jim Vernioz… Mais le frère de Marianne ne la regardait pas, il ne savait même pas qu’elle existait, bien qu’elle le croisât souvent à la mairie. Et il n’était pas libre, elle l’avait aperçu plusieurs fois avec une très jolie jeune fille.
— Elle n’a pas la langue dans sa poche, votre gamine !
Annelise sursauta. Elle avait perdu le fil de la conversation durant un instant
et elle se demanda ce qu’avait pu dire encore Florette. Elle était embarrassée et elle se hâta de dévier la discussion :
— Aloïs Castanet a un chien superbe.
— C’est un des colleys élevés et dressés par Jim Vernioz, observa Thomas avec une grimace.
Jim Vernioz… Rien que d’entendre prononcer ce nom, Annelise était troublée. Pouvait-on tomber amoureuse d’un homme à qui l’on n’a jamais adressé la parole, simplement parce que tout en lui vous plaît et vous fait fondre, sa silhouette, le son de sa voix, sa façon de marcher… « Il faut que je me l’enlève de la tête, se persuada Annelise, je n’ai rien à en attendre. »
Thomas Garon poursuivait :
— Les colleys dressés sont de bons bergers peut-être, mais ils ne tiendraient pas tête à un loup !
— Un loup ? Pourquoi vous dites ça, monsieur Garon ?
— Pour rien. Je veux simplement dire que les colleys de Jim Vernioz ne sont pas
aussi vaillants que ma Frisquette, qui se ferait tuer si on attaquait une de
ses ouailles. Alors, qu’est-ce que vous voulez savoir, jeune dame ?
— Tout, répondit-elle, car je connais peu le milieu de l’élevage.
— Eh bien, interrogez-moi, et même je vous propose un sujet de reportage inédit. Ça vous changera des comptes-rendus sur les matchs des juniors ou sur l’affaire débile de la Joncheraie.
— Débile ? Pourquoi dites-vous cela ? Je trouve ce projet formidable, moi.
— Stop. Ne parlons pas de ça, sinon nous allons nous disputer, jeune dame. J’ai mieux à vous offrir : j’ai convoqué un sourcier, et je vous assure, ce brave homme a du talent ! Quand il y a de l’eau à trouver quelque part, il la trouve ! Sa baguette est comme ensorcelée. La séance vaut le coup d’œil.
— Vous avez besoin d’eau ?
— Oui. J’en ai assez de transporter des bacs. Même si au pré les moutons boivent moins qu’à l’abri, il leur faut tout de même de la flotte. Cet été qui est particulièrement sec m’a décidé.
— Je viendrai. Cette séance peut faire l’objet d’un article intéressant, en effet.
— Mercredi prochain. Vers les quinze heures. Vous pourrez amener Florette bien sûr.
Il observait la petite fille qui avait pris Frisquette par le cou.
— Tu as l’air d’aimer les bêtes, toi !
— Oh oui ! J’ai un chien moi aussi, mais il est vieux, et il est resté à la maison. Il s’appelle Léon.
— C’est un joli nom pour un chien !
Le regard gris de Thomas avait croisé le regard bleu de l’enfant et le miracle avait eu lieu. Pour la première fois depuis longtemps – depuis Marianne, son premier et son seul amour, Marianne qu’il détestait aujourd’hui –, Thomas Garon était apprivoisé.
***
Il n’y avait pas de loup alpha ni de loup oméga, pour la bonne raison que la meute n’existait pas : il n’y avait qu’un couple, le mâle et la femelle, qui fondaient leur propre famille.
Depuis quelques mois, ils sillonnaient de vastes étendues, plus vite qu’un météore traverse l’espace. Ils étaient orphelins. Leurs parents avaient disparu. D’autres membres de leur meute avaient été tués par les hommes : un quota permettait d’abattre un certain nombre de loups par an, par tirs de prélèvement.
Ils étaient si jeunes encore, quand ils avaient entrepris ce long périple à travers les montagnes. À peine huit mois, et c’était encore l’hiver. Un hiver assez doux, heureusement. Certains loups, pour diverses raisons,
quittent leur meute natale entre neuf et trente-cinq mois. Mais ils n’étaient pas prêts. L’absence de leur mère créait un vide énorme, son enseignement inachevé les laissait désemparés.
Deux, ce n’est pas beaucoup. La vie en groupe présente des atouts pour la chasse. Il leur fallait tout expérimenter d’un coup, se souvenant du peu que la louve leur avait appris.
Nés au printemps, ils en avaient traversé un autre avec bien des épreuves et parfois la faim au ventre. Mais l’été depuis son début était prodigue de dons. Ils devinaient vaguement que l’automne serait une étape à franchir, une passerelle entre les beaux jours et la saison rude dont ils
gardaient un souvenir d’épouvante.
L’année dernière, louveteaux joueurs et choyés par leurs parents, ils avaient vu les arbustes ployer sous le poids des baies,
les écureuils amasser leur magot de glands dans un grand envol de feuilles jaunes.
Ils avaient senti épaissir leur robe, à l’époque où les canards sauvages passaient au-dessus des montagnes. Mais cette année, ils devraient passer la mauvaise saison sans aide, ils grandiraient, seuls. L’âge adulte et le temps des amours étaient loin encore, ils n’avaient pas atteint la maturité sexuelle, qui s’acquiert vers les deux ans. La faim, le froid, la nécessité de trouver au moins des petites proies les contraindraient à marcher davantage, à mettre tout en œuvre pour subsister, malgré leur inexpérience.
Mais le temps était de leur côté, et, s’ils avaient survécu alors qu’ils étaient si jeunes et démunis, la mauvaise saison les trouverait plus forts, aguerris. En attendant, c’était l’été, et les proies ne manquaient pas.
La nuit tombait quand ils parvinrent à l’extrémité d’un plateau. Alors ils lancèrent leur cri, ce hurlement particulier à leur espèce, mais seules les étoiles au ciel l’entendirent et c’était bien ainsi.
***
Thomas Garon ne fermait pas les volets de sa chambre. Le jour, en se levant, lui
servait de réveille-matin. Il ouvrit les yeux, puis les cligna. Le mur en face de son lit
avait pris une jolie coloration rose. Il se dressa d’un bond, s’étira longuement et, nu, ouvrit la fenêtre. Le soleil écartait les brumes de ses doigts d’or, pour laisser filtrer une aube tendre. Il respira à fond, puis il se dirigea vers le cabinet de toilette où il prit une douche froide. Comme il ne se rasait que tous les trois ou quatre
jours, il se contenta de passer un peigne dans sa tignasse hirsute, après avoir enfilé un pantalon de toile et un pull-over troué aux coudes : les matinées étaient fraîches, à plus de sept cents mètres.
Il alla réchauffer du café de la veille et s’en versa un grand bol. Il but, debout, pendant que Frisquette avalait ses
croquettes. Puis il sortit pour aller voir ses moutons. L’été, il avait moins de travail, le troupeau restait à l’extérieur, mais il vérifiait soigneusement la bonne forme de ses bêtes. Cette surveillance quotidienne lui permettait d’intervenir aux premiers signes d’un problème sanitaire. Les parasites internes représentaient le principal souci de santé. La bonne gestion des pâturages avec des rotations fréquentes évitait les ennuis. En outre, Thomas laissait pousser l’herbe qui constituerait les futurs fourrages, suffisamment haut pour empêcher l’ingestion de larves de parasites. Aux Sapets, aucune de ses bêtes n’avait contracté le piétin, maladie infectieuse provoquée par une bactérie qui cause des ravages dans les tissus cornés des onglons. Aussi, l’hiver, quand les animaux étaient confinés dans la bergerie, il respectait scrupuleusement la propreté des litières. Il n’hésitait pas à faire appel au vétérinaire si une mise bas s’annonçait mal, et bien sûr il le convoquait pour vacciner les bêtes, ainsi protégées contre bon nombre d’affections.
Le vaste pâturage était entouré d’un côté par des haies, à l’ombre desquelles les moutons pouvaient se reposer quand il faisait très chaud. En juin, les bêtes avaient été débarrassées de leur toison. C’était nécessaire, mais cela constituait une grosse charge financière pour des petits éleveurs comme Thomas ou Aloïs Castanet qui ne vivaient pas vraiment de leur troupeau. On vendait bien la
laine, mais le prix au kilo ne représentait pas grand-chose, comparé au prix de la tonte. Il était loin le temps où on utilisait l’épaisse toison des moutons pour garnir les matelas ! Qui couchait aujourd’hui sur un matelas de laine ?
Thomas avait construit plusieurs abris sur ses pâtures. Il laissait les mères nourrir les petits, car il ne fabriquait pas de fromages comme Aloïs. Il s’approcha d’un jeune qui commençait à brouter depuis peu et il l’observa. C’était un animal gracieux, mais déjà robuste. Il faisait partie de ces agneaux dits « gris », ou « broutards », ou encore « tardons », qui se nourrissent à la fois d’herbe et du lait de leur mère. Ils seraient prochainement vendus pour leur viande, à partir du mois de septembre.
Avec sa chienne qui savait exactement ce que son maître désirait, l’homme évoluait parmi le troupeau, avec calme et assurance. Les ovins le connaissaient
et ils ne s’enfuyaient pas à son approche, au contraire. Thomas ne voulait pourtant pas s’attacher à chaque animal en particulier ; le destin de ces agneaux, des mâles surtout, était de devenir de la viande de boucherie. C’était triste, mais c’était ainsi, la loi de la chaîne alimentaire. Il fallait bien gagner un minimum d’argent pour que tourne l’exploitation, et on ne pouvait pas garder toutes les bêtes.
Plus tard dans la matinée, Thomas rentra afin de se préparer un casse-croûte. Son regard s’attarda sur la façade de la maison et ses pignons. Au niveau du toit, ils dépassaient des couvertures et formaient des gradins. C’était une architecture que l’on retrouvait surtout sur le grand plateau du Vercors, mais aussi parfois plus
bas et même dans le nord de l’Isère. Un procédé qu’on appelait toits en sauts de moineaux ou bien en pas d’oiseaux ! Cette dénomination très poétique couvrait la nécessité de rehausser les pignons pour éviter que la violence du vent abîme la toiture. Et lors des précédentes tempêtes, Thomas avait pu en vérifier l’efficacité.
Il entra chez lui, passa dans la cuisine. Le pain se trouvait encore sur la
table. Il sortit un saucisson du garde-manger grillagé, à l’ancienne, où il plaçait aussi ses fromages. Un système de poulie permettait de descendre cette sorte de cage à la hauteur de la table. Cela ne datait pas d’hier, et Thomas avait voulu préserver la méthode instaurée par son grand-père. Il se prépara un copieux casse-croûte, qu’il arroserait d’un verre de bon vin. Un verre, oui, c’était tout ce qu’il s’autorisait par jour, depuis des années… Il ne voulait surtout pas penser à sa dernière cuite qui remontait à sa jeunesse. Car c’était ce jour-là qu’il avait perdu Marianne, irrémédiablement.
Tout en dévorant, il regardait autour de lui, avec satisfaction. Après la mort de son père, à force d’ingéniosité et de patience il avait su tirer parti de cette grande baraque en pierres de
taille, bâtie pour défier le temps. Il en avait fait un intérieur confortable. Télévision, congélateur, rien ne manquait. On l’accusait de vivre en ermite, mais pas plus qu’Aloïs Castanet, et il n’était pas un sauvage pour autant ; Annelise Boulet, cette gentille journaliste, pouvait en témoigner, se dit-il avec un sourire, évoquant aussi l’adorable Florette. Lui, qui n’avait pas d’enfant et n’en aurait jamais, se sentait une âme de papy gâteau en compagnie de cette moucheronne.
Ce qui le hérissait, en fait, c’était de penser à Marianne. Et il y pensait trop souvent à son goût ces derniers temps. Des années durant, il avait pu tenir à peu près son image à distance, surtout pendant l’époque où elle avait été mariée. Mais, depuis qu’elle était à la tête de la municipalité et qu’elle lui avait demandé de vendre une parcelle inculte près des marécages de la Joncheraie, il ne décolérait plus. Que croyait-elle ? Qu’il allait accepter, trop content de lui plaire ?
— Elle m’emmerde ! dit-il à Frisquette, qui, perplexe, leva vers lui sa tête ébouriffée.
Rassasié, Thomas rangea le pain dans la maie et fit remonter la cage grillagée au plafond. Il avait à faire à l’extérieur, et il reviendrait pour un second casse-croûte vers une heure. Le soir, il se préparait de la soupe, il en avait parfois pour deux ou trois jours. Il n’avait pas le temps pour des repas élaborés. À la rigueur, une omelette, un plat de pâtes, oui, c’était dans ses possibilités, mais la soupe c’était sacré, une habitude des familles, une tradition même, que la plupart des gens ici et ailleurs dans la campagne observaient. Il
chercha son feutre pour s’en coiffer, car le soleil cognait déjà. Puis il hésita, revint sur ses pas. Dans un tiroir de son bahut, il y avait une photo
jaunie, découpée dans un journal et protégée par un plastique. Il avait soudain envie de la revoir. C’était le jour du mariage de Marianne avec René Lebreuil. Il lui suffisait de la regarder pour raviver sa colère. Le morceau de papier tremblait entre ses mains. Comme chaque fois qu’il s’abandonnait à ces réminiscences amères, il eut envie de froisser l’article, d’en faire une boulette qu’il jetterait au feu, mais il résista de nouveau, et replaça le fragment de journal à sa place, dans le tiroir.
Ce René Lebreuil était si insipide ! Qu’avait-elle pu lui trouver ? Il ne lui avait même pas fait un enfant ! Puis, vaguement honteux, Thomas se souvint avoir aperçu Marianne enceinte, une fois. Elle avait perdu son bébé à la naissance, il l’avait appris par Aloïs Castanet qui se tenait au courant de tous les potins du village. Il est vrai
qu’elle avait élevé son frère, un gamin qui aurait pu être son fils, étant donné leur différence d’âge. Il n’avait que huit ans quand il s’était retrouvé sans ses parents. Jim Vernioz… Son presque voisin. Ils n’étaient pas des ennemis, il leur arrivait même de discuter avec sympathie. Lui, il n’avait rien contre Jim, en fait. Il cristallisait toute sa colère et sa rancune sur Marianne. Ses regrets, aussi, mais cela il ne l’aurait admis pour rien au monde.
Pourtant, quand elle n’était encore qu’une gamine, elle l’admirait, lui, Thomas Garon ! Il était son héros ; ne l’avait-il pas trouvée, un jour qu’elle s’était égarée en pleine tempête de neige, et ramenée au village sur son tracteur équipé d’une étrave ? Il était bien plus âgé qu’elle, mais, absorbé par son travail sur la propriété, il n’avait pas trop le temps de courir les filles. Quand il avait un besoin trop
pressant, il allait voir une professionnelle qui vendait ses charmes, en ville.
Et puis aucune ne lui plaisait, parmi celles de ses conscrites qu’il connaissait et qui auraient pu faire une bonne amie ou une fiancée très acceptable. Mais celle-là, qui prenait treize ans, puis quatorze, et qui le regardait d’une façon si tendre, il s’était mis à éprouver pour elle un sentiment très doux, très particulier. Il s’était dit : « Je vais attendre qu’elle grandisse ! » Un jour elle avait eu seize ans ; elle était sortie avec lui, presque officiellement. Il voulait l’épouser, lui, tout de suite, mais il n’osait pas en parler, car elle était encore bien trop jeune.
Et puis il avait commis ce geste stupide, qui les avait éloignés l’un de l’autre.
C’était l’année des dix-sept ans de Marianne, et lui, il était un homme déjà ; huit ans de plus, ça compte. Il avait des désirs qu’elle ne ressentait pas, ne pouvait même pas deviner. Ils s’étaient retrouvés à la fête votive. Thomas était avec des copains, elle des amies. Il avait forcé un peu sur la boisson. Ça lui arrivait quelquefois, à cette époque. Il était agacé parce qu’elle faisait mine de l’ignorer et qu’elle préférait papoter avec ses camarades. En fait, Marianne avait parfaitement remarqué qu’il avait bu et elle était indignée, elle ne comprenait pas. Pour elle, qui ne l’avait jamais vu dans cet état, c’était un comportement inacceptable. Le bal avait commencé vers dix-sept heures. Il était allé l’inviter, mais elle avait refusé. Il avait bien conscience qu’elle détournait la tête pour échapper à son haleine explicite, et, au lieu de regretter son comportement, il était furieux parce qu’elle le fuyait. Il n’avait pas l’habitude de boire, et il avait le vin mauvais. Elle avait dansé avec des garçons de son âge, et lui, il avait continué à picoler avec ses copains. Vers dix-neuf heures, elle avait pris son vélo pour regagner la maison de ses parents, dans un autre hameau, à l’opposé des Froides-Collines. Alors il avait décidé de la suivre et de l’arrêter pour s’expliquer. Il l’avait dépassée avec sa voiture qui zigzaguait, en était descendu, et s’était posté à l’entrée du chemin qu’elle devait emprunter. Elle portait une robe blanche et des sandales dorées ; ses cheveux qu’elle avait longs à l’époque volaient sur ses épaules. Elle était grande et belle, elle avait un corps de femme, même si elle conservait une véritable innocence. Et ce soir, particulièrement, elle le rendait fou.
Comment en était-il arrivé là ? Il s’était laissé entraîner bien trop facilement par ses copains et il en ressentait les effets
pernicieux. Si son père avait été encore de ce monde, jamais il ne se serait comporté ainsi, car Pierre Garon ne plaisantait pas avec la morale et le respect qu’on doit aux femmes.
Elle arrivait ! Soudain il avait surgi, comme un diable hors de sa boîte. Il avait immobilisé le vélo par le guidon. Fiévreux et volubile, il lui avait dit sans ambages qu’elle n’était plus une petite fille, elle était devenue bien belle, il pensait sans cesse à elle et voulait lui faire l’amour. Pourquoi ne pas laisser ce vélo de côté et monter dans sa voiture ? Il l’emmènerait jusque chez lui, aux Sapets, où ils seraient bien tranquilles, puisqu’il vivait seul, à présent. Et il en avait assez ! Mais pour le moment ce n’était pas à l’avenir qu’il pensait. L’alcool lui était monté à la tête, il avait le feu aux reins et l’objet de ses désirs était à sa portée ! Il se croyait tout permis, brusquement, fort de cette adoration qu’elle lui vouait depuis son âge le plus tendre. « Laisse-moi passer, tu es saoul ! » lui avait crié Marianne, dégoûtée. Il lui avait alors débité de ces sottises que disaient les jeunes pleins de sève qui avaient trop arrosé la fête votive.
Le vélo était tombé, Marianne avait eu peur et cette peur exaspérait Thomas autant que les dérobades de celle qu’il considérait comme sa future femme, même si le mariage était une option encore lointaine. Maladroit, il avait attrapé la main de celle dont il rêvait jusqu’alors si chastement. Il avait touché ses cheveux, son visage, son cou. Marianne avait reculé. Il l’avait attrapée et serrée contre lui, et des doigts impatients s’insinuaient sous son corsage.
« Lâche-moi, lâche-moi ou j’appelle à l’aide ! »
Elle pouvait bien crier, Thomas n’en avait cure. Il avait essayé de la faire monter de force dans sa voiture. Mais Marianne l’avait mordu au bras et, de surprise, il l’avait lâchée. Alors elle lui avait échappé et s’était mise à courir. En temps normal, il l’aurait rattrapée, mais il vacillait sur ses jambes. Confusément, à travers les brumes de l’alcool, il comprenait qu’il avait dépassé les bornes.
« Attends, avait-il crié d’une voix enrouée, attends donc, Marianne, je t’aime, je ne veux pas te faire de mal ! Je regrette de t’avoir effrayée ! »
L’aurait-il malmenée… pire, peut-être, si elle ne lui avait pas échappé ? Aujourd’hui encore, il n’avait pas de réponse à cette question. Elle non plus, sans doute. C’était lui qui était dans son tort, et c’était lui qui lui en voulait au point de se venger en lui menant la vie dure en
tant qu’administré, et en lui refusant la vente d’une parcelle en friche dont la municipalité avait besoin pour un projet de lotissement.
Ce soir-là, tout s’était joué. Il était resté sur place, appuyé contre sa voiture, et il avait vomi. Ça l’avait un peu soulagé. Le soleil couchant avait fait briller quelque chose dans l’herbe, au bord du talus. Une boucle. Alors il s’était aperçu que Marianne avait perdu une de ses jolies sandales. Il l’avait ramassée, avait fait quelques pas encore, tandis qu’un mal de tête terrible lui enserrait les tempes.
« Marianne ! » avait-il crié encore.
Mais elle était loin, elle avait fui, pieds nus, jusqu’à la maison de ses parents, tenant dans ses mains la seconde sandale. Il
apercevait encore entre les haies la tache claire de sa robe blanche. Son vélo était resté sur la route.
Il l’avait redressé, et placé contre le talus. Il était trop mal en point et trop honteux, aussi, pour le porter chez les Vernioz… où il aurait été sans doute mal accueilli. Marianne s’était-elle plainte à ses parents ? Il ne l’avait jamais su. Le lendemain, quand il était repassé, le vélo avait disparu. Marianne était probablement venue le reprendre.
Mais elle ne voulait plus le fréquenter. Quand elle l’apercevait au bourg, elle changeait de trottoir. Et lui, Thomas, restait paralysé. Il ne savait plus comment s’y prendre pour l’aborder et lui demander pardon. Elle ne montait plus aux Sapets. Elle n’allait plus chercher des fromages chez Aloïs Castanet. Alors il lui avait écrit. Les mots qu’il avait tracés sur le papier à lettres, il les savait par cœur, encore aujourd’hui :« Pardon, Marianne, je ne voulais pas te faire de mal, j’étais éméché, on avait pas mal fêté la vogue avec les copains. Je sais, ce n’est pas une excuse, j’ai eu tort. Toi, tu as eu très peur et je m’en veux énormément. Je ferai tout pour te faire oublier ce moment de folie, pardonne-moi et
rends-moi ta confiance, c’est mon vœu le plus cher. Mes intentions sont honnêtes, je veux t’épouser dès que tu auras dix-huit ans. »
Elle n’avait pas répondu, elle s’était mariée trois ans plus tard, avec un autre. Le temps avait passé, Thomas ne s’était jamais intéressé à une autre femme.
La sandale, il l’avait rangée dans un coffre. Quelquefois il la sortait de sa cachette, il la prenait entre
ses mains, la contemplait le cœur serré, puis la reposait, avec un sentiment de gâchis irrémédiable.
***
Annelise pensait à la rentrée des classes, qui aurait lieu début septembre. L’année dernière, Florette n’était pas très motivée, il lui avait fallu s’adapter à une nouvelle école. La jeune femme se souvenait encore du jour de leur départ. Pour sa part, elle n’avait aucun regret. Il lui était trop difficile de rester dans un lieu où, malgré tout, elle avait connu des jours de bonheur avec Alexandre. Représentant d’une grande marque de voitures étrangères, il était souvent absent. Beau garçon, beau parleur, son charme était un atout dans son métier et il avait eu très vite des aventures. Annelise ne supportait pas l’infidélité. Lui, il trouvait que cela ne prêtait pas à conséquence. C’était tout juste s’il ne s’en vantait pas. Quand il la voyait trop triste ou en colère, il redevenait très amoureux et lui promettait de ne plus la faire souffrir. Il parlait alors de
mariage… pour plus tard. Elle essayait de le croire. Mais séduire était dans la nature d’Alexandre. Il aimait la conquête, il aimait le changement.
Il n’avait pas été ravi lorsque Annelise s’était trouvée enceinte, sans l’avoir voulu, car elle n’était pas du genre à faire un enfant dans le dos d’un homme. Il avait reconnu leur fille, sans discuter, et ils s’étaient installés ensemble. Les bébés ne l’intéressaient pas, mais, quand Florette avait eu trois ans, il s’était attaché à elle. Il était si souvent absent que la petite le connaissait à peine. Lorsqu’il était à la maison, les disputes n’arrêtaient pas. Ce n’était pas bon pour l’enfant, ils en convenaient l’un et l’autre. Finalement Alexandre avait décidé de partir. Puisqu’ils n’étaient pas mariés, la séparation était simple. Annelise restait brisée par cet échec.
Elle se souvenait de la dernière fois où ils s’étaient trouvés ensemble dans leur appartement grenoblois qui sonnait creux, à présent. Alexandre était venu tout de même la veille l’aider à trier et à nettoyer, chapitré par ses parents, de braves gens, qu’Annelise aimait beaucoup. Ce jour-là, ils gardaient Florette.
Un employé avait relevé le compteur de l’électricité. Puis il avait fallu attendre le gérant de l’immeuble, qui venait pour faire l’état des lieux. L’homme avait tiré les volets derrière eux et pris les clés. Les bagages d’Annelise avaient été vite engouffrés dans le coffre de la voiture garée devant l’immeuble. La veille, la camionnette des déménageurs avait emporté ses meubles pour les déposer à son nouveau domicile. Sur ce point, Alexandre n’avait pas formulé d’exigence ; il lui laissait tout, trop content de partir les mains dans les poches, libre
comme l’air. Elle regardait celui qui avait partagé sa vie pendant sept ans. C’est si triste, la fin d’un amour ! En quelques mois, ils étaient devenus de parfaits étrangers. Il y avait Florette, qui malgré tout constituait entre eux un lien indestructible. Alexandre ne réclamait pas de droit de visite ; on s’arrangerait à l’amiable, affirmait-il. Ce n’était pas de la générosité de sa part, au contraire une forme d’égoïsme : il ne souhaitait pas se conformer à un calendrier strict, qui aurait pu le gêner dans ses projets du moment.
« Eh bien, voilà, j’espère que tu te plairas dans ta nouvelle existence. »
Il était sincère, il ne lui voulait pas de mal, il n’avait jamais voulu la faire souffrir, d’ailleurs. Si elle s’était montrée plus accommodante, il n’y aurait pas eu de séparation, car, à sa façon, il y tenait. Son regard s’attardait sur lui et elle le trouvait plus séduisant que jamais. À cet instant, elle avait éprouvé un fugitif retour de flamme, elle avait eu envie de poser ses lèvres sur le cou de cet homme, juste à sa hauteur. Mais ce n’était pas le moment, ce ne serait plus jamais le moment. Ils étaient descendus par l’escalier l’un derrière l’autre, il avait dit encore : « Florette va manquer à mes parents, ils ne la verront pas aussi souvent. Je ne sais pas pourquoi tu
vas t’enterrer dans ce patelin perdu. »
Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’elle avait besoin de calme et d’un autre cadre de vie. Loin de la grande ville si possible. On lui avait proposé ce poste de correspondante locale, qui l’aiderait à joindre les deux bouts, car les traductions, même payées convenablement, ne permettaient pas de lui assurer des revenus suffisants.
Annelise s’efforça de chasser de son esprit ce dernier jour où elle avait vu Alexandre, car depuis il n’était pas revenu en Isère et n’avait pas revu leur fille, ce qui scandalisait sa famille, tout acquise à Annelise. Il remettait toujours au lendemain. Florette n’en semblait pas affectée, et le lien n’était pas rompu, car il lui téléphonait régulièrement. Depuis la séparation de ses parents, la petite fille était beaucoup plus épanouie, d’ailleurs.
Annelise avait installé une table devant la maison, à l’ombre d’un grand tilleul. Pendant les beaux jours, elles prenaient leurs repas à l’extérieur, ce qui enchantait Florette. Elle avait tout préparé, il ne lui restait qu’à faire chauffer le lait pour le chocolat de la petite fille. Neuf heures
tintaient au clocher du village, neuf coups apportés par la brise, quand Florette arriva, mignonne à croquer dans son pyjama rose. Elle était flanquée de Léon, un vieux chien de race indéfinissable. L’enfant et l’animal étaient inséparables. Léon dormait sur une couette près du lit de Florette, ce que préférait Annelise. Il aurait bien dormi à ses côtés, mais ses rhumatismes l’empêchaient de sauter près d’elle. Elles avaient adopté le corniaud l’année dernière en s’installant. Elles étaient allées dans un refuge de la SPA pour choisir un animal. C’était difficile, car Florette aurait aimé tous les sauver. Mais personne ne voulait de ce vieux chien si maigre et si
triste. Il les regardait humblement derrière le grillage de son box. Il n’attendait plus rien. Elles avaient été émues aux larmes. On leur avait appris que Léon avait appartenu à un retraité, décédé. L’animal était inconsolable. Les enfants de ce brave homme ne voulaient pas de lui et l’avaient confié au refuge. Mais, étant donné son âge et son aspect guère reluisant, aucun des visiteurs ne s’attardait devant lui. Annelise ne pourrait jamais oublier la joie du vieux cabot
quand la fillette lui avait passé un collier et l’avait entraîné au bout d’une laisse toute neuve.
Florette s’était installée devant son chocolat fumant et elle y trempait une tartine beurrée. Léon s’était faufilé sous la table et avait posé un museau quémandeur sur ses genoux.
— On va monter aujourd’hui chez mon gentil ogre, maman ? demanda-t-elle en fourrant un morceau de sa tartine dans la gueule du chien.
Elle ne réclamait jamais son père, mais elle se montrait aimable avec lui quand il lui téléphonait. À présent, Alexandre était installé pour de bon à Paris, et depuis six mois il vivait avec une femme qui avait une petite fille
de cinq ans. C’était un comble : il se faisait appeler papa par la gamine, lui qui n’avait jamais vraiment assumé sa paternité ! Annelise se demandait si Florette en était jalouse. L’enfant ne laissait rien voir de ses sentiments.
— Nous irons dans l’après-midi chez Thomas Garon, pour voir opérer le sourcier, ma chérie.
— Tu crois vraiment que ce monsieur va trouver de l’eau ?
— Je l’espère pour Thomas et ses moutons. Chaque année, l’été est de plus en plus sec.
— À cause du réchauffement climatique ?
— Entre autres, ma chérie.
— Tu vas travailler à tes traductions ce matin ?
— Non, ma puce. Je dois aller prendre quelques photos des parcelles de la
Joncheraie qui va devenir un lotissement résidentiel. Veux-tu venir avec moi ?
— Je préfère rester ici avec Léon.
Annelise laissait souvent sa fille seule aux Pins ; elle ne s’absentait jamais bien longtemps et Florette était raisonnable. Quand elle s’apprêta à partir, la fillette avait fait sa toilette et s’était habillée. Elle avait posé ses poupées sur la table qu’Annelise avait débarrassée.
— Je vais jouer, et puis je mettrai le couvert, ça t’avancera, maman.
Annelise se pencha pour l’embrasser. Elle la serra contre elle avec emportement. Florette était encore si petite !
— À tout à l’heure, ma puce.
Comme prévu, elles montèrent avec Léon sur les hauteurs des collines dans l’après-midi. Annelise admirait le paysage grandiose formé d’éléments multiformes qui se déroulaient comme un patchwork jusqu’à la vallée de l’Isère. Plus haut, les cimes se hissaient vers le ciel pur. Une buse planait, s’immobilisait, comme suspendue dans l’espace par un fil invisible. Un vol de passereaux passa en désordre dans l’azur et Annelise les suivit du regard un instant. C’était si beau qu’elle en avait les larmes aux yeux.
Alexandre se moquait de sa sensibilité qu’il appelait de la sensiblerie. Les valeurs essentielles l’avaient toujours laissé indifférent. Il n’était pas du genre à pleurer de bonheur en découvrant un lever de soleil ; d’ailleurs, à l’heure où le soleil se levait, il était généralement au lit !
Annelise fut tirée brusquement de ses souvenirs par la grosse voix de Thomas Garon.
— Voici Séraphin, le sourcier, notre chercheur d’eau !
Annelise lui tendit une main qu’il serra énergiquement, puis il octroya une caresse à Léon qui remua la queue. Séraphin était un homme âgé, mais droit comme un peuplier. Il était vêtu de façon désuète et plutôt originale, avec un petit feutre perché sur le sommet du crâne.
Si tout se passait bien, elle tenait là de quoi rédiger un joli article. Elle sourit à Séraphin, qui venait de se munir d’une étrange baguette en forme de fourche à deux dents écartées.
— C’est du coudrier, expliqua le vieil homme.
— Du coudrier ?
— Du noisetier, si vous préférez.
— Me donnez-vous l’autorisation de faire quelques photos pour illustrer mon article ?
— Bien entendu.
Après la publication de cet article, il allait être très sollicité, il le savait, mais il aimait rendre service. Il ne se faisait pas payer ; cependant, il acceptait volontiers un dédommagement en nature. Avant de se lancer, il examinait soigneusement le terrain
en observant la végétation, en se renseignant aussi sur le type de sous-sol. Thomas avait agi de même avant de le convoquer et il lui avait fait part de ses déductions.
— Allons-y, c’est sur la droite, poursuivons par ce sentier.
S’écartant des brebis qui s’étaient arrêtées de paître pour les regarder, ils s’engagèrent dans un étroit layon bordé de hautes fleurs formant des grappes d’un rose vif.
— Des épilobes, fit remarquer Séraphin. Ils apprécient les endroits humides.