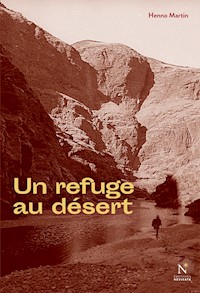
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
En 1935, deux jeunes géologues allemands, Henno Martin et Hermann Korn, fuient l’Allemagne nazie pour le Sud-Ouest africain – l’actuelle Namibie – afin d’y effectuer des recherches. Lorsque la guerre éclate en 1939, la plupart des hommes de nationalité allemande sont arrêtés par les Britanniques et internés dans des camps de prisonniers. Nos deux géologues, pacifistes et idéalistes, refusent ce sort et s’échappent dans le désert du Namib. Ils se cacheront pendant deux années dans ces vastes étendues écrasées de chaleur, vivant à la manière des Bushmen et évitant de se faire repérer par les autorités lancées à leur recherche. Les péripéties se succèderont dans ce havre de paix, loin de la folie des hommes. Parvenant à suivre les événements de la guerre grâce à une petite radio embarquée, ils seront finalement contraints de quitter le désert, poussés par l’épuisement. Ce récit sobre et poignant, maintes fois réédité, est celui d’une magnifique aventure dans une nature sauvage et préservée, d’une extraordinaire beauté.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Henno Martin (1910-1998) est un géologue allemand qui travailla de longues années dans l’actuelle Namibie. Après la guerre, il se spécialisa dans l’exploration des nappes d’eau souterraines, découvrant notamment la source qui permet aujourd’hui encore d’alimenter la capitale namibienne Windhoek.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Préface
Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis que Hermann Korn et moi-même, alors fraîchement diplômés en géologie, avons embarqué pour le Sud-Ouest africain. Notre choix était motivé par deux raisons. Tout d’abord, et cette raison me tenait peut-être plus à cœur que Hermann, nous étions tenaillés par le désir de voir le monde. Ensuite, nous étions tous deux convaincus qu’Hitler préparait une guerre dont nous voulions nous tenir aussi éloignés que possible, tout comme de la pression politique intérieure croissante qui se dirigeait vers « l’uniformisation de tous les domaines de la vie » et « l’espionnage généralisé ».
Je me souviens de la fin de l’automne 1934. Quelqu’un, dont nous n’avons jamais su le nom, avait annoncé une réunion de tous les étudiants en géologie pour un samedi soir. Une association de géologues nazis devait être créée. Personne n’est venu. La seule lumière ce soir-là provenait de ma lampe de travail que j’avais allumée au-dessus de mon bureau dans la bibliothèque. J’ai entendu le battement lourd de la porte de l’institut, des pas martiaux dans la bibliothèque, avant de me trouver devant un uniforme de l’administration, qui exécuta un Heil Hitler énergique : il était tout de même très étrange que personne ne soit venu à la réunion prévue, me dit-il. J’ai évoqué le fait que l’annonce avait été passée trop tard, ma thèse de doctorat, la date de remise, et je l’ai regardé de plus près. Il est soudain devenu aimable : il avait étudié la géologie et possédait encore les clés de l’institut. Encore plus aimable : je devais réfléchir sur le fait qu’il pourrait être très utile pour ma carrière que je lui fasse de temps en temps un rapport sur l’attitude de mes camarades d’études et de mes professeurs vis-à-vis du « mouvement ». Sur ce, il claqua des talons, j’entendis un autre Heil Hitler et il disparut.
Mon frère, de deux ans mon cadet, s’est laissé gagner par l’idéologie nazie. Il est devenu organiste, puis professeur de musique et enseignant au conservatoire de Heidelberg, pour finir officier pendant la guerre. Il est tombé au printemps 1945 dans l’Est de l’Allemagne, alors que les chars russes avançaient vers Berlin.
Quarante ans se sont écoulés depuis que mon ami Hermann, le chien Otto et moi avons cherché un refuge dans le désert afin d’échapper à la folie de la Seconde Guerre mondiale. Nous avions trouvé le refuge que nous cherchions, et nos aventures dans cette lutte pour la survie nous ont obligés à faire face à des instincts humains profonds, primaires. Aujourd’hui encore, après tant d’années, les scènes de notre existence dans le désert restent gravées dans ma mémoire, et chaque visite au Namib est pour moi comme un retour à la maison.
Lorsque j’ai écrit ce livre, il y a vingt-sept ans, le gibier, source pour nous de nourriture et d’émerveillement, était sur le point d’être exterminé par des chasseurs sans scrupules. Aujourd’hui, la « falaise des Carpes » et ses environs, ainsi que les dunes de sable au sud du canyon du Kuiseb ont été incorporés au parc national du Namib Game Park. Je me réjouis de voir que les hardes d’antilopes, d’oryx et de zèbres semblent se reconstituer, alors que non loin de là, au Desert Research Station de Gobabeb, sur le cours inférieur de la rivière Kuiseb, des scientifiques étudient les conditions de vie extrême dans ce désert unique.
Il y a quarante ans, lorsque Hermann et moi vivions une vie de carnivores, et que la radio venait troubler la sérénité de nos soirées dans le désert par un rappel quotidien des atrocités de la guerre, nos pensées et nos discussions ne cessaient de tourner autour des questions énigmatiques sur l’évolution de la vie et de l’homme, de ses cultures étonnantes et de ses échecs répétés.
Entre-temps, les dangers que nous avions perçus à l’époque n’ont cessé de croître et semblent même s’accélérer. Nos observations sur la complexité de la nature humaine, sur sa capacité à adopter à la fois un comportement altruiste et dévastateur, et nos questions sur l’évolution de l’humanité, qui est passée de familles de cueilleurs-chasseurs à des sociétés guerrières concurrentes, n’ont en rien perdu de leur pertinence.
La chose le plus importante, peut-être, que j’ai apprise à travers cette expérience de vie dans le Namib, c’est que l’esprit humain peut se montrer plus fort que les conditions de vie les plus impitoyables. L’avenir nous dira si cette faculté primera sur la confiance aveugle que nous plaçons dans la mécanique inexorable du progrès, qui se double souvent d’une incompréhension de la nature humaine.
Henno Martin
Windhoek, juillet 1980
Carte
1Terminus prison
Avec un horrible bruit de ferraille, la lourde porte de la prison de Windhoek se referma derrière nous. Instinctivement, je me retournai pour jeter un dernier coup d’œil à l’immensité aveuglante du ciel qui se découpait au-dessus du mur d’enceinte. Puis, regardant à nouveau devant moi, j’aperçus, au-dessus du portail intérieur, une inscription légèrement fanée proclamant : « Tout pour l’Amélioration ». L’hypocrite consolation datait sans doute de l’époque où le Sud-Ouest africain était une colonie allemande. En d’autres circonstances, je l’aurais trouvée très drôle, mais à présent, je n’avais aucune envie de rire.
Les formalités furent expédiées en deux temps trois mouvements. Le greffier porta nos noms sur le registre d’écrou – Hermann Korn, Henno Martin, profession : géologues – un geôlier nous enleva nos ceintures et lacets de chaussures. Une minute plus tard, nous étions enfermés, dans deux cellules voisines.
Je pris conscience de mon état de faiblesse. La longue journée de voyage vers cette triste destination s’était achevée tard dans la nuit. Malgré ma lassitude, je n’arrivais pas à trouver le sommeil. Une faible lumière, provenant d’une lampe éclairant la cour, passait par la fenêtre grillagée et atténuait l’ombre épaisse de la cellule. Couché sur le dos, je fixais le vide. J’avais l’impression d’étouffer entre ces murs rapprochés. Quelle pièce exiguë, quelle horrible sensation d’écrasement, succédant sans transition à la merveilleuse liberté et aux horizons sans fin du désert où nous avions séjourné pendant si longtemps !
Je ne cessais de repenser à ce que nous avions vécu. Quelle aventure magnifique ! Nous avions tenté d’échapper à la société secouée par la fièvre de la guerre, nous avions, comme on disait alors, « effectué un repli stratégique ». Durant deux ans et demi, nous nous étions cachés dans le désert, menant une vie spartiate de chasseurs, n’obéissant qu’à une seule loi : celle du monde sauvage. Nos seules frontières avaient été notre propre capacité à survivre dans ce milieu hostile.
Les images se bousculaient dans ma tête. Inlassablement, je revivais ce que nous avions laissé derrière nous : la beauté de la nature, le sentiment de liberté qu’elle inspirait, les animaux qui peuplaient le désert, la faim et la soif qui nous avaient fait tant souffrir, les nuits silencieuses sous une voûte cloutée d’étoiles argentées.
Et voilà que tout était terminé…
Demain matin, nous ne serions pas forcés de traquer notre petit-déjeuner : on allait nous l’apporter dans nos cellules. Nous avions rejoint la société ou, plutôt, c’était elle qui nous avait rejoints. Il ne me restait qu’un moyen d’évasion : fermer les yeux afin de revoir les mille images de notre splendide solitude.
2La fuite
La Seconde Guerre mondiale entrait dans sa deuxième année. Les armées allemandes venaient d’envahir les Pays-Bas et commençaient tout juste leur percée vers la France.
Dans ce vase clos qu’était la petite ville de Windhoek, la propagande des puissances belligérantes créait un véritable climat d’hystérie, mélange explosif d’enthousiasme, de peur, d’affolement. Difficile, même pour un scientifique, de garder la tête froide dans une telle atmosphère survoltée. Toutefois, mon ami Korn et moi estimions que cette guerre ne nous concernait pas. C’était justement parce que nous l’avions vu venir que nous étions partis d’Europe. Nous ne tenions pas à prendre part au suicide de tant de peuples civilisés.
À présent, hélas, la guerre semblait sur le point de nous rattraper. Le nombre d’Allemands qui disparaissait derrière les barbelés des camps d’internement ne cessait de croître.
Chaque matin, nous nous étonnions d’être encore en liberté. Une situation d’autant plus angoissante que nous étions habitués à parcourir sans aucune contrainte l’immense solitude de la steppe et du désert. Nous étions donc résolus à conserver notre neutralité personnelle et notre indépendance.
Un soir, alors que nous étions assis sur les marches de notre perron, nous nous mîmes à discuter de la situation. Il fallait faire quelque chose, mais quoi ? C’est alors que nous revint à l’esprit une des phrases que nous avions lancée en plaisantant quelques mois auparavant : si jamais la guerre éclate, on part dans le désert !
Soudain, l’innocente boutade se transformait en idée sensée, en projet réalisable. La solution que nous avions vainement cherchée, nous la tenions enfin, une solution logique, magnifique, fascinante. Très agités, nous en discutâmes aussitôt les chances de succès, en essayant de peser le pour et le contre.
L’éclat des constellations tournait lentement au-dessus de nos têtes, et lorsqu’elles atteignirent les monts de l’ouest, notre décision était prise : nous partirions dans le désert, loin de la folie des hommes, pour y attendre la fin de la guerre.
Nous n’emmènerions que notre chien, dont le consentement était acquis d’avance : grand amateur de sorties, il agitait la queue dès qu’il nous voyait préparer nos cantines. Il s’appelait Otto. Nous lui avions donné ce nom à l’époque où, chiot titubant, il offrait presque le même aspect vu de face ou de dos, comme ce nom dont les lettres se lisent dans un sens comme dans l’autre : de droite à gauche et de gauche à droite.
En grandissant, il avait perdu cette particularité, on ne risquait plus de confondre sa tête et son postérieur, mais le nom lui était resté.
Après quatre jours d’une activité fébrile, tout était prêt. Une pyramide de caisses et de sacs savamment arrimés s’entassait sur le plateau de notre camion. Nous quittâmes Windhoek aux premières lueurs de l’aube. Notre destination était la gorge sauvage, d’accès difficile, du Kuiseb, un de ces cours d’eau temporaires du désert que les Sud-Africains désignent assez curieusement sous le nom de « rivière ».
Comparé aux distances énormes du Sud-Ouest africain, ce trajet était relativement court : nous n’allions qu’à 200 kilomètres environ de Windhoek. Pour y parvenir par le chemin le plus court, nous aurions dû suivre la piste carrossable – le pad pour employer le terme boer – qui, empruntant la vallée du Kuiseb, descendait du haut plateau vers le namib, désert qui s’étend jusqu’aux grèves de l’Atlantique (le namib, mot hottentot signifiant simplement le désert, a fini par désigner globalement toute cette région, entre le massif des falaises et l’océan).
Malheureusement, le pad nous était interdit. Dans les fermes isolées, situées sur la piste, notre passage n’aurait pas manqué d’attirer l’attention, si bien que la police, dès les premières recherches, aurait retrouvé notre trace. Nous décidâmes donc de faire un vaste détour, par Okahandja et Karibib. D’ailleurs, afin de ne négliger aucune précaution, nous avions sollicité, et obtenu, l’autorisation de nous installer à Karibib. Ainsi, au cas où, en haut lieu, on envisageait notre internement, nous disposerions d’une appréciable avance.
De ce fait, la véritable aventure ne commença pour nous qu’après la traversée de cette localité. Un dénivelé de terrain nous cacha brusquement les dernières maisons et, désormais entourés par les pierres et le sable, nous pénétrâmes définitivement dans le domaine du désert. D’un commun accord, nous fîmes une halte prolongée dans les premiers contreforts de la montagne pour repartir seulement après le coucher du soleil. Déjà, nous nous conduisions en évadés : nous devions nous terrer le jour, et marcher sous le couvert de l’obscurité. La nuit venue, nous reprîmes notre lente avancée, longeant le massif des monts Chuos. Trajet fastidieux, à travers un plateau lunaire descendant en plan incliné vers le sud-ouest.
La lumière de nos phares aveugla brièvement des oryx, ces robustes antilopes du désert, qui marchaient en bande. Vers deux heures du matin, nous nous arrêtâmes pour dormir dans une dépression sablonneuse. Nous en avions bien besoin.
Comme les étoiles pâlissaient, nous engageâmes notre camion dans un ravin aux parois grises et nues, aboutissant à la gorge encaissée du Swakop. Un véritable canyon, redouté par les voyageurs à cause de la profonde couche de sable meuble que les eaux tumultueuses de la « rivière » y avaient accumulée. Avertis du danger, nous dégonflâmes les pneus jusqu’à ce qu’ils fussent suffisamment aplatis. Puis nous fonçâmes, le moteur lancé à plein régime. Le passage dangereux franchi, nous regonflâmes les pneus et entamâmes la remontée par un ravin qui semblait la réplique exacte du précédent. Sur le plateau, nous trouvâmes une piste à peine marquée dont les méandres suivaient la cassure déchiquetée du Swakop, en direction de la côte.
Même sous les rayons presque verticaux du soleil, le désert conservait ici son aspect incolore. À part quelques rares filons de basalte noir, l’immensité n’était qu’une grisaille aux tons indistincts où se confondaient le ciel et la terre. Toute estimation des distances devenait impossible. La haute colline qui avait surgi à l’horizon se réduisit finalement à une légère ondulation de terrain, la cabane abandonnée que nous avions cru discerner se révéla, quelques instants plus tard, n’être qu’un bidon d’essence mangé par la rouille.
Cependant, au bout d’une heure, nous aperçûmes une grande silhouette noire qui se refusait à rapetisser. Encore deux ou trois minutes, et nous vîmes qu’il s’agissait d’une vache, debout au milieu de la piste ; à côté d’elle, les restes sanglants d’un petit veau qu’elle venait de mettre au monde. Un peu plus loin, sur un amas de débris rocheux, rôdaient trois chiens sauvages (lycaons ou loups peints), leurs sinistres faces de hyènes tournées vers notre voiture.
La vache appartenait sans doute à la famille de métis qui vivait au fond de la gorge du Swakop, dans une masure en argile. Efflanquée, à moitié morte de faim, la malheureuse bête essayait encore de défendre, à coups de cornes, le cadavre déchiré de son veau contre les carnassiers tout aussi efflanqués et affamés qu’elle. Elle tourna la tête pour nous jeter un regard éploré, mais nous ne pouvions rien pour elle ; dans notre situation, gaspiller ne serait-ce qu’une seule balle eût été pure folie.
Les chiens sauvages surveillaient nos mouvements avec attention. Ils furent certainement heureux de nous voir repartir ; le camion disparu, ils étaient sûrs de tenir leur proie. Pour nous, l’image fugitive, raccourci sinistre d’un drame anonyme, survenant le premier matin de notre randonnée dans le désert, constituait une introduction symbolique à l’impitoyable lutte pour l’existence qui nous attendait.
Nous dûmes bientôt quitter la piste afin de gagner, roulant vers le sud-est, la vallée du Kuiseb. Comme dans cette partie du désert les traces des pneus restaient généralement visibles pendant plusieurs jours, nous suivîmes la bande noire, polie par le vent, d’une veine basaltique ; un vieux sac, attaché à l’arrière du camion, effaçait nos empreintes dans les brefs passages sablonneux.
À présent, il était midi. Un soleil de plomb dardait ses rayons impitoyables sur la plaine infinie, tandis que dans les dépressions, les zones d’ombre se confondaient pour former des flaques sombres. Notre destination immédiate était un col étroit qui entaillait une arête de schistes noirs. Toutefois, nous ne pouvions songer à l’atteindre d’une traite. En effet, notre trajet coïncidait avec le parcours de la ligne aérienne Windhoek-Swakopmund, et dans ce paysage désolé, un camion aux pare-brise miroitants, qui plus est traînant un énorme panache de poussière derrière lui, n’aurait pas manqué d’éveiller le soupçon d’un pilote, aussi distrait soit-il.
Nous nous arrêtâmes donc dans une petite vallée où quelques tamaris, miraculeusement sortis du sol encroûté de sel, offraient un vague couvert. Après avoir rangé le camion contre un pan de falaise, nous nous installâmes à l’ombre douteuse du feuillage grisâtre et, tout en nous restaurant, examinâmes le site. La voiture nous parut désagréablement grande et brillante. Nous en frottâmes les surfaces avec un chiffon imbibé d’huile, puis l’aspergeâmes de sable. Après ce traitement, elle devait, vue de haut, se confondre avec le paysage. Du moins, nous l’espérions.
— On s’en tirera, je pense, dit Hermann. De toute façon, ils ne vont guère commencer à nous chercher avant une dizaine de jours.
— Et même à ce moment-là, répondis-je, ils ne viendront pas par ici. Ils fouilleront d’abord la région du mont Brûlé.
— Ah ! Et pourquoi ?
Je pris mon air le plus futé.
— Primo, parce que c’est par là-bas que nous avons travaillé avant de rentrer à Windhoek. Secundo, parce que j’ai pris certaines précautions.
— Quelles précautions ?
— J’ai laissé, bien en évidence sur mon bureau, un buvard couvert d’inscriptions révélatrices : une sorte de plan de marche, avec les distances et le calcul des quantités d’essence nécessaires, ainsi que des initiales qui concordent avec les localités de ce district. Un policier qui se donnerait le mal de déchiffrer ce document arriverait inévitablement à la conclusion que nous sommes partis vers le mont Brûlé.
Hermann se mit à rire : le mont Brûlé se trouvait à quelque 300 kilomètres au nord de notre destination. Par la suite, nous devions apprendre que la première patrouille lancée à notre recherche s’était effectivement dirigée vers le mont Brûlé.
La chaleur était torride, encore aggravée par un vent d’est sec et corrosif. En attendant le soir, nous nous mîmes à relier le poste de T.S.F. à la batterie du camion et nous plaçâmes l’antenne sur un buisson épineux.
Ainsi, nous pouvions, au milieu du désert, écouter les communiqués militaires. Les chars allemands étaient en train d’enfoncer les lignes françaises. La voix qui nous parvenait de l’éther paraissait à la fois irréelle et vivante, comme si nous l’entendions dans un rêve. Parfois, nous avions presque l’impression de percevoir, à travers les rafales sifflantes du vent, le grondement lointain des blindés.
Le chien Otto gisait, haletant, sous la voiture. Nous aussi étions torturés par la soif ; nos gorges douloureuses et la fatigue du trajet nocturne nous empêchaient de commenter les événements d’Europe. Malheureusement, nous étions forcés d’économiser l’eau dont nous n’avions pu emporter qu’une maigre réserve. Ce fut seulement à la tombée de la nuit que nous nous offrîmes le luxe d’en avaler quelques gorgées. Puis nous repartîmes à travers un damier de petites « rivières » ensablées encadrant de vastes champs de roches polis par l’érosion éolienne. Hermann avait pris le volant, pour le lâcher en jurant, une demi-heure plus tard : nous nous étions enlisés dans le sable d’un cours d’eau asséché. De nouveau, il fallut dégonfler les pneus et les regonfler un peu plus loin : une corvée fastidieuse et pénible. Nos nerfs commençaient à être mis à rude épreuve. J’eus le malheur de faire une remarque désagréable, sur quoi Hermann, furieux, me lança un bref : « Conduis donc, toi ! » et se retira, boudeur, dans son coin de cabine. Je jugeai préférable de ne pas répondre.
Les ombres démesurées du soir soulignaient à gros traits d’encre les mille rainures, crevasses, bandes d’éboulis du terrain. Montant des dépressions, le crépuscule envahissait l’horizon. J’appuyai sur l’accélérateur ; nous voulions à tout prix parcourir quelques kilomètres avant la nuit complète. Soudain, comme un bloc de roche me forçait à imprimer au volant un mouvement brutal, mon coude toucha le klaxon. Le contact se coinça, déclenchant un vacarme continu.
J’avais beau savoir que, dans cette immense solitude, personne ne pouvait l’entendre, je sentis mon cœur battre à grands coups tandis que, sautant à terre, je cherchais fébrilement un tournevis dans le fouillis du coffre à outils. Hermann jurait comme un charretier et Otto, ignorant la raison de ce bruit infernal, aboyait à s’en faire éclater les poumons.
Le klaxon hurlait toujours ; les deux ou trois minutes que je mis à le débrancher me parurent une éternité. Quand, enfin, le silence du désert retomba sur notre groupe échevelé, nous nous regardâmes d’un air ahuri. Visiblement, Hermann pensait la même chose que moi : en nous mettant dans un tel état, nous nous étions conduits comme des imbéciles. Il éclata de rire, je l’imitai, et Otto, au comble de la joie, recommença à aboyer.
Toutefois, nous en avions assez pour le moment. Quelques centaines de mètres plus loin, nous fîmes halte à l’abri d’une paroi rongée par le vent et, dans le sable encore tiède, creusâmes deux entonnoirs aplatis. La nuit précédente, nous n’avions guère dormi, mais maintenant, nerfs et reins brisés, nous n’eûmes pas à attendre le sommeil. Enveloppés dans nos sacs de couchage, Otto couché à distance égale de ses deux maîtres, nous ne tardâmes pas à fermer les yeux, dans le silence étoilé du désert.
3Première chasse
Le lendemain matin, le soleil nous trouva déjà en route. Nous coupions à travers une plaine de calcaire blanc, le capot pointé sur la double pyramide bleue des monts Tumas et Amichab, dressée comme une île au-dessus de l’immensité désolée. Dans l’atmosphère matinale claire et d’une fraîcheur vivifiante, le pessimiste le plus endurci aurait repris goût à l’existence. Otto manifestait une agitation bruyante : sur notre gauche s’ébattaient plusieurs springboks, belles antilopes de taille moyenne, aux poils érectiles argentés, et la brise d’est apportait leur odeur droit dans les naseaux du chien.
Deux heures plus tard, au pied des premiers contreforts, nous cherchâmes péniblement notre chemin dans un véritable labyrinthe de ravins et de failles. Le passage que nous finîmes par découvrir débouchait sur une étendue de sable rouge, rigoureusement vide, à part cinq épineux isolés.
Un peu plus tard, un petit troupeau d’oryx s’arrêta pour nous dévisager l’espace de quelques instants. Les bêtes nous présentèrent leurs faces, au bizarre dessin noir et blanc, puis elles s’éloignèrent avec une tranquille indifférence. Manifestement, nous ne les intéressions guère. En revanche, nous, les créatures supérieures, commencions à éprouver une vague inquiétude en constatant qu’on ne voyait nulle part le moindre brin d’herbe verte ; seules quelques touffes grises et racornies, vestiges de l’année précédente, émergeaient par endroits de la couche de sable rouge.
Une longue et douce rampe, recouverte d’une carapace de blocs arrondis, porta bientôt l’eau du radiateur à ébullition. Nous dûmes nous résoudre à sacrifier une partie de la précieuse réserve que contenaient nos gourdes en toile épaisse. Puis, de nouveau, nous descendîmes vers une vaste dépression aux reflets rougeâtres sous des volutes de vapeurs que la chaleur faisait vibrer. Nous mîmes le cap sur deux petites buttes-témoins, aux arêtes en dents de scie. Le camion rangé dans un pan d’ombre, nous escaladâmes l’éperon est afin de nous orienter. Les yeux douloureusement plissés, nous nous efforcions de percer du regard les flots de lumière tremblante. Très loin, à l’extrémité sud du plateau calcaire, on devinait un bastion de rocs blancs. Quelque part aux environs de ce piton devait s’ouvrir la gorge du Kuiseb. On avait l’impression de distinguer, dans la blancheur infinie, un réseau de minces traits noirs, sans doute les cassures abruptes de plusieurs gorges secondaires. Malheureusement, il était à peu près impossible, dans cette clarté aveuglante, de situer la principale ligne de partage des eaux. Nos jumelles explorèrent systématiquement le terrain dans l’espoir de découvrir d’éventuels points de repère. Nous voulions en effet suivre le trajet le plus direct, sans nous égarer dans l’une des innombrables gorges affluentes. Car ce n’était que dans le grand canyon du Kuiseb que nous étions sûrs de trouver de l’eau. Si nous manquions ces mares, mieux valait ne pas imaginer le sort que le désert nous réserverait.
Avançant à une allure de tortue, nous roulions à présent sur une sorte de chaussée formée de débris calcaires dont les bords tranchants devaient mettre à mal nos pauvres pneus. La première « balise » que nous avions choisie du haut de notre observatoire était un épineux desséché. Quand, quelques kilomètres plus loin, nous passâmes devant un second épineux, le bastion blanc paraissait toujours aussi éloigné. Un springbok, coupant perpendiculairement notre route, avait l’air de flotter, ridiculement déformé, dans l’atmosphère surchauffée. Les yeux nous brûlaient, écorchés par l’insupportable chaleur. Soudain, nous aperçûmes une tache verte qui nous attira comme un aimant. C’était un minuscule vley, une combe circulaire qui devait retenir, tous les deux ou trois ans, les maigres précipitations des pentes environnantes. Une lamentable caricature d’oasis dont les quelques arbres entouraient tristement un fond de sable sec. Pourtant, nous fûmes heureux de nous étendre à l’abri du feuillage rabougri ; dans le désert, on apprend vite à se contenter de peu. Nous décidâmes de prendre un repos bien mérité avant de nous mettre en quête d’un endroit plus confortable.
Le temps de décharger, de nous restaurer, et l’après-midi touchait à sa fin. Une brise d’ouest refoulait la chaleur compacte. Les rayons de plus en plus obliques du soleil adoucissaient l’aspect lunaire du plateau. On apercevait même, par endroits, de petites touffes d’herbe verte, très rares, très espacées, mais tout de même bien vivantes. Leur présence indiquait que cette région du désert avait reçu au moins quelques gouttes de pluie. Peut-être y avait-il même du gibier ?
Il y en avait : à force de fouiller la plaine, nous finîmes par distinguer, sur le fond sombre d’une paroi, deux points clairs qui se déplaçaient lentement, probablement des springboks en train de paître. Mais comment allions-nous nous en approcher à bonne portée sur cette étendue pratiquement dépourvue de relief ? Problème d’autant plus aigu que nous ne possédions pas de carabines : à la déclaration de guerre, nous avions dû remettre nos armes de chasse aux autorités britanniques. Nous n’avions pu sauver qu’un gros pistolet et un vieux fusil à chevrotines. Quant aux munitions, ce n’était guère plus brillant : nous disposions, en tout et pour tout, de quarante-quatre cartouches à plomb, et de quelque trois cents coups pour le pistolet.
Au cours de nos délibérations afin d’arrêter un plan d’action, Hermann fit preuve de son optimisme habituel, et Otto, agitant frénétiquement la queue, nous fit comprendre qu’il se sentait assez fort pour attraper les antilopes tout seul. Finalement, je pris position à une certaine distance, entre deux blocs de calcaire, le fusil à côté de moi, pendant qu’Hermann et Otto se glissaient vers les bêtes. Par les jumelles, j’observais leur laborieuse progression. Soudain, je vis le chien dresser la tête : il avait dû sentir les antilopes. Je crus qu’il allait s’élancer, mais Hermann, d’un geste menaçant, le rappela à l’ordre, et il s’immobilisa, poussant l’obéissance jusqu’à laisser mon ami prendre une trentaine de mètres d’avance. Rampant d’abord à quatre pattes, puis sur le ventre, Hermann jouait admirablement son rôle de chasseur primitif. Ayant atteint l’éperon rocheux, il s’arrêta. À moins de se rendre invisible, il ne pouvait aller plus loin ; un pas de plus et les springboks, déambulant à une centaine de mètres sur sa droite, l’auraient immédiatement aperçu. Je le vis lever le pistolet, prendre appui sur un genou et assurer sa visée. Je retins ma respiration, tout en suivant les mouvements insouciants de notre gibier à travers les jumelles. Enfin, la détonation claqua. L’une des bêtes fit trois petits bonds, puis toutes les deux, manifestement perplexes, allongèrent le cou pour regarder vers le rocher. Hermann visa une seconde fois, mais Otto, à bout de patience, ne lui donna pas le temps de presser la gâchette. Lancé comme une flèche, il déboula et fila droit sur les antilopes qui s’enfuirent aussitôt, bondissant avec une légèreté incroyable, malheureusement pas dans ma direction.
Revenus à notre « oasis », nous commentâmes ce premier échec en quelques phrases lapidaires. Nous pouvions en tirer au moins une conclusion : il nous restait beaucoup à apprendre. Otto, lui, ne rentra que bien plus tard pour se cacher sous le camion en poussant des jappements plaintifs.
4Le canyon
Je me souviens de notre première matinée comme d’un rêve ! D’énormes rochers aux arêtes effilées découpaient de longs pans d’ombre bleue dans la blancheur aveuglante du plateau, créant l’illusion d’un champ de neige raviné par l’action du vent. À l’est, les falaises dressaient une muraille bleu acier, rempart cyclopéen d’un univers interdit ; le bastion calcaire qui marquait notre ultime étape ne paraissait éloigné que de quelques minutes. En fait, nous mîmes plus d’une heure à l’atteindre, et le compteur marquait 8 kilomètres de plus.
Pour escalader cette forteresse, je choisis l’unique voie à peu près praticable, une rampe d’éboulis qui, en Europe, aurait rebuté le chauffeur le plus téméraire. Lançant la voiture à la puissance maximum de la première vitesse, insensible aux cailloux giclant sous les roues, je parvins au sommet. Mais mon sourire satisfait, à peine ébauché, se figea en grimace de stupeur : le monde semblait se terminer abruptement, juste sous le capot du camion. Imprimant une violente secousse au volant, au grand dam d’Otto qui reçut mon coude sur le museau, je réussis à placer la voiture de travers. Au lieu d’arriver sur un plateau, nous avions débouché sur une crête étroite. Encore bien secoués, nous sondâmes du regard le précipite où nous avions failli atterrir : un dédale chaotique d’arêtes grises, d’ombres noires, de failles roussâtres.
Revenus de notre frayeur, nous eûmes cependant la joie de découvrir la profonde faille du canyon principal : un large lit de sable qu’encadraient d’innombrables ravins et crevasses. À droite et à gauche, derrière les multiples socles de calcaire blanc, apparaissaient les masses bleues de quelques buttes-témoins, aux contours crénelés ; tout à l’arrière-plan, presque sous l’horizon, on devinait les molles ondulations des dunes rouges.
Le vide béant à nos pieds nous fascinait. Quel paysage grandiose, impitoyable, inconcevable sous le ciel clément des régions tempérées ! C’étaient bien les célèbres gramadoelas1 dont on disait que le diable les avait créées un jour de mauvaise humeur.
L’idée que ce pays inhumain allait être notre refuge pour des mois, peut-être des années, me remplissait d’effroi et, en même temps, d’une sorte de joie sauvage. Hermann, plus prosaïque, se borna à constater :
— Là-dedans, ils auront du mal à nous retrouver.
Le sommet proprement dit du bastion auquel nous accédâmes par un col juste assez large pour le passage du camion constituait un plateau rigoureusement horizontal, mesurant peut-être trois mille mètres sur cinq cents, et complètement nu, sauf pour un petit épineux et quelques buissons noueux qui subsistaient au fond d’une petite cuvette. Après avoir dissimulé la voiture sous les branches tordues, nous nous mîmes à la recherche d’une voie descendant vers le canyon. En effet, avant de prendre une décision quant à notre installation définitive, il nous fallait étudier les possibilités d’approvisionnement en eau. Si les flaques et sources du Kuiseb étaient taries, notre projet devenait irréalisable.
Nous nous engageâmes sur une piste de zèbres qui longeait des parois blanches creuses et sculptées par le vent, contournant des blocs énormes qui avaient dû se détacher des corniches en surplomb. Arrivés au pied de la muraille, nous pénétrâmes dans un labyrinthe de ravins encaissés entre des arêtes schisteuses rayées de nervures de mica. Où devions-nous tenter la descente dans le canyon ? Probablement, les falaises qui le bordaient, tantôt inclinées à un angle approchant de la verticale, tantôt en surplomb, n’étaient praticables qu’en quelques rares endroits. Et la patiente inspection à laquelle nous nous étions livrés du haut du sommet ne nous avait pas permis de découvrir un seul de ces passages. Il paraissait donc plus sûr de tout simplement suivre la piste des zèbres. On devait pouvoir se fier à l’instinct de ces bêtes qui habitaient la contrée depuis des millénaires.
La piste suivait les arêtes, car les ravins latéraux franchissaient la différence de niveau uniquement par des degrés hauts de plusieurs étages, aux formes cubiques polies par le vent. C’était un royaume minéral, sans trace de vie, le domaine du calcaire aux contours durs et des plaques schisteuses à l’éclat soyeux. Même plus bas où se voyaient, piqués dans la rocaille, quelques épineux et buissons nains, l’impression lunaire subsistait : les végétaux, avec Ieurs branches grisâtres, paraissaient pétrifiés. Nous finîmes par nous étonner de la présence des empreintes laissées par les sabots des zèbres : le simple fait qu’un être vivant pût s’égarer dans cette désolation terrifiante avait quelque chose d’irréel.
Nous sursautâmes en entendant des appels brefs, presque des coups de sifflet. Levant la tête, nous aperçûmes, sur une corniche vertigineuse, un couple de petites antilopes klipspringer, semblables aux chamois d’Europe, qui nous observaient avec curiosité. Encore un coup de sifflet et elles s’enfuirent, rebondissant de falaise en falaise comme des balles de caoutchouc, pour disparaître finalement dans une faille.
— Si nous avions cette légèreté… grommela Hermann, écœuré.
Comparés aux antilopes, nous étions évidemment plutôt patauds. Mais, enfin, nous avancions, et même dans la bonne direction. Vingt minutes plus tard, nous atteignîmes le fond du canyon. Quel bonheur de marcher sur le sable et le fin gravier, après cette infernale rocaille qui nous cisaillait les pieds ! Quelques centaines de mètres plus loin, nous découvrîmes une mare. Nous pouvions enfin étancher notre soif ; Otto, à lui seul, but plus que ses deux maîtres ensemble.
Désaltérés et ragaillardis, nous fîmes peut-être dix pas pour nous immobiliser brusquement, écarquillant les yeux : devant nous, il y avait une succession d’empreintes énormes – tout du moins énormes par comparaison avec les marques que de nombreux zèbres et oryx avaient laissées dans la vase humide. Des empreintes faites incontestablement par un ongulé artiodactyle de forte taille. Mais lequel ?
— Peut-être une girafe, suggéra Hermann d’un ton rêveur.
J’éclatai de rire.
— Une girafe dans le désert ? Mon pauvre vieux, c’est le soleil qui te fait divaguer ?
— Tu as une autre explication ? grommela-t-il, vexé.
— Ma foi, on dirait presque…
— On dirait un buffle, ricana-t-il. Qui se nourrit de sable, probablement.
— Pas exactement un buffle, rectifiai-je. Plutôt un taureau. Rappelle-toi ce que nous ont dit, l’année dernière, les fermiers du Kuiseb supérieur : parfois, quelques têtes de bétail se perdent et retournent à l’état sauvage. C’est sans doute un de ces vagabonds…
— Mais de quoi vivrait-il ? s’obstina Hermann. Évidemment, il y a de l’eau. En revanche, on ne voit pas un brin d’herbe. Ton taureau ne peut tout de même pas mâcher des cailloux !
Pourtant, il s’agissait bien d’un taureau. Un peu loin, nous tombâmes sur deux séries d’empreintes, les unes légèrement moins larges, les autres beaucoup plus petites. Manifestement, il y avait, dans ce coin du désert, toute une famille : le taureau, la vache et le veau. Déjà, nous calculions l’enrichissement de notre garde-manger que promettait cette découverte. Tout en rêvant de grillades et de ragoûts, nous progressâmes à pas de loup, marquant un arrêt à chaque tournant du canyon, afin de ne pas mettre en fuite notre précieux bétail. Malheureusement, la précaution se révéla inutile : les bêtes restaient invisibles. Nous eûmes toutefois la consolation de trouver partout de l’eau. Presque chaque méandre du canyon abritait une flaque.
Nous fîmes alors la seconde grande découverte de la journée : au milieu d’une mare à moitié asséchée flottait un poisson mort ! Une carpe, en plein désert ! Une chose était certaine : cette carpe ne devait pas être la seule de son espèce. Entrant dans l’eau qui nous arrivait aux genoux, nous explorâmes des pieds la couche de vase. Soudain, Hermann poussa un cri : « J’en ai senti une ! » Il plongea les bras dans l’eau opaque d’un geste résolu et, tout en ramant frénétiquement, parvint à refouler la carpe vers la berge. Il y eut une pluie de gouttes verdâtres, Otto aboya furieusement, puis Hermann parvint à saisir le poisson. Fièrement, il brandit sa proie, une carpe mesurant exactement vingt-quatre centimètres. Comme l’heure du déjeuner approchait et que nous étions affamés, nous décidâmes de la manger tout de suite sur place.
Ce qui souleva immédiatement plusieurs problèmes d’ordre culinaire. D’abord, nous n’avions emporté, pour cette première reconnaissance, ni casserole ni poêle. Nous éludâmes la difficulté en grillant la carpe sur une pierre plate. Le bois ne manquait pas ; les eaux du Kuiseb avaient déposé un peu partout des branches que le soleil avait obligeamment séchées. Secundo, nous n’avions pas de sel, nous n’en avions d’ailleurs trouvé aucune trace sur les bords des flaques rencontrées jusqu’à présent. Comme nous méditions sur ce contretemps, nos regards s’arrêtèrent sur un tamaris. Ce buisson sécrète, plus exactement élimine du sel, ce qui lui permet de subsister sur des nappes saumâtres où toute autre plante refuserait de pousser. Nous allumâmes un feu dans un enfoncement de la paroi, frottâmes au-dessus de la carpe quelques branches de tamaris pour la saupoudrer de sel et attendîmes. Ce fut assez long. Malgré la chaleur du brasier, la cuisson se fit avec une lenteur désespérante. Manifestement, la pierre plate ne constituait pas un foyer idéal. Bien plus tard seulement, nous devions mettre au point un procédé plus expéditif.
D’où pouvaient bien venir ces carpes ? Probablement, la saison des pluies particulièrement violente de l’année 1934 qui avait rompu tant de digues dans les fermes des hauts plateaux les avait emportées jusqu’à ce canyon. L’inondation remontant à six ans, la présence des carpes indiquait que, pendant ce laps de temps, les mares n’avaient jamais tari. Une constatation rassurante dont la portée se trouvait cependant réduite par le fait qu’à en juger d’après l’état actuel du canyon, aucune pluie ne s’était produite depuis plus d’un an. En somme, notre provision d’eau existait, mais elle risquait de disparaître.
Quoi qu’il en fût, nous étions enchantés d’avoir trouvé du poisson frais au milieu du désert. Afin de concrétiser notre gratitude, – après tout, la reconnaissance du ventre n’est pas un vain mot – nous baptisâmes le bastion rocheux du nom de « falaise des Carpes ».
Nous poursuivîmes notre exploration jusqu’à la tombée de la nuit. Puis, n’ayant découvert aucun endroit propice à une installation définitive, nous remontâmes, reprîmes la voiture et, après une descente acrobatique par la rampe d’éboulis, regagnâmes le vley qui nous avait abrités la nuit précédente. Allumer un feu de camp sur le plateau du bastion, visible à des dizaines de kilomètres, eût été de la dernière imprudence.
1 Mot afrikaans, d’origine inconnue, désignant une terre reculée et inhospitalière. (NdE)
5Notre premier logis
Le pilier est de la falaise des Carpes n’était relié à la masse principale du plateau que par un col à escarpements multiples, aux bords tranchants, une sorte d’escalier géant dont l’allure était tout sauf engageante.
Pour franchir ce passage avec le camion, nous dûmes créer une piste en enlevant des blocs de roche et en comblant l’intervalle des marches avec des plaques, de manière à obtenir un plan incliné. Nos efforts trouvèrent cependant leur récompense : à peine arrivés sur le balcon suivant, nous découvrîmes une « fausse grotte », formée par une paroi largement inclinée en avant, au-dessus d’une étendue de sol plat. De tels sites servaient déjà de refuge à l’âge de pierre. L’emplacement était parfait. Orienté au Midi, le surplomb offrait un maximum de protection contre le soleil ; une piste de zèbres, profondément marquée, descendait jusqu’au fond du canyon. Et surtout, l’endroit caché au centre des gramadoelas, à une bonne cinquantaine de kilomètres de la ferme la plus proche, n’était accessible que par un seul passage, malaisé et difficile à découvrir. Bref, c’était la retraite idéale.
Pour installer le « living-room », nous choisîmes la partie ouest de la paroi où l’angle d’inclinaison était particulièrement accusé. Nous y plaçâmes nos deux chaises pliantes, une vieille valise métallique en guise de table, et l’un sur l’autre, deux réservoirs à essence, malheureusement vides, qui allaient faire fonction d’armoire. Celui du haut reçut le poste de T.S.F.
Comme dans tout logement bien conçu, la « cuisine » faisait suite au living-room. Le bois de chauffage ne se trouvant qu’en bas, dans le canyon, nous nous attachâmes à réduire le tirage du poêle. Après plusieurs essais décevants, Hermann eut une idée géniale : le poêle allait être enterré dans une tranchée tapissée de plaques de calcaire, parfait « ersatz » de pierre réfractaire. Le buffet de cuisine, composé également de réservoirs à essence, ressemblait aux modules de cuisine moderne que l’on peut agrandir à loisir. Le long de la paroi, nous fixâmes quelques planches, pour les pommes de terre, les oranges et notre provision de conserves : confiture, choucroute, extrait de tomate. La farine, le sucre, le riz, les fruits et légumes secs restaient provisoirement dans la cabine du camion. En revanche, nous ne savions pas encore où ranger le camion lui-même. Allait-il falloir construire un garage ?
Derrière la cuisine, à l’endroit le moins abrité, la « chambre à coucher » se réduisait à deux couchettes peu profondes, creusées dans le sol dur, comportant des logements soigneusement étudiés pour les hanches et les épaules. Au fond, sur une couche isolante de grosse toile, nous disposâmes les draps, le sac de couchage, les couvertures et l’oreiller. On trouve facilement, dans les villes, des lits moins confortables.
Au début de l’après-midi, tout était terminé, et nous pouvions contempler notre œuvre. À vrai dire, l’ensemble ne paraissait pas très accueillant, un campement de romanichels particulièrement pouilleux. Mais, enfin, nous avions un toit. Comme la réserve d’eau avait sérieusement diminué, nous redescendîmes, chargés de gourdes et de bidons, dans le canyon qu’envahissaient déjà les ombres de la nuit. Il y avait des empreintes fraîches sur la piste des zèbres. Avant de nous engager plus loin, nous fouillâmes du regard le lit de sable, dans l’espoir d’apercevoir les traces de « notre taureau ». Espoir déçu : à part quelques tamaris et un groupe de jeunes anas2, le vaste ravin était vide.
La première mare se trouvait à tout au plus cent mètres du débouché de la piste. Tout au bout en aval, l’eau avait, en se retirant, déposé une couche de terre alluvionnaire, noire, humide, certainement fertile. Il devait être possible d’en faire un jardin. Ces quelques mètres carrés de vase, perdus dans l’univers de sables brûlants et de roches surchauffées, semblaient contenir une merveilleuse promesse. Tout en remplissant nos récipients, nous évoquâmes avec un lyrisme débordant la chair juteuse des blettes, la fraîcheur succulente des tomates que nous allions récolter. Hermann, tout attendri, était en train de décrire les délices d’une salade de concombre quand un coup de sifflet nous fit lever la tête. Directement au-dessus de nous, une petite antilope se dressait sur une corniche minuscule, accrochée en pleine paroi. Hermann eut juste le temps de retenir Otto par la queue ; à la même seconde, j’épaulai et appuyai sur la détente. Pendant que l’écho de la détonation rebondissait d’arête en arête, la bête plia des genoux, tomba en avant et vint s’écraser à quelques pas de la mare.
Le chemin du retour fut plutôt pénible. Hisser notre charge d’eau et le poids supplémentaire de l’antilope sur la falaise qui surplombait le canyon d’environ deux cents mètres s’avérait être un exercice harassant. Nous nous consolâmes en songeant que, dans une ou deux semaines, nous ne manquerions plus d’entraînement.
Puis ce fut la nuit. L’étroit croissant de la lune flottait dans la limpidité du ciel. Nous nous régalions de foie et de cervelle, laissant à Otto le cou de notre premier gibier. Notre dernier morceau de pain nous servait à essuyer les assiettes. La Croix du Sud brillait sous le toit avancé de notre grotte, les contours des crêtes dessinaient des lignes claires entre les étoiles et la profondeur de la plaine. Le silence était absolu ; on aurait dit que l’immobilité aride de l’espace coulait goutte à goutte sur la terre endormie.
La conversation, après avoir effleuré le sujet pénible de la guerre, s’orienta tout naturellement vers nos chances de survie dans le désert. Nous savions que notre existence allait se dérouler à l’extrême limite des possibilités physiques. Le désert allait s’imposer à nous. Même sur le plan moral notre situation paraissait précaire. D’une part, la vie primitive qui allait être la nôtre nous imposerait des mœurs incroyablement frustes, presque brutales. De l’autre, nous devions à tout prix conserver intactes notre sensibilité et notre lucidité, gages de notre équilibre mental. En somme, nous allions être ballottés entre deux conditions contradictoires, certes, mais qu’il fallait concilier. Plus d’une fois, des ermites qui avaient échoué dans cette synthèse avaient fini par perdre la raison. Plus d’une fois, des querelles dépourvues de tout fondement avaient dégénéré en voies de fait pour se terminer par un meurtre. Dans l’immense solitude de la nuit silencieuse, nous nous rendions compte que l’avenir nous réservait bien des épreuves, qu’aux aventures de la vie de nomade allaient devoir s’ajouter les aventures plus périlleuses de l’esprit. Nous apprendrions peut-être à subsister comme les Bushmen, ces chasseurs sud-africains qui vivaient encore comme des chasseurs-cueilleurs : nous ne retrouverions jamais leur façon de penser et de ressentir.
Les journées suivantes furent consacrées à notre installation définitive. D’abord, il fallut monter la génératrice éolienne qui devait alimenter la batterie de la T.S.F. et du camion. Ensuite, il nous fallait une bonne cachette pour le camion lui-même. Après plusieurs heures de vaines recherches, je découvris, à peut-être 5 kilomètres de notre « villa », une paroi suffisamment inclinée pour former une sorte de hangar. Le trajet jusqu’à ce point, situé dans un ravin au nord de notre bastion, m’avait paru praticable, à condition d’être quelque peu déblayé. En réalité, ce « quelque peu » se traduisit par une demi-journée d’efforts cuisants, pour ne pas dire herculéens. Quand, enfin, le camion fut à l’abri, les roues démontées et enveloppées pour protéger les pneus, Hermann s’affala sur une pierre et prit un air désespéré.
— Dire qu’il va falloir ramener la batterie, maintenant ! gémit-il. Tu parles d’une partie de plaisir !
La batterie placée dans un sac à dos, nous nous regardâmes et, d’un même mouvement, secouâmes la tête. Si jamais la toile passablement usée se déchirait sous ce poids concentré, la batterie se briserait au sol et nous serions irrémédiablement coupés du monde extérieur. Un risque que nous ne pouvions nous permettre de courir ! Nous entourâmes la batterie d’une bande molletière qui, passant par l’ouverture du sac, venait se poser sur le front du porteur.
Grâce à ce procédé antique, nous réussîmes à ramener notre précieux fardeau sans lui infliger de dommages.
Le soir, nous branchâmes l’appareil pour la première fois depuis plusieurs jours. Mais nous étions harassés, maussades, et le vent frisquet qui, soufflant du sud-ouest, pénétrait directement dans notre retraite ne contribuait pas précisément à notre confort. Grelottants, accroupis dans l’obscurité à même le sol, nous faisions tourner les cadrans de l’appareil. La contradiction flagrante entre les communiqués de la BBC





























