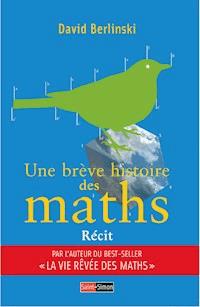
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saint-Simon
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les plus grands mathématiciens de l'HistoireDescartes, Euclide, Leibniz, Newton… Cinq ans après l’incroyable succès de La Vie rêvée des Maths, David Berlinski, le célèbre mathématicien philosophe, revient avec un nouveau volume tout aussi captivant.Au fil d’anecdotes historiques, il passe en revue la vie et l’œuvre des plus grands mathématiciens. Son style accessible et amusé plonge le lecteur dans l’aventure envoûtante et inattendue des mathématiques.Sous sa plume, théorèmes, axiomes, fonctions et démonstrations n’ont plus de secrets. Berlinski réussit avec cet ouvrage l’équation impossible entre les chiffres et les lettres.David Berlinski invite le lecteur à découvrir les théories mathématiques au fil des siècles.CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE- "De la littérature scientifique atteignant la perfection. Il n’est pas simplement facile à lire ; parce qu’il est extrêmement intelligent, ce livre peut aussi inspirer des professionnels." (N. N. Taleb, Professeur à l’Université du Massachusetts)- "Une histoire des maths amusante et pleine de grâce, incroyablement facile à lire" (G. Chaitin, Chercheur au Centre IBM Thomas J. Watson) A PROPOS DE L'AUTEUR Philosophe et mathématicien, David Berlinski est né à New York en 1942. Il a été professeur à Columbia, Stanford et Rutgers. Il vit aujourd’hui à Paris où il se consacre exclusivement à l’écriture. Il est l’auteur de nombreux romans et essais parmi lesquels figurent le Don de Newton et la Vie d’Albert Einstein (Simon & Schuster, 2001) et Une petite histoire des mathématiques (Random House, 2001).EXTRAITL’histoire des mathématiques commence en 532 av. J.-C., année de naissance du mathématicien grec Pythagore. Fuyant son île natale de Samos pour échapper au tyran Polycrate, Pythagore voyagea en Égypte où, comme tant de jeunes Grecs impressionnables, il « apprit des Égyptiens le nombre et la mesure [et] fut stupéfait de la sagesse des prêtres… »Par la suite, il s’installa dans le Sud de l’Italie, se mit à enseigner et attira rapidement des disciples. On dispose de très peu d’informations directes sur sa vie, si ce n’est que ses contemporains le tenaient pour admirable. Aucun de ses écrits n’a été retrouvé ; mais il a échappé à l’oubli, préservé par l’ambre de divers témoignages littéraires. L’admission dans la secte pythagoricienne reposait naturellement sur les compétences mathématiques. L’observation du secret était de mise, et les fèves, bannies du régime alimentaire. Les nouveaux membres devaient garder le silence pendant plusieurs années, politique qu’aujourd’hui encore de nombreux enseignants trouveront exemplaire, et étaient censés mettre ce laps de temps à profit pour méditer et réfléchir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce que la presse en dit
« De la littérature scientifique atteignant la perfection. Il n’est pas simplement facile à lire ; parce qu’il est extrêmement intelligent, ce livre peut aussi inspirer des professionnels. »
N. N. Taleb, Professeur à l’Université du Massachusetts, auteur de Fooled by Randomness.
« Une histoire des maths amusante et pleine de grâce, incroyablement facile à lire. »
G. Chaitin, Chercheur au Centre IBM Thomas J. Watson, auteur de Meta Math ! The Quest for Omega.
« Des hommes des cavernes aux torses velus couverts de fourrures nauséabondes taillaient le nom des nombres sur le manche de leur hache tandis que la graisse de bison crépitait sur le feu de bois. » On ne s’ennuie pas avec l’histoire des mathématiques racontée par David Berlinski ! […] L’auteur retrace de manière rapide mais originale une saga de notre science favorite de la Préhistoire à nos jours. […] En seulement 192 pages, c’est bref mais plaisant et cela donne envie d’en savoir plus en parcourant cette fois des ouvrages d’approfondissement. »
Magazine Tangente.
Pour Susan Ginsburg
« Le nombre de pages de ce livre est exactement infini. Aucune n’est la première, aucune n’est la dernière. »
Le Livre de sable Jorge Luis BORGES
Le nombre
L’histoire des mathématiques commence en 532 av. J.-C., année de naissance du mathématicien grec Pythagore. Fuyant son île natale de Samos pour échapper au tyran Polycrate, Pythagore voyagea en Égypte où, comme tant de jeunes Grecs impressionnables, il « apprit des Égyptiens le nombre et la mesure [et] fut stupéfait de la sagesse des prêtres… » Par la suite, il s’installa dans le Sud de l’Italie, se mit à enseigner et attira rapidement des disciples. On dispose de très peu d’informations directes sur sa vie, si ce n’est que ses contemporains le tenaient pour admirable. Aucun de ses écrits n’a été retrouvé ; mais il a échappé à l’oubli, préservé par l’ambre de divers témoignages littéraires. L’admission dans la secte pythagoricienne reposait naturellement sur les compétences mathématiques. L’observation du secret était de mise, et les fèves, bannies du régime alimentaire. Les nouveaux membres devaient garder le silence pendant plusieurs années, politique qu’aujourd’hui encore de nombreux enseignants trouveront exemplaire, et étaient censés mettre ce laps de temps à profit pour méditer et réfléchir. Certains pythagoriciens considéraient le monde extérieur comme une prison, une grotte peuplée d’ombres tremblotantes et de formes sombres et grossières. Ajoutons à cette scène confuse mais statique l’éclair sublime de l’intuition mathématique.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, il n’était guère besoin de défendre la thèse selon laquelle, en mathématiques comme en presque tout, les Grecs étaient des précurseurs. Les spécialistes des lettres classiques qui avaient mis des années à maîtriser les infernales déclinaisons grecques voyaient naturellement les Anciens grecs drapés dans leurs toges comme « des confrères d’une autre université ». Puis l’histoire antique du Proche-Orient est devenue plus précise à mesure que de grands érudits se plongeaient dans l’étude des tablettes cunéiformes et recréaient la vie d’anciens empires qui avaient été, jusque-là, engloutis dans un avant impénétrable. On a alors pu établir des choses remarquables, une histoire précédant l’histoire classique, la preuve que, dès l’aube des temps, des hommes et des femmes ont employé et aimé les mathématiques. Des marques faites sur des haches néolithiques permettent même de penser que les origines des mathématiques remontent extraordinairement loin dans le passé, et que des hommes des cavernes aux torses velus couverts de fourrures nauséabondes taillaient le nom des nombres sur le manche de leur hache tandis que la graisse de bison crépitait sur un feu de bois. Et pourquoi pas ? Comme le langage, les mathématiques sont le patrimoine de la race humaine.
Le poids de ces siècles insupportablement lointains disparaît. Nous voici environ six siècles avant la naissance du Christ. Les Grecs sont sur le point de se frayer un chemin dans tous les couloirs de la culture. Il y a tout lieu de croire qu’ils savent tout et qu’ils l’ont toujours su. Certes, les Babyloniens possédaient déjà, avant eux, une somme de connaissances mathématiques prodigieusement avancées. Observateurs sans pareils, ils avaient soumis un certain nombre de phénomènes célestes à l’autorité de techniques mathématiques précises. Ils étaient d’une intelligence remarquable. « J’ai trouvé une pierre mais ne l’ai point pesée, » écrivit un scribe. « J’ai ensuite pesé six fois son poids, ajouté deux gin, puis ajouté un tiers d’un septième, multiplié par 24. [Le résultat faisait] 1 mana. » Quel était, demande à présent le scribe à ses élèves aux cheveux huilés, « le poids de la pierre ? » Les mathématiciens verront sans doute un visage ô combien familier transparaître à travers les problèmes des scribes babyloniens – leur visage, bien sûr, omniprésent et toujours le même.
Pourtant, ces spécialistes des lettres classiques occupés à boire du sherry dans la salle commune du temps avaient raison. Les Grecs étaient bien des précurseurs.
Les nombres naturels 1, 2, 3… commencent à 1 et continuent indéfiniment, les trois petits points du mathématicien indiquant une progression sans fin. À peine essaie-t-on d’imaginer le plus grand nombre naturel possible qu’on peut en concevoir un autre, plus grand, par exemple en ajoutant 1 au premier. Et si les nombres sont infinis, ils sont aussi merveilleusement variés. Alors que le grand prodige indien S. Ramanujan gisait dans un hôpital londonien, gravement malade, les poumons minés par les glacials hivers anglais, son ami, le mathématicien G. H. Hardy, vint lui rendre visite. Paralysé par sa propre pudeur, Hardy ne put que marmonner le numéro du taxi qu’il l’avait conduit à l’hôpital : 1729.
« Pas très intéressant, comme nombre, je suppose », ajouta-t-il.
« Détrompez-vous, Hardy, » répliqua aussitôt Ramanujan, « c’est le plus petit nombre qui puisse s’exprimer comme la somme de deux cubes de deux façons différentes. »
Comme Ramanujan, les pythagoriciens se passionnaient pour l’inépuisable variété des nombres naturels, pour leurs personnalités. Ils étaient fascinés par 1, 3, 6 et 10, parce que ces nombres peuvent être figurés géométriquement comme des triangles composés de points. Ils comprenaient parfaitement l’importance des nombres divisibles uniquement par eux-mêmes et par 1 – les nombres premiers, comme 2, 3, 5, 7 et 11 ; et ils pourraient bien avoir saisi le caractère primordial de ces nombres premiers, luisant tels de sombres rubis dans la pâle panoplie des nombres ordinaires. Ils découvrirent que certains nombres, comme 6, 28 et 496, peuvent s’exprimer comme la somme de leurs diviseurs. Ils vivaient dans des grottes – c’est du moins ce que dit la légende – et là, accroupis, un tas de cailloux posés sur les genoux, ils découvrirent qu’il existait, outre les nombres triangulaires, des nombres carrés, et des relations d’amitié entre les nombres (quand l’un est la somme des diviseurs de l’autre, par exemple, ou quand la somme de deux nombres triangulaires consécutifs, comme 3 et 6, donne un nombre carré), et des progressions d’une série de nombres à une autre ; et durant tout ce temps, tandis que brûlaient leurs chandelles de suif, ils manipulèrent les nombres naturels comme s’ils jouaient, sérieux mais jamais solennels, leur infinie curiosité touchant parfois à une forme d’extase intellectuelle qui les différencie radicalement des scribes et des comptables aux sourcils broussailleux du Proche-Orient antique qui suivaient d’un pas lourd l’axe sévère et purement utilitaire d’une civilisation commerciale.
Qu’importaient aux pythagoriciens la monstrueuse pyramide ou le sphinx à l’œil vide d’un quelconque pharaon ? Ils étaient mathématiciens.
Superstitieux ? Certainement, mais Pythagore et les pythagoriciens portèrent leurs élucubrations à un plus haut niveau. C’est en cela qu’ils se distinguent. Ses mains veinées décrivant des cercles dans l’air enfumé, Pythagore en arriva à croire aux nombres, à leurs harmonies surnaturelles et à leurs symétries étranges. « Le nombre est le premier principe, » affirmait-il, « quelque chose d’indéfini, d’incompréhensible [et] qui renferme en lui tous les nombres. » Les pythagoriciens donnèrent à cette monade le nom de 1 et semblèrent par moments suggérer qu’on pouvait subordonner les nombres naturels à un lent et fastidieux processus permettant de tous les générer à partir de la monade dans une sorte de monstrueuse et pullulante création numérique. « Et le premier principe des nombres est, en substance, la première monade, une monade mâle qui enfante tous les autres nombres. » Les nombres 2, 3 et 4 entrent dans la pensée pythagoricienne empreints de l’odeur du nombre 1 : le 2 trapu et féminin, le 3 marquant un retour à la masculinité avec son triangle à trois pointes qui, une fois retourné (base en haut, sommet en bas), évoque une paire de larges épaules descendant vers une aine virile. Le nombre 4 mérite d’être glorifié – même si je n’ai aucune idée du pourquoi de la chose, hormis le fait que la somme de 1, 2, 3, et 4 donne 10, point à partir duquel la série de nombres opère un retour à 1 dans la mesure où 11 s’exprime comme la somme de 1 et de 10. C’est le nombre 10 qui était l’objet d’un serment sacré prêté la nuit au son du hululement des hiboux et dédié à « celui qui a transmis à nos âmes la tétraktys, source et racine de la nature inépuisable. »
À demi-folle, sans doute, et mystique, la pensée pythagoricienne offre l’occasion de scruter les profondeurs de ce lieu inconscient où les mathématiques trouvent leur origine, de contempler les nombres naturels comme ils l’ont sans doute été pour la toute première fois, c’est-à-dire comme une composante puissante et érotique de la création même. « Le nombre, » écrivaient les pythagoriciens, « est l’essence de toutes choses. » Le temps a éparpillé les pythagoriciens et oblitéré leur sens du jeu, pourtant cette affirmation n’a rien perdu de son captivant pouvoir de séduction. Le nombre ? L’essence de toutes choses ? De toutes choses ? Ces mots étranges et mystérieux, les Grecs les entendirent et s’efforcèrent de leur donner un sens, mais le sable allait devoir couler sur les monuments de l’Antiquité avant qu’ils pénètrent à nouveau la conscience du mathématicien. Lorsque Galilée engagea la grande révolution scientifique du monde occidental en déclarant que le livre de la nature s’écrit dans le langage des mathématiques, il ne faisait que retraduire cette idée.
Les pythagoriciens ne parvinrent jamais à expliquer ce qu’ils voulaient dire quand ils affirmaient que le nombre est l’essence de toutes choses. Au début de la création de la secte, ils conjecturèrent que c’était parce que, très littéralement, « les éléments des nombres étaient les éléments de toutes les choses. » C’est de cette façon, remarque Aristote, qu’ils construisirent « la totalité du cosmos à partir des nombres ». Un point de vue qu’ils ne purent soutenir. Aristote note froidement qu’il « est impossible que les corps [physiques] soient faits de nombres », ne serait-ce que parce que les corps physiques sont en mouvement et pas les nombres. À un moment donné, les allégeances intellectuelles de la secte se modifièrent et les pythagoriciens commencèrent à établir une distinction toute platonique entre le monde des choses saisissables par les sens et celui des choses saisissables par la raison. L’aspect littéral de la doctrine pythagoricienne s’efface : les nombres sont une chose, le domaine des objets sensibles une autre. Les nombres n’en restent pas moins l’essence de toutes choses tandis que les pythagoriciens progressent à tâtons vers la remarquable doctrine qui veut que l’harmonie entre les nombres soit un guide de l’harmonie entre les choses.
« Pour donner un exemple, » remarqua Aristote en parlant des pythagoriciens, « dès lors que dix leur semblait être le nombre parfait et englober l’ensemble des nombres, ils affirmèrent que le nombre de corps célestes était de dix et, ne pouvant en observer que neuf, postulèrent l’existence d’un dixième astre, l’Anti-Terre. » Une hypothèse qui n’a rien de saugrenue ni de mystique : c’est le même processus déductif qui n’a cessé de guider les physiciens du XVIIe au XXIe siècle. C’est le fondement de leur foi.
Dans les années 1920, par exemple, le physicien anglais Paul Dirac décida d’étendre les équations de champ de Klein-Gordon pour qu’elles contiennent des solutions relativistes pour l’électron. Laissons de côté les détails de cette entreprise ; ce qui compte, c’est la manœuvre de navigation qui consiste à s’engager sur une route que l’on ne peut pas voir en se guidant d’après une route que l’on a déjà vue. Dirac se heurta rapidement à des difficultés. Il fallait qu’il factorise des équations, comme quand on passe de x2 + 11x + 10 à (x + 10) et (x + 1), et il avait besoin pour cela de nouveaux objets mathématiques. En avançant à tâtons, il parvint à résoudre les équations de Klein-Gordon, l’électron relativiste apparaissant comme le corrélat physique d’un objet mathématique. Puis il remarqua une chose étrange. Les solutions auxquelles il était parvenu étaient aussi fourchues que la queue du diable. L’une correspondait à l’électron attendu, le signe négatif de la solution s’accordant avec la charge négative de l’électron ; mais une autre, opposée, semblait répondre en tout point à l’électron exceptée pour la charge. Des physiciens de moindre envergure se seraient discrètement débarrassés de cette solution anormale avant de poursuivre leur chemin. Dirac, lui, affirma l’existence du positron.
Il avait vu la fourche sur la queue du diable. Quelques années plus tard – pas beaucoup, d’ailleurs – la physique expérimentale confirma l’existence du positron.
Écartons sans hésiter le côté fumeux du folklore pythagoricien – les fèves, la mystique des nombres, le charabia et la superstition. Une réalité demeure : passée à travers le prisme d’un millier de systèmes philosophiques, la doctrine selon laquelle tout est nombre reste l’idée centrale de la science occidentale, la clé indispensable de la coordination.
Les historiens grecs racontent une petite histoire curieuse. Un navire est en train de cingler à travers la mer Egée, les vagues clapotant contre sa coque tandis que les rameurs chantent en chœur. À son bord se trouvent plusieurs mathématiciens, tous pythagoriciens, encore que j’ignore totalement la raison pour laquelle un groupe de mathématiciens aurait décidé de prendre la mer.
Le théorème de Pythagore réduit à néant toute interprétation simpliste du « tout est nombre ». Le dénouement a lieu à bord de ce navire que l’on vient de voir quitter le port. Sur le pont poussiéreux du bateau, un mathématicien du nom de Hippase de Métaponte vient de dessiner un triangle rectangle dont les côtés font une unité de long ; se raclant la gorge pour attirer l’attention de ses condisciples, il fait observer que, selon le théorème de Pythagore, la longueur de l’hypoténuse doit correspondre à la racine carrée de 2.
Tap. Supposons que m/n a été réduit à sa plus simple expression.
Dans ce cas, soit m et n sont tous les deux impairs (1/3 réduit à partir de 2/6), soit m est pair et n impair (2/5 à partir 8/20), soit, enfin, m est impair et n pair (1/2 à partir de 4/8).
Hochement de tête général. Belle journée pour une croisière.
Mais si moi je m’arrête là, Hippase, lui, continua sur sa lancée en faisant remarquer avec une évidente satisfaction qu’on venait d’aboutir à une contradiction, si bien que – tap, tap, tap – supposer que la racine carrée de 2 correspond au rapport de deux nombres naturels ne tenait pas debout, si bien que – tap, tap, tap – on ne pouvait pas mesurer certaines distances au moyen des nombres naturels, si bien que – tap, tap, tap –
Mais c’est là que s’achève l’histoire. Les pythagoriciens s’emparèrent d’Hippase et le jetèrent à la mer, où, sans cesser de pérorer, il périt ignominieusement.
On raconte qu’à un certain moment de sa carrière mathématique, Pythagore se proclama l’égal d’un dieu.
Il n’avait pas tort.
La démonstration
Les mathématiques sont faites d’intuition, d’invention et d’illumination subite, mais elles sont également resplendissantes et solides comme une cathédrale gothique. Les Pythagoriciens étaient des esprits perspicaces doublés de métaphysiciens audacieux ; pour autant, ils ne se souciaient guère de manutention ou de construction durable et se contentaient de laisser leurs pensées scintiller au clair de lune. Deux siècles après leur disparition, c’est le mathématicien grec Euclide qui retroussa ses manches pour s’atteler à la tâche de bâtir des cathédrales. On l’appelait au Moyen Âge Euclide d’Alexandrie ou Euclide de Mégare, mais ces attributions sont incorrectes et c’est débarrassé du fardeau de deux faux noms qu’il nous est parvenu comme l’Euclide des Éléments, l’ouvrage qui lui a valu l’immortalité. Il s’agit là, bien entendu, d’un raccourci qui réduit à une simple note de bas de page bon nombre de mathématiciens de moindre importance entre le sixième et le quatrième siècle av. J.-C. Mais chaque cathédrale a ses souris.
Comme celle de Pythagore, la vie d’Euclide est auréolée de mystère ; on ignore même sa date et son lieu de naissance. C’est le philosophe et mathématicien grec Proclus qui a fourni le commentaire le plus détaillé sur sa vie : il se ramène à un simple paragraphe. « Euclide vivait, » écrit Proclus, « au temps de Ptolémée Ier. » Il était donc plus jeune que les élèves de Platon, ajoute-t-il, et plus vieux qu’Eratosthène et qu’Archimède. Ptolémée Ier, souverain d’Égypte, simple nain parmi ces géants, fait dans le récit de Proclus une brève et piteuse apparition lorsqu’il demande « si, en géométrie, il n’y a pas de voie plus courte que les Éléments. »
« Il n’existe pas de voie royale menant à la géométrie, » dit Euclide au pharaon d’un ton brusque.
Très conscient de l’importance de son sujet, Euclide nourrissait accessoirement un talent pour les réparties caustiques. Un autre commentateur grec, Stobée, rapporte qu’un élève ayant innocemment demandé ce qu’il pourrait gagner à étudier la géométrie, Euclide ordonna à un esclave de donner quelques pièces de monnaie au garçon, « puisqu’il tient à faire du gain de ce qu’il apprend. » Les pièces tintent, tombent et roulent dans la poussière. Stobée, l’élève borné et l’obligeant esclave sont tous en vie vers le début du IVe siècle av. J.-C. De même qu’Euclide, bien sûr. On l’admire, on lui demande conseil, on le respecte, on parle de lui ; il est célèbre ; il connaît du monde et mène une vie affairée. Puis, se moquant de façon presque désarmante de la place et du lieu, il disparaît dans un souffle d’éternité.
Très longtemps, les Éléments restèrent une référence pour tous les gens cultivés, hommes ou femmes, à tel point que lorsque sept siècles après la mort d’Euclide un philosophe s’adressant à un public d’intellectuels romains demanda malicieusement « comment construire un triangle équilatéral à partir d’un côté donné », ses auditeurs saisirent immédiatement l’allusion à la première proposition des Éléments et, avec la satisfaction de ceux qui se félicitent de leur propre culture, se mirent à commenter, en grec, le chef-d’œuvre qui avait forgé leur caractère. Gloussements d’aise à la ronde. Au XVIIe siècle, pour exposer dans ses grandioses Principia Mathematica la première et la plus grande des théories physiques, Isaac Newton choisit d’exprimer ses idées dans la langue de la géométrie euclidienne en recouvrant autant que possible les traces de ses propres inventions mathématiques, tant était grand encore l’ascendant d’Euclide.
Les pythagoriciens avaient été grisés par les nombres naturels ; Euclide, lui, était un géomètre qui se proposait de mettre de l’ordre dans les formes sensuelles mais changeantes du monde sensible. Ses Éléments sont un grand chef-d’œuvre qui, comme tout chef-d’œuvre, possède de multiples dimensions, toutes issues de la vaste intelligence d’Euclide. À première vue, il s’agit d’un manuel. Il progresse du simple au compliqué ; il est magistralement organisé ; il est clair, concis et affûté comme la lame d’un couteau. Et comme tout bon manuel, il est incompréhensible. La géométrie euclidienne exige un effort de collaboration entre l’initié et le profane, l’enseignant qui ronronne d’une voix monotone et l’élève qui somnole, jusqu’à ce que la maîtrise du sujet éclose lentement dans l’espace tiède qui s’ouvre entre ronronnement et somnolence.
Malgré l’importance que peut avoir pour des générations de lycéens son utilisation frauduleuse aux examens, un manuel a peu de chance d’assurer à son auteur l’immortalité. Mais derrière le manuel d’Euclide il y a un traité, un ouvrage plus grand et plus noble, qui s’adresse au mathématicien, donc au professionnel. Ainsi, bien sûr, qu’à nous. Les objets de la géométrie plane possèdent une existence qui leur est propre, indépendamment des mathématiques. Il s’agit des points, des lignes, des angles, des cercles, des triangles, des carrés et des rectangles trapus de la vie quotidienne. Le plateau de la table dessine un carré ; le stylo trace un point ; la règle, une ligne ; et les ombres, dans la lumière éclatante du soleil, s’étendent dans un certain angle par rapport au mur ou au clocher de l’église qui les projettent. En mesurant les angles intérieurs de divers triangles, les arpenteurs égyptiens avaient certainement vu l’évidence : la somme de ces angles intérieurs fait plus ou moins cent quatre-vingts degrés.
Plus ou moins, notez bien.
Pris comme un traité, comme une théorie en fait, les Éléments mettent de l’ordre dans les débris changeants et perpétuellement déroutants de l’expérience. La géométrique pratique est une discipline empirique qui vit, respire et transpire dans le monde réel où les mesures sont toujours approximatives et les choses imprécises, confuses ou embrouillées. Dans la géométrie euclidienne, les points se précisent, les lignes se redressent, les angles se font plus nets ; des idéalisations sont faites, certains éléments de l’univers sensible, abandonnés, d’autres, conservés. Le triangle formé en joignant les pouces et les index (pour encadrer une scène, par exemple) disparaît pour céder la place au triangle euclidien, un triangle à la fois parfait et contrôlé, une fantastique extrapolation à partir du réel, une porte vers l’absolu. Dans le triangle euclidien, toutes les lignes sont droites, tous les angles sont nets et la somme des angles intérieurs se monte précisément à cent quatre-vingts degrés.
Précisément, notez bien.
Nous voici maintenant en mesure, vous et moi, d’apprécier le troisième avatar présent dans les Éléments. De même qu’il y a un traité derrière le manuel, il y a une dissertation derrière le traité, car les Éléments ne sont pas seulement un livre sur la géométrie mais un livre sur la manière d’écrire un livre sur la géométrie et qui contient de ce fait la grande coqueluche de la linguistique postmoderne : un méta-texte.
Ce troisième avatar – une dissertation sur la méthode – répond à une question vaste et générale : comment les mathématiciens parviennent-ils à la certitude ? Une réponse consiste bien sûr à dire qu’ils n’y parviennent pas et ne peuvent y parvenir, mais déterminer si cette réponse est certaine est loin d’être certain et si elle ne l’est pas, alors à quoi sert-elle ? C’est autour de semblables raisonnements circulaires qu’une grande partie de la pensée postmoderne s’emballe sans jamais prendre de la vitesse. Une autre réponse, proposée par Euclide et tous les mathématiciens qui l’ont suivi, est de dire qu’on parvient à la certitude par une méthode des plus singulières. Cette méthode dont Euclide s’est fait le champion est celle de la démonstration ; avec elle, il a transformé l’art et la pratique des mathématiques en un exercice aussi stylisé et exigeant que le kabuki japonais.
En mathématiques, une démonstration est un raisonnement : elle tombe de ce fait dans la sphère d’influence de la logique. Par l’une de ces troublantes coïncidences qui jalonnent l’histoire des idées, Aristote créa la science de la logique formelle à peu près à l’époque où Euclide construisait son propre système de géométrie. Bien que n’appartenant pas à la même génération, Euclide et Aristote se tiennent bras dessus bras dessous, liés dans les idées, liés dans le temps et liés dans l’histoire. La logique formelle englobe cependant un domaine plus large que les mathématiques : elle traite de la déduction et du raisonnement en général ; une démonstration mathématique est un outil plus précis et plus spécialisé qu’une argumentation théologique ou juridique. Ce n’est qu’au vingtième siècle que les mathématiques et la logique, après avoir si longtemps échangé leurs haleines moites, fusionneront fiévreusement pour donner naissance à une discipline unique, celle de la logique mathématique.
En mathématiques, une démonstration est une construction intellectuelle où l’on part d’hypothèses pour arriver à des conclusions par un certain nombre d’étapes déductives précises. Les hypothèses sont appelées axiomes et les conclusions théorèmes. Affinons un peu cette définition : une démonstration est une série finie d’affirmations telles que chaque affirmation est un axiome ou découle directement d’un axiome au moyen de règles strictes et étroitement définies. Le travail du mathématicien est de dériver des théorèmes à partir de ses axiomes ; pour peu qu’il ait soigneusement bâti son système, il peut faire jaillir une cascade de théorèmes d’une série d’axiomes minutieusement choisis. Telle est, en résumé, la méthode de la démonstration, même si aucun résumé ne peut rendre compte de sa rigueur ni des exigences extraordinaires qu’elle fait peser sur les mathématiciens. La démonstration mathématique ne possède aucun équivalent dans l’expérience intellectuelle humaine. Raison de plus pour s’émerveiller à la pensée qu’Euclide ait pu la créer et la mettre simultanément en pratique dans les Éléments, un peu comme s’il était parvenu à s’auto-enfanter.
La méthode de la démonstration offre au mathématicien la perspective d’une certitude, mais c’est une forme de certitude conditionnelle. On part d’hypothèses pour aboutir à des conclusions ou d’axiomes pour aboutir à des théorèmes. Si le marteau de la certitude s’abat sur les théorèmes, il ne saurait tomber avec la même force sur les axiomes.
Euclide partagea ses hypothèses en trois catégories : les définitions, les postulats et les notions communes. Les définitions, disons-le tout de go, sont décevantes. Au nombre de vingt-trois, chacune d’elles donne l’impression qu’Euclide se lance dans une entreprise intellectuelle qu’il est incapable de mener à bien. Ainsi, écrit-il, un point est ce qui n’a aucune partie ; une ligne est une longueur sans largeur ; et les extrémités d’une ligne sont des points. Telles sont la première, la deuxième et la troisième définition d’Euclide. La critique que leur font les logiciens, c’est soit qu’elles tournent en rond, soit qu’elles amorcent un recul fâcheux. Savoir qu’un point est ce qui n’a aucune partie ne sert pas à grand-chose si n’avoir aucune partie se définit comme le fait d’être semblable à un point ; et sinon comme cela, alors comment ? Pris entre la ronde et le recul, les textes de géométrie modernes se contentent d’énumérer leurs termes indéfinis sans essayer de leur donner un sens. D’autres termes sont définis explicitement par référence aux termes indéfinis. Cette façon de faire est saine et valable : en remontant progressivement la chaîne des définitions on aboutit à un cul-de-sac où le sens des termes est soit posé soit passé sous silence.
Les notions communes d’Euclide sont plus satisfaisantes. Tombant dans la catégorie des banalités intellectuelles précieuses, elles n’ont rien qui puisse offenser la logique. Les voici :
Les grandeurs égales à une même grandeur sont égales entre elles.
Si des grandeurs égales sont ajoutées à des grandeurs égales, les totaux sont égaux.
Si des grandeurs égales sont retranchées à des grandeurs égales, les restes sont égaux.
Les grandeurs qui s’adaptent entre elles sont égales entre elles.
Le tout est plus grand que la partie.
Euclide les baptisa notions communes car il estimait que, d’une certaine façon, elles devaient faire partie intégrante de tout système mathématique traitant de la géométrie. Les logiciens modernes jugeraient qu’elles appartiennent au domaine de la logique mais peu importe leur habitat naturel : nul ne risque de susciter l’indignation en affirmant que le tout est plus grand que ses parties.
Restent les postulats, germes de la géométrie euclidienne. Ils doivent répondre à deux contraintes : être suffisamment riches pour qu’on puisse en dériver tout ce qui est important en géométrie ; être suffisamment évidents pour qu’on les accepte sans discussion. Les postulats d’Euclide ne sont pas parfaits. Un ver se dissimule parmi eux. Néanmoins, jugé à l’aune de ses prédécesseurs, le système qu’ils permettent de bâtir s’avère non seulement remarquable mais sans précédent et il fait d’Euclide le plus grand dans ce domaine parce que le premier.
Cinq postulats suffisent pour créer le monde euclidien. Les trois premiers sont de nature constructive : ils affirment que quelque chose peut être fait ; ils permettent de le faire. Supposons possibles les actions suivantes, écrit Euclide :
1. Tracer une droite de tout point à tout autre point.
2. Prolonger un segment de droite en une droite complète.
3. Tracer un cercle avec n’importe quel centre et n’importe quel rayon.
Ces trois postulats sont simples et facile à comprendre. Postulat 1 : là où il y a deux points, il y a une ligne. Postulat 2 : là où il y a une ligne droite, il y a une ligne droite plus longue, et ainsi de suite à l’infini. Postulat 3 : des cercles à gogo.
Le quatrième postulat est une déclaration qui englobe sous l’aspect de l’égalité tous les triangles rectangles où qu’ils se trouvent dans l’espace :
4. Tous les angles droits sont égaux entre eux.
Reste le cinquième postulat et avec lui, le ver dans le fruit. Un ver que l’on voit aujourd’hui se tortiller dans la formulation du mathématicien écossais du XVIIIe siècle John Playfair :
5. Par un point pris hors d’une droite, on peut mener une et une seule parallèle à cette droite.





























