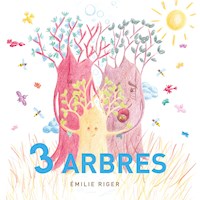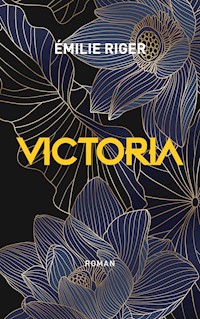
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un prénom royal pour seul héritage paternel, une mère mal-aimante, un beau-père qui ne sera jamais son père. Victoria a dix-sept ans, et de la noirceur plein la tête. Des questions sans réponses. Des envies d'ailleurs non assouvies parce qu'autour d'elle, ils sont indispensables. Amie la folle, Vincent le silencieux et Octave le lumineux, qui l'aime. Quand elle met au monde l'enfant d'Octave, la noirceur est toujours là, l'envie trop forte. Victoria disparaît. Octave devient père et attend, parce qu'il est sûr, de l'amour, du futur, d'eux. Dans ce roman à deux voix, où tout est affaires de poids et de choix, où les aspirations se heurtent aux réalités crues, où destin et construction se défient, il s'agira de trouver sa place. Celle où le noir prend vie par la lumière. Au fil d'une écriture ténue, Emilie Riger déploie une humanité sensible. Bouleversante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le bonheur, lui aussi, est inévitable. Anonyme
Sommaire
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 1
Depuis toute petite, je sais deux choses : je ne dois pas traîner dans les pattes de ma mère, et l’homme à côté d’elle n’est pas mon père, même si je l’appelle papa.
Deux certitudes se sont donc installées très vite : il n’existe pas vraiment de place pour moi et les mots ne disent pas ce qu’ils sont censés signifier. Pourtant, certains me plaisent beaucoup. « Funambule », par exemple. Il contient toute la légèreté d’une bulle suspendue dans les airs, on pourrait presque oublier que les bulles finissent toujours par éclater.
– Vic, tu m’écoutes ?
Non, je ne l’écoute pas. Lui, c’est Octave, mon petit ami. Encore un mot qui ne veut rien dire, il est plus grand que moi d’au moins vingt centimètres, et ce n’est pas mon ami. Mon amoureux, peut-être, même si cela sonne enfantin et que je ne suis pas sûre de savoir ce qu’est l’amour. Par contre, je sais que les bras d’Octave sont le seul endroit où je me sens presque à ma place. La première fois qu’il m’a embrassée, j’ai trouvé cela plus incongru qu’agréable. Je n’avais pas l’habitude des baisers. Mais Octave est patient.
– Tu es d’accord ou pas ?
Il s’est redressé sur un coude, faisant basculer ma tête. Je le pousse pour qu’il se rallonge.
– D’accord pour quoi ?
Il prend mon menton dans ses doigts, attend que je le regarde. Il sait si je l’écoute ou pas quand il sonde mes yeux.
– D’accord pour camper avec Vincent et Amie ce week-end.
Je rêve de bouleversement, de chamboulement. Octave me propose de camper à trois kilomètres d’ici avec deux copains d’enfance que l’on connaît par cœur. Il faudra comme chaque fois faire pipi dans l’herbe derrière un arbre, se laver dans une rivière gelée, manger des conserves sur un réchaud à gaz et se coller des claques pour écraser les moustiques. Mais Octave se fout de ces détails.
– Si tu veux.
– Tu préfères autre chose ?
Je me tourne sur le côté, mon dos collé à son ventre, pour échapper à ses questions. Oui, je veux autre chose, qu’il change le monde pour construire une vie capable de prendre le pas sur mes pensées. Mais Octave ne veut rien changer. Octave aime le monde tel qu’il est, surtout quand il me tient dans ses bras. Ce n’est pas de l’arrogance, c’est lui qui me l’a dit.
Octave est gentil. J’aime son visage, ses mains, sa simplicité – et sa gentillesse. Je m’appelle Victoria, lui m’appelle « Vic », ça ne me dérange pas, ou « Victoire », ce qui m’agace davantage car je ne peux m’empêcher de voir de l’ironie dans ce surnom. Il est drôle aussi, et léger. Tellement léger qu’il me fait du bien tout en mettant en valeur à quel point je suis pesante. Je me demande parfois s’il n’est pas trop léger, justement. Tout est simple pour lui, trop simple pour mon esprit alambiqué. J’aurais voulu un amoureux de roman qui m’envole si loin que j’en oublierais mes questions et mes déséquilibres. J’aurais été d’accord pour gober ses promesses comme des shoots de tequila, tellement je veux fermer fort les yeux et croire – en quoi je ne sais pas, et ce n’est pas important – juste croire. S’il m’avait désigné les étoiles en jurant qu’il redessinerait leurs constellations pour moi, j’aurais pu le croire. Mais voilà, Octave aime le monde tel qu’il est quand il me tient dans ses bras, que pourrait-il changer ? À la place, il m’embarque dormir sous une tente à trois kilomètres.
– Comme tu veux. Je m’en fous.
Nous venons de faire l’amour dans le petit lit à une place qui occupe ma chambre. Avec un préservatif, toujours, toujours, toujours. Ma mère a ancré dans ma tête la terreur d’une grossesse surprise dès mon entrée au collège – je suis un accident, je ne vais quand même pas reproduire l’erreur ?
Maintenant, j’ai envie qu’il s’en aille. La bibliothèque aligne mes livres contre le mur en face de moi et nous sommes jeudi. Le jeudi, j’écoute de la musique en faisant les poussières. Je vide chaque étagère, époussète tous mes romans, avant de les remettre à leur place, bien alignés, classés par ordre alphabétique. Il n’y a pas vraiment d’espace pour moi dans ce monde en-dehors des bras d’Octave, mais j’aime que chaque chose soit à sa place.
Quand Octave se lève, le froid vient se déposer sur ma peau là où son corps m’enveloppait. Il se rhabille alors que je tire la couette sur mes épaules.
– Samedi, on bosse notre exposé et après on se taille au lac avec Vincent et Amie. O.K. ?
Je hoche la tête. J’aime Amie, mais sa bibliothèque m’angoisse. Elle range ses livres en fonction des personnages qui habitent les romans. Impossible pour elle de laisser côte à côte le cynisme du narrateur de Soumission et la candeur du Homer Wells de L’œuvre de Dieu, la part du Diable, même si Houellebecq et John Irving voisinent dans l’alphabet. Elle pense que les livres communiquent entre eux, et veut protéger les belles âmes qu’ils contiennent et mettre à l’écart les mauvaises. Il en résulte un désordre insensé sur ses étagères, et son père libraire approvisionne très souvent son désordre. Amie est folle, c’est la raison la plus probable de notre amitié. Mais sa folie est douce, la mienne est rugueuse.
Je cligne des yeux. Je ne sais pas depuis combien de secondes, combien de minutes, Octave est agenouillé devant moi, à étudier mon visage en fronçant les sourcils.
– Ça va, Vic ?
S’il fronce les sourcils, c’est parce qu’il s’inquiète pour moi, souvent, trop.
– Oui.
– On se voit demain ?
Je voudrais répondre non. Que demain, je serai partie ailleurs, loin, à la recherche d’un lieu où j’aurais ma place. Que je voudrais qu’il vienne avec moi, parce que sans lui, j’aurais peur. Mais je n’ai aucune idée de la direction qu’il faut prendre pour partir à l’aventure. C’est plus facile de rester là. Demain, je le retrouverai au lycée.
Il m’embrasse et sort de la chambre, ses baskets à la main. Je me demande comment je vais tuer le temps pour oublier toutes ces heures à venir qui seront désespérément identiques, prévisibles et ennuyeuses, jusqu’au moment où je le retrouverai. Et je déteste avoir besoin de lui aussi fort alors qu’il ne m’apporte pas ce dont j’ai envie.
Ma grand-mère disait qu’il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Elle avait des tas d’expressions débiles comme ça ; je n’ai pas pu les empêcher de s’incruster dans ma mémoire. Moi, dans mon panier, il y a Octave, et c’est tout. Amie aussi, parce qu’elle est folle, et Vincent parce que son père thanatopracteur tient les pompes funèbres et qu’il veut prendre sa suite. Je suis bizarre, c’est logique que j’aime les gens bizarres. Il n’y a qu’Octave qui ne cadre pas – trop normal.
À moins que sa bizarrerie à lui, ce soit de m’aimer, moi.
– Vous savez qui vous allez faire ?
La phrase de Vincent n’a aucun sens : on ne peut pas « faire » quelqu’un. Mais Vincent est un vrai fainéant avec les mots. Il sait très bien les utiliser, simplement il s’en donne rarement la peine. Il décolle les yeux de la compote de pommes qu’il vient de finir et me fixe. C’est son truc, Vincent, le silence et les yeux. C’est comme ça qu’il parle en fait, pas avec la bouche.
Octave ne répond pas, il a le nez dans son téléphone, à lire un article sur je ne sais quel match. Les Jeux olympiques le rendent dingue avec le décalage horaire. Ce matin, il s’est endormi d’un coup en cours d’espagnol. Sa tête a heurté la table avec un bruit sourd et la prof s’est retournée. Il s’est redressé dans un sursaut, mais il a maintenant une grosse bosse au milieu du front.
Amie ne répond pas non plus. Tournée sur sa chaise, elle parle à une fille derrière notre table, je ne sais pas laquelle, je ne retiens pas leurs noms, elles m’énervent. Il reste donc moi.
– Non, on n’a pas encore cherché.
– Ça me saoule. T’as pas un nom à me refiler ?
– Non, s’exclame Amie soudain revenue parmi nous. On va chercher – et trouver. Et ça va être difficile, parce que c’est justement ce qui va prouver à quel point ça déconne, tout ça.
« Tout ça », c’est notre prof d’histoire qui veut nous lancer à la découverte des femmes artistes oubliées. Dans son esprit, vingt-six élèves travaillant en binômes arracheront treize femmes au purgatoire de l’oubli. Ça me paraît bidon, parce qu’on ne trouvera jamais aucune trace de celles qui ont vraiment été oubliées. Mais allez discuter avec un prof… en tout cas, pas avec celui-là.
– Si, j’ai trouvé.
Octave a posé son téléphone, il joue avec mes doigts posés sur la table.
– Qui ?
– Élizabeth Siddal.
On le regarde ahuris.
– Qui ?
Lui ne regarde que moi.
– Une poétesse et peintre qui a servi de modèles aux grands artistes préraphaélites.
J’enlace sa main et la serre fort. J’écris beaucoup, notamment des poèmes, Octave le sait, même si ni lui ni personne ne les a jamais lus. Je les déchire au fur et à mesure. Et j’aime la peinture préraphaélite. Je peux passer une éternité devant mon affiche de la noyade d’Ophélie peinte par Millais. Octave se penche vers moi.
– C’est elle, Ophélie.
Je serre sa main encore plus fort. C’est pour des moments comme ça que le mot amoureux me plaît, même s’il est enfantin.
Élizabeth Siddal 1829-1862 Élizabeth SiddalL 1829-1862
Octave fronce les sourcils mais je tiens à ce second « L » originel. Il secoue la tête puis éclate de rire.
– C’est presque trop !
– Trop quoi ?
– Trop romantique. Sa vie, sa mort… Il pointe les feuilles couvertes de notes et de photos étalées sur son lit. Elle est tellement romantique qu’on dirait qu’elle est l’archétype du romantisme.
Modèle des peintres préraphaélites, leurs tableaux reflètent sa beauté à l’infini, ses épais cheveux roux, ses grands yeux verts aux paupières lourdes, sa peau pâle. Elle apparaît sur tant de toiles, présente et intemporelle à la fois, comme une déesse ayant condescendu à se laisser voir un instant par les hommes.
C’est elle, l’Ophélie de Millais. J’ai passé des heures à observer cette peinture. Ma mère croit à une fascination morbide pour le suicide, elle n’a rien compris. Je suis touchée par le désespoir qui émane du roman de Shakespeare, bien sûr, mais le désespoir est tellement commun. Ce qui me fascine, c’est l’approche de Millais. Alors que le drame se joue sur le visage d’une jeune femme malheureuse au point de vouloir échapper à la vie, sur les lignes de son corps abandonné aux flots, Millais a apporté une telle précision au décor que je peux identifier chaque fleur, chaque plante qui enveloppe sa dérive. Ce soin méticuleux porté aux plus infimes détails, cette idée d’une nature d’essence supérieure (divine ?), aussi importante que l’homme, me ressemblent. Et « Lizzie » n’était pas non plus tout à fait à sa place dans cette Angleterre victorienne (Victoria, mon prénom, celui de la reine, est le point de départ de mon intérêt pour cette période). Être modèle pour peintre faisait un peu désordre à cette époque.
– Tu la regardes différemment, maintenant ?
Je fixe Octave vautré dans les oreillers, les mains derrière la tête. Il est né nonchalant, et rien de ce qu’il a vécu depuis ce jour n’est venu contrarier cet abandon confiant.
– Qui ?
– Ton Ophélie, tu la regardes différemment ?
Pour peindre son tableau, Millais a fait poser Élizabeth dans une baignoire remplie d’eau pendant des heures, en plein hiver. Absorbé par son travail, il a laissé s’éteindre les lampes placées dessous pour chauffer le bain. Élizabeth a gardé la pose, sans rien dire. Que se passait-il dans sa tête alors que l’eau refroidissait et qu’elle gisait là, immobile, bouche entrouvertes et yeux fixes, dans la peau d’une femme qui venait de se noyer ? Elle a attrapé une pneumonie, qui fut soignée au laudanum, dont elle devint dépendante. Est-ce à cet instant que le drame a contaminé sa vie ? Avec l’addiction ? Ou un peu plus tard, quand Rossetti en a fait son modèle exclusif, refusant qu’elle continue à poser pour d’autres peintres pendant que lui batifolait avec d’autres femmes ? Pourtant, il a dû l’aimer. Il lui a enseigné la peinture, elle fût alors considérée comme un génie pour ses talents artistiques. L’histoire dit qu’elle était tellement faible au moment de leur mariage, qu’il fallut la porter jusqu’à l’autel. Était-ce Rossetti qui la soutenait dans la nef de l’église ? L’a-t-il de nouveau soulevée dans ses bras en la découvrant morte quelques mois plus tard à seulement trente-quatre ans ? Il l’enterra avec l’unique copie de ses propres poèmes, mais sept ans plus tard, il fit rouvrir son cercueil pour les récupérer. Pas fou, Rossetti.
Était-ce une histoire d’amour ou d’emprise ? Rossetti a changé son nom, de Sidall en Sidal. Elle écrivait des poèmes sans jamais être allée à l’école pour apprendre à lire et à écrire. Elle fut la seule femme dont les toiles furent présentées à l’exposition préraphaélite de 1860.
Élizabeth SiddalL. Je veux rendre à Élizabeth ses deux ailes.
Cette histoire de nom me préoccupe. Nous faisons simplement un exposé pour le prof d’Histoire. Pourtant, par ce biais étrange, la « Grande Question du Père » fait de nouveau irruption dans ma vie.
Mon père a imprimé sa marque avant de partir. Il m’a nommée.
Victoria.
Quel est le pouvoir d’un prénom ? Est-ce lui qui nous sort du néant, dessine les contours de notre existence ? Définit-il notre capacité à être, à devenir une personne qui dit « je » ? Ou bien est-ce simplement une étiquette, une convenance, un code pour s’appeler et s’interpeller, être rangé dans une case administrative ?
Victoria.
Pourquoi ?
Parce qu’il aimait la reine, c’est tout ce que ma mère a pu me dire. Qu’est-ce qui, dans sa vie, faisait écho à la reine Victoria ?
Il m’a transmis cet héritage, cette passion supposée, puis a disparu.
Il est parti, tout de suite après ma naissance. Il m’a reconnue puis s’est enfui, comme si mon existence écrite noir sur blanc était devenue trop grande, trop réelle pour qu’il puisse y faire face.
Il est parti, en me laissant me débrouiller avec Victoria, ce prénom, la seule chose qu’il ait voulue pour moi avant de me quitter. Seule pour me construire et devenir quelqu’un à la hauteur de ce nom, Victoria. Comme si ce prénom était un objectif qu’il m’avait assigné.
J’ai appris par cœur l’histoire de la reine. J’ai cherché et creusé les plus infimes détails, à la recherche de ce but que je suis censée atteindre et qui est peut-être la clé pour le trouver. Mais quel objectif ? Savoir le définir, l’isoler parmi des milliers d’informations, cela fait-il partie du test ? J’aurais voulu quelques indices pour m’aiguiller. Qu’est-ce qu’il attend de moi ?
Je cherche et creuse. Il suffit que je le mérite, que je me montre à la hauteur. Je suis incapable de dire si cette obsession vient de l’importance que ce père inconnu peut avoir pour moi, ou si je tiens ce trait de caractère de ma mère, comme si j’avais hérité d’une pièce de machine au milieu de ma chair. Mais quand j’aurai trouvé, il reviendra, n’est-ce pas ?
Je rêve d’un père parce que je sais qu’il existe, quelque part, ailleurs. Si j’avais ignoré le jeu des chaises musicales qui a suivi ma naissance, aurais-je ressenti le moindre manque ? Probablement pas.
À dire vrai, je ne pense pas tout le temps à mon père. Souvent, mais pas tout le temps. Je fais diversion avec une multitude de peurs, nourrie par les films catastrophes et postapocalyptiques dont je fais une consommation effrénée, pour éviter la seule vraie peur réaliste qui m’obnubile et dépasse mes forces. Elle est à la fois immense et minuscule, omniprésente et absente. Car ce cauchemar est sournois. S’il se réalise, rien ne changera dans ma vie. Et pourtant, tout sera différent. Cette angoisse qui me pousse vers des horreurs distrayantes – les zombies ont ma préférence – est de ne jamais exister aux yeux de mon père. Lorsque je le rencontrerai, s’il ne me juge pas digne de la reine Victoria, je ne serai donc pas digne d’être aimée de lui.
Comme il est absent de ma vie, concrètement, cela ne changerait rien. Mais comment pourrais-je poursuivre une vie qu’il mépriserait ?
Je voudrais m’ennuyer et utiliser mon énergie à me demander pourquoi je m’ennuie autant, ou ce que j’ai envie de faire. Je voudrais que mes pas suivent un chemin nettement tracé, comme la plupart de mes copains. Mais cet alter ego royal m’empoisonne l’existence. Il exige de moi de ne pas me contenter de ce que j’ai sous la main. Il me contraint à me poser la question de ce que je veux devenir, au lieu de devenir ce qui se présente.
Les attentes supposées de mon père ont hautement stimulé mon imagination. Le pragmatisme de ma mère, au lieu de les contrebalancer, leur a donné un côté presque obsessionnel en tordant mes rêveries jusqu’à en faire des obligations. Je ne sais pas d’où me vient que cette imagination se plaise à me démontrer que tout doit tourner à la catastrophe à tout instant. Que moi et tous ceux qui m’entourent, même s’ils n’en ont pas conscience, sommes perpétuellement sur la brèche entre calme et enfer, une jambe de chaque côté. Comme si nous bâtissions nos vies au-dessus d’une faille sismique sans nous préoccuper de la moindre norme de construction. Normal que tout s’écroule si souvent. Rien n’est solide, rien n’est acquis, tout peut sombrer d’un instant à l’autre, comme le Titanic.
Alors quel que soit l’amour d’Octave, comment pourrait-il compenser les deux désamours qui fondent ma vie : mon père et ma mère ?
– Tu as fini de remplir tes vœux ?
Nous dînons tous les trois devant la télé, ma mère, mon beau-père Luc et moi. Rien ne vient jamais troubler ce moment qui tient à la fois du rituel et de la fuite. Regarder ensemble les informations nous permet de nous éviter. Pas de regards croisés, aucun silence aspirant à être rempli.
Ma mère ne me demande pas si j’ai établi une liste de souhaits pour Noël. Elle veut savoir si je suis à l’heure dans mes démarches administratives pour mes études. Le mythique Parcoursup, qu’ils auraient dû appeler « Parcours du combattant ».
Ma mère s’appelle Sabine, et elle est pragmatique. Je ne pourrais pas dire si c’est sa nature, ou si cela lui est venu avec la vie. Pour faire tourner une brasserie, a-t-on un autre choix que le pragmatisme ? Mais la question ne me vient pas naturellement, c’est mon ami Vincent qui me l’a posée. Je ne vois de ma mère que ce qui la cache : sa fatigue perpétuelle, son efficacité, son acharnement. Je serais incapable de dire qui est Sabine derrière ces écrans de fumée, si elle peut être drôle parfois et pas toujours sérieuse ; enthousiaste et pas seulement méfiante ; aventureuse ou lieu de préférer la prudence ; tendre au-delà de ses exigences… Si elle est quelqu’un ou quelque chose en-dehors de cette machine à trouver des solutions et atteindre des buts. Alors je me contente des apparences : les mains plissées de trop tremper dans l’eau, les jambes gonflées par les piétinements, les yeux âpres posés sur le monde, la vie, son travail – et moi. Sabine reste toujours à un cheveu de l’amertume, bien trop occupée pour gaspiller son énergie en regrets inutiles.
Le tambourinement impatient de ses doigts sur la nappe me ramène à sa question. Ma préoccupation majeure actuelle – et urgente, doit être mon avenir. J’avais prévu de suivre une formation d’assistante sociale, mais je ne sais plus si je le veux encore. J’ai envie d’aider, de donner. De me sentir utile aussi, probablement. Mais plus je regarde les informations de 20 heures en dînant, plus je me dis que la tâche est immense, bien plus grande que moi. J’ai le sentiment que je pourrais me laisser consumer par ma vocation, être engloutie par les souffrances à combattre, sans que cela fasse la moindre différence : je ne ferais pas le poids face au malheur du monde. Alors, à quoi bon ?
Le risque majeur, si je ne trouve pas très vite un projet professionnel réaliste et solide, est de me faire embaucher d’office au Café des Roses, la brasserie de ma mère. Porter le plateau, je sais, ma mère me l’a appris dès le collège, histoire de m’occuper « sainement ». Du temps libre, oui, mais pas trop, car comme chacun sait, l’oisiveté est mère de tous les vices. Mais ce que j’ai accepté de bon gré pour gagner des sous et aider ma mère quand elle manquait de bras, je n’en veux à aucun prix pour les quarante années à venir. Travailler avec ma mère et prendre sa suite n’est pas une option à mes yeux, mais c’en est une pour Sabine si je ne me décide pas très rapidement.
– Non, je n’ai pas fini de remplir mes vœux. Mais j’ai encore un peu de temps.
Pas beaucoup, d’accord, mais un peu.
– Pas fini ? As-tu seulement commencé ?
Elle allume une cigarette pour ravaler une vacherie que je n’ai aucune envie d’entendre, mais que je ressens comme si elle l’avait crachée à voix haute. Elle mêle mépris et impatience. Son impatience à se débarrasser de moi maintenant qu’elle atteint enfin le bout de son devoir, m’élever : je vais avoir dix-huit ans dans quelques mois. Mon beau-père Luc joue sa sempiternelle carte de l’apaisement.
– Allons, chérie, elle traverse l’adolescence, ce n’est pas facile.
Cela sonne toujours étrangement de l’entendre appeler ma mère « chérie ». Sabine me semble à mille lieues de ce statut de tendre amoureuse qu’il s’obstine à lui attribuer.
– Quelle adolescence ? Ce concept est un fourre-tout qu’on utilise à toutes les sauces. Est-ce que j’ai fait une crise d’adolescence, moi ? Non. J’ai accouché et j’ai travaillé.
La crudité de ses mots me renvoie à la brutalité du monde dans lequel elle vit, où ne comptent que le concret et l’utile. Un monde dénué de toute spiritualité. J’économise mon énergie en calquant mon attitude raisonnable sur celle de Luc.
Mon beau-père se racle la gorge pour prévenir qu’il va prendre la parole. Luc fait toujours ça avant de parler, comme s’il devait demander la permission. Lui non plus n’est pas sûr d’avoir sa place autour de notre table.
Je l’appelle papa parce que c’est plus pratique. J’ai cru que c’était ce que l’on attendait de moi. Au vrai, j’ai maintenant compris que ma mère se fout royalement de comment je l’appelle, tant que je lui obéis et ne lui casse pas les pieds au point de lui donner envie de partir.
En fait, il ne serait jamais parti, m’a-t-il avoué un jour. Même un enfant-démon aurait échoué à le faire fuir, simplement parce qu’il aime Sabine, c’est aussi simple et incompréhensible que ça. Mais si elle finit par le comprendre un jour, ce sera trop tard pour en faire son bonheur. Après toutes ces années, ma mère ne sait toujours pas si elle l’aime, s’il lui inspire de la tendresse ou de l’agacement, si elle veut le remercier ou s’en débarrasser. C’est comme une contagion de l’incertitude constante de Luc qui déteint sur tout ce qu’il touche. Autant ma mère est capable de prendre une décision en un quart de seconde à propos de sa brasserie ou de sa fille, autant en ce qui le concerne, elle se pose les mêmes questions depuis dix-huit ans. Elle ne l’a pas épousé par amour, mais parce qu’il était plus facile d’être deux pour élever un enfant : une opportunité en quelque sorte. Sabine se sent redevable envers Luc, c’est peut-être aussi cela qui la perturbe. Mais il a au moins le mérite d’être toujours d’accord avec elle et de savoir tout réparer. C’est utile, un homme qui sait tout réparer, m’a-t-elle dit. Pas seulement les voitures dans son garage, ça c’est son métier, mais tout, de la machine à laver au volet roulant de la cuisine ou à la chambre froide de la brasserie.
Sabine veut une vie pratique. Luc m’a raconté un jour qu’il l’aimait si fort qu’il m’avait englobée dans son amour, comme un lot indissociable, une bête à deux têtes. Il m’est même plutôt reconnaissant, car il pense que sans mon poids qui tirait les bras de ma mère vers le bas, jamais elle n’aurait baissé les yeux sur lui.
C’est souvent une affaire de poids, dans la vie. Ceux que l’on porte, que l’on traîne et trimballe. Je voudrais que ce ne soient pas les poids qui construisent les vies. Qu’elles se bâtissent plutôt sur les aspirations, les soulagements, et peut-être même les envies. Cela ferait probablement des vies plus légères.
Pour en revenir à Luc, qu’en plus je sois sage lui inspira une vague affection à mon égard. Cet à-peu-près mal délimité, informe, sans consistance, est le reflet exact de l’homme qu’il est – si tant est qu’un être aussi indécis puisse avoir un reflet exact – fidèle serait plus approprié.
Ce soir pourtant, il se gratte la gorge d’une façon différente : il semble avoir quelque chose d’important à dire. En tout cas, important pour lui, suffisamment pour qu’il coupe le son de la télé et se tourne pour être assis bien en face de moi.
– Victoria, tu vas avoir dix-huit ans. Je ne sais pas trop de quoi tu as envie pour ton anniversaire.
– Je ne comprends pas. On travaille sur ma voiture depuis des mois. C’est toujours ma voiture, hein ?
Il agite la main comme pour chasser une mouche.
– Oui, oui, bien sûr. Mais je voulais t’offrir quelque chose de différent.
– Quoi ?
Il aligne soigneusement ses couverts le long de l’assiette, replace son verre de vin.
– Je me suis dit… Après tout ce temps, tu pourrais être ma fille… « pour de vrai ». Je veux dire, jusque dans les papiers. Je pourrais t’adopter, si tu en as envie aussi.
Sabine fait tomber sa cigarette sur la nappe et lâche un juron en frottant le trou pour éteindre les escarbilles. Moi, je suis sous le choc.
– Tu es sérieux, là ? je lui demande.
– Oui. Après tout, ça fait dix-huit ans que je m’occupe de toi. S’agirait juste de le mettre par écrit.
– Tu étais au courant ?
Ma mère ne répond pas. Elle découvre mon « cadeau » à l’instant. Je veux qu’elle se fâche, qu’elle crie qu’on ne peut adopter que les orphelins, pas les filles qui ont un père. Mais Sabine ne dit rien, elle a la même tête que lorsqu’elle fait la caisse en fin de journée : elle calcule ce que cela peut lui rapporter. En quel bon argent Sabine est-elle en train de convertir cette adoption ?
Mon beau-père attend, avec cette bonne grosse patience qu’il m’a toujours témoignée. Il est là depuis le début. Il a tenu ma main bien serrée dans la sienne jusqu’à ce que je sache regarder avant de traverser la rue. Il a assisté à tous les spectacles de fin d’année, se coltinant la danseuse-papillon, le pirate ou la chorale de la classe. Il lui est arrivé de m’emmener chez le dentiste. Il respecte scrupuleusement la porte fermée de la salle de bains depuis que j’ai grandi. Il m’a mis un tournevis dans les mains dès que mes doigts ont commencé à attraper le monde. Gamine, je portais ma casquette à l’envers pour l’imiter, il tourne toujours la visière sur sa nuque avant de se pencher sur un moteur. Dans son garage où j’ai passé des milliers d’heures, j’aime le noir de la gomme des pneus, les traces de graisse sur son bleu en grosse toile, le cambouis qu’il essuie avec un vieux chiffon qu’il fourre ensuite dans sa poche, toujours la même, celle de gauche à l’arrière.
Je sens combien c’est important pour lui. M’adopter, c’est le plus beau cadeau auquel il a pu penser. Au moment où ma mère rêve de me voir débarrasser le plancher, il m’offre un nid où m’abriter en cas de pépin, un refuge. C’est ça, son cadeau d’anniversaire. De l’amour. Un amour sans date de péremption. Un amour qui me choisit et qui durera au-delà de lui, puisqu’il m’offre son nom, fait de moi sa descendance.
Je voudrais lui dire oui. Il m’a appris la tendresse des gestes et la complicité silencieuse bien plus que Sabine. Je n’ai rien à lui reprocher, mis à part cette inertie qui ne change jamais une virgule aux actes de ma mère.
Mais il y a une chose que je ne parviens pas à lui pardonner : il est là, alors que mon père ne l’est pas.
Un beau-père ne suffit pas. Ce « beau » précède et efface tout ce que contient le mot père. Un père artificiel. Je sais qu’il n’a pas chassé l’autre, au contraire, il a comblé un vide abyssal. Mais il est le faux père. Un subterfuge. Le négatif parfait de celui qui m’a donné la vie.
Il m’a élevée au lieu de m’abandonner.
Il m’a accompagnée au lieu de me fuir.
Il m’a aimée de près au lieu de disparaître au loin.
Il est l’anté-père.
Je voudrais lui dire merci et hurler non. Je ne peux me résoudre à aucun des deux. Alors je pose ma serviette à côté de mon assiette, je me lève et monte dans ma chambre.
La porte refermée, je tourne le verrou, m’adosse au bois et contrains ma respiration qui s’emballe. Je reste ainsi de longues minutes, les yeux fixés sur le mur blanc face à moi. Puis à gestes lents, je m’avance jusqu’à mon bureau et prends mon téléphone pour envoyer un message.
« Mon beau-père veut m’adopter. »
Je retourne m’appuyer contre la porte pour attendre. Octave répond toujours vite, quelle que soit l’heure.
« Tu en as envie ? »
Je tape les mots que j’ai étouffés face à Luc.
« Non. J’ai déjà un père. »
« Rendez-vous à la rivière ? »
J’inspire longuement, comme si Octave m’avait arrachée à la noyade.
« Oui. »
Je jette le téléphone sur le lit, marche jusqu’à la fenêtre que j’ouvre en grand et sort sur l’avant-toit. Mes bottines crissent sur les tuiles quand je m’agenouille au bord avant de sauter. J’atterris sur le sol avec un son étouffé, et traverse le jardin noyé par la nuit. Je marche lentement.
Octave doit parcourir un chemin plus long que moi, mais il le fera en courant, Octave a toujours besoin de s’agiter inutilement. Son corps contient trop d’énergie, alors que chez moi, celle-ci se concentre dans la cervelle. Je me plante au pied du chêne et ferme les yeux. Près de moi, la rivière coule en frémissant, indifférente. Je jette parfois un œil vers le virage d’où Octave va débouler, mais le plus souvent, je guette à l’oreille le tap-tap régulier et vif de ses semelles sur la terre. J’ai déjà essayé de poser ma main sur le sol pour ressentir les vibrations de son approche, mais Octave est trop léger, jusque dans sa course : il semble gagné par l’apesanteur dès que son corps s’anime. Un frottement en pointillés me parvient au bout de quelques minutes à peine, il a dû partir immédiatement et courir plus vite que d’habitude. Il arrive jusqu’à moi, à peine essoufflé, et dose du regard le mélange instable de douleur et de colère qui m’habite. Je lui laisse le temps de poser son diagnostic avant de lâcher :
– Les hommes, changer le nom des femmes, c’est tout ce qu’ils savent faire.
Il prend ma main et nous marchons le long de la rivière, Octave resserre son étreinte sur mes doigts.
– Le jour où on se mariera, moi aussi je changerai ton nom.
D’une bourrade brutale, je le projette dans la rivière. Il disparaît sous la surface puis ressort la tête et la secoue comme un chiot qui s’ébroue. Campée sur la rive, je m’énerve.
– Je n’ai jamais dit que je voudrai t’épouser ! Et encore moins que je voudrai prendre ton nom !
Octave s’accroche à une branche, puis tend une main pour que je le hisse hors de l’eau. Dès qu’il est sorti, je le lâche.
– D’accord. Mais t’étais pas obligée de me balancer à la flotte pour le dire. Elle est gelée.
Il enlève son tee-shirt et l’essore, avec ce calme imperturbable qui fait retomber mes colères comme des soufflés trop cuits.
– Ce n’était pas du luxe. Tu puais la transpiration.
– Je suis venu dès que tu m’as appelé.
– En courant. Tu pues quand tu viens en courant.
Octave coince son tee-shirt dans sa ceinture.
– C’est pour arriver plus vite.
Je le repousse.
– Ne me touche pas, je vais être mouillée.
Octave me rattrape, me serre entre ses bras.
– Je t’aime.
Je gigote encore un peu pour ne pas me rendre trop vite. Puis me laisse aller contre lui et ferme les yeux. Il se penche pour embrasser mes cheveux.
– Voilà, c’est pour ça que c’était important que j’arrive vite.
Nous restons un long moment immobiles. Je m’en veux de l’avoir poussé dans l’eau, je le sens trembler contre moi. Je m’écarte.
– Va-t’en.
– Déjà ?
– Oui.
Octave n’insiste pas. Il a froid et il sait qu’en restant, il défera le peu de réconfort qu’il a réussi à m’apporter. Il m’embrasse, s’éloigne à reculons, puis pivote et repart à petites foulées. Quand il se retourne juste avant de me perdre de vue dans le virage, je sais à la façon dont il ralentit qu’il n’aime pas la solitude de ma silhouette. Il lève la main, je lui réponds, trop pâle dans la lumière de la lune pour le rassurer.
– Quand on se mariera, Vic, c’est moi qui prendrai ton nom ! crie-t-il.
Il disparaît dans le chemin et n’entend pas la réponse que je chuchote pour moi-même.
– Lequel, Octave ? Celui de ma mère, qui m’a eue sans me vouloir ? Celui de mon père, qui m’a nommée sans m’aimer ? Celui de mon beau-père, qui veut m’adopter ?... Quel est mon nom ?
Luc a ouvert la boîte de Pandore. Depuis sa proposition, me talonne jour et nuit l’idée que j’ignore d’où vient tout ce qui, en moi, n’est pas hérité de ma mère. Je pourrais presque palper cet inconnu que j’abrite, une latence, une menace qui me guette, tapie dans l’ombre. Comment pourrais-je en faire abstraction, quand tous passent leur temps à me le répéter ? Chaque « Victoria » murmuré, assené, ordonné, chuchoté, écrit, crié, soupiré, me rappelle qu’en moi sommeille un mystère, une reine endeuillée à laquelle mon père m’a liée avant de disparaître. Je ne sais même pas s’il m’a enchaînée ou amarrée, si la souveraine est une condamnation ou un repère.
– Tu devrais partir à sa recherche. Si tu n’arrives plus à vivre avec son absence, alors retrouve-le.
Amie est fébrile ce soir, et cela m’inquiète. Elle est comme ça quand les mots lui encombrent la tête et qu’elle doit la purger en les jetant sur le papier. Le moindre secret, même chuchoté, parvient jusqu’à elle, comme s’il trouvait refuge en elle et qu’elle était son interprète. Amie capte les histoires qui flottent autour d’elle et les écrit pour « purifier l’air », dit-elle. Nous sommes un village sans secret. Sauf ceux que l’on garde pour nous, et qui nous rongent. À une autre époque, Amie aurait été brûlée comme sorcière. Moi, je ne veux pas que mon histoire soit emprisonnée dans un carnet.
– Je suis d’accord, dit Vincent en me tendant une brochette de chamallows sortie du feu.
Je croque dedans. C’est tiède, un peu brûlé à l’extérieur, le sucre chaud écœurant à l’intérieur. Je n’aime plus ça, j’ignore pourquoi on s’obstine à en manger à chaque fois que l’on campe tous les quatre. Peut-être pour garder en mémoire le goût de l’enfance.
Quand on est enfermés dans la tente, alors que Vincent et Amie dorment depuis longtemps, je chuchote :
– Tu n’as pas dit ce que tu en pensais.
Octave caresse mes cheveux, embrasse mon oreille.
– Tu le sais déjà.
Peut-être, mais j’ai besoin de l’entendre.
– Toi et moi savons qu’un jour, tu devras partir à sa recherche. Et ça me fait peur.
Octave est téméraire, il ne craint jamais rien. Qu’il m’avoue sa peur me terrifie.
– Pourquoi ?
– J’ai peur que tu souffres. J’ai peur de te perdre si tu ne reviens pas. Et même si je sais que tu seras obligée d’essayer un jour, je ne veux ni l’un, ni l’autre.
Je n’avais jamais sérieusement pensé à prendre l’initiative de contacter mon père. Ma mère le ressentirait comme une trahison, une donnée qui perd singulièrement de son importance maintenant qu’elle exprime son impatience à se débarrasser de moi. Je ne sais pas trop comment réagirait mon beau-père, mais après tout, ce « je ne sais pas » est une constante quand il s’agit de lui, ce qui rend son cadeau d’autant plus sidérant. À la limite du cadeau empoisonné.
En fait, je n’y ai jamais pensé sérieusement, car je croyais dur comme fer que si je le méritais, il reviendrait spontanément. Comme si j’étais équipée d’une jauge et mon père d’un détecteur, et qu’un signal silencieux se déclencherait quand je serai suffisamment remplie pour l’intéresser. Du jour au lendemain, il serait sur le pas de ma porte, prêt à me féliciter et à me faire entrer dans sa vie.
Cette pensée magique m’a protégée de son absence aussi loin que je m’en souvienne. J’ai accordé à mon père un pouvoir surnaturel, une toute-puissance qui apportera forcément une belle fin à notre histoire. Ils vécurent heureux.
Maintenant seulement, je réalise qu’aucun lien magique ne nous unit. S’il n’est pas revenu, peut-être que quelque chose l’en a empêché – la culpabilité ? le remords ? Mon imagination pourrait broder sur cette théorie pendant des mois. Si je veux savoir, je dois aller chercher mes réponses. Peut-être attend-il que je sois prête à faire le premier pas vers lui, tout simplement. Peut-être attend-il depuis bientôt dix-huit ans. Ce premier pas est la seule façon que j’ai de lui dire que je veux le connaître. Peut-être se sent-il inutile, voire indésirable.
– Je dois y aller.