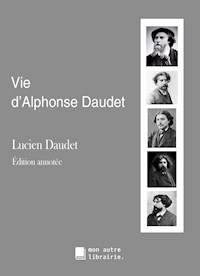
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mon Autre Librairie
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Il règne une grosse ambiguïté autour de la figure d'Alphonse Daudet : le nom seul fait chanter les cigales, embaumer la lavande, miroiter la mer au fond des calanques... mais l'homme, lui, était nettement plus sombre. Méridional, il vécut à Paris. Romancier, il consacra surtout son talent à dénoncer les aspects les plus corrompus d'une société où il était mal à l'aise. Humaniste, celui qui écrivit "Rien de grand sans solidarité humaine" cultivait des opinions et des amitiés surprenantes... Un Homo duplex, comme il se qualifiait lui-même, que les fils nous raconte ici avec tendresse et délicatesse. (Édition annotée.)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vie d’Alphonse Daudet
Lucien Daudet
Édition annotée
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Gallimard, Paris, 1941.
Les notes entre crochets ont été ajoutées pour la présente édition.
Illustration : la maison de Champrosay
au temps d’Alphonse Daudet
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2022, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-38371-054-7
Table des matières
Première partie
L’ENFANCE ET LA MISÈRE
Deuxième partie
LA JEUNESSE, L’AMOUR,LA PATRIE
Troisième partie
LA DEUXIÈME JEUNESSE,TRAVAIL ET SUCCÈS DANS LE BONHEUR
Quatrième partie
L’ÂGE MÛR, TRAVAIL ET GLOIRE DANS LA DOULEUR
Épilogue
Reliques
À la mémoire vénérée de Madame Alphonse Daudet
L. D.
« Ma mère – était ma mère. »
Victor Hugo
Il ne s’agit pas ici d’une vie romancée d’Alphonse Daudet. J’ai simplement essayé de reconstituer les cinquante-sept années de son existence, millésime par millésime, à la faveur de ce qu’il a écrit sur lui-même et de ce que m’ont appris certaines traditions familiales et certaines lettres inédites. La mémoire infaillible de sa veuve et tout ce qu’elle m’avait raconté maintes fois des époques antérieures à ma naissance m’ont guidé aussi, de même que mes souvenirs personnels depuis ma petite enfance.
Je n’ai pas supposé ce que j’ignorais, mais si, faute de renseignements très complets sur la prime jeunesse d’Alphonse Daudet je n’ai pas pu dire toute la vérité, du moins, à travers ces pages, on ne trouvera que la vérité la plus scrupuleuse.
Toutes les fois que j’ai fait parler mon père, j’ai essayé d’être fidèle comme un disque de gramophone.
Enfin, sa vie et son œuvre étant, à mon avis, étroitement liées et intimement dépendantes l’une de l’autre (et bien souvent même s’expliquant l’une par l’autre), ce livre est aussi, je crois, la bibliographie très complète d’une œuvre nombreuse et touffue, et – comme il arrive pour tous les grands écrivains – aussi célèbre qu’incomplètement connue.
Puissé-je avoir renforcé en la motivant cette tendresse particulière que beaucoup de lecteurs d’Alphonse Daudet éprouvent pour lui autant que pour ses livres.
Lucien DAUDET.
1941
Première partie
L’ENFANCE ET LA MISÈRE
I.
Voici sans doute le premier souvenir d’Alphonse Daudet. Souvenir si caractéristique et faisant déjà si bien entrevoir quelques dominantes essentielles de sa personnalité qu’il me semble être le prologue de sa vie et de son œuvre.
Il devait avoir entre deux et trois ans. Ses parents l’avaient mis en nourrice aux environs de Nîmes, suivant la coutume du temps.
On imagine cet enfant à l’épaisse chevelure bouclée, sombre mais dorée au soleil, aux yeux bruns dont les cils se confondent avec le regard brûlant, un peu voilé. Sa nourrice lui a dit de rester assis sagement sur la marche du seuil. La rue du village est poussiéreuse et déserte. L’enfant ne peut pas voir le fond de la rue car tout ce qu’il regarde est trouble et vague. Il ne sait pas qu’il y voit mal, il croit que tout le monde a cette même brume devant les yeux. Il s’est fait une vision à lui : s’il contemple de tout près ses doigts ou la pierre de la marche, il y découvre des détails qui l’amusent beaucoup et le font rêver.
En ce moment, il éprouve autant de peur que de curiosité : des chiens enragés rôdent dans le pays, ils peuvent surgir à tout moment. Ces chiens l’attirent et l’épouvantent. Si seulement il pouvait les apercevoir... Soudain un hurlement là-bas : « Les chiens fous ! Les chiens fous ! » Deux ombres, un galop furieux qui soulève la poussière, des cris, des plaintes, le silence... Pendant quelques jours on parle encore des chiens, qu’on a tués. Puis il n’est plus question d’eux. Mais voilà qu’un matin on entend des gémissements et des cris inhumains : une femme, un vieux, des enfants qui avaient été mordus, meurent suppliciés sans qu’on puisse même les soulager.
Le petit Alphonse est hanté par leurs tortures, il en souffre d’autant plus qu’on ne lui explique pas comment ni par qui ils sont torturés, et son imagination le torture aussi et il pense à l’Enfer dont parle sa nourrice. Il essaye de se représenter les souffrances de ces malheureux, il voudrait les soulager, il se sent mourir de pitié pour eux. Jamais il ne les oubliera, et, pour toujours, il gardera l’horreur sacrée des chiens.
***
Il était né à Nîmes le 13 mai 1840 à neuf heures du matin. Dans le Petit Chose (1867) dont toute la première partie suit de près la vérité, il dit : « Je suis né à Nîmes le 13 mai 18... » sans prévoir que cette date, plus tard, sera une date pour les Lettres françaises.
Son père, Vincent Daudet, était un fabricant et marchand de foulards, un modeste soyeux d’assez humble origine qui avait épousé une demoiselle Adeline Reynaud, fille d’un soyeux, elle aussi, native également du Vivarais, c’est-à-dire de l’Ardèche, mais d’un milieu supérieur, plus civilisé.
L’Ardèche est donc le berceau de ces deux familles. On signale un Daudet graveur (une gravure de lui, que je connais, un paysage, est habile, sans plus). Un autre Daudet qui aurait été l’un des historiographes de Louis XV. Un autre encore, viguier du Vigan : celui-là avait épousé une Esterhazy et c’est l’Impératrice Eugénie qui, ayant découvert son existence dans un livre sur les Esterhazy, me l’avait signalé en 1907. Un Daudet aussi, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, comme on dirait aujourd’hui, et qui dressa une liste complète des routes et canaux de France existant au XVIIIe siècle. Enfin une légende prétend qu’une fille de Maurice de Saxe et d’Adrienne Lecouvreur aurait épousé un certain chevalier Daudet. L’intérêt de cette légende serait d’apparenter Alphonse Daudet à George Sand, mais on n’en trouve aucune trace sérieuse. Il y a un si grand nombre de Daudet, dont le nom s’écrit tantôt Daudet, tantôt Daudé, et sans liens de parenté entre eux, que ces recherches sont assez vaines.
Autant il est intéressant pour un La Rochefoucauld de remonter jusqu’à la maison de Lusignan ou pour un Rohan jusqu’au premier vicomte de Porhoët, puisque, aussi longtemps qu’il y aura des La Rochefoucauld et des Rohan ces illustres origines seront de plus en plus étonnantes, et quasi féeriques ces points de départ, (certaine Maison française ne prétend-elle pas remonter à Mérovée, telle autre ne revendique-t-elle pas une parenté avec la Sainte-Vierge, telle autre encore avec Hercule ?) autant, pour une famille obscure, brusquement illuminée en cours de route par un météore et destinée à retomber dans l’oubli, seul le météore compte puisqu’il est à la fois le point de départ et l’aboutissement. C’est pourquoi ces questions généalogiques me semblent négligeables en ce qui concerne Alphonse Daudet ; un grand homme vaut moins par le sang de ses aïeux que par la synthèse imprévue de son propre sang : ses ascendants, ses proches, ne font figures que de « donataires », en d’autres termes, de donneurs de sang, dans le fond du tableau.
De souche paysanne, évidemment. La région aussi a dû jouer son rôle : le Vivarais est l’un des pays les plus paysans de France, et, d’autre part, ses origines ethniques remontent loin, jusqu’à la Grèce, dit-on.
***
Quand Alphonse Daudet vint au monde, les affaires de son père commençaient à péricliter. Vincent Daudet, dont certains aspects, certaines paroles de M. Eyssette, dans Le Petit Chose sont certainement vrais, était un très brave homme, bon père, bon époux, mais « une nature enflammée, violente, exagérée, aimant les cris, la casse et le tonnerre », sujet à « des colères formidables qui s’attaquaient à tout et surtout à la révolution » car il était ardent royaliste, comme beaucoup de méridionaux : il avait fait une fois le voyage de Frohsdorf pour apporter à M. le comte de Chambord l’hommage de son loyalisme, et vivait sur ce souvenir. D’autre part, son imagination devait être grande : à une époque où la soie et tout ce qui se rapportait à elle, jusqu’à la feuille de mûrier, aliment du ver à soie, représentait une sorte de religion locale, Vincent Daudet s’était dit que la soie artificielle pourrait être une belle invention et quelqu’un de sa famille conserva longtemps un petit carré d’étoffe « écossaise », seul vestige de cette fantaisie chimérique, appelée un siècle plus tard à de si hautes destinées, mais dont la mise en œuvre avait contribué à ruiner l’inventeur. Les autres causes de la ruine, sans compter les prodromes et l’éclatement de la Révolution de 1848, furent la disparition d’un gros client de Marseille, emportant une somme considérable pour l’époque, un procès avec des marchands de matières colorantes, plusieurs grèves et, pour finir, deux incendies successifs.
Le visage de Vincent Daudet – traits réguliers et massifs, joues carrées, yeux autoritaires et vifs, nez trop fort et trop court – ce visage de vieux Romain que je regarde sur la seule photographie qui existe de lui, paraît plus que son âge d’alors (soixante-deux ou trois ans) mais, dans la jeunesse, devait être assez beau.
Sur une photographie de la même époque, Adeline Reynaud est le contraire de lui. Une expression grave, presque triste, d’une grande dignité, allonge encore ses longs traits émaciés. Les yeux creux et résignés sont d’une sainte. Le front, découvert, est beau, noble. Elle avait eu un nombre d’enfants surprenant : dix-sept, prétend-on, dont treize étaient morts quand naquit le petit Alphonse. Elle avait tout offert à Dieu, ses couches, son mari très bon mais trop emporté, comme elle lui offrit plus tard sa ruine. Silencieuse, résignée, sa vie se passait entre l’église, où elle restait agenouillée pendant de longues heures, et la lecture. C’était sa seule dépense : le cabinet de lecture. Dieu lui avait tout retiré, la plupart de ses enfants, sa fortune, même son logis, mais lui avait laissé cette double passion : la prière et la lecture. Aussi, quand il eut été ramené de chez sa nourrice, c’est elle qui voulut apprendre à lire à son petit Alphonse.
– Ma mère, lui disait sa jeune bru, vingt-cinq ans plus tard, Alphonse est l’enfant de votre Foi, c’est pourquoi il ressemble à Notre-Seigneur, et l’enfant de vos lectures, c’est pour cela qu’il est lui.
Le petit garçon était trop jeune pour comprendre que la vie de ses parents se rétrécissait d’année en année. Le frère aîné, Henri, était loin. Il terminait ses études dans un séminaire et, malgré sa santé précaire, allait bientôt être ordonné prêtre. Le second fils, Ernest, né en 1837, était un enfant d’une sensibilité maladive, profondément habité par l’esprit familial, d’une bonté, d’une serviabilité bien au-dessus de son âge, mais sa compréhension, quoique développée de très bonne heure, ne pouvait naturellement être d’aucune aide à personne. À neuf ou dix ans, on ne peut que pleurer (il ne s’en privait pas !) et assister, impuissant, aux désastres dont on devine l’approche.
Malheureux Vincent Daudet ! On le voit, sentant monter à la fois la ruine et la Révolution. Que de colères et, sans, doute, combien de maladresses ! Non, la vie, déjà, ne devait pas être gaie à Nîmes, dans ces années-là, et plus tard les deux frères étaient d’accord pour dire que peu de jeunesses avaient été aussi tristes que la leur.
Il est fâcheux qu’Alphonse Daudet ne se soit pas raconté davantage lui-même à travers son enfance. En somme, nous ne savons presque rien de ses toutes premières années. Quelquefois, une note de deux lignes qui résume cependant bien des choses : « Tout petit, je jouais à la marelle sous la porte d’Auguste, aux osselets dans les arènes ou sur les marches du temple de Diane. » D’où, sans doute, son goût pour les grands auteurs latins. Ou encore une constatation générale sur sa famille, sur lui-même : « Il y a dans toutes les familles, surtout celles dont les types sont les plus similaires, toujours une brutale exception qui semble une revanche, une protestation violente de la Nature et de ses lois de pondération, d’équilibre. Moi, dans mon milieu si désespérément bourgeois, j’ai été un peu ça. »
Et comme corollaire, cette réflexion mélancolique : « J’ai passé ma vie à étouffer mon père au-dedans de moi, je le sentais se réveiller à chaque instant avec ses colères, ses manies... » Il arrive aussi que lui reviennent, au hasard, « mille détails, chansons de table, absence de toute barbe », et c’est page à page, à travers son œuvre, qu’on peut entrevoir un de ces « détails ». Ou ceci : « Délicieux goûter que tout petits on nous envoyait faire au jardin avec un morceau de pain, et permission de picorer à même la treille ou l’espalier... Quelle buée autour de tout ça... » Pour toute sa vie, ce goût du pain avec les fruits, n’importe quels fruits... Je crois que tout jeune il fut, comme il le dit « entre ciel et terre », dans le rêve autant que dans la réalité.
De très bonne heure, sa myopie exceptionnelle (par la suite les verres de ses lunettes de travail et de son monocle étaient aussi concaves que des cupules) dut l’obliger à une constante transposition qui eut sans doute une grande influence sur son esprit, et développa exceptionnellement son odorat et son ouïe : il sentait et écoutait un paysage autant qu’il le regardait, ou plutôt son œil, ses narines et ses oreilles s’étaient habitués, dès sa connaissance des choses, à s’unir pour s’entraider. Je vois là une des sources de son extraordinaire sensibilité, mot trop banal mais qui, pour une fois, peut s’appliquer exactement à lui, comme le prouve cette note, importante pour sa formation :
« Quelle merveilleuse machine à sentir j’ai été, surtout dans mon enfance ! À tant d’années de distance, certaines rues de Nîmes, noires, fraîches, étroites, sentant les épices, la droguerie, me reviennent dans une lointaine concordance d’heure, de couleurs de ciel, de sons de cloches... Des impressions, des sensations à remplir des tas de livres, et toutes d’une intensité de rêve. »
Et ailleurs :
« Ô choses de mon enfance, quelle impression vous m’avez laissée ! J’ai un souvenir de mes trois ans, un feu d’artifice à Nîmes et que je vis porté à bras... Les moindres détails m’en sont restés, le murmure des arbres au vent de nuit – sans doute ma première nuit dehors – l’extase bruyante de la foule, les « ah » montant, éclatant, s’étalant avec les fusées dont le reflet éclairait d’une pâleur fantomale les visages autour de moi... »
Ce souvenir, peut-être antérieur à celui des chiens enragés, confirme encore cette réceptivité car, écrit par l’homme mûr, il garde sa valeur native, on le devine venu directement des sources de la mémoire, et ce « ah » de la foule, inséparable du feu d’artifice, n’est-il pas déjà l’un de ces accessoires de paysages où il excella plus tard et où l’humanité se trouve toujours mêlée, ne fût-ce que par un cri ? (Cf au commencement du deuxième acte de l’Arlésienne, la solitude de la Camargue aggravée encore par l’appel de la Mère : « Frédéri !... Frédéri !... »)
Tout cela est essentiel pour l’œuvre et pour l’homme, de même que sa passion précoce pour la cabane, l’abri. Quand les affaires marchent au plus mal, son imagination transforme le jardin de la fabrique, y voit un coin solitaire, un refuge où il se compare à Robinson dans son île, un renfermement qui est une sauvegarde, une protection. Il a besoin de se sentir seul, défendu contre il ne sait quoi au juste. Cela (il y reviendra souvent par la suite, et transformé de mille manières) est très curieux chez un être d’autre part turbulent, sociable, exubérant et aimant la vie au maximum, l’aimant au point qu’il se reprochait plus tard de l’avoir trop aimée.
Sans doute le goût de la cabane n’était-il pas seulement chez lui un désir d’isolement humain, mais une manifestation originelle de son amour foncier pour la lecture – amour très précoce, comme on le verra – et de sa passion pour le travail qui ne se développa que vers la trentième année et, jusqu’à la fin, devint de plus en plus tyrannique. Une autre cabane encore est le repliement de la pensée, pour lui permettre l’élaboration du miel dans la nuit de la ruche.
Et puis ce fut la fin de ces premières années-là.
La fabrique et la maison étaient vendues. Il fallait quitter Nîmes, s’arracher au passé. La famille Daudet était obligée de s’exiler là-bas, dans le Nord, dans les brumes de Lyon.
Le Petit Chose nous laisse deviner la détresse de ce départ. L’enfant de huit ans, avant de quitter sa cabane, son île, ses grottes, parle aux objets « comme à des personnes », dit aux platanes : « Adieu mes chers amis » et aux bassins de teinturerie qui étaient son Océan : « Adieu, nous ne nous verrons plus. » En sanglotant, il demande au grenadier de lui donner une de ses fleurs : c’était le 30 septembre 1848, jour du départ pour Lyon. Il envoie encore des baisers à ce qu’il quitte pour toujours, il porte en lui ce matin-là tout ce qu’un être, jeune ou vieux, peut contenir de regrets et de désespoir...
II.
Ils embarquèrent tous sur le bateau qui remontait le Rhône jusqu’à Lyon : Vincent Daudet, madame Daudet portant dans ses bras sa dernière enfant née trois mois plus tôt, une petite Anna au maillot, les deux garçons et la vieille Annou, leur servante depuis des années. De plus, des bagages, des caisses contenant quelques meubles, une cage... On se représente cette famille éperdue, les ordres, les contre-ordres, les garçons grondés, pleurant, riant, malgré tout prodigieusement excités par ce voyage qui était pour eux le tour du monde.
Bien entendu, Alphonse avait trouvé le moyen, pendant les trois jours qu’ils passèrent sur le bateau, de s’organiser un semblant de cabane à la pointe extrême, près de l’ancre, « sous une grosse cloche qu’on sonnait en entrant dans les villes ». Puis ce fut l’arrivée à Lyon, le dépaysement, le ciel bas, le trajet dans les rues inconnues, et l’entrée enfin dans « l’horrible maison ». L’escalier était gluant, la cour ressemblait à un puits, et dès le premier soir leur petit logement de quatre pièces était noir et grouillant de blattes, appelées aussi « cafards » mais qu’on ne connaissait à Nîmes que sous le nom terrifiant de babarottes. Avant même d’ouvrir les caisses et de monter les lits, il fallut chasser les babarottes.
Pauvre, pauvre madame Daudet ! À ce moment elle dut prier Dieu pour qu’il lui permît d’oublier sa jeunesse heureuse, les beaux jours passés dans leur propriété de l’Ardèche, la vaste demeure bien montée, confortable, le verger ensoleillé : dire que la petite Adeline d’autrefois était devenue cela...
Drame insignifiant en soi, mais qui dut mettre le comble au désarroi général : la fidèle Annou, sur qui madame Daudet se reposait pour toutes choses car elle-même n’était pas une très experte maîtresse de maison, fut bientôt prise du « mal du pays », abandonna la famille et retourna à Nîmes.
Une phrase du Petit Chose résume l’arrivée et le séjour à Lyon : « J’avais honte d’être dans la rue parce que nous étions pauvres... »
À chaque page du livre on retrouve des traces de cette gêne et de cette déchéance.
Le collège était trop cher, on ne pouvait songer à y faire entrer Alphonse. On dut se contenter de la manécanterie de Saint-Nizier où, à défaut de classes régulières, le petit garçon apprenait ce qu’il fallait de latin pour servir la messe, répondre aux offices, faire enfin son métier d’enfant de chœur, tantôt dans sa robe rouge, tantôt dans sa robe noire, suivant les cérémonies auxquelles il participait. Il était si petit, qu’un matin, portant le Livre de la droite à la gauche de l’autel, il fut entraîné par le poids et tomba avec le Livre, au grand scandale du prêtre et des assistants.
Les parents s’inquiétèrent à la longue de ces études trop fantaisistes et s’adressèrent à l’un de leurs amis, recteur d’Université, qui put obtenir pour Alphonse une bourse au collège de Lyon.
Là, il subit tout de suite une de ces humiliations qui, pour les enfants, ont une grande importance : il était le seul élève à porter une blouse. Cette remarque m’a toujours surpris car il ne se souciait guère des questions vestimentaires, et ce n’est sans doute pas de la blouse qu’il avait honte, mais de tous les mépris, de toutes les taquineries auxquels elle l’exposait : ces fils de bourgeois portaient une veste, et la blouse était le costume des enfants d’ouvriers. Et puis ses livres de classe avaient été achetés « d’occasion » sur les quais, ils étaient sales, des pages manquaient ; il ne possédait aucun de ces jolis cahiers, porte-plumes ou crayons dont les collégiens sont fiers. Il n’avait rien. C’est de là que date peut-être son indifférence pour les objets, pour tous les objets quels qu’ils fussent : il adoptait une fois pour toutes un objet qui lui semblait commode, encrier, pipe ou boutons de manchettes. Le reste, étranger pour lui à sa destination d’utilité ou d’élégance, n’existait qu’en tant que souvenir : c’est ainsi qu’il rangeait autour de lui, sur sa table, à portée de sa main et de son regard, tout ce que lui donnait sa femme, fétiches précieux et chers mais dont il ne se servait pas. Peut-être aurait-il aimé tous ces accessoires de la vie, si son enfance n’en avait pas été complètement privée.
Au collège, sa myopie le gênait d’autant plus que le professeur n’y croyait pas, et celui-ci, agacé par cette blouse d’allure révolutionnaire, préféra ignorer une fois pour toutes le nom de cet aveugle mal vêtu et l’interpellait dédaigneusement : « Dites donc, vous, là-bas, petit Chose... » Professeur inconnu dont le mépris a eu un si long écho !...
Ces misères n’empêchaient pas le collégien de faire des progrès rapides : entre sa dixième et sa quatorzième année, prix de latin et de grec, accessits d’excellence et de grammaire, et, naturellement, comme il arrive toujours, unique accessit de composition française. Comment faisait-il pour travailler si bien, manquant trop souvent le collège sous les prétextes les plus invraisemblables, inventant n’importe quoi pour se livrer à la passion qui lui était venue depuis l’arrivée à Lyon et le voisinage du Rhône, la passion du canot, et à son autre passion, héritée de madame Daudet, la lecture ?
Son existence commence vraiment à Lyon, dont il avait gardé un souvenir ineffaçable, désolant et attirant comme est le souvenir des lieux où l’on a souffert, et où il fit naître, plus tard, quelques-uns de ses personnages les plus typiques. C’est à Lyon que se formèrent son corps et son esprit, formation trop précoce à quoi il dut sa qualité essentielle : une incomparable expérience humaine. Et quand on comprend qu’il dut cette expérience aux malheurs de ses parents et que, sans la ruine, au lieu d’être un petit garçon forcément abandonné à lui-même, et privé de toute surveillance, il aurait été un petit garçon comme les autres, isolé du monde extérieur et conduit au collège par une gouvernante, on est tenté de bénir l’ensemble des circonstances qui avaient fait de ces bourgeois aisés presque des pauvres et, à certaines heures, de ce petit garçon bien élevé, ce qu’on appelle couramment un enfant de la rue.
Voici comment il parle de ses parties de canot :
« Il y a un coin de quai auquel je ne pense jamais sans émotion. Je revois l’écriteau cloué au bout d’une vergue : Cornet, bateaux de louage, le petit escalier qui s’enfonçait dans l’eau, tout glissant et noirci de mouillure, la flottille de petits canots s’alignant au bas de l’escalier, se balançant doucement bord à bord...
« Le père Cornet a été le Satan de mon enfance, ma passion douloureuse, mon péché, mon remords. M’en a-t-il fait commettre des crimes avec ses canots ! Je manquais l’école, je vendais mes livres, qu’est-ce que je n’aurais pas vendu pour un après-midi de canotage !
« Tous mes cahiers de classe au fond du bateau, la veste à bas, le chapeau en arrière, et dans les cheveux le bon coup d’éventail de la brise d’eau, je tirais ferme sur mes rames, en fronçant les sourcils pour bien me donner la tournure d’un vieux loup de mer ... Quel triomphe de me mêler à ce grand mouvement de barques, de radeaux, de trains de bois, de mouches à vapeur qui se côtoyaient, s’évitaient, séparés seulement par une mince ligne d’écume ! ... Tout à coup, les roues d’un vapeur battaient l’eau près de moi ... Et je suais, je me débattais, empêtré dans le va-et-vient de cette vie du fleuve que la vie de la rue traversait incessamment, par tous ces ponts, toutes ces passerelles, qui mettaient des reflets d’omnibus sous la coupe des avirons ... Enfin, à force de fatigues, tout moite et rouge de chaleur, je parvenais à sortir de la ville. Les ponts s’espaçaient sur la rive élargie. Quelques jardins de faubourg, une cheminée d’usine s’y reflétaient de loin en loin. À l’horizon, tremblaient des îles vertes. Alors, n’en pouvant plus, je venais me ranger contre la rive, au milieu des roseaux tout bourdonnants, et là, abasourdi par le soleil, la fatigue, cette chaleur lourde qui montait de l’eau étoilée de larges fleurs jaunes, le vieux loup de mer se mettait à saigner du nez pendant des heures. Mes voyages n’avaient jamais un autre dénouement. Je trouvais cela délicieux. »
Les promenades en canot coûtaient deux sous, les deux sous qui constituaient sa semaine de collégien. Mais à présent il y avait aussi les livres, le bouquiniste de la rue de Retz. Il n’était pas facile de tout concilier. Un jeudi, au moment où il venait de recevoir ses deux sous, traversant la chambre de sa mère, il voit devant la pendule, sur la cheminée, une pièce de deux francs – la dépense de toute la famille pour la journée. Après un moment d’hésitation pendant lequel il connut l’angoisse du voleur, la panique, le remords, puis l’attrait irrésistible, il s’empare des deux francs – vingt fois deux sous, une fortune – et se sauve dans la direction du père Cornet... En passant devant une église, il voit une vieille mendiante qui lui crève le cœur. Pour une fois, enfin, il va pouvoir faire l’aumône, car il souffre déjà de la misère des autres, il donne à la mendiante les deux sous qu’il tient toujours dans sa main avec la pièce volée, et se met à courir vers le Rhône, mais à la réflexion les remerciements et l’émoi de la femme l’inquiètent. Il regarde dans sa main : il s’est trompé ! Il a donné les quarante sous ! Toujours courant, il revient sur ses pas pour faire l’échange des pièces, mais la mendiante, qui d’un coup venait de faire sa journée, était partie ! Alors il rentre à la maison, se jette aux genoux de sa mère en sanglotant et lui avoue tout.1
Quelquefois il lui prenait aussi un désir d’aventures, d’il ne savait trop quoi. Les êtres vagues qu’on appelle « les gens » commençaient à l’intéresser.
« Tourmenté du désir de sortir de moi-même, de m’incarner en d’autres êtres dans une manie commençante d’observation, d’annotation humaine, ma grande distraction pendant mes promenades était de choisir un passant, de le suivre à travers Lyon, au cours de ses flâneries ou de ses affaires, pour essayer de m’identifier à sa vie, d’en comprendre les préoccupations intimes.
« Un jour, pourtant, que j’avais escorté de la sorte une fort belle dame de toilette éblouissante, jusqu’à une maison basse aux persiennes closes, au rez-de-chaussée occupé par un café où chantaient des voix rauques et des harpes, mes parents, à qui je faisais part de ma surprise, m’interdirent de continuer mes études errantes et mes observations sur le vif... »
Ce souvenir est intéressant en tant que premier éveil du romancier.
Tout prétexte lui était bon pour rentrer en retard. Au besoin, pour justifier son désheurement, il inventait une nouvelle surprenante, comme ce soir où avant même que ses parents eussent eu le temps de le gronder, il s’écria : « Le Pape est mort ! » ce qui, naturellement, fit oublier le reste. Bon gré, mal gré, il finissait toujours par retrouver la petite chambre glacée où couchaient les deux frères. Quelquefois madame Daudet, silencieuse, priant peut-être à voix basse, venait s’asseoir près d’Alphonse et tricotait sans lever les yeux.
Canot, lecture, curiosité humaine, c’était déjà chez lui l’amour de la vie. En même temps se révélait ce goût de l’imprudence physique, un attrait pour le danger qui allait de pair, plus tard, avec une extrême prudence et une inquiétude constante pour ceux qu’il aimait.
Il avait douze ou treize ans. Un grand incendie éclata la nuit dans l’immeuble voisin du leur, rue Vaubecourt. (Hasards et rencontres : la dernière maison qu’il habita et où il mourut, 41, rue de l’Université, à Paris, était l’hôtel de la duchesse douairière de Clermont-Tonnerre, née Nettancourt-Vaubecourt). Donc, réveillé par les cris de terreur, surexcité par la lueur sinistre qui éclairait leur chambre, il se lève et sans consulter personne se précipite dans l’escalier en flammes pour aider les pompiers qui l’entraînent avec eux sans remarquer son jeune âge. Il les imite, les aide, risque la mort autant qu’eux, mais enfin : « ... Un pompier m’arrache mon tuyau des mains, puis, au moment de nous lancer dans la fumée de l’escalier, agrippe un des seaux pleins d’eau qui sont à terre, m’en verse la moitié sur la tête, me pousse, me soutient, des marches croulent, la rampe est en feu, je ne vois rien, je n’entends plus, et je me retrouve chez moi, grondé, taloché, embrassé, ruisselant, sorti de l’incendie comme d’une baignade...2 »
Bientôt, ce fut la mort du frère aîné, Henri, le séminariste. On le savait malade mais on ne le croyait pas en danger. Madame Daudet, appelée précipitamment, prit la diligence avec Ernest, laissant à Lyon son mari et Alphonse, et bientôt une dépêche arriva, remise sur le pas de la porte par le facteur : l’enfant, qui avait déjà le sens du malheur, comprit tout de suite ce qu’annonçait la dépêche ; il l’ouvrit en cachette de son père et lut : « Il est mort, priez pour lui. » Depuis ce soir où il avait dû annoncer lui-même à son père la mort de l’aîné, tout télégramme imprévu lui causait une certaine appréhension.
Des dix-sept enfants, il ne restait plus qu’Ernest, Alphonse et la petite Anna.3 Cela n’empêchait pas Adeline Daudet de répéter volontiers : « Mes enfants, Dieu bénit les familles nombreuses ! » entendant sans doute par là, catholique comme elle l’était, que les pires épreuves sont souvent une bénédiction.
Vers ce temps-là, entre ses quatorzième et quinzième années, Alphonse Daudet, à force de lire, à force de s’exalter au milieu de ses parties de canot et de regarder à sa manière autour de lui, en voyant toutes choses dans une brume où certains détails se précisaient et s’éclairaient d’une façon singulière, commença à écrire. C’était à l’occasion de la naissance d’un cousin, fils d’une des tantes de Nîmes, sœurs de sa mère, madame Montégut. Apprenant que ce petit Louis était venu au monde, il écrivit :
Enfants d’un jour, o nouveaux nés,
Petite bouche, petit nez,
Petite lèvre demi-close,
Membres tremblants,
Si frais, si blancs
Si roses...
Le poème finissait ainsi :
Enfants d’un jour, o nouveaux nés,
Pour le bonheur que vous donnez
À vous voir dormir dans vos langes,
Espoir des nids,
Soyez bénis,
Chers anges !
Le sens du rythme est déjà d’un poète, encore enfantin mais qui sait cependant ce qu’est la poésie. Bientôt il faisait des progrès, comme le prouve la pièce connue, si souvent mise en musique depuis quatre-vingts ans, par des compositeurs illustres ou obscurs :
Dans ses langes blancs, fraîchement cousus
La Vierge berçait son Enfant Jésus...
etc., etc.
Ces petits poèmes, Alphonse Daudet ne les renia jamais ; ils firent partie plus tard, et toujours depuis cette époque, du volume intitulé les Amoureuses. Enhardi par la surprise et l’admiration de sa mère et surtout de son frère Ernest (Vincent Daudet était plus réfractaire à la littérature), il écrivit un roman, Léo et Chrétienne Fleury, et osa le porter lui-même au rédacteur en chef d’un des principaux journaux de Lyon, lequel, voyant entrer ce petit collégien avec un manuscrit, le reçut assez mal et garda le manuscrit que, naturellement, il ne publia pas, et qu’on ne retrouva jamais. Ernest Daudet affirmait que ce roman était déjà un bon roman d’Alphonse Daudet, mais il faut se méfier des opinions et jugements familiaux, et pour ma part, j’en doute fort. Je crois que l’auteur en doutait aussi.
Cependant, depuis cinq ans il n’était plus question de révolutions ni de troubles : le Coup d’État de 1851,4 puis l’établissement de l’Empire en 1852 avaient, suivant la formule excellente et célèbre, rassuré les bons et fait trembler les méchants. Napoléon III régnait sur la France, à la grande satisfaction de tous sauf, justement, des méchants, épouvantés, mais tapis encore dans leurs repaires. – « Ces méchants, qui sont-ils ? » demandait déjà Athalie. Il avait épousé Eugénie de Montijo, comtesse de Teba, jeune Espagnole de la plus haute naissance dont la beauté était unique, dont la bonté commençait à être proverbiale. Le petit Prince Impérial venait de naître, le 16 mars 1856, la France était heureuse et une période de prospérité inouïe commençait pour elle. La ville de Lyon donnait le signal de cette prospérité, le maréchal de Castellane5 gouvernait la région en dosant très habilement la mansuétude et la sévérité. On le craignait autant qu’on le respectait. Ce grand soldat qui était aussi un grand seigneur, qui tout jeune homme avait fait héroïquement la campagne de Russie, connaissait les hommes et savait les conduire. On se le montrait quelquefois dans les rues de Lyon, accompagné de ses officiers d’ordonnance. Le jeune Alphonse était attiré vers lui autant qu’il en avait peur. (Aussi, trente-cinq ans plus tard, lisait-il ses Mémoires avec passion.)
En cette même année 1856, il avait seize ans, il terminait avec succès sa classe de rhétorique. Hélas, la France était prospère mais la famille Daudet ne l’était pas. Depuis huit ans, Vincent Daudet avait essayé en vain plusieurs commerces, plusieurs métiers, rien n’avait réussi. Ce n’était plus la ruine, c’était l’aboutissement de la ruine, avec tout ce qu’il entraîne d’horrible et d’irrémédiable. Ils ne pouvaient plus vivre. Il fallait que le foyer se dispersât pour que chacun pût manger. Les quelques meubles qui avaient survécu à la fabrique furent vendus à même le trottoir. Ce fut le malheureux Ernest, âgé de dix-neuf ans, qui s’occupa de cela. Son sens pratique et sa bonté s’employaient du mieux qu’il pouvait, mais cet affreux début fut présent à son souvenir tout le long de sa longue vie.
Grâce à Monseigneur Dupanloup, qui le connaissait un peu par relations communes, Vincent Daudet obtint un de ces sinistres emplois de placier en on ne sait quoi, qui font de leur victime mal payée un commis-voyageur circulant en toutes régions, par tous les temps, en toutes saisons, connaissant les nuits glacées ou torrides dans des wagons crasseux et, à cette époque encore, dans des diligences éreintantes. Le pauvre homme, imbu d’excellentes traditions et qui, malgré son caractère difficile, aimait tendrement sa femme et ses enfants, allait se trouver seul au monde sur les routes. Adeline Daudet partit pour Nîmes où la recueilleraient tour à tour ses deux sœurs, Ernestine et Zoé. Ernest avait trouvé un tout petit poste de journaliste à Blois, c’était du moins de quoi ne pas mourir de faim. Quant à Alphonse, qui voulait faire sa philosophie et terminer ses études, il sollicita et obtint, sans prévoir à quoi il s’engageait, un emploi de maître d’études – de pion, comme on dit, – au collège d’Alès.
Il y a quatre ans, assistant à un film tiré du Petit Chose, (joli film d’ailleurs, qui, par exception, avait gardé intacte la poésie du roman), quand apparurent sur l’écran les images de cet écartèlement familial et que je vis pleurer sous ses cheveux blancs l’actrice chargée du rôle de madame Eyssette, (sans qu’elle pût se douter que la vraie madame Eyssette – Adeline Daudet – avait gardé une chevelure noire jusqu’à un âge avancé, comme il arrive à beaucoup de méridionales) et que je vis le père se désoler, et sangloter aussi les deux frères – l’excellent comédien qui était Daniel Eyssette ressemblait beaucoup sinon de traits du moins d’expression et d’aspect à ce que pouvait être alors Alphonse Daudet – un sentiment inconnu, difficile à exprimer, s’empara de moi. Je me disais : ce public sait de quoi il s’agit, il a lu en majorité le Petit Chose, il regarde le film comme on regarde un livre d’images, il n’en demande pas plus. Moi, je sais que sont réunies et s’entrecroisent sur cet écran beaucoup d’ondes : cette séparation, événement vrai, transmis à Alphonse Daudet par sa mémoire et qu’il transposa sur le plan d’une fiction romanesque, puis imprimé, entré dans le domaine du livre et lu, depuis soixante-dix ans, par des centaines et des centaines de milliers de lecteurs, jusqu’au jour où un lecteur, producteur de films, a décidé de faire vivre ces instants-là sur l’écran ! Cet homme et cette femme désespérés, je restais leur petit-fils malgré toutes les transformations qu’on avait fait subir à leur douleur depuis leur douleur de 1856, et cet adolescent éperdu qui m’apitoyait en tant qu’être humain et en tant que spectateur, se trouvait être mon père, dont brusquement le malheur me frappa comme jamais il ne l’avait fait.
Ce malheur légendaire, transmis de génération en génération comme une sorte de propriété indivise et que j’avais admis une fois pour toutes, dès ma première connaissance des choses, sans peut-être l’avoir jamais assez plaint, j’en comprenais brusquement l’horreur. Je cherchais une comparaison exacte qui pût fixer ce que j’éprouvais. Je crois que ce qui ressemble le plus à mon émoi est ce qu’éprouve tout chrétien dans une église quand il fait ce qu’on appelle son Chemin de Croix et qu’il retrouve, même représenté par le plus banal des chromos, le message transmis depuis des siècles, encore actuel, encore vivant, malgré toutes ses transformations et déformations successives.
Cette existence au collège d’Alès dut être indicible. On ignorera toujours la part romanesque et la part de réalité de la première partie du Petit Chose (la deuxième partie, très inférieure, est complètement fictive) mais tout ce que nous en connaissons est atroce et confirmé beaucoup plus tard par Alphonse Daudet,6 en un raccourci plus triste encore que le roman, parce qu’il prouve qu’après trente ans passés depuis cette époque, l’oubli n’était pas venu.
« Oui, c’est bien moi ce Petit Chose, obligé de gagner sa vie à seize ans dans cet horrible métier de pion, et l’exerçant au fond d’une province, d’un pays de hauts-fourneaux qui nous envoyait de grossiers petits montagnards m’insultant dans leur patois cévenol, brutal et dur. Livré à toutes les persécutions de ces monstres, entouré de cagots et de cuistres qui me méprisaient, j’ai subi là les basses humiliations du pauvre.
« Longtemps après ma sortie de ce bagne d’Alès, il m’arrivait souvent de me réveiller au milieu de la nuit, ruisselant de larmes : je rêvais que j’étais encore pion et martyr. Par bonheur, cette dure entrée dans la vie ne m’a pas rendu méchant et je ne maudis pas trop ce temps misérable qui m’a fait supporter légèrement les épreuves de mon noviciat littéraire et les premières années de Paris. Elles ont été rudes, ces années. »
Aucune trace de correspondance ne reste de ce séjour à Alès. Adeline Daudet aurait sans doute conservé les lettres de son pauvre garçon s’il avait écrit régulièrement, mais on imagine les rares courriers, la solitude, le désespoir qui replie sur elles-mêmes les natures les plus confiantes ; sans doute, le plus rarement possible, une lettre insignifiante et sans aucun détail, pour dire que tout allait bien et qu’il était en bonne santé.
Il y a une très belle parole de saint Jean Chrysostome : « Ce sont les naufrages de la mer qui forment les marins. » Sans ce naufrage que fut pour lui le séjour de quatorze mois à Alès, qui sait si les tristes années de Lyon s’estompant, s’adoucissant peu à peu dans le souvenir, Alphonse Daudet aurait possédé ce dosage particulier qui est son bien propre, et la grande caractéristique de son génie : amertume et tendresse, violence et pitié ?
Tout ce qu’avait déchaîné en lui ce temps affreux constitua peut-être le meilleur de lui-même et devint une inépuisable source de richesses.
III.
Ernest qui savait, lui, combien son frère était malheureux à Alès et qui devinait tout ce qu’Alphonse ne lui disait pas, décida de le faire venir à Paris, maintenant que lui-même y avait trouvé un emploi de secrétaire près d’un vieux monsieur qui lui dictait ses Mémoires, et qu’il collaborait à un ou deux journaux. Le pauvre Petit Chose, à bout de forces morales et de résistance physique, n’hésita naturellement pas et quitta son bagne, non sans se venger innocemment des méchancetés de « l’homme aux clés », celui qui, dans le roman, s’appelle Monsieur Viot.
« Quel voyage ! (écrivait-il en 1887, dans Histoire de mes livres.) Rien qu’en y pensant trente ans après, je sens encore mes jambes serrées dans un carcan de glace et je suis pris de crampes d’estomac. Deux jours en wagon de troisième classe sous un mince habillement d’été, et par un froid ! Ma place payée, il me restait en poche quarante sous, mais pourquoi m’en serais-je inquiété ? J’étais si riche d’espérances ! J’en oubliais d’avoir faim. Malgré les séductions de la pâtisserie et des sandwiches qui s’étalaient au buffet des gares, je ne voulais pas lâcher ma pièce blanche soigneusement cachée dans une de mes poches. Pourtant, vers la fin du voyage, tandis que le train, en geignant et nous ballottant d’un côté à l’autre, nous emportait à travers les tristes plaines de la Champagne, je fus bien près de me trouver mal. Mes compagnons de route, des matelots qui passaient leur temps à chanter, me tendirent une gourde. Des braves gens ! Qu’elles étaient belles leurs rudes chansons, et bonne leur eau-de-vie rêche, pour quelqu’un qui n’avait pas mangé pendant deux fois vingt-quatre heures ! Cela me sauvait et me ranimait, la lassitude me disposait au sommeil, je m’assoupis, mais avec des réveils périodiques aux arrêts des trains et des rechutes de somnolence lorsqu’on se remettait en marche.
« Un bruit de roues qui sonne sur des plaques de fonte, une gigantesque voûte de verre inondée de lumière, des portes qui claquent, des chariots à bagages qui roulent, une foule inquiète, affairée, des employés de la douane. Paris !
« Mon frère m’attendait sur le perron. Nous nous mîmes en route vers le quartier Latin, le long des quais déserts, par les rues endormies... »
Plusieurs fois – à commencer par le Petit Chose – Alphonse Daudet revint sur cette arrivée à Paris. Elle lui avait laissé un souvenir définitif. Le long de ces quais déserts, dans la nuit épaisse qui précède l’aube de novembre, les odeurs et les vagues bruits venus du Jardin des Plantes et de la Halle aux Vins, à droite la Seine et ses émanations fluviales, voilà les premières impressions d’une ville qu’il devait connaître si bien, et d’autant mieux qu’il la regarda toujours avec les sens de quelqu’un qui vient d’y débarquer. Paris fut toujours pour lui une ville nouvelle, dont il aimait à explorer le visage et l’âme, différent en cela de beaucoup d’écrivains qui, nés à Paris ou y ayant vécu depuis leur enfance, l’acceptent en bloc, croient inutile de revenir sur ses aspects essentiels puisque tout le monde les connaît, et n’éprouvent pas, comme Alphonse Daudet, le besoin de les recréer.
Il est à remarquer que le plus grand romancier de tous les temps et de tous les pays – Balzac – qui, le premier, donna une place immortelle à Paris dans un grand nombre de ses œuvres n’y était pas né non plus. Si Paris venait un jour à être détruit, c’est grâce à Balzac, tourangeau, et à Alphonse Daudet, nîmois, qu’il faudrait recourir pour en retrouver une topographie complète.
La joie des deux frères dut être grande : peut-être, comme il arrive en ce cas, commencèrent-ils par parler tous deux à la fois, récapitulant leur commun passé, leurs récents passés différents, se donnant des nouvelles du père, de la mère, de la petite Anna, s’interrompant pour un détail immédiat, Alphonse posant des questions : quel était ce quai ? Pourquoi ces grilles ? Pourquoi ces vagues appels de fauves, pourquoi ces tonneaux ? Ernest répondait à tout, quoique tombant de sommeil, et tenait son frère par le bras.
Arrivés dans la mansarde où les attendait un petit souper du genre régal, (détails triviaux mais qui sont les preuves de la tendresse et plus tard serrent le cœur, désolants appels au passé mort qui ne répond plus), ils purent constater les changements.
On se représente assez bien les deux frères d’après leurs photographies de cette année-là. Ernest qui n’a que vingt ans en paraît trente. Les traits tirés, la bouche triste, les yeux caves, il a certainement beaucoup souffert, lui aussi. Plus tard, le visage amène et reposé de cet homme si « comme il faut » et essentiellement « Second Empire » ne reflétait rien de ce temps-là. Quant à Alphonse, qui a dix-sept ans et demi, il en paraît vingt. Ses longs cheveux, très plats, à peine bouclés, encadrent un visage d’une régularité charmante, mais plus d’un mort que d’un vivant. La bouche sourit, mais est-ce un sourire, ou murmure-t-elle « grâce au ciel, mon malheur passe mon espérance ». Il faudrait le Vinci... La tête est un peu penchée, ce qui rétrécit encore l’ovale. Les yeux voilés, comme nimbés de la brume qu’ils voyaient et qui semble émaner d’eux, sont d’une tristesse infinie, des yeux de bête traquée qui vous regardent l’âme, en même temps, il faut bien le dire, que leur sournoiserie, leur lourdeur, évoquent une sensualité effrénée. L’expérience cruelle que révèle cette jeune figure est presque effrayante.
Je crois qu’on n’a jamais assez insisté sur le rôle admirable que joua Ernest Daudet à cette époque. Si pauvre lui-même, il n’hésite pas à pratiquer pour son frère ce qu’on appelle dans leur pays « l’aumône fleurie » – aumône d’un pauvre à un plus pauvre.
Alphonse Daudet eut la chance d’avoir pour mère la sainte Adeline Daudet, puis Ernest qui fut pour lui une autre mère – il l’appelle d’ailleurs dans le Petit Chose, « ma mère Jacques » – et enfin et surtout, comme on le verra, il trouva aussi une mère en sa jeune femme, des trois, la plus maternelle.
C’était une grande responsabilité pour Ernest, ce frère dont il soupçonnait le talent, à l’avenir de qui il faisait confiance, mais, en somme, dont il connaissait surtout la fantaisie, les hauts et les bas de turbulence et de découragement, et dont il ignorait ce que la vie en ferait. Le mélange d’émancipation trop précoce et de timidité normale à cet âge-là, devait être déconcertant. Peut-être ne réfléchissait-il pas à tout cela et se contentait-il d’aimer son frère, se fiant à la chance pour le reste. Il ne faut pas oublier qu’ils étaient deux petits provinciaux, affligés d’un effroyable accent (plus tard, Ernest en conservait quelques traces qu’on ne retrouvait pas chez son frère – peut-être dans le rire, et encore ! – sauf dans deux ou trois mots qu’il prononçait comme jadis à Nîmes, le gaz qui devenait le gass, Anna qui devenait En-na, etc.). Cet accent même était alors la preuve de leur naïveté.
***
Je crois que c’est ici le moment de parler d’Ernest Daudet, rempli pour son frère d’indulgence et de bonté dans ces temps difficiles et qu’il ne cessa jamais d’aimer, même quand leurs destinées eurent cessé d’être parallèles.
Il faut posséder une grande noblesse de cœur pour se résigner, sans amertume visible et sans envie, à être Thomas Corneille, ce qui arriva par la suite à Ernest Daudet. Or, non seulement il n’envia jamais la gloire de son frère, mais au contraire, il s’employa toujours, de son mieux, à l’exalter. Quant à lui, qui fut un historien très distingué et un travailleur admirable – ses ouvrages sur l’Émigration, sur les personnages les plus remarquables de la Restauration, sans compter tous les documents inestimables d’archives publiques et privées qu’il sut mettre en valeur avec un grand talent, en font foi – s’il n’eut pas toujours la grande audience qu’il méritait, c’est d’abord parce que la célébrité de son frère le reléguait au second plan à cause de cette manie humaine qui aime mieux comparer que juger (c’est plus facile, plus vite fait), et ensuite parce qu’il eut le tort de vouloir être aussi un romancier, quoique dans ce domaine ses dons fussent inférieurs à ses dons d’historien, et qu’en écrivant des romans, il allait lui-même au-devant des comparaisons.
En tout cas, l’Académie se montra très injuste envers lui en ne le recevant pas dans sa Compagnie, et j’ai toujours trouvé féroce et digne de l’Immortel ce mot d’un académicien, quelques années après la mort d’Alphonse Daudet : « Nous n’avons pas eu Pierre, jamais nous n’aurons Thomas ! »
Pour ma part, j’ai beaucoup aimé ce frère aîné qui, après avoir empêché son cadet de mourir de chagrin, puis de mourir de faim, se montra toute sa vie un excellent frère, et, chose plus rare, un beau-frère tendre et charmant pour celle qui, à partir de 1867, avait remplacé « ma mère Jacques ». Ce frère aussi, plein de tact et de discrétion qui dans les années consécutives à la mort d’Alphonse Daudet, se trouva bien souvent, pendant des séjours à la campagne, faire de longues promenades à pied, libres et confiantes, avec un jeune homme curieux de connaître mieux les premières années de son père, certains détails de sa vie intime, de cette nuit effrayante où s’enfonce la jeunesse de ceux qui nous ont précédés dans la naissance et dans la mort – ce frère aîné qui jamais, jamais, ne commit une indiscrétion, ne racontait rien que tout le monde ne sût, et qui, à quelques questions précises, ne répondait que par un sourire évasif.
« Cher Ernest, tu as toujours été pour moi le meilleur des amis... » lui disait un soir à la campagne la veuve d’Alphonse Daudet, à l’heure où la vérité en étincelles sort des bûches d’une grande cheminée. Cette parole en disait long, et je crois qu’Ernest Daudet fut aussi le meilleur ami de son frère.
***
Ils vivaient ensemble et s’entendaient bien, allant de mansarde en mansarde, de l’hôtel du Sénat, qui existe encore au n° 5 de la rue de Tournon, à une maison de la rue Bonaparte, toute proche du clocher de Saint-Germain-des-Prés et détruite par le percement du boulevard Saint-Germain. D’autres mansardes encore qu’on ne repérera jamais.
À l’hôtel du Sénat, Alphonse Daudet connut un jeune méridional, avocat braillard et plein de feu qui s’appelait Gambetta, entouré d’amis dont l’occupation était de préparer avec lui dans de sombres officines le remède-à-tous-les-maux qui serait la République démocratique. Alphonse Daudet ne prenait pas ces projets au sérieux, la littérature seule valait pour lui la peine de vivre.
« La littérature était l’unique but de mes rêves. Soutenu par la confiance illimitée de la jeunesse, pauvre et radieux, je passai toute cette année dans mon grenier à faire des vers. C’est une histoire commune et touchante ... Mais je ne pense pas que personne ait jamais commencé sa carrière dans un dénuement plus complet que moi.
« À l’exception de mon frère, je ne connaissais personne. Myope, gauche et timide, quand je me glissais hors de ma mansarde, je faisais invariablement le tour de l’Odéon, je me promenais sous ses galeries, ivre de frayeur et de joie à l’idée que j’y rencontrerais des hommes de lettres. Rencontrer des hommes célèbres, échanger avec eux par hasard quelques mots, il n’en faut pas plus pour enflammer l’ambition ! ‘Et moi aussi j’arriverai’, se dit-on avec confiance...
« ... J’oubliais mon indigence, j’oubliais mes privations, comme dans cette veillée de Noël où j’enfilais des rimes avec emportement, tandis qu’en bas les étudiants festinaient à grand bruit et que la voix de Gambetta grondant sous les voûtes de l’escalier, répercutée par les murs du corridor, faisait vibrer ma vitre gelée. »
La difficulté fut bientôt de trouver un éditeur pour toutes ces « rimes ». Ce n’est pas tentant de publier le premier volume de vers d’un garçon de dix-huit ans ! Alphonse Daudet ? Ce prénom invraisemblable ! (Il est vrai que Lamartine s’appelait aussi Alphonse...) et ce nom prosaïque, avec ses deux syllabes redondantes ! « Tout cela est voué à l’obscurité ! » se disaient les éditeurs. Pourtant, il s’en trouva un, nommé Tardieu, qui habitait aussi rue de Tournon, et consentit à publier ce petit volume qu’on décida d’appeler Les Amoureuses.
Par quel miracle trois ou quatre journaux parlèrent-ils de ce livre ? Il eut quelques articles bienveillants qui firent connaître le nom de son auteur et lui permirent de publier dans quelques périodiques, dans quelques vagues revues, dans Le Monde Illustré, de petits contes, des chroniques en vers qu’il appelait « chroniques rimées », (d’autres de ces chroniques devaient paraître deux ou trois ans plus tard dans LeFigaro), le tout écrit dans une langue légère, fluide, marquant aussi un certain affranchissement des conventions littéraires : ce jeune homme ne s’installait pas derrière son guignol, mais il en sortait souvent la tête pour interpeller familièrement son auditoire. De tout cela, d’ailleurs, il n’y a pas grand’chose à retenir.
***
Cependant, aux heures où la littérature ne l’absorbait pas, son frère n’était plus son seul ami. Depuis quelques mois il avait beaucoup d’amis ou soi-disant tels, poètes sans talent, politiciens sans avenir, médecins sans malades, avocats dont les seules plaidoiries étaient destinées aux cafés – tout ce qu’on appelait alors la Bohème, qui a toujours existé et qui existera toujours quels que soient les cataclysmes mondiaux, et qu’Alphonse Daudet engloba plus tard sous le nom de Ratés. Dans la fumée des pipes, l’odeur de l’alcool et de la bière, des femmes circulaient sous prétexte d’Art. Le charme et la beauté du jeune écrivain, son entrain exubérant, faisaient de lui la proie rêvée...
Théodore de Banville, le délicieux poète des Cariatides, décrivait ainsi Alphonse Daudet dans la Lanterne Magique :
« Une tête merveilleusement charmante, la peau d’une pâleur chaude et couleur d’ambre, les sourcils droits et soyeux. L’œil, enflammé, noyé, à la fois humide et brûlant, perdu dans la rêverie, n’y voit pas, mais est délicieux à voir. La bouche voluptueuse, songeuse, empourprée de sang, la barbe douce et enfantine, l’abondante chevelure brune, l’oreille petite et délicate, concourent à un ensemble fièrement viril, malgré la grâce féminine. Avec ce physique invraisemblable, Alphonse Daudet avait le droit d’être un imbécile, au lieu de cela, il est le plus délicat et le plus sensitif de nos poètes. Pourquoi n’est-il pas né milliardaire, comme Rothschild, pendant qu’il était en train de faire du paradoxe ! »
Non, il n’était pas né milliardaire, mais sa beauté et sa « bouche voluptueuse » allaient être pour lui un terrible piège. À ce moment-là surtout, il aima trop la vie. Quand on voyait surgir cette gaîté, cette flamme -– « flamme et vent du Midi vous êtes irrésistibles ! » s’écrie-t-il plus tard dans Numa Roumestan – qui donc pouvait deviner que le matin, il avait simplement déjeuné d’une botte de radis ? Son existence ressemblait à présent au regard de son premier portrait : une brume hagarde, amoureuse et violente. Il aimait à se battre pour rien, pour le plaisir de la gymnastique (comme naguère, les parties de canot sur le Rhône) et d’après certains récits, je crois qu’il rossait volontiers les cochers de fiacres, et sans doute devait-il être rossé aussi par eux. Enfin sa vie était lamentable – il suffit de lire Sapho et aussi la dédicace (supprimée depuis), de la première édition des Amoureuses : « À Marie R... ».7
En 1934, un matin, comme je rentrais à la maison vers l’heure du déjeuner, la concierge me remit un petit paquet, à mon nom, qu’un inconnu venait de déposer dans la loge. Le paquet contenait une trentaine de lettres adressées à Alphonse Daudet, les unes à l’encre, les autres au crayon : Marie R... Sapho !... Je vis la date de la première lettre : 1858, et m’arrêtai là. Naturellement il n’était pas question que je lusse ces lettres. Elles ne m’appartenaient pas. Elles sortaient d’un passé où je n’avais pas le droit de pénétrer, que je n’avais plus la curiosité de connaître. Ce jeune homme à qui elles étaient écrites, il s’en fallait de nombreuses années qu’il eût des droits sur moi, que j’eusse des devoirs envers lui : il ne m’était encore rien. Alors ?... Pourquoi me serais-je mêlé à sa vie ? Et si j’avais eu à le juger, quelle gêne... Je remis les lettres quelques heures plus tard – tant j’avais hâte qu’elles ne fussent plus à la maison et que leurs cendres mêmes n’empoisonnassent pas un air si différent – à un ami dont j’étais certain qu’il ne les lirait pas non plus, pour qu’il les brûlât. Ce qu’il fît. Nous supposâmes qu’Alphonse Daudet avait gardé les lettres de Sapho jusqu’à son mariage, qu’alors il les avait remises à un ami pour qu’il les rendît à Marie R..., que, pour une raison inconnue, l’ami n’avait pas pu remettre la correspondance à son épistolière, mais ensuite ? Qu’étaient devenues ces lettres pendant près de soixante-dix ans, et pourquoi me les avoir rendues ? Jamais je ne saurai si ce fut par conscience, par bonté ou par méchanceté. En tout cas le but, quel qu’il fût, ne fut pas atteint.
Je ne parlai pas de cet incident à la veuve d’Alphonse Daudet pour qui, après tant d’années, les aventures qui avaient précédé son mariage (lesquelles lui avaient été racontées jadis en détail par une « bonne âme » de sa belle-famille) étaient restées comme des épisodes infiniment tristes.
Elle y faisait quelquefois allusion devant moi, avec gêne, indulgence et mélancolie.
Ces années-là furent sans doute pour Alphonse Daudet les plus misérables de toutes, car leur insouciance apparente masquait une forme de pauvreté pire que celle du Petit Chose, une vie aux abois avec ses emprunts, ses dettes, ses ennuis, et surtout, pour ce garçon imbu de traditions bourgeoises et qui avait le goût du foyer, même quand il n’avait pas de foyer, ou que le foyer n’était que « miroirs ternis et que flammes mortes », un sentiment de déchéance, et aussi un remords envers lui-même...
Il essayait de travailler un peu, bien peu, car entre 1858 et 1861 il ne fit rien paraître en volume. Voici une strophe d’un poème de ces années-là, inédit je crois, intitulé Le Confesseur :
Mon père, soyez bon pour elle,
Soyez bon, prenez en pitié
Cette âme charmante mais frêle
Et songez qu’une tourterelle
N’est pas tourterelle à moitié.
Quelques-uns de ces poèmes parurent dans la Revue fantaisiste.
***
En 1860, l’Impératrice Eugénie avait eu connaissance des Amoureuses – par qui ? comment ? – et, s’amusant quelquefois, le soir, à Saint-Cloud, à réciter des vers devant son Cercle, avait dit un ou deux poèmes d’Alphonse Daudet. On trouva ces vers charmants. La souveraine fit prendre des informations et sut que le jeune poète était dans le dénuement. Sur la recommandation de quelqu’un – une femme, évidemment, et bienveillante : Ernest Daudet savait qui, mais garda toujours son secret – l’Impératrice dit un jour au duc de Morny,8 ministre d’État, Président du Corps Législatif, petit-fils naturel du grand prince de Talleyrand, du génie de qui il avait hérité une flamme : « Monsieur le duc, nous avons un jeune poète, il faut lui faire un sort. » C’est ainsi qu’Alphonse Daudet devint troisième secrétaire du duc de Morny. « J’ai été à l’âge de vingt ans attaché au cabinet d’un haut fonctionnaire, et mes amis de ce temps- là savent quel grave homme politique je faisais. L’Administration elle aussi a dû garder un singulier souvenir de ce fantastique employé à crinière mérovingienne, toujours le dernier venu au bureau, toujours le premier parti, et ne montant jamais chez le Duc que pour lui-demander des congés.9 »
La mansarde était alors dans une sordide impasse de l’avenue Montaigne, coulisse de ce quartier élégant. Il parla souvent de cette impasse par la suite, il y situa aussi, dans Jack





























