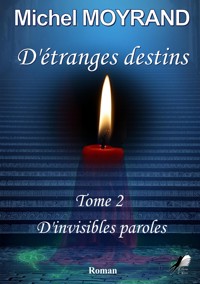Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libre2Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les secrets de famille, emportés par les morts et découverts de manière fortuite par des descendants, peuvent rester mystérieux et apparaître bouleversants. L’histoire, ici très romancée, de Louise, Mathilde et Maurice en est une parfaite illustration.
Louise Ladoux, l’une des filles de Jean et Juliette, agriculteurs de bonne réputation, se retrouve enceinte. Pour cacher l’état déshonorant de sa fille, le père la chasse du domicile et n’accepte son retour que seule. Conduite tôt le matin dans une carriole bâchée, elle rejoint en auto-stop la ville où elle est hébergée dans un couvent. Sans autre solution, elle abandonne Mathilde deux jours après sa naissance et rejoint sa famille. Mathilde ne connaîtra jamais sa maman, elle ira de famille d’accueil en famille d’accueil où elle vivra la moquerie, le mépris et la maltraitance.
Victime d’un employeur multi-engrosseur, elle devient, à son tour, maman célibataire, et donne naissance à Maurice. Laissé en pension, il vivra sa situation comme un abandon maternel et décidera de suivre les cheminots mosellans réfugiés à Périgueux en 1939 de retour en Lorraine.
Louise, humiliée, vécut discrètement dans la maison familiale, près de sa sœur Eugénie, de son beau-frère Aubin Ribert et de leurs 6 enfants, sans qu’aucun ne sache que tante Louise était la sœur de leur mère et en ignorant l’existence de Mathilde et de Maurice.
La mort de Maurice Ladoux révéla les Vies brisées de sa mère et de sa grand-mère.
Un roman aussi intriguant qu’addictif, où l’auteur nous emporte dans des secrets oubliés et leurs funestes conséquences…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Fonctionnaire et homme politique à la retraite, Michel Moyrand, autodidacte né en février 1949 en Haute-Vienne, regarde avec inquiétude les menaces qui pèsent dangereusement sur notre planète et sur l’espèce humaine. Les nouvelles formes d’injustice et d’intolérance qui envahissent la société lui font penser aux époques les plus sombres de notre Histoire.
La nature, la poésie, la photographie, l’écriture encadrent désormais ses journées qu’il aime partager en famille et avec quelques amis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michel MOYRAND
Chevalier de la Légion d’HonneurChevalier dans l’ordre national du Mérite
Vies brisées
Roman
Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par Libre 2 Lire
www.libre2lire.fr – [email protected], Rue du Calvaire – 11600 ARAGON
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
ISBN Papier : 978-2-38157-292-5ISBN Numérique : 978-2-38157-293-2
Dépôt légal : Septembre 2022
© Libre2Lire, 2022
Avertissement de l’auteur
L’histoire romancée que vous allez découvrir tout au long de votre lecture est inspirée de faits qui ont existé. Par respect pour ces personnes, les noms propres et certains noms de lieux ont été modifiés.
Michel Moyrand
Avant-propos
Tout prêtait à croire que la vérité pleine et entière circulait, que la confiance régnait sans limites, que la solidarité était totale, que chacun restait attentif au bien-être de l’autre dans la famille Ladoux. Depuis plus de trois siècles jusqu’à nos jours, les générations se succèdent de belle manière, dans cette ferme du Buis, construite en Périgord noir, sur les coteaux calcaires et caillouteux du petit village de Pierre-Blonde sur la commune de Murbois. Quelques faiblesses dans la gestion de la ferme ont rendu nécessaire, à certains moments un peu reculés dans le temps désormais, la vente de quelques parcelles de terre pour éponger des dépenses abusives et combler l’arrivée de dettes, qui, colportées, n’auraient pas manqué de déshonorer les responsables et d’assombrir une belle réputation coutumière. Jean, vendeur ambulant de flanelle, de retour de la guerre, épousa Juliette et avec elle le dur métier d’agriculteur qu’il exerça à la ferme du Buis. Comme les générations précédentes, honneur et réputation devaient rester, pour lui aussi, les deux mamelles nourricières à bien entretenir afin que les anciennes renommées du lieu et des résidents soient parfaitement préservées.
Au son de la cloche de la brebis, reine du troupeau, les garçons, mais pas qu’eux, se portaient aisément volontaires pour partager avec la belle jeune bergère Louise Ladoux, les heures de garde de son troupeau, espérant quelques douces et agréables câlineries et bien davantage. Les greniers à foin et les froides bories apparaissaient comme des lieux privilégiés où l’adultère de voisinage s’épanouissait allégrement. En ce temps-là, seule, la méthode du professeur japonais Ogino pouvait éviter des fécondités accidentelles et pas souhaitables.
Louise, l’aînée des enfants du couple Jean et Juliette, tout auréolée de ses vingt ans, n’échappait guère aux avances, parfois insistantes, de jeunes mâles des alentours en quête de copulations aventureuses, mais aussi à celles d’hommes mariés, pères de famille en souffrance sexuelle. Se tournaient également vers elle les regards insistants et avides de quelques forains qu’elle rencontrait chaque jeudi sur le marché de Tonrasse. Ceux d’un vieux voisin encore fringant, du jeune et séduisant curé, mais aussi ceux plus discrets de son père et de son frère lui signifiaient leurs franches convoitises. Sous l’effet de ses propres envies et des multiples approches, elle découvrit les élans masculins et n’échappa pas à une grossesse bien mal venue. Dès qu’elle annonça un soir cette nouvelle, à l’abri de toute oreille fouineuse et bavarde, à son père de retour des champs, sa vie bascula définitivement dans l’horreur et le malheur. Elle fut mise sans délai hors du foyer avec interdiction de retour en tant que mère, préservant ainsi la fierté de Jean et l’honneur de la famille déjà fragilisée par deux décès très rapprochés.
Hébergée dans un couvent, puis ouvrière maraîchère, elle mit au monde le 10 février 1909, à l’hospice de Périgueux une petite fille qu’elle prénomma Mathilde en hommage à l’une de ses sœurs décédée. L’exigence plus qu’autoritaire de son père et l’absence totale de perspective acceptable d’une vie commune avec son enfant l’obligèrent à abandonner Mathilde deux jours après sa naissance et à rejoindre seule sa famille comme son père l’y avait autorisé.
Louise vécut célibataire, et terriblement malheureuse à la ferme du Buis, près de son père devenu veuf, puis remarié à Maria, de sa jeune sœur Eugénie qui épousa Aubin Ribert avec qui elle eut six enfants. Mathilde, enfant abandonné confié très tôt à l’assistance publique, alla de famille d’accueil en famille d’accueil où le mépris, la mise à l’écart et la maltraitance furent quasiment son quotidien, jusqu’à son arrivée dans la famille Dessele et sa rencontre avec Madame de la Perchhaute, une riche bourgeoise de Périgueux. Jeannot Dessele, paysan plus attiré par les jupons que par l’exploitation, n’hésita pas à profiter d’elle comme quelques autres d’ailleurs. Enceinte, bien assistée par Marie, l’épouse de Jean, Mathilde mit au monde Maurice qu’elle ne put prendre avec elle quand elle dut quitter la ferme en faillite exploitée jusque-là par Marie et Jeannot.
Maurice, enregistré sans père à l’état civil sous le nom de sa maman Ladoux, grandit aux côtés d’Henri Dessele, fils de Jeannot et Marie, considéré par tous comme son demi-frère. Le statut de bâtard, que ses camarades d’école, comme plus tard ses collègues de travail, lui rappelaient en permanence, l’éloignement de sa maman alors qu’il n’avait que huit ans firent de lui un enfant, puis un adolescent et un jeune homme triste et timide, moqué et renfermé. Aussi, employé de la SNCF, il mit à profit, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le retour des cheminots mosellans dans leurs départements pour se joindre à eux et rompre définitivement avec son lieu de vie qui le faisait tant souffrir. Fort de son passé et des connaissances de celui de sa maman, il sut, là-bas, trouver en lui la force et la confiance nécessaires pour s’engager et donner un sens social profond à sa vie. Sa détermination à combattre l’injustice et la maltraitance, notamment celle faite aux femmes en entreprise et aux enfants abandonnés, lui fit tenir de hautes responsabilités et rencontrer des gens de pouvoir. Ses nobles engagements et sa puissante militante lui valurent reconnaissance, distinction et mise à l’honneur.
Sur la colline
Sur l’une des crêtes caillouteuses du Périgord noir, à deux cent cinquante mètres d’altitude environ, se trouve la discrète et joviale commune de Murbois avec sa série d’accueillants hameaux. Elle se situe à l’Est du vaste département de la Dordogne. Elle est proche de la Corrèze et non loin du Lot. Ses paysages y sont verdoyants et variés. On y distingue aisément d’un côté des vertes prairies et de l’autre des petites parcelles cultivées sur des plateaux plus arides. L’arrivée du phylloxéra vers 1860 dévasta les nombreuses plantations de vigne qui couvraient une large partie du territoire communal. Des traces gallo-romaines intéressantes et spectaculaires y sont observables. L’église Notre-Dame de Murbois, construite au XIIe siècle et remaniée au XVe, est dotée de deux clochers qui lui confèrent une singularité toute particulière. L’un d’eux est dénommé clocher-mur à trois baies campanaires, il supporte deux très belles cloches. Le centre-bourg est situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Tonrasse, chef-lieu du canton. Cette jolie petite municipalité n’est traversée par aucune rivière, par aucune route départementale. Son charme atypique ne souffre absolument pas de cette double absence. Si, la route départementale construite à la fin du XIXe siècle pour relier les villes de Brive et Sarlat évite Murbois, ce n’est dû qu’à la vigoureuse opiniâtreté d’un élu d’une commune voisine. En effet, cet édile, profondément désappointé de n’avoir pu obtenir, malgré ses innombrables interventions auprès des plus hautes autorités de l’État, le passage sur son territoire de la ligne ferroviaire Paris-Toulouse via Brive, obtint en compensation l’aménagement de la route départementale dans son centre-bourg.
Parmi la quinzaine de hameaux répartis sur la commune de Murbois, celui de Pierre-Blonde comptait, vers la fin du XIXe siècle, une dizaine de foyers et une quarantaine d’habitants. Plusieurs fermes importantes y tenaient bonne place. La plupart étaient closes par de gros portails en fer forgé, fixés à de robustes piliers en pierre de taille portant parfois la date de leur installation. Les maisons et les fermes avaient toutes été construites avec la pierre locale de couleur brun orangé. Cette pierre identitaire du sud Périgord, lumineuse et chaude, invite le visiteur à la regarder et même à la toucher. Les toitures de la plupart des bâtiments étaient alors recouvertes en ardoise qui provenait en majorité d’une carrière corrézienne. Ce matériau découvert vers la fin du XVIe siècle fut surtout utilisé pour remplacer les toits de chaume et de lauze. Ce qui devint vite dans la région une tradition donna un essor économique certain à la commune fournisseuse de ce matériau. Cette matière noble offre de multiples propriétés, dont une parfaite étanchéité, et une grande résistance aux rudes conditions climatiques. Elle présente également l’avantage d’avoir une bonne capacité à se fendre en fines lames. L’ardoise est devenue dans notre pays un produit de luxe très onéreux. Sa couleur bleutée occupe une place de tout premier ordre dans la rubrique des beaux produits couvrants. Le métier d’ardoisier exige une longue expérience où les gestes et les outils sont issus d’un savoir-faire ancestral. L’extraction de la roche dans les carrières relève d’une pratique extrêmement ordonnée et parfaitement maîtrisée. L’opération, dite de rebillage, permet de réduire les gros blocs de pierre détachés par explosion, en pièces beaucoup plus petites avant d’engager la procédure du clivage qui consiste à effeuiller les blocs en fines lames. Vient ensuite la minutieuse troisième et dernière phase, la taille, que l’on peut qualifier d’artistique tant elle fait appel à une parfaite maîtrise du geste. Les fines lames d’ardoises sont ensuite taillées et percées pour pouvoir être clouées sur les planches des charpentes. On peut différencier deux formes des produits finis, l’une carrée rencontrée sur les toitures corréziennes et celle ogivale utilisée dans le Massif central notamment. Il est à noter que l’abbaye du mont Saint-Michel a été recouverte, dit-on, par des ardoisiers corréziens. Comme beaucoup d’autres villages, celui de Pierre-Blonde avait fière allure ainsi décoré, et ne l’a point perdue. Il porte aujourd’hui encore pour partie cette élégante décoration. Sur cette zone géographique, depuis la fin du XXe siècle, les nouvelles constructions sont en général recouvertes en tuiles colorées bleu ardoise d’un coût nettement inférieur à celui de l’ardoise.
Jusqu’aux années 1970-80, plusieurs générations d’agriculteurs vivaient sous le même toit en Périgord. Cette vieille pratique a désormais totalement disparu tant le nombre d’agriculteurs s’est réduit. Ainsi ont succombé les longues lignées familiales que l’on y rencontrait et qui maintenaient et transmettaient les connaissances historiques des lieux et des légendes.
Dans le village de Pierre-Blonde, l’une des fermes est aujourd’hui encore occupée par les descendants d’une famille dont l’installation remonte avant le début du XVIIIe siècle. Les générations qui s’y sont succédées ont, chacune à leur manière, marqué leurs passages dans ce lieu emblématique d’un bel esprit d’entraide et de convivialité. L’état d’esprit familial, qui règne encore à la ferme du Buis, reflète un enracinement affectif très profond. Dans ce lieu parfaitement identifié, au gré des alliances nuptiales, ont vécu durant les trois siècles écoulés trois grandes filiations qui ont pour nom propre, Brétignac – Ladoux et Ribert. Le nom de Ladoux entra dans la ferme du Buis suite au mariage en 1880 de Jean et de Juliette l’unique fille d’Émile et Léonie Brétignac qui tenaient cette propriété de Louis Brétignac, père d’Émile qui en avait lui-même hérité de son père Henri.
Jean, vendeur de flanelle
Le jeune Jean Ladoux était le fils aîné d’un couple de commerçants installé sur la commune de Gimontac distante d’une quinzaine de kilomètres du village de Pierre-Blonde. Le père de Jean exerçait la profession de costumier-tailleur. Sa mère, sans profession jusqu’à son mariage, avait appris ce métier qui lui plaisait beaucoup, au contact de son mari. Leur boutique avait une bonne réputation, la concurrence était peu nombreuse sur le secteur à ce moment-là. Le couple Ladoux habillait les hommes en costume trois-pièces à l’occasion des mariages, des communions ou pour des événements spéciaux. Il vendait des chemises et des pantalons, des sous-vêtements, des cravates et des chaussettes. Sans être de riches commerçants, la famille vivait plutôt aisément de leurs activités. Jean était l’aîné d’une fratrie de quatre enfants, composée de deux sœurs et deux garçons. Après avoir été à l’école de Gimontac, jusqu’à douze ans, Jean, sans diplôme, voulut apprendre le métier de costumier-tailleur avec ses parents. Le certificat d’études primaires n’existait pas encore. Il fut instauré par une simple circulaire en date du 20 août 1866, signée de Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique. Ladite circulaire demandait aux recteurs d’inviter les inspecteurs d’académie à instaurer le certificat d’études primaires. Ce qui fut aussitôt réalisé et perdura, certes sous des formes variées, jusqu’en 1989, date de la suppression de ce diplôme.
Dès l’âge de seize ans, Jean, tout en travaillant avec ses parents, décida d’aller sur les marchés de son secteur géographique, vendre des ceintures de flanelle. À cette époque, et durant fort longtemps, de nombreux travailleurs exposés aux intempéries comme les paysans, les bûcherons, les maçons ou encore les charpentiers, mais aussi les ouvreurs de routes s’équipaient de cette bande de tissu pour protéger le bas de leur dos du froid et de l’humidité. Jean se déplaçait à bicyclette deux à trois jours par semaine sur les marchés environnants pour vendre son produit, et ainsi gagner un peu d’argent. Dès potron-minet, il fixait les rouleaux de flanelle de couleur beige, de quarante centimètres de large et de dix mètres de long, enveloppés d’un papier kraft très épais, sur les porte-bagages avant et arrière de son vélo. Il en plaçait également sur son dos qu’il fixait à l’aide de sangles adaptées à cet effet. Il pouvait ainsi transporter sans trop se fatiguer jusqu’à quarante mètres de produit, sachant qu’il n’en écoulait rarement plus de vingt-cinq, dans les meilleurs jours. En moyenne, les clients prenaient trois mètres cinquante de ce produit pour ceindre, par-dessus leur chemise, le bas du dos et maintenir leurs reins au chaud. Il arrivait que des personnes un peu ventripotentes en achètent quatre mètres cinquante ou cinq mètres, mais c’était assez rare. En 1880, un franc valait trois euros vingt-sept en valeur 2021. Le prix d’un mètre de flanelle était d’environ deux francs à cette époque. Jean trouvait une clientèle fidèle sur ses lieux de vente où il revenait au moins chaque quinzaine et pour certains, chaque huitaine. Il avait fait beaucoup de connaissances, il faut dire qu’il était sympathique, jovial, honnête et bon vendeur.
Il plaisait beaucoup aux filles, là aussi il est bon de préciser qu’il était grand et fort, élégant et beau garçon. Sur le marché de Tonrasse, il avait remarqué Juliette, une belle jeune fille qui accompagnait très régulièrement son père, Émile Brétignac, solide paysan qui venait vendre chaque jeudi matin les produits de sa ferme sur ce marché de bonne notoriété et très fréquenté. Émile et sa fille descendaient de Pierre-Blonde à Tonrasse avec Intrépide, leur gros cheval noir qui tirait la carriole à quatre roues qu’Émile débâchait par beau temps. Non seulement il apportait ses légumes et ses volailles au marché, mais il lui arrivait très souvent de transporter également quelques voisines esseulées et d’autres dont les maris ne pouvaient se soustraire à leurs travaux quotidiens. Elles aussi étaient habituées à faire commerce à Tonrasse. Juliette n’avait pas encore vingt ans, mais elle s’en approchait. Elle était mignonne, souriante et causante. Elle avait croisé pour la première fois le regard de Jean Ladoux alors que son père Émile achetait une nouvelle ceinture de flanelle. Elle avait bien remarqué une lueur particulière dans son regard. Cette lumière émise par les beaux yeux bleus du vendeur de flanelle était à la fois tendre et un peu aguichante. Juliette, un peu timide n’avait pas répondu à ce premier appel lumineux et avait évité d’engager la conversation. Toutefois, en repartant, elle s’était retournée et avait lancé vers le jeune camelot un petit regard complice et discret. En reprenant aux côtés de son père le chemin vers leur banc de marchandises, elle avait senti monter en elle une sorte de petite émotion très particulière. Quelle était cette étrange sensation qui avait ainsi traversé son corps et lui avait rougi le visage ? Le regard de ce garçon qu’elle venait furtivement de croiser avait-il déjà chauffé son cœur et mouillé ses yeux de manière ignorée ? La reprise des activités de vendeuse chassa bien vite ce moment de bien-être.
Au hameau de Pierre-Blonde, le quotidien de Juliette était davantage occupé par le travail que par les flâneries et les rêveries. Cependant, elle repensait aux yeux bleus de l’étalagiste et au tendre regard qu’il lui avait adressé tandis qu’Émile achetait une pièce de tissu de flanelle. Évidemment, son père n’en achetait pas souvent ce qui ne lui donnait guère l’occasion de rencontrer ce marchand-forain situé fort loin de l’emplacement de vente des Brétignac. Jean, quelque peu émoustillé par la beauté de la jeune fille, n’avait pas hésité, après cette discrète rencontre, à se rapprocher de son banc. La présence d’Émile le priva de tout échange avec Juliette. Les jeudis suivants, ils purent, à l’insu du père de Juliette, échanger quelques mots et de beaux sourires qui valaient force discussions, au moins à cette période de leur rencontre. Au fur à mesure que les jeudis de marché se succédaient, ils firent plus ample connaissance. Leurs discussions eurent lieu dans des endroits plus intimes et prirent une tournure plus sentimentale. Le père de Juliette qui allait boire un verre de vin rouge au café du Pont neuf avec d’autres vendeurs ou certains clients fidèles, avait bien remarqué le rapprochement des deux jeunes gens, mais n’avait rien laissé transparaître à sa fille.
Mobilisation de Jean
Un jeudi matin de novembre 1873, alors qu’un épais brouillard recouvrait la vallée, que de fines gouttelettes de pluie tombaient sans interruption et qu’un froid vif pénétrait les corps, Jean avait cherché, sans la trouver, Juliette. Il voulait lui annoncer qu’il venait de recevoir son avis de mobilisation pour partir au service militaire. Cet appel ne l’enchantait guère et même le rendait très triste. Sa tristesse fut décuplée lorsqu’il apprit que les Brétignac n’étaient pas ce jour-là sur le marché et que leur emplacement habituel était exceptionnellement inoccupé. Il ne pouvait donc pas annoncer à la fille pour qui le cœur commençait à vibrer qu’il allait être absent durant plusieurs années. La loi Cissey avait fixé la durée du service militaire à cinq ans. Jean partit en laissant sa place vide et Juliette sans nouvelles. Dès qu’elle reprit ses activités de marchande, elle s’empressa d’aller à l’emplacement de vente où se trouvait habituellement Jean. À son tour, elle éprouva une grande déception en voyant l’espace inoccupé. Elle demanda au commerçant d’à côté s’il connaissait les causes de l’absence du vendeur de ceintures de flanelle. Le vieux camelot, un peu volubile, lui apprit que le garçon était parti faire son service militaire dans le nord de la France. Juliette le remercia et s’en retourna sur son emplacement un peu triste et préoccupée par ce qu’elle venait d’apprendre. Elle aurait bien aimé savoir où et pour quelle durée Jean était parti à la guerre, mais elle n’osa demander à personne, par crainte de laisser entrevoir la discrète petite flamme qu’avait allumée en elle ce garçon. Cette nouvelle la troubla beaucoup et lui fit regretter de n’avoir pas pu dire au revoir au jeune homme pour qui elle éprouvait une certaine attirance. Elle aurait voulu lui souhaiter bon courage et connaître son lieu d’affectation. Elle dut passer ainsi plusieurs années sans nouvelles de Jean. Avant de rejoindre les troupes de Louis Napoléon Bonaparte, en guerre en Italie du Nord et en Autriche, il bénéficia de quelques jours de permission sans toutefois avoir la possibilité de se rendre sur le marché de Tonrasse où il aurait aimé rencontrer Juliette. Faute de lui avoir demandé son nom et son adresse, il ne put lui écrire. Ils vécurent ainsi séparés durant quasiment cinq années, sans rien pouvoir se dire, sans rien savoir l’un de l’autre, en espérant secrètement pouvoir se retrouver le plus vite possible. Ils ne savaient certainement pas encore que leurs premiers sentiments prendraient un jour la couleur de l’amour et les uniraient. Le soldat Ladoux fut blessé à deux reprises. Il fut cité à l’ordre de son régiment pour avoir pris part à plusieurs opérations très dangereuses et pour s’être montré courageux, plein d’entrain, et s’être distingué lors de très violents combats. Il rentra définitivement chez ses parents très affaibli, où il dut suivre une très longue période de convalescence avant de pouvoir reprendre ses activités de costumier-tailleur, puis celles de vendeur itinérant de ceintures de flanelle.
Retour de Jean
Cinq longues années s’étaient écoulées entre le moment du départ de Jean et son retour sur les marchés du sud Périgord. Son père souffrait d’une grave maladie qui avait considérablement ralenti l’activité du magasin de Gimontac. Il était atteint d’une arthrose déformante des doigts et des mains. Certaines tâches comme la découpe du tissu, l’assemblage des pièces lui étaient devenues impossibles à réaliser. Jean dut le remplacer et travailler à temps complet à la confection des habits commandés. Il ne put reprendre comme il l’avait imaginé son activité de vendeur ambulant. Il dut aussi former son jeune frère au métier de tailleur. Ernest, en raison d’un pied bot, fut exempté de service militaire. Il n’avait guère d’autre possibilité professionnelle que celle de suivre la voie de ses parents et d’assurer la continuité des activités. Jean avait songé à prendre la suite de son père et s’installer dans le magasin familial, mais, très vite, il comprit, compte tenu de l’infirmité de son frère, que cette idée ne pouvait se réaliser. Les activités de ce commerce n’étaient pas suffisamment importantes pour occuper en permanence deux personnes. Aussi, tout en transmettant son savoir-faire à son frère, il reprit ses anciennes occupations de vendeur de ceintures de flanelle. Il redoutait que d’autres vendeurs aient occupé ses emplacements sur les marchés qu’il fréquentait avant sa mobilisation. La plupart étaient restés vacants et aucun marchand de flanelle n’était venu occuper les places disponibles. Il n’eut donc aucune peine à reprendre ses vieilles habitudes et son ancienne clientèle très satisfaite de retrouver le produit qui lui avait fait défaut. Ainsi, il repartit tôt les matins, le cœur joyeux sur sa bicyclette, vers les marchés. Naturellement, il songeait à celui de Tonrasse et à Juliette. Il était à la fois impatient de la retrouver et inquiet de connaître sa situation qui avait peut-être changé au cours de cette longue période de séparation. Il s’interrogeait parfois, et même souvent, sur ce qu’elle faisait, si elle venait toujours avec son père les jeudis matin au marché, si elle avait trouvé un amoureux, si elle s’était mariée ou pas. Au fond de lui, il aurait bien voulu savoir si elle pensait encore à lui ou si elle l’avait oublié. Lui, il avait très envie de la retrouver, mais serait-elle heureuse de le revoir ? Autant de questions qui encombraient depuis des mois, des années même, l’esprit de l’homme vendeur de ceintures de flanelle.
Son retour sur le marché de Tonrasse fut aussitôt salué par tous et sa présence se répandit très rapidement sur ce lieu de ventes. Juliette et son père continuaient à y vendre leurs produits. Quand Émile apprit le retour de Jean sur la place du champ de foire, il ne manqua pas d’aller très vite lui dire bonjour et se réapprovisionner en matière protectrice, comme beaucoup d’hommes le firent. Juliette, le cœur serré, s’empressa à son tour d’aller lui souhaiter un bon retour. Elle ne résista pas à l’envie de l’embrasser et de lui dire combien elle était heureuse de le retrouver et combien il lui avait manqué. Jean fut immensément content de revoir Juliette. À son tour il la prit dans ses bras et l’embrassa plusieurs fois devant les gens ravis de voir ses deux jeunes personnes heureuses de se retrouver. L’intensité émotionnelle de Jean et Juliette fut révélatrice du bonheur partagé qu’ils ressentaient et ne passa pas inaperçue. Ils se connaissaient à peine quand Jean reçut sa feuille de route pour effectuer son service militaire et ensuite partir à la guerre. Il n’était pas question d’évoquer à ce moment-là un possible avenir commun. Juliette savait que les parents du jeune homme tenaient boutique à Gimontac et lui savait qu’elle était avec les siens dans une ferme implantée sur la commune de Murbois. Avec le temps et la maturité que la guerre lui avait inculqué, Jean pensait secrètement à se marier et à quitter définitivement le magasin d’habillement de Gimontac. Son frère Ernest pouvait désormais en assurer, seul et pleinement, la gestion. Les échanges entre Juliette et Jean se firent plus fréquents et plus intenses. Quelques mois plus tard, ils annoncèrent à leur famille respective leur projet de mariage.
Marié et paysan
Il n’avait pas échappé au père de Juliette que les deux jeunes gens se plaisaient, il en avait d’ailleurs parlé discrètement à Léonie, son épouse. Aussi, quand Jean lui dit, un jeudi matin, qu’il voulait marier sa fille, il ne fut guère surpris. Il fit cependant semblant de l’être, pour ne pas montrer qu’il avait suivi discrètement leur rapprochement. Il lui répondit avec courtoisie qu’il allait évoquer cette question avec sa fille et son épouse, et qu’ils se reverraient prochainement pour parler de son affectueuse supplique. Après en avoir discuté avec Juliette et Léonie, il fit savoir au garçon impatient, qu’il aurait plaisir à l’avoir pour gendre. Au cours des mois suivants, les deux familles se rencontrèrent, les accommodements d’usage furent établis, puis en juin 1880 les noces furent célébrées à la mairie et en l’église de Murbois. Il avait été convenu que Jean s’installerait avec Juliette à la ferme du Buis et qu’ils en deviendraient les exploitants directs à la mort d’Émile et de Léonie. Les parents de Jean avaient légué à Ernest le magasin de Gimontac et avaient donné à Jean et à ses deux sœurs, parties à la grande ville, une somme d’argent assez rondelette. Les débuts du couturier à la ferme furent rudes, très rudes même. Il n’avait jusque-là aucune notion de ce qu’était le métier d’agriculteur et de la pénibilité de certaines tâches. Ses premiers contacts avec les animaux de trait furent particulièrement éprouvants. Bien guidé par Émile, son beau-père, il apprit cependant très vite son nouveau métier. Il apporta des idées nouvelles dans diverses productions et plus particulièrement dans celle du tabac qui n’était jusque-là guère pratiquée sur la commune. Il comprit rapidement qu’il fallait rentabiliser au mieux toutes les petites parcelles qui composaient la propriété par des plantations annuelles et enherber les plus grandes pour optimiser les rapports de chacune d’entre elles.
Si son arrivée au hameau de Pierre-Blonde fut particulièrement bien accueillie, l’espace habitable disponible à la ferme du buis apparut vite trop limité pour recevoir dans de bonnes conditions les deux familles. Aussi, Émile et Jean décidèrent d’agrandir la maison. Ils lui donnèrent un volume supplémentaire en hauteur notamment, ils relevèrent d’un étage l’existant avec l’aide de deux ou trois membres de la famille spécialisés dans les travaux du bâtiment. Trois nouvelles chambres et une grande salle à manger furent construites et aménagées en quelques mois. Une sortie en terrasse, équipée d’un escalier extérieur en pierres, fut construite pour donner un accès extérieur à la nouvelle salle de réception. On peut lire, gravé sur le linteau de la porte, la date de 1887 qui reflète probablement celle où furent réalisés ces importants travaux. Entre 1881 et 1894, Jean et Juliette eurent cinq enfants, deux garçons : François et Édouard ; trois filles : Louise, Mathilde et Eugénie. Tous naquirent à la ferme du Buis. Édouard mourut à l’âge de neuf mois, et Mathilde à quatorze ans.
Dans le village de Pierre-Blonde, comme un peu partout, les paysans s’entraidaient pour effectuer les gros travaux, notamment les fenaisons, les moissons, les vendanges ou encore la récolte des noix. Jean aimait beaucoup ces moments d’entraide qui se terminaient très souvent par des repas copieux et en général bien arrosés. Il mettait à profit ces rencontres pour chanter et danser joyeusement. L’hiver, il aimait se retrouver entre voisins pour jouer aux cartes lors de traditionnelles veillées, toutes ponctuées par un encas très consistant. Trois générations vivaient sous le même toit de la ferme du Buis. La vie en commun se déroulait dans de bonnes conditions, même si, parfois, l’ambiance y était un peu pesante et le climat tendu. Jean et son beau-père ne cessaient d’apporter des améliorations à la propriété et, dès qu’une mise en vente de parcelles de terre cultivable ou de bois se présentait à eux, ils se montraient toujours acquéreurs.
Plus le temps passait, plus Émile laissait son gendre guider seul les travaux de l’exploitation. Jean avait appris à dresser les bœufs et les chevaux, à assister une vache, une brebis ou une truie lors de mises bas difficiles. Il savait abattre les arbres à l’aide d’une grosse scie à large lame équipée de deux poignées en bois qui exigeait deux hommes forts pour pénétrer les troncs et provoquer leur chute. Il excellait dans la construction de murs en pierre sèche, comme dans la vinification du moult des raisins des vignes plantées par Émile. En seulement quelques années, il était devenu un paysan, excellent producteur, bon vendeur et coriace acheteur.
Avec l’âge qui avançait, Léonie et Émile n’allaient plus beaucoup aux champs, ils restaient à la maison où ils jardinaient et préparaient les repas pour toute la famille. Le voisinage faisait souvent appel aux multiples connaissances de Jean pour régler une difficulté, débloquer une situation exigeante où la force et bien souvent l’habileté s’avérait nécessaire. Il était toujours disposé à rendre service, ce qui lui valait l’excellente réputation d’homme serviable et compétent. Il avait également acquis celle de grand séducteur auprès des femmes. Nombreux étaient les hommes qui se méfiaient à juste raison de son empressement les soirs de fêtes quand ils le voyaient discuter ou faire valser leurs épouses ou leurs filles devenues matures.
Au cours de la même année, Émile et Léonie moururent parmi les leurs, bien accompagnés, à quelques mois d’intervalles et laissèrent tous leurs biens en héritage à Jean et à Juliette. Dès lors, en nouveau propriétaire des lieux, Jean ne tarda pas à prendre plus de liberté, à faire preuve de moins d’assiduité et d’application dans son travail. Il se rendait régulièrement au bourg de la commune, où il fréquentait assidûment le bistrot et passait de longues heures à discuter sans trop se préoccuper de sa ferme voire de sa famille. Juliette, en revanche, s’occupait avec beaucoup d’attention de ses trois enfants, François, Louise et Eugénie. Elle nourrissait seule matin et soir les animaux, les nombreuses volailles et conduisait le troupeau de moutons à la pâture qu’elle gardait deux à trois heures tous les après-midi.
À Pierre-Blonde, les constructions avaient toutes une vocation agricole. Les premières semblaient remonter au début du XVIIIe