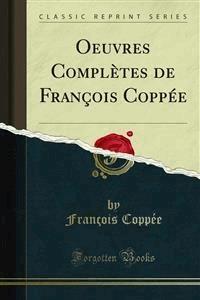Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le jeune duc de Hardimont se trouvait à Aix en Savoie, où il faisait prendre les eaux à sa fameuse jument Périchole, devenue poussive depuis le « chaud et froid » qu'elle avait attrapé au Derby, et il finissait de déjeuner, lorsqu'ayant jeté un regard distrait sur le journal, il y lut la nouvelle du désastre de Reichshoffen."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076400
©Ligaran 2015
Le jeune duc de Hardimont se trouvait à Aix en Savoie, où il faisait prendre les eaux à sa fameuse jument Périchole, devenue poussive depuis le « chaud et froid » qu’elle avait attrapé au Derby, et il finissait de déjeuner, lorsqu’ayant jeté un regard distrait sur le journal, il y lut la nouvelle du désastre de Reichshoffen.
Il vida son verre de chartreuse, posa sa serviette sur la table du restaurant, fit donner à son valet de chambre l’ordre de boucler les malles, prit, deux heures après, l’express de Paris, et courut au bureau de recrutement s’engager dans un régiment de ligne.
On a beau avoir mené, de dix-neuf à vingt-cinq ans, l’existence énervante du petit crevé – c’était le mot d’alors, – on a beau s’être abruti dans les écuries de courses et dans les boudoirs de chanteuses d’opérettes, il est des circonstances où l’on ne peut oublier qu’Enguerrand de Hardimont est mort de la peste à Tunis, le même jour que saint Louis, que Jean de Hardimont a commandé les Grandes Compagnies sous Du Guesclin, et que François-Henri de Hardimont a été tué en chargeant à Fontenoi avec la Maison-Rouge. Si épuisé qu’il fût par ses scandaleuses et imbéciles amours avec Lucy Violette, la prima-donna du théâtre des Nudités-Parisiennes, le jeune duc, en apprenant qu’une bataille avait été perdue par des Français sur le territoire français, sentit le sang lui monter au visage et eut l’horrible impression d’un soufflet.
C’est pourquoi, dans les premiers jours de novembre 1870, rentré dans Paris avec son régiment qui faisait partie du corps de Vinoy, Henri de Hardimont, fusilier à « la troisième » du « second » et membre du Jockey, était de grand-garde avec sa compagnie devant la redoute des Hautes-Bruyères, position fortifiée à la hâte, que protégeait le canon du fort de Bicêtre.
L’endroit était sinistre : une route plantée de manches à balais et toute défoncée de boueuses ornières, traversant les champs lépreux de la banlieue, et, sur le bord de cette route, un cabaret abandonné, un cabaret à tonnelles, où les soldats avaient établi leur poste. On s’était battu là peu de jours auparavant ; la mitraille avait cassé en deux quelques-uns des baliveaux de la route, et tous portaient sur leur écorce les blanches cicatrices des coups de feu. Quant à la maison, son aspect faisait frémir ; le toit avait été crevé par un obus, et les murs lie de vin semblaient badigeonnés avec du sang. Les tonnelles éventrées, sous leurs réseaux de brindilles noires, le jeu de tonneau renversé, la balançoire dont le vent humide faisait grincer les cordes mouillées, et les inscriptions auprès de la porte, égratignées par les balles : Cabinets de société – Absinthe – Vermouth – Vin à 60 cent. le litre – qui encadraient un lapin mort, peint au-dessus de deux queues de billard liées en croix par un ruban, tout rappelait avec une ironie cruelle la joie populaire des dimanches d’autrefois. Et, sur tout cela, un vilain ciel d’hiver où roulaient de gros nuages couleur de mine de plomb, un ciel bas, colère, haineux.
À la porte du cabaret, le jeune duc se tenait immobile, son chassepot en bandoulière, son képi sur les yeux, ses mains gourdes dans les poches de son pantalon rouge, et grelottant sous sa peau de mouton. Il s’abandonnait à sa sombre rêverie, ce soldat de la défaite, et il regardait d’un œil navré la ligne des coteaux, perdus dans la brume, d’où s’échappait à chaque instant, avec une détonation, le flocon blanc de la fumée d’un canon Krupp.
Tout à coup, il sentit qu’il avait faim.
Il mit un genou en terre et tira de son sac, posé près de lui contre le mur, un gros morceau de pain de munition ; puis, comme il avait perdu son couteau, il mordit à même et mangea lentement.
Mais, après quelques bouchées, il en eut assez ; le pain était dur et avait un goût amer. Dire qu’on n’en aurait de frais qu’à la distribution du lendemain, si l’intendance le voulait bien, encore. Allons, c’était quelquefois bien rude, le métier ; et ne voilà-t-il pas qu’il se souvenait, à présent, de ce qu’il appelait jadis ses déjeuners hygiéniques, lorsque, le lendemain d’un souper un peu trop échauffant, il s’asseyait contre une fenêtre du rez-de-chaussée, au Café-Anglais, qu’il se faisait servir – mon Dieu, la moindre des choses ; – une côtelette, des œufs brouillés aux pointes d’asperges, et que le sommeiller, connaissant ses habitudes, posait sur la nappe et débouchait avec précaution une fine bouteille de vieux léoville, doucement couchée dans un panier. Fichtre de fichtre ! C’était le bon temps tout de même, et il ne s’habituerait jamais à ce pain de misère.
Et, dans un moment d’impatience, le jeune homme jeta le reste de son pain dans la boue.
Au même instant, un lignard sortait du cabaret ; il se baissa, ramassa le morceau, s’éloigna de quelques pas, essuya le pain avec sa manche et se mit à le dévorer avidement.
Henri de Hardimont avait déjà honte de son action et considérait avec pitié le pauvre diable qui faisait preuve d’un si bon appétit. C’était un long et grand garçon, assez mal bâti, avec des yeux de fiévreux et une barbe d’hôpital, et d’une maigreur telle que ses omoplates faisaient saillie sous le drap de sa capote usée.
– Tu as donc bien faim, camarade ? dit-il en s’approchant du soldat.
– Comme tu vois, répondit celui-ci, la bouche pleine.
– Excuse-moi donc. Si j’avais su qu’il pût te faire plaisir, je n’aurais pas jeté mon pain.
– Il n’y a pas de mal, va, reprit le soldat. Je ne suis pas si dégoûté.
– N’importe, dit le gentilhomme, ce que j’ai fait est mal et je me le reproche. Mais je ne veux pas que tu emportes une mauvaise opinion de moi, et comme j’ai du vieux cognac dans mon bidon… parbleu ! nous allons boire la goutte ensemble.
L’homme avait fini de manger. Le duc et lui burent une gorgée d’eau-de-vie ; la connaissance était faite.
– Et tu t’appelles ? demanda le lignard.
– Hardimont, répondit le duc, en supprimant son titre et sa particule… Et toi ?
– Jean-Victor… On vient seulement de me verser dans la compagnie… Je sors de l’ambulance… J’ai été blessé à Châtillon… Ah ! l’on était bien, à l’ambulance, et l’infirmier vous y donnait de bon bouillon de cheval… Mais je n’avais qu’une égratignure ; le major m’a signé ma sortie, et, tant pis ! on va recommencer à crever de faim… Car, tu me croiras si tu veux, camarade, mais, tel que tu me vois, j’ai eu faim toute ma vie.
Le mot était effrayant, dit à un voluptueux qui s’était surpris tout à l’heure à regretter la cuisine du Café-Anglais, et le duc de Hardimont regarda son compagnon avec un étonnement presque épouvanté. Le soldat eut un sourire douloureux, qui laissa voir ses dents de loup, ses dents d’affamé, si blanches dans sa face terreuse, et comme s’il eût compris qu’on attendait de lui une confidence :
– Tenez, dit-il en cessant brusquement de tutoyer son camarade, devinant sans doute en lui un heureux et un riche, – tenez, promenons-nous un peu de long en large sur la route pour nous réchauffer les pieds, et je vous dirai des choses que vous n’avez sans doute jamais entendues… Je m’appelle Jean-Victor, Jean-Victor tout court, parce que je suis un enfant trouvé, et mon seul bon souvenir, c’est le temps de ma première enfance, à l’hospice. Les draps étaient blancs, à nos petits lits, dans le dortoir ; on jouait dans un jardin, sous de grands arbres, et il y avait une bonne sœur, toute jeune, pâle comme un cierge, – elle s’en allait de la poitrine – dont j’étais le préféré et auprès de qui j’aimais mieux me promener que de jouer avec les autres enfants, parce qu’elle m’attirait contre sa jupe en posant sur mon front sa main maigre et chaude… Mais à douze ans, après la première communion, plus rien que de la misère ! L’administration m’avait mis en apprentissage chez un rempailleur de chaises du faubourg Saint-Jacques. Ce n’est pas un métier, vous savez ; impossible d’y gagner sa vie, à preuve que, la plupart du temps, le patron ne pouvait embaucher comme apprentis que les pauvres petits qui sortent des Jeunes-Aveugles. Aussi c’est là que j’ai commencé à souffrir de la faim. Le patron et la patronne, – deux vieux Limousins, qui sont morts assassinés, – étaient des avares terribles, et le pain, dont on vous coupait un petit morceau à chaque repas, restait sous clef le reste du temps. Et le soir donc, au souper, il fallait voir la patronne avec son bonnet noir, quand elle nous servait la soupe, en poussant un soupir à chaque coup de louche dans la soupière… Les deux autres apprentis, les « Jeunes Aveugles », étaient les moins malheureux ; on ne leur en donnait pas plus qu’à moi, mais ils ne voyaient pas du moins le regard de reproche de cette méchante femme quand elle me tendait mon assiette… Et voilà le malheur, j’avais déjà un gros appétit. Est-ce de ma faute, voyons ?… J’ai fait là trois ans d’apprentissage, avec une fringale continuelle… Trois ans ! On connaît le métier en un mois ; mais l’administration ne peut pas tout savoir et ne se doute pas qu’on exploite les enfants… Ah ! vous vous étonniez de me voir prendre du pain dans la boue ? Allez, j’ai l’habitude ; j’en ai assez ramassé des croûtes dans les ordures, et quand elles étaient trop sèches, je les laissais tremper toute la nuit dans ma cuvette… Il y avait quelquefois des aubaines aussi, il faut tout dire, les morceaux de pain grignotés d’un bout, que les gamins tirent de leurs paniers et jettent sur le trottoir, en sortant de l’école. Je tâchais de rôder par là, en faisant les courses… Et puis, quand l’apprentissage a été fini, ce fut le métier, comme je vous le disais, qui ne nourrissait pas son homme. Oh ! j’en ai fait d’autres, j’avais du cœur à l’ouvrage, allez ! J’ai servi les maçons ; j’ai été garçon de magasin, frotteur, est-ce que je sais ? Bah ! aujourd’hui, l’ouvrage manquait ; une autre fois, je perdais ma place… Bref, je ne mangeais jamais à ma suffisance… Ah ! tonnerre ! j’en ai eu de ces rages en passant devant les boulangeries ! Heureusement pour moi, dans ces moments-là, je me suis toujours souvenu de ma bonne sœur de l’hospice, qui me recommandait si souvent d’être honnête, et j’ai cru sentir sur mon front la chaleur de sa petite main… Enfin, à dix-huit ans, je me suis engagé… Vous le savez aussi bien que moi, le troupier en a tout juste assez… Maintenant – ce serait presque pour en rire – voilà le siège et la famine !… Vous voyez que je ne vous ai pas menti, tout à l’heure, quand je vous disais que j’avais toujours, toujours eu faim !
Le jeune duc avait bon cœur, et en écoutant cette plainte terrible, dite par un homme comme lui, par un soldat que l’uniforme faisait son égal, il se sentit profondément ému. Ce fut même heureux pour son flegme de dandy que le vent du soir séchât dans ses yeux deux larmes qui venaient de les obscurcir.
– Jean-Victor, dit-il en cessant à son tour par un instinct délicat de tutoyer l’enfant trouvé, si nous survivons tous deux à cette affreuse guerre, nous nous reverrons et j’espère vous être utile. Mais, pour le moment, comme il n’y a pas d’autre boulanger aux avant-postes que le caporal d’ordinaire et comme ma ration de pain est deux fois trop grosse pour mon mince appétit, – c’est dit, n’est-ce pas ? – nous partagerons en bons camarades.
Elle fut solide et chaude, la poignée de main que se donnèrent les deux hommes ; puis, comme la nuit tombait et qu’ils étaient harassés par les veilles et les alertes, ils rentrèrent dans la salle du cabaret où une douzaine de soldats étaient couchés sur de la paille et, s’y jetant à côté l’un de l’autre, ils s’endormirent d’un profond sommeil.
Vers minuit, Jean-Victor s’éveilla seul, ayant faim probablement. Le vent avait balayé les nuages et un rayon de lune, pénétrant dans le cabaret par le trou du toit, éclairait la blonde et charmante tête du jeune duc, endormi comme un Endymion. Encore tout attendri de la bonté de son camarade, Jean-Victor le regardait avec une admiration naïve quand le sergent du peloton ouvrit la porte et appela les cinq hommes qui devaient aller relever les sentinelles avancées. Le duc était du nombre, mais il ne s’éveilla point à l’appel de son nom.
– Hardimont, debout ! répéta le sous-officier.
– Si vous le voulez bien, mon sergent, dit Jean-Victor en se levant, je monterai sa faction… il dort si bien… et c’est mon camarade.
– Comme tu voudras.
Et, les cinq hommes partis, les ronflements recommencèrent.
Mais, une demi-heure après, des coups de feu, pressés et tout proches, éclatèrent dans la nuit. En un instant, tout le monde fut sur pied ; les soldats sortirent du cabaret, marchant avec précaution, la main au tonnerre du fusil, et regardant au loin sur la route, toute blanchie par la lune.
– Mais quelle heure est-il donc ? dit le duc. J’étais de faction cette nuit.
Quelqu’un lui répondit :
– Jean-Victor y est allé à votre place.
En ce moment, on vit un soldat qui arrivait en courant sur la route.
– Eh bien ? lui demanda-t-on, quand il s’arrêta, tout essoufflé.
– Les Prussiens attaquent… replions-nous sur la redoute.
– Et les camarades ?
– Ils viennent… Il n’y a que ce pauvre Jean-Victor…
– Comment ? s’écria le duc.
– Tué raide d’une balle dans la tête… Il n’a pas dit : ouf !
Une nuit de l’hiver dernier, vers deux heures du matin, le duc de Hardimont sortait du cercle avec son voisin, le comte de Saulnes ; il venait de perdre quelques centaines de louis et sentait un peu de migraine.
– Si vous le voulez bien, André, dit-il à son compagnon, nous reviendrons à pied… J’ai besoin de prendre l’air.
– Comme il vous plaira, cher ami, quoique le pavé soit bien mauvais.
Ils renvoyèrent donc leurs coupés, relevèrent le collet de leurs pelisses et descendirent vers la Madeleine. Tout à coup le duc fit rouler un objet qu’il avait frappé du bout de sa bottine ; c’était un gros croûton de pain tout souillé de boue.
Alors, à sa stupéfaction, M. de Saulnes vit le duc de Hardimont ramasser le morceau de pain, l’essuyer soigneusement avec son mouchoir armorié et le poser sur un banc du boulevard, dans la lumière d’un bec de gaz, bien en évidence.
– Qu’est-ce que vous faites donc là ? dit le comte en éclatant de rire. Êtes-vous fou ?
– C’est en souvenir d’un pauvre homme qui est mort pour moi, répondit le duc dont la voix tremblait légèrement… Ne riez pas, mon cher, vous me désobligeriez !
Sa Majesté la Reine de Bohême – il y aura toujours un royaume de Bohême pour les conteurs – voyage dans l’incognito le plus strict et le plus modeste, sous le nom de comtesse des Sept-Châteaux et seulement accompagnée de la vieille baronne de Georgenthal, sa dame lectrice, et du général Horschowitz, son chevalier d’honneur.
Malgré les bouillottes et les fourrures, il a fait continuellement froid dans le compartiment réservé, et quand la Reine, lasse de son roman anglais ou impatientée par le tricot du général – car le général tricote, – voulait jeter un regard sur la campagne blanche de neige, elle était forcée de frotter un moment avec son mouchoir la vitre du wagon, que la gelée couvrait d’étincelants micas et de délicates fougères de glace. En vérité, c’est un caprice singulier et bien digne d’une tête de vingt ans qu’a eu Sa Majesté de partir pour Paris en plein hiver, et d’aller y retrouver sa mère, la Reine de Moravie, qui devait la venir voir à Prague au printemps prochain. N’importe, il a fallu se mettre en route par dix degrés au-dessous de zéro ; la baronne a dû secouer ses vieux rhumatismes ; le général, au désespoir, a laissé là un magnifique couvre-pieds qu’il était en train de tricoter pour sa belle-fille, n’emportant pour tromper les ennuis du chemin, que de quoi confectionner une modeste paire de bas de laine. Le voyage a été rude ; toute l’Europe est couverte de neige et l’on vient d’en traverser la moitié, avec beaucoup de retards et de difficultés, sur des chemins de fer dont le service est désorganisé par la rigueur de la saison. Enfin le but se rapproche ; ce soir, à neuf heures, on a dîné au buffet de Mâcon, et bien que, cette nuit encore, les bouillottes soient à peine tièdes et qu’au dehors de gros flocons blancs voltigent dans les ténèbres, la baronne et le général, sommeillant sous les manteaux fourrés et les couvertures, rêvent, chacun dans leur coin, de l’arrivée et du séjour à Paris, où la bonne dame pourra satisfaire une petite dévotion spéciale et où le vieux brave se rendra sans retard dans un certain magasin de lainages de la rue Saint-Honoré, le seul où il puisse rassortir convenablement ses écheveaux verts.
Quant à la reine, elle ne dort pas.
Fiévreuse et frissonnante dans sa grande pelisse de renard bleu, le coude dans le capiton et la main crispée parmi le désordre des magnifiques cheveux couleur de paille qui s’échappent de son coquet talpack de voyage, elle songe, les grands yeux ouverts dans la pénombre, écoutant machinalement les vagues et lointaines musiques que les oreilles fatiguées des voyageurs croient entendre dans le galop de fer des express. Elle revit toute son existence par le souvenir, la pauvre jeune reine, et elle songe qu’elle est bien malheureuse.
Elle se revoit d’abord, petite princesse à mains rouges et à taille plate, auprès de sa sœur jumelle, celle qu’on a mariée tout là-bas, dans le Nord, de sa sœur qu’elle aimait tant et qui lui ressemblait à tel point que, lorsqu’elles avaient le même costume, il fallait leur mettre dans les cheveux des nœuds de rubans de couleurs différentes pour ne pas les confondre. C’était avant que l’émeute eût renversé le trône de ses parents, et elle aimait l’atmosphère calme et assoupissante de la petite cour d’Olmutz où l’étiquette était tempérée par la bonhomie ; c’était le temps où son père, le bon roi Louis V, qui depuis lors est mort de chagrin en exil, l’emmenait à pied, à travers le parc, sans quitter son habit de cour et ses plaques, prendre avec sa sœur le café au lait, à quatre heures de l’après-midi, dans un pavillon chinois, envahi par les liserons et la vigne vierge, d’où l’on voyait le cours de la rivière et le lointain amphithéâtre des collines rougies par l’automne.
Puis c’était son mariage, et le grand bal de la présentation, en cette belle nuit de juillet où l’on entendait monter, par les fenêtres ouvertes, le murmure de la foule qui se pressait dans les jardins illuminés. Comme elle tremblait, quand on l’avait laissée seule un instant dans la serre avec le jeune roi ! Elle l’aimait pourtant déjà, elle l’avait aimé dès le premier regard, quand il s’était avancé, l’aigrette blanche au bonnet, si élégant et si souple dans son uniforme bleu tout endiamanté, et faisant sonner à chaque pas les éperons d’or recourbés de ses petites bottes grises à mille plis. Après la première valse, Ottokar lui avait pris le bras, et tout en caressant sa longue moustache noire, l’avait conduite dans la serre, l’avait fait asseoir sous un grand palmier, puis, se plaçant à côté d’elle et lui prenant la main avec la plus noble aisance, lui avait dit, en la regardant dans les yeux : « Princesse, voulez-vous me faire l’honneur de devenir ma femme ? » Alors elle avait rougi, baissé le front et répondu en comprimant d’une main les battements fous de son cœur : « Oui, sire ! » tandis que les violons enragés des Tziganes attaquaient tous ensemble la première note de la marche tchèque, ce chant sublime d’enthousiasme et de triomphe !
Hélas ! comme ce bonheur s’était vite envolé ! Six mois d’erreur et d’illusion, six mois à peine, et puis, un jour, en pleine grossesse, un hasard brutal lui apprenait qu’elle était trompée, que le roi ne l’aimait pas, ne l’avait jamais aimée, et que le lendemain même de son mariage, il avait soupé chez la Gazella, la première danseuse du théâtre de Prague, une fille. Et ce n’était pas tout ! Elle avait su alors ce qu’elle était seule à ignorer, la vieille liaison d’Ottokar avec la comtesse de Pzibrann, dont il avait trois enfants, qu’il n’avait jamais quittée au milieu de cent fantaisies, et dont il avait eu l’audace de faire la première dame d’honneur de sa femme. L’amour de la Reine fut tué du coup, ce frêle et timide amour qu’elle n’avait jamais osé avouer à son mari et qu’elle comparait maintenant à cet oiseau privé qu’étant petite fille, elle avait étouffé dans sa main fermée brusquement, en tressaillant au bruit d’une potiche cassée par une fille de chambre.
Son fils ! Sans doute, elle avait un fils, et elle l’aimait ; mais, chose affreuse ! bien souvent, assise auprès du berceau doré et timbré de la couronne royale, où dormait son petit Wladislas, la Reine avait senti passer dans son cœur comme un courant de glace en regardant cet enfant, engendré par un homme qui l’avait atrocement, cyniquement outragée. D’ailleurs, elle ne l’avait jamais à elle, à elle toute seule du moins. Ce n’était plus comme chez ses bons parents, que – nouvelle douleur – une révolution venait de chasser au loin, et tout s’accomplissait, dans cette antique et orgueilleuse Cour de Bohême, d’après les lois du plus étroit cérémonial. Tout un essaim de duègnes et de nourrices sèches, vieilles dames à grands airs et à bonnets montés, s’agitait autour du berceau royal, et, lorsque la Reine venait s’informer de son fils et l’embrasser, on lui disait avec solennité : « Son Altesse a un peu toussé cette nuit… Son Altesse souffre des dents… » Et il lui semblait que les haleines glacées de ces femmes soufflaient sur son cœur de mère pour le glacer et pour l’éteindre.
Ah ! vraiment, elle n’en pouvait plus, la pauvre Reine, et la vie était trop mauvaise. Aussi, parfois, succombant de chagrin et d’ennui, elle obtenait du roi licence d’aller voir la reine de Moravie, réfugiée en France ; elle se sauvait, elle s’évadait comme d’une prison, – seule, car la tradition s’opposait à ce que le prince-héritier voyageât sans son père, – et elle courait pleurer toutes ses larmes, les deux bras jetés au cou de sa mère en cheveux gris.
Cette fois-ci, elle était partie subitement, sans demander la permission et après un rapide baiser sur le front de Wladislas endormi ; car elle était comme folle de dégoût et de honte. La débauche du roi devenait chaque jour plus publique ; il avait maintenant des ménages et des familles dans toutes les villes de la Bohême, dans tous ses rendez-vous de chasse. C’était partout une risée, et l’on chantait, dans les rues de Prague, des couplets satiriques où l’on se demandait ce que deviendrait cette race illégitime, et si, comme jadis Auguste le Fort, Ottokar ne ferait pas de tous ses bâtards un escadron de gardes d’honneur. Pour subvenir aux frais d’un tel pullulement, le roi faisait argent de tout, épuisait et endettait l’État. Le commerce des décorations était particulièrement scandaleux, et l’on citait un tailleur de Vienne qui avait fait fortune en vendant, pour cinq cents florins, aux amateurs de croix étrangères, des habits noirs dans la poche et à la boutonnière desquels on trouvait le brevet et le ruban de l’ordre le plus illustre de la Bohême, d’un ordre militaire qui date de la guerre de Trente Ans.
Mais quoi donc ? Depuis un moment, le train ralentit sa marche ; il s’arrête. Que signifie cette halte en rase campagne, en pleine nuit ? Le général et la baronne se sont éveillés, très inquiets ; et le chevalier d’honneur, ayant baissé la glace, se penche dans le noir hors de la portière ; et voilà que la lanterne du chef de train, qui courait dans la neige le long des voitures, s’arrête, s’élève et éclaire tout à coup les moustaches blanches de chat en colère et le bonnet de loutre du général.
– Qu’y a-t-il ? Pourquoi cet arrêt ? demande le vieil Horschowitz.
– Il y a, monsieur, que nous voilà en détresse pour une heure au moins… Deux pieds de neige ! Plus moyen d’avancer !… Les Parisiens se passeront demain de café au lait.
– Comment ? Une heure à rester ici, par ce temps !… Vous savez, les bouillottes sont froides…
– Que voulez-vous, monsieur ?… On vient de télégraphier à Tonnerre pour avoir une équipe de balayeurs… Mais, je vous le répète, il y en a au moins pour une heure.
Et l’homme s’éloigne avec sa lanterne, du côté de la locomotive.
– Mais c’est abominable ! mais Votre Majesté va prendre un rhume ! glapit la baronne.
– En effet, j’ai froid, dit la Reine en frissonnant.
Le général comprend que c’est le moment d’être héroïque ; il saute sur la voie, enfonce dans la neige jusqu’aux genoux et rattrape l’homme à la lanterne. Il lui parle à demi-voix.
– Mais, quand ce serait le Grand-Mogol, je n’y pourrais rien, répond l’employé. Cependant, nous sommes devant une maison de cantonnier ; il doit avoir du feu chez lui… Et si cette dame veut descendre ?… Eh ! Sabatier ?…
Une seconde lanterne s’approche.
– Allez donc voir si le cantonnier a du feu dans sa maison.
Fort heureusement, il en a. Le général est plus heureux que s’il avait gagné une bataille ou terminé la dernière bande de tricot de son fameux couvre-pieds. Il revient au compartiment de la Reine, fait part du résultat de ses démarches, et, un instant après, les trois voyageurs, tapant des pieds pour faire tomber la neige accumulée sous leurs chaussures, sont dans la salle basse de la maisonnette, où le cantonnier, qui vient de les introduire et qui a gardé sa peau de bique, s’agenouille devant la cheminée et jette du bois mort sur les landiers.
La Reine, assise devant la flamme joyeuse, a rejeté sa pelisse sur le dossier de sa chaise de paille ; elle a ôté ses longs gants de Suède pour se chauffer les mains, et elle regarde autour d’elle.
C’est une chambre de paysan. On marche sur l’aire sèche et raboteuse ; des bottes d’oignons pendent aux poutres enfumées ; il y a un vieux fusil de braconnier sur deux clous au-dessus de la cheminée et quelques assiettes à fleurs sur le buffet. Le général a fait la grimace tout à l’heure en apercevant, piquées au mur par des épingles, deux images d’Épinal : le portrait de M. Thiers, orné du grand cordon de la Légion d’honneur, et celui de Garibaldi en chemise rouge. Mais ce qui attire l’attention de la jeune Reine, c’est, auprès du grand lit et demi-caché par les rideaux de cotonnade rayée, un berceau d’osier d’où vient de sortir le geignement d’un enfant qui s’éveille.
Bien vite, le cantonnier a laissé son feu et est allé vers le berceau, et voilà qu’il le balance doucement.
– Fais dodo, ma cocotte, fais dodo ! c’est rien, c’est des amis à papa.
Il a l’air d’un bon père, l’homme à la peau de bique, avec son crâne chauve de saint Pierre, sa moustache rude d’ancien soldat et ses deux grandes rides tristes dans les joues.
– C’est votre petite fille ? lui demande la Reine avec intérêt.
– Oui, madame, c’est ma Cécile… Elle aura trois ans le mois prochain.
– Mais… sa mère ? interroge Sa Majesté avec hésitation, et comme l’homme secoue la tête : Vous êtes veuf ?
Mais il fait un nouveau signe de dénégation. Alors, la Reine, tout émue, se lève, s’approche du berceau et regarde Cécile qui s’est rendormie, en serrant tendrement sur son cœur un petit caniche de carton.
– Pauvre enfant ! murmure-t-elle.
– N’est-ce pas, madame, dit alors le cantonnier d’une voix sourde, n’est-ce pas qu’il faut qu’une mère ait bien peu de cœur pour abandonner sa fille à cet âge-là ? Qu’elle m’ait quitté moi, après tout, c’est de ma faute… J’avais eu tort d’épouser une femme trop jeune pour moi, tort de la laisser aller à la ville, où elle a fait de mauvaises connaissances… Mais abandonner cet amour ! N’est-ce pas que c’est une infamie ? Enfin il faudra bien que je l’élève à moi tout seul, le pauvre chiffon ! C’est difficile, allez, à cause du service… Le soir, je suis souvent forcé de la laisser là, criant et pleurant, quand j’entends siffler le train… Mais, dans la journée, par exemple, je l’emporte avec moi, et elle est déjà bien aguerrie, la mignonne, elle n’a plus peur du chemin de fer… Tenez, hier, je la tenais sur mon bras gauche tandis que de la main droite je présentais mon fanion. Eh bien, elle n’a pas seulement tressailli au passage du rapide… Ce qui m’embarrasse le plus, voyez-vous, c’est de lui coudre ses robes et ses bonnets… Heureusement qu’on a été caporal aux zouaves, dans le temps, et qu’on connaît un peu le fil et les aiguilles.
– Mais, mon pauvre homme, reprend la Reine, c’est une tâche bien difficile… Écoutez, je désire vous aider… Il doit y avoir un village aux environs, et, dans ce village, des braves gens qui se chargeront de garder votre petite fille… Si ce n’est qu’une question d’argent…
Mais le cantonnier hoche encore la tête.
– Non, ma bonne dame, non. Je ne suis pas fier et j’accepterai de bon cœur tout ce qu’on voudra bien faire pour Cécile… mais je ne m’en séparerai jamais… non, pas même une heure !
– Mais pourquoi ?
– Pourquoi ? répond l’homme d’une voix sombre. Parce que je ne me fie qu’à moi pour faire de cette enfant ce que n’a pas été sa mère… une honnête femme ! Mais, pardon, auriez-vous l’obligeance de bercer un peu Cécile ? On a besoin de moi sur la voie.
Saura-t-on jamais à quoi pensait la jeune Reine de Bohême, dans cette nuit d’hiver où elle a bercé pendant une heure l’enfant d’un pauvre cantonnier, tandis que le général et la baronne, dont elle avait refusé l’assistance, faisaient le gros dos devant le feu ? Quand le chef de train a ouvert la porte et a crié : « Allons, messieurs et dames, l’express va repartir… en voiture ! » la Reine a déposé sur le berceau de la petite Cécile son porte-monnaie gonflé d’or et le bouquet de violettes de sa ceinture, et elle est remontée en wagon.
Mais Sa Majesté n’a passé que deux jours à Paris ; elle est tout de suite revenue à Prague, d’où elle ne s’absente presque plus, et où elle se consacre tout entière à l’éducation de son fils. Les gouvernantes à trente quartiers qui jetaient sur l’enfance du l’ombre de leurs bonnets funèbres, n’ont plus que des sinécures. S’il y a encore des rois en Europe quand le petit Wladislas aura grandi, il sera ce que n’a pas été son père, un bon roi. À cinq ans, il est déjà très populaire, et lorsqu’il voyage avec sa mère sur ces bons chemins de fer de Bohême qui vont comme des fiacres, et qu’il aperçoit par la portière du wagon-salon un cantonnier portant un bambin sur son bras et présentant de l’autre son petit drapeau, le royal enfant, à qui sa mère fait un signe, lui envoie toujours un baiser.